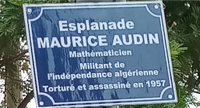En 2023, 70 ans après,
revient dans la mémoire française
la fin brutale en 1953 des défilés populaires
commémorant la Révolution française
Si le massacre parisien du 17 Octobre 1961, après des décennies de déni et de mensonges, est apparu dans la mémoire française, il n’en est pas de même pour celui du 14 juillet 1953, Place de la Nation. La police a ouvert le feu sur le cortège des indépendantistes algériens, tuant six d’entre eux et un syndicaliste de la Métallurgie CGT qui les défendait, et faisant des dizaines de blessés par balles. Cette répression a précipité le déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne. Elle a marqué aussi la fin des défilés populaires du 14 juillet qui ont existé lors du Front populaire et après la Libération. 70 ans après, une commémoration spectaculaire aura lieu le 13 juillet Place de la Nation. Et des associations comme le MRAP, la LDH, Attac, la Libre Pensée, les Ami(e)s de Maurice Rajsfus, l’ITS et des organisations syndicales ou politiques s’interrogent sur un appel à refaire un défilé populaire pour le 14 juillet.