
L’Allemagne face à son passé colonial, par Florian Kappelsberger
Reconnaissance d’un génocide, restitution d’objets d’art, question de réparations : comment l’Allemagne affronte-t-elle son histoire coloniale ?

Reconnaissance d’un génocide, restitution d’objets d’art, question de réparations : comment l’Allemagne affronte-t-elle son histoire coloniale ?
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé, jeudi 28 novembre 2024 que son homologue français Emmanuel Macron a reconnu dans une lettre qu’il lui a adressée que les forces coloniales
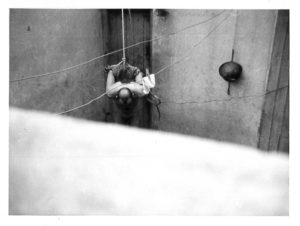
La pratique de la torture ne peut être imputée à une minorité de combattants français. L’Etat français a dysfonctionné, il doit s’interroger sur le fait d’avoir autorisé la pratique systématique de la torture durant la guerre d’Algérie.

Le nom de Thomas Robert Bugeaud, lié aux massacres des civils lors de la conquête de l’Algérie ne mérite pas de figurer dans l’espace parisien.
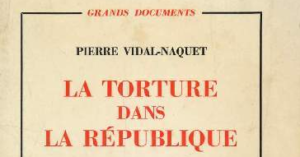
Un Appel lancé par l’ACCA a été rendu public le 4 mars au siège de la Ligue des droits de l’Homme. Relayé entre autres par l’AFP, RFI, « Le Monde »…

Comme le rapporte Le Monde, le président allemand en visite en Tanzanie a, le 1er novembre 2023, demandé « pardon » pour les massacres de masse commis par l’armée coloniale allemande au

Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, des initiatives nombreuses de reconnaissance du passé esclavagiste et de réparations se produisent au Royaume-Uni. Après Edimbourg, Glasgow, Bristol, la Banque d’Angleterre, l’Université de Cambridge, ce sont l’Eglise d’Angleterre en janvier 2023 et le journal britannique de centre gauche The Guardian en avril 2023 qui ont « présenté des excuses », lancé des enquêtes et mis en œuvre un programme de « réparations ».

Dans une série de quatre enquêtes d’Olivier Pascal-Moussellard, publiées en août 2023, l’hebdomadaire Télérama aborde le thème de « l’esclavage en héritage ». Les trois premières racontent comment deux familles britanniques ainsi que le quotidien The Guardian, ont fait leur « coming out » d’un lourd passé esclavagiste et ont tenté de le « réparer » dans un Royaume-Uni en pointe sur la reconnaissance de l’esclavage. La quatrième enquête, qu’on lira ici, est consacrée à Pierre Guillon de Princé, descendant d’armateurs négriers de Nantes, qui assume le passé de sa famille. « On ne peut pas être coupable d’un crime que l’on n’a pas commis. Pour autant, rester indifférent au fait que ses aïeux aient dû leur fortune à la vente d’êtres humains ne me paraît pas possible. » Une réflexion encore très rare en France.

Le coup d’Etat militaire perpétré au Niger le 25 juillet 2023 a suscité des manifestation d’hostilité à la France. Dans un entretien à Mediapart, la spécialiste de l’histoire du Niger Camille Lefebvre, autrice de Des pays au crépuscule. Le moment de l’occupation coloniale (Sahara-Sahel) (Fayard, 2021, réédité en poche en 2023), met en perspective historique cette hostilité, ainsi que les réactions françaises. Elle décrit la marque indélébile laissée par la violence colonisatrice, qui fut particulièrement grande au Niger. Elle pointe le fait que les autorités civiles et militaires françaises, comme l’opinion publique, se refusent à la prendre en compte et perpétuent une approche néo-coloniale de la situation. Faute, dit-elle, « d’affronter collectivement » la question du passé colonial.

Impossible d’empêcher que les épisodes du passé qu’une mémoire officielle a voulu refouler fassent retour. En marge du défilé des Champs-Elysées, où le président de la République a affiché une amitié choquante avec le premier ministre indien, Narendra Modi, qui mène une politique intégriste à l’opposé des fondateurs de l’Union indienne, plusieurs rassemblements ont eu lieu. Le 13 juillet, un hommage aux victimes du 14 juillet 1953, six Algériens et un syndicaliste français, place de la Nation, et, le 14 juillet au matin, place de la Bastille, de nombreuses associations ont proclamé lors d’un rassemblement leur intention de reprendre en 2024 les défilés populaires pour la fête nationale. Elles se sont jointes l’après-midi au défilé de la Marche des solidarités auquel plusieurs milliers de personnes ont participé entre la place Félix Eboué (Daumesnil) et la Bastille.
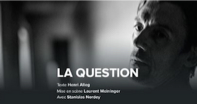
Le Festival Off d’Avignon présente au Théâtre des Halles du 7 au 26 juillet 2023 un spectacle intitulé La Question, mis en scène par Laurent Meininger. Le comédien Stanislas Nordey y joue et dit le texte culte du même nom, publié en 1958, dans lequel le journaliste membre alors du parti communiste algérien Henri Alleg, décédé il y dix ans, y raconte la torture qu’il a subie entre les mains de l’armée française à Alger en juin 1957, ainsi que des milliers d’autres personnes enlevées dans le cadre de ce qui a été appelé improprement la « bataille d’Alger ». Nous publions ici la présentation et un court extrait de ce spectacle, ainsi qu’un article publié sur son blog Mediapart par le journaliste et écrivain Jean-Pierre Thibaudat.

Dans son numéro de juin 2023, la revue Passés-Futurs, consultable en ligne sur le site Politika, publie un riche dossier intitulé « L’incertain statut des statues. Constructions et déconstructions ». Dirigé par Marc Olivier Baruch, il examine sous divers angles la question posée avec acuité dans plusieurs pays depuis le mouvement Black Lives Matter de ce qu’il faut faire aujourd’hui des statues honorant dans l’espace public des personnages liés à l’esclavagisme et à la colonisation. Outre la présentation de cette revue et son sommaire, nous publions un extrait d’un article de l’historien Olof Bortz qui passe en revue les réactions plutôt « progressistes » des historiens britanniques et celles, plus rares et plus « conservatrices », des historiens français.