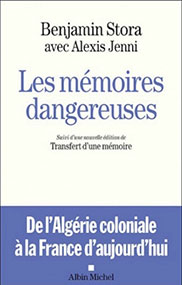L’Élysée, le bâtiment qui témoigne à Paris
du passé esclavagiste de la France
Trois siècles après sa construction au XVIIIe siècle par un homme qui a fait fortune grâce à l’esclavage, l’Élysée est le principal témoignage à Paris des richesses engendrées par la traite négrière. Les autres bâtiments parisiens occupés par des esclavagistes ou par des institutions qui les ont soutenus, tel l’hôtel de Massiac, ont disparu. Comme l’explique Benoît Grossin sur le site de France culture, un travail de mémoire reste à accomplir. La construction d’un mémorial de l’esclavage à Paris, qui serait un lieu à vocation pédagogique, avec des expositions, des reproductions d’œuvres et une médiathèque, est proposée par l’historien Marcel Dorigny, membre du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage bientôt installée place de la Concorde. Son siège sera à l’Hôtel de la Marine, ancien ministère de la Marine et des colonies, qui a été au cœur de l’histoire de la traite et de la colonisation.