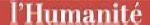[/Palais de l’Elysée, le mardi 9 mars 2021./]
[/Palais de l’Elysée, le mardi 9 mars 2021./]
Il revient à l’Etat d’articuler de manière équilibrée la liberté d’accès aux archives et la juste protection des intérêts supérieurs de la Nation par le secret de la Défense nationale. Décidé à favoriser le respect de la vérité historique, le Président de la République a entendu les demandes de la communauté universitaire pour que soit facilité l’accès aux archives classifiées de plus de cinquante ans. Le chef de l’Etat a ainsi pris la décision de permettre aux services d’archives de procéder dès demain aux déclassifications des documents couverts par le secret de la Défense nationale selon le procédé dit « de démarquage au carton » jusqu’aux dossiers de l’année 1970 incluse. Cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d’attente liés à la procédure de déclassification, s’agissant notamment des documents relatifs à la guerre d’Algérie. En complément de cette mesure pratique, le gouvernement a engagé, sur la demande du Président de la République, un travail législatif d’ajustement du point de cohérence entre le code du patrimoine et le code pénal pour faciliter l’action des chercheurs. Il s’agit de renforcer la communicabilité des pièces, sans compromettre la sécurité et la défense nationales. L’objectif est que ce travail, entrepris par et avec les experts de tous les ministères concernés, aboutisse avant l’été 2021. SERVICE DE PRESSE ET VEILLE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE — T. +33 (0)1 42 92 83 01 — Source
Réaction des associations à l’origine des recours
devant le Conseil d’État
au communiqué du 9 mars 2021 du président de la République
relatif à l’accès aux archives « secrètes »
Les associations ayant attaqué devant le Conseil d’État les instructions générales interministérielles n° 1300 de 2011 et de 2020 prennent note du communiqué du président de la République de ce jour, 9 mars 2021, sur l’accès aux archives publiques antérieures à 1971 qui portent un tampon « Secret ». Derrière les effets d’annonce, ce communiqué appelle la plus grande vigilance quant à l’ampleur exacte de « l’avancée » obtenue. En premier lieu, nous notons que le Président de la République annonce, « dès demain », la possibilité pour les services d’archives de procéder aux déclassifications des documents couverts par le secret de la Défense nationale par le procédé dit de « démarquage au carton ». Cette mesure semble certes de nature à écourter sensiblement les délais d’attente pour les chercheurs qui se rendront au Service historique de la Défense et aux Archives diplomatiques. Mais elle appelle trois précisions : • En premier lieu, il existe de nombreux autres services d’archives que le Service historique de la Défense et les Archives diplomatiques qui conservent des documents classifiés, parfois en très grand nombre. C’est le cas, en particulier, des Archives nationales. Or, faut-il le rappeler, les archivistes qui appartiennent au réseau des Archives qui relèvent du Ministère de la Culture ne sont pas autorisés, à la différence de leurs collègues du ministère des Armées par exemple, à déclassifier les documents ? Ils continueront donc à solliciter les autorités émettrices et à attendre de longs mois une réponse. • Ensuite, elle ne signifie en aucun cas que les recherches arrêtées depuis trop longtemps pourront reprendre dès demain : elles ne le pourront qu’à la condition que ces « démarquages », même au carton, soient effectivement formellement réalisés, ce que rien ne garantit. La mise en œuvre effective, même au carton, de la procédure de déclassification prendra de nombreux mois, car il s’agit de dizaines de milliers de cartons d’archives qui sont concernés. • Enfin, nous rappelons que les mesures de « démarquage au carton » annoncées aujourd’hui ne permettent pas de photographier les documents, ce qui alourdit le travail en une période où les places dans les centres d’archives sont limitées du fait des contraintes sanitaires, et pénalise fortement les citoyennes et citoyens qui habitent en province. Mais là n’est pas l’essentiel : le vrai problème est que le communiqué de presse du président de la République ne change malheureusement rien au fond du problème. Bien au contraire, il confirme qu’il est toujours nécessaire de déclassifier des documents d’archives publiques que la loi déclare pourtant communicables « de plein droit ». C’est précisément cette violation du code du patrimoine qui a justifié les deux recours que nous avons engagés devant le Conseil d’État en septembre 2020 et en janvier 2021. Le président de la République en est bien conscient, et c’est la raison pour laquelle il annonce, en second lieu, « un travail législatif d’ajustement du point de cohérence entre le code du patrimoine et le code pénal pour faciliter l’action des chercheurs ». Nous devrions sans doute nous réjouir de cette reconnaissance implicite de l’illégalité de la procédure administrative de déclassification lorsqu’elle est appliquée à des documents que la loi déclare « communicables de plein droit ». Mais nous ne pouvons que constater qu’aucune information n’a été donnée quant à la nature exacte de la modification du code du patrimoine qui est prévue. On peut craindre que les délais d’accès aux archives soient allongés pour certains types de documents, en régression par rapport aux choix que le Parlement avait faits en 2008. Pour notre part, nous considérons qu’ouvrir un chantier législatif sur la révision des délais de libre accès aux archives c’est prendre un risque…. le risque que l’économie générale de la loi sur les archives soit revue. Dès lors, nos trois associations continueront à être très vigilantes quant au respect des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit d’accès aux archives. Elles continueront leur action. CONTACTS • Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement Supérieur et de la recherche : créée en 1969, l’AHCESR est une association professionnelle qui regroupe les enseignants-chercheurs et les chercheurs en histoire contemporaine en poste dans les institutions de recherche et d’enseignement supérieur français. Elle défend leurs intérêts collectifs et constitue un lieu de réflexion et d’échanges sur les mutations du métier d’historien et la formation des étudiants. En tant que société savante, l’AHCESR anime la discussion scientifique sur l’évolution des manières d’écrire l’histoire contemporaine (1789 à nos jours). Contact : Raphaëlle Branche, présidente, ; Thomas Vaisset, secrétaire général de l’AHCESR / Twitter : @ArchiCaDebloque • Association des archivistes français : l’AAF regroupe près de 2500 membres, professionnels des archives du secteur public comme du secteur privé. Elle est un organe permanent de réflexions, de formations et d’initiatives mis au service des sources de notre histoire, celles d’hier comme celles de demain. Contact : Céline Guyon, présidente / Twitter : @Archivistes_AAF • Association Josette et Maurice Audin : L’Association Josette et Maurice Audin (AJMA) a pour objet d’agir pour faire la clarté sur les circonstances de la mort de Maurice Audin, assassiné par l’armée française dans le cadre d’un système de tortures et de disparitions forcées ; d’agir pour l’ouverture des archives ayant trait à la guerre d’Algérie et pour la vérité sur les disparus de la guerre d’Algérie du fait des forces de l’ordre françaises ; de faire vivre la mémoire de Josette et Maurice Audin et de leurs combats. Contact : Pierre Mansat, président / / 06 76 86 08 63 @Mansat
 lettre a la ministre des armees du conseil scientifique de la recherche historique de la defense
lettre a la ministre des armees du conseil scientifique de la recherche historique de la defenseLa loi de 2008 n’est pas respectée
En « facilitant » l’accès aux archives de la guerre d’Algérie, Macron poursuit sa politique des « petits pas » sur la réconciliation mémorielle
Des déclassifications « au carton » jusqu’à 1970
Les historiens s’étaient plaints depuis plus d’un an d’un durcissement de l’attitude des administrations à la suite d’une circulaire émise début 2020 par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), un organisme dépendant de Matignon. Elle enjoignait aux services d’archives d’appliquer de manière pointilleuse une instruction générale interministérielle (IGI) de 2011 sur le respect du secret-défense, un texte jusque-là mis en œuvre de manière relativement ouverte. La règle – la déclassification éventuelle doit être opérée « feuillet par feuillet » – devait, désormais, être observée dans toute sa rigueur, une subite crispation qui a paralysé nombre de recherches en cours depuis un an. Un collectif d’historiens et d’archivistes avait réagi en déposant un recours devant le Conseil d’Etat contre la controversée IGI de 2011. Afin d’apaiser l’inquiétude de la communauté des chercheurs et archivistes, M. Macron a ainsi décidé que la période couverte par les déclassifications « au carton » serait étendue jusqu’à l’année 1970, alors que ce procédé simplifié (plus rapide que la déclassification « au feuillet ») ne pouvait, jusque-là, pas s’appliquer au-delà de 1954. En d’autres termes, la période de la guerre d’Algérie relève, désormais, de cette procédure simplifiée du « carton », ce qui devrait, selon l’Elysée, « écourter sensiblement les délais d’attente liés à la procédure de déclassification » des documents relatifs à cette séquence historique. A plus long terme, le plan de l’Elysée est de « résorber le hiatus » entre le code du patrimoine et le code pénal en matière d’archives. Le compromis, qui consistera à « renforcer la communicabilité des pièces sans compromettre la sécurité et la défense nationales », prendra nécessairement une forme législative. Le Parlement devrait en être saisi « avant l’été », assure la présidence de la République. « Ça avance méthodiquement et à un rythme soutenu », s’est félicité Benjamin Stora en évoquant les chantiers mémoriels embrassés par son rapport. « Au-delà des déclarations abstraites, il y a un changement de cap par rapport à l’Algérie et à la guerre, ajoute-t-il. On révèle, on dévoile, on progresse. » Dans la communauté des historiens et des archivistes, l’annonce de l’Elysée sur les archives inspire des réactions mitigées, oscillant entre la satisfaction et la prudence face à des incertitudes non encore levées.« Il faut rester vigilant »
« C’est une bonne nouvelle, car cela va accélérer les délais de communication des archives », commente l’historienne Sylvie Thénault, qui précise toutefois que cette facilitation de la déclassification concernera surtout le service historique des armées et la direction des archives du ministère des affaires étrangères, l’impact sur les Archives nationales (où sont rassemblés des documents de sources ministérielles diverses) étant limité. En outre, Mme Thénault met en garde contre le « risque » que la modification législative annoncée par l’Elysée « révise le code du patrimoine dans un sens restrictif ». « Il faut rester vigilant sur l’ouverture de ce chantier législatif », confirme Céline Guyon, présidente de l’Association des archivistes français. L’annonce de l’Elysée ne résout pas en effet la divergence qui oppose l’Etat et la communauté des historiens et archivistes dans l’analyse de la hiérarchie des normes : là où l’exécutif évoque la nécessité d’« articuler » code du patrimoine et code pénal, les historiens et les archivistes récusent l’existence d’un conflit entre les deux normes en affirmant la « supériorité du code du patrimoine ». Aussi l’harmonisation souhaitée par l’Elysée comporte-t-elle le « risque d’une régression du code du patrimoine », avertit Mme Guyon. Le débat n’en est qu’à ses prémices. Le rapport Stora a au moins le mérite de le mettre sur la place publique.
Déclassification des archives de la guerre d’Algérie :
le fils de Maurice Audin demande au président de la République
de faire appliquer la loi
 franceinfo : Emmanuel Macron a reconnu en 2018 que votre père a été torturé et tué par l’armée française, c’est un pas en avant dans la reconnaissance des crimes commis par les militaires français en Algérie ?
Pierre Audin : En septembre 2018, il n’a pas seulement reconnu cet état de torture et assassinat, il a aussi annoncé qu’il allait ouvrir des archives pour l’ensemble des disparus de la guerre d’Algérie, en précisant qu’il s’agirait aussi bien des civils que des militaires, des Français que des Algériens. Ça faisait beaucoup de monde pour les huit années de guerre de la guerre d’indépendance. Là, concrètement, au lieu de faire cette ouverture de toutes les archives concernant tous les disparus, il a, en 2019, simplement fait un décret concernant Maurice Audin et rien que lui. Et maintenant, on constate que le SGDSN, le secrétariat général à la Défense et la sécurité nationale, qui est une espèce d’officine secrète qui travaille auprès du Premier ministre, a décidé de ne pas appliquer la loi concernant les archives et de faire une règle administrative très compliquée. La loi de 2008 dit qu’au bout de 50 ans, les archives sont consultables. Il y a quelques exceptions, par exemple des dossiers de santé, des choses comme ça, mais autrement, les archives sont consultables quoi qu’il arrive, qu’il y ait un tampon secret défense ou pas dessus.
Et ce n’est pas le cas aujourd’hui ?
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Depuis 2011, le SGDSN a décidé et il l’applique depuis 2020, qu’il fallait déclassifier chaque papier, c’est à dire que si l’administration, l’armée, par exemple, a mis un tampon « secret défense », il faut que l’armée mette un tampon « déclassifié ». Si elle ne l’a pas fait, on ne peut pas consulter le document.
La loi dit que c’est consultable. Il doit reconnaître que la loi dit que c’est consultable et permettre de consulter.
Le corps de votre père n’a jamais été retrouvé. Vous pensez que cette information figure quelque part dans l’une de ces archives ?
Personnellement, je serais assez étonné qu’elle y figure, parce que les militaires ont fait tout ce qu’il fallait pour faire disparaître toute trace. À l’époque, quand on disait que quelqu’un s’était évadé, c’était clair que la personne avait été assassinée. Là, dans le cas de Maurice Audin, je crois que c’est la seule fois, ils ont été jusqu’à la scène de l’évasion. Il y a un militaire qui a joué le rôle de Maurice Audin et ils ont joué la scène de l’évasion devant un civil, de façon à avoir un témoin civil de la chose. Donc, il est tout à fait clair que pour Maurice Audin, il y a peu de chances qu’on en trouve des traces dans les Archives nationales. Dans les archives [du général Jacques] Massu, [qui avait obtenu des pouvoirs de police pour faire cesser les actions du FLN] peut-être. Par contre, des milliers d’autres ont des traces dans les archives parce que les militaires sont de gros producteurs de paperasses. Et donc, il y a énormément de choses qui doivent effectivement figurer dans les archives. Secret défense, OK, mais les 50 ans sont largement passés et donc il n’y a pas de souci. Le président de la République devrait être garant de la loi qui a été adoptée par la représentation nationale et devrait dire tant qu’il n’y a pas une autre loi, c’est cette loi qui s’applique. C’est quelque chose d’original de la révolution, le fait de dire que les archives doivent être consultables par les citoyens. OK, il y a un délai de 50 ans. Mais c’est tout. Il y a un délai de 50 ans.
franceinfo : Emmanuel Macron a reconnu en 2018 que votre père a été torturé et tué par l’armée française, c’est un pas en avant dans la reconnaissance des crimes commis par les militaires français en Algérie ?
Pierre Audin : En septembre 2018, il n’a pas seulement reconnu cet état de torture et assassinat, il a aussi annoncé qu’il allait ouvrir des archives pour l’ensemble des disparus de la guerre d’Algérie, en précisant qu’il s’agirait aussi bien des civils que des militaires, des Français que des Algériens. Ça faisait beaucoup de monde pour les huit années de guerre de la guerre d’indépendance. Là, concrètement, au lieu de faire cette ouverture de toutes les archives concernant tous les disparus, il a, en 2019, simplement fait un décret concernant Maurice Audin et rien que lui. Et maintenant, on constate que le SGDSN, le secrétariat général à la Défense et la sécurité nationale, qui est une espèce d’officine secrète qui travaille auprès du Premier ministre, a décidé de ne pas appliquer la loi concernant les archives et de faire une règle administrative très compliquée. La loi de 2008 dit qu’au bout de 50 ans, les archives sont consultables. Il y a quelques exceptions, par exemple des dossiers de santé, des choses comme ça, mais autrement, les archives sont consultables quoi qu’il arrive, qu’il y ait un tampon secret défense ou pas dessus.
Et ce n’est pas le cas aujourd’hui ?
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Depuis 2011, le SGDSN a décidé et il l’applique depuis 2020, qu’il fallait déclassifier chaque papier, c’est à dire que si l’administration, l’armée, par exemple, a mis un tampon « secret défense », il faut que l’armée mette un tampon « déclassifié ». Si elle ne l’a pas fait, on ne peut pas consulter le document.
La loi dit que c’est consultable. Il doit reconnaître que la loi dit que c’est consultable et permettre de consulter.
Le corps de votre père n’a jamais été retrouvé. Vous pensez que cette information figure quelque part dans l’une de ces archives ?
Personnellement, je serais assez étonné qu’elle y figure, parce que les militaires ont fait tout ce qu’il fallait pour faire disparaître toute trace. À l’époque, quand on disait que quelqu’un s’était évadé, c’était clair que la personne avait été assassinée. Là, dans le cas de Maurice Audin, je crois que c’est la seule fois, ils ont été jusqu’à la scène de l’évasion. Il y a un militaire qui a joué le rôle de Maurice Audin et ils ont joué la scène de l’évasion devant un civil, de façon à avoir un témoin civil de la chose. Donc, il est tout à fait clair que pour Maurice Audin, il y a peu de chances qu’on en trouve des traces dans les Archives nationales. Dans les archives [du général Jacques] Massu, [qui avait obtenu des pouvoirs de police pour faire cesser les actions du FLN] peut-être. Par contre, des milliers d’autres ont des traces dans les archives parce que les militaires sont de gros producteurs de paperasses. Et donc, il y a énormément de choses qui doivent effectivement figurer dans les archives. Secret défense, OK, mais les 50 ans sont largement passés et donc il n’y a pas de souci. Le président de la République devrait être garant de la loi qui a été adoptée par la représentation nationale et devrait dire tant qu’il n’y a pas une autre loi, c’est cette loi qui s’applique. C’est quelque chose d’original de la révolution, le fait de dire que les archives doivent être consultables par les citoyens. OK, il y a un délai de 50 ans. Mais c’est tout. Il y a un délai de 50 ans.
Dans le New York Times du 9 mars 2021
France Eases Access to Secret Historical Archives, but Obstacles Remain
par Constant Méheut
Lire l’article

Guerre d’Algérie. La déclassification des archives
va-t-elle mener à de nouvelles découvertes ?
Les disparus au centre des attentions
Si « l’histoire de la guerre d’Algérie a été en grande partie écrite », estime Céline Guyon, présidente de l’association des archivistes français, toutes les zones n’ont pas pour autant été explorées. « Des dizaines de milliers de personnes ont disparu durant la guerre d’Algérie. De nombreuses familles ne savent pas dans quelles conditions leur proche a été exécuté ou enterré, regrette Pierre Mansat, président de l’Association Josette et Maurice Audin, qui œuvre pour la reconnaissance des crimes coloniaux. Il y a beaucoup de choses à mettre à jour sur ce plan là et les archives sont essentielles. » « La question des disparus algériens et français de cette guerre reste effectivement l’un des points aveugles de la recherche historique, appuie Linda Amiri, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Guyane. Il en va de même pour « les ratonnades » en Algérie qui furent nombreuses, les lieux d’enfermement divers et variés, officieux et officiels, la « Main Rouge » (organisation française secrète). » Pour l’historienne Linda Amiri, qui a notamment travaillé sur l’action du Front de libération national en France, il reste des faits « à exhumer » sur cette guerre d’Algérie, « et d’autres, plus connus, à mieux analyser au regard des nouvelles sources orales et écrites aujourd’hui disponibles ». En ce qui concerne les essais nucléaires menés dans le Sahara algérien par la France entre 1960 et 1966, autre angle mort de la recherche, l’Élysée a annoncé que les informations resteront secrètes, au grand dam d’Alger qui les réclame.Réaction mitigée des historiens et archivistes
Les sujets ne manquent donc pas. Mais cette annonce d’Emmanuel Macron, qui fait un pas de plus vers la réconciliation mémorielle, va-t-elle vraiment permettre de faire bouger les lignes ? « Elle montre que les actions menées par les historiens et les archivistes depuis plus d’un an ont été partiellement entendues », estime Céline Guyon, présidente de l’association des archivistes français. Réaction partagée par Thomas Vaisset, secrétaire général de l’AHCESR (Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur) et maître de conférences à l’université du Havre : « Le président constate qu’il y a un problème, il y a une prise de conscience. Depuis deux, trois ans, il demande que les historiens travaillent sur l’Algérie, mais ce n’est pas possible. » Pourquoi ? Depuis plus d’un an, historiens et archivistes dénoncent un durcissement des administrations sur le respect du secret-défense de certains documents. À tel point qu’un collectif a saisi le Conseil d’État en septembre 2020 contre l’instruction générale ministérielle (IGI) de 2011 sur laquelle s’appuient les administrations pour limiter l’accès aux archives.Tous les dépôts d’archives ne sont pas concernés
Si cette annonce d’Emmanuel Macron est perçue comme une avancée sur la forme, historiens et archivistes préfèrent rester prudents sur le fond. « Nous sommes sceptiques car peu de choses changent par rapport à hier, soupire Thomas Vaisset qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale. La seule nouveauté, c’est que la déclassification qui allait jusqu’à 1954 est élargie jusqu’à 1971. Mais concrètement, je ne verrais pas plus d’archives aujourd’hui que j’en ai vues hier. » Pierre Mansat, lui, déplore le fait que le « secret-défense » entrave la consultation des documents archivés d’avant 1971, pourtant autorisée à tous grâce au « Code du patrimoine de 2008, rappelle-t-il. Ce n’est pas au président de la République de dire si la loi doit être appliquée ou non. Elle doit être appliquée, c’est tout. » Céline Guyon ajoute que cela « ne va pas régler les problèmes d’accès aux archives », et ce pour plusieurs raisons. « La mesure de simplification qui est annoncée ne concerne pas l’ensemble des dépôts d’archives, explique-t-elle. À la différence de leurs collègues archivistes au service historique de la défense, les archivistes aux archives nationales n’ont pas les compétences pour déclassifier. Ils doivent continuer, malgré les annonces de l’Élysée, à solliciter les autorités émettrices des documents pour recueillir leur autorisation et surtout pour qu’elles viennent in situ les déclassifier. »« Une méconnaissance du travail de chercheur »
Dans sa déclaration, l’Élysée parle d’une déclassification « au carton ». Concrètement, cela permet à l’archiviste d’isoler des documents classés Défense présents dans le même carton et de communiquer uniquement ceux qui ne sont pas tamponnés. Cette technique apporte une difficulté aux étudiants, selon l’historien Thomas Vaisset, et montre « une méconnaissance de la façon dont les chercheurs travaillent. Lorsqu’ils se rendent aux archives, ils rentabilisent leur temps en prenant en photo les documents, feuille par feuille, qu’ils souhaitent étudier ensuite. » Cette reproduction nécessite une marque l’autorisant, tel un coup de tampon. « Quand on déclassifie au carton, on ne met pas cette marque sur chaque document, donc le chercheur ne peut plus le photographier », explique-t-il. Argument également mis en avant par ses confrères Pierre Mansat et Linda Amiri. « Cela pénalise beaucoup les chercheurs qui habitent en province et dans les Outre-mer », avance la maître de conférences à l’université de Guyane. Les volumes concernés, titanesques, sont aussi à prendre en compte pour rendre accessibles ces documents. « Cela représente des dizaines de milliers de cartons, donc ça ne va pas se faire dans des délais courts, estime la présidente de l’association des archivistes français. Cela peut prendre des mois, voire des années. » Si les archives publiques restent une source importante pour les chercheurs, elles sont loin d’être la seule. Pierre Mansat sait depuis plusieurs années qu’il n’apprendra plus rien sur le sort de Maurice Audin, mathématicien assassiné par l’armée française dans ces archives publiques. « Pour avancer, il faudrait que nous ayons accès aux archives privées de certaines personnes, comme celles du général Massu détenues par sa veuve. Mais elle refuse de les rendre publiques » , détaille-t-il. « Les archives privées sont celles qui apportent le plus souvent de la nouveauté et viennent documenter l’histoire », assure Céline Guyon, la présidente de l’association des archivistes français. [POUR SOUTENIR LE RECOURS DEPOSE
SIGNER ET FAIRE CIRCULER LA PETITION
qui s’approche de 20 000 signatures/rouge]
Les comptes Twitter du collectif qui a lancé cette pétition
@ArchiCaDebloque @Archivistes_AAF, @ahcesr
Nos articles sur cette bataille des archives
depuis septembre 2019
• Le débat sur l’accès aux archives de la guerre d’Algérie le 29 octobre 2019 • Des historiens protestent contre la fermeture de l’accès aux archives coloniales le 13 février 2020 • La mémoire historique classée secret-défense ? le 17 février 2020 • Un recours a été déposé au Conseil d’Etat pour demander l’ouverture des archives classées « secret-défense » le 25 septembre 2020 • Divers articles, émissions de radio et un reportage d’Al Jazeera diffusé sur les réseaux sociaux après le dépôt du recours au Conseil d’Etat le 5 octobre 2020 • La table ronde publiée par l’Humanité le 23 octobre 2020 • Le gouvernement persiste à vouloir entraver, quitte à contredire les promesses du président, l’accès aux archives des guerres d’Indochine et d’Algérie le 29 novembre 2020 • A la suite d’un nouveau texte qui aggrave la fermeture en cours. Pour l’accès aux archives. Un nouveau recours déposé au Conseil d’Etat le 18 janvier 2021 • Le film « Après l’affaire Audin. Les disparus et les archives de la guerre d’Algérie » de François Demerliac qui retrace les démarches qui ont permis d’aboutir à la déclaration présidentielle du 13 septembre 2018 et la mobilisation depuis pour l’ouverture des archives.