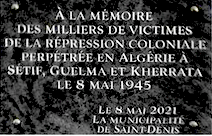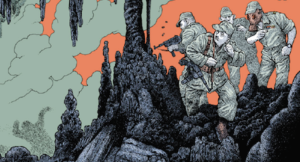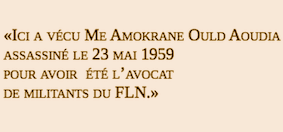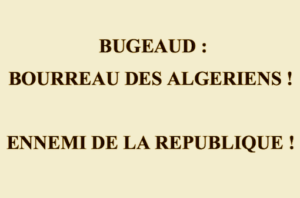La Belgique tente de regarder
en face son passé colonial :
quelles leçons pour la France ?
Depuis plusieurs années, sous l’impulsion de collectifs militants « décoloniaux », un vif débat, dont notre site s’est fait l’écho, se déroule en Belgique, jusqu’au Parlement, sur le passé colonial et sur son héritage. L’article de Mediapart que nous reproduisons fait le point sur les avancées et les limites des actions en cours, tant sur la reconnaissance de la nature du système de domination coloniale que sur la décolonialisation de l’espace public et la restitution des biens spoliés. A mettre bien sûr en rapport avec les difficultés de la France à avancer elle-aussi sur les mêmes questions.