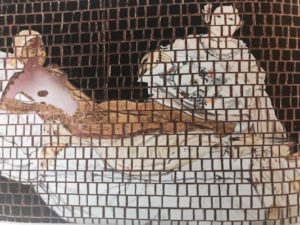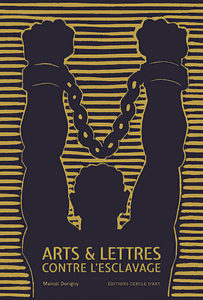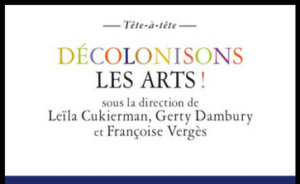Les réflexions d’un historien britannique
à propos d’un monument ou d’une statue
de l’émir Abd el-Kader en France
Parmi les préconisations du rapport que Benjamin Stora a remis à sa demande le 20 janvier 2021 au président de la République, Emmanuel Macron, figure la construction, au moment du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie en 2022, d’une stèle à l’émir Abd el-Kader à Amboise, où il a vécu en résidence surveillée de 1848 à 1852, ainsi que la restitution de son épée à l’Algérie. Rendre hommage à ce héros de la lutte du peuple algérien face à la colonisation française est une nécessité. Pour sa part, notre site a réclamé, dès octobre 2017, sur la suggestion d’Alain Ruscio, l’ouverture d’un débat sur l’installation d’une statue d’Abd el-Kader sur la place qui porte son nom à Paris, inaugurée par son maire, Bertrand Delanoë, en novembre 2006. Ci-dessous les réflexions à ce sujet de l’historien britannique Neil MacMaster.