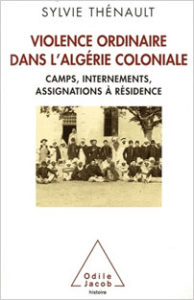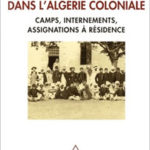Camps, internements, assignations à résidence
Paris, Odile Jacob, 2012, 381 p., 25.90 euros.
En 1888, l’Administration pénitentiaire française faisait dresser une carte des établissements dont elle avait la direction. L’Algérie y figurait dans un cartouche, au même titre que la Corse – une rareté, d’après les spécialistes de la cartographie1. Cette représentation n’en est pas moins symbolique de l’« assimilation » de l’Algérie à la France, mot d’ordre de la politique républicaine à l’égard de sa colonie de peuplement installée au Maghreb. L’organisation du système pénitentiaire de l’Algérie était semblable à celle de la métropole et de la Corse : il comprenait une maison centrale pour les hommes (Lambèse), une pour les femmes (Le Lazaret), un pénitencier agricole (Berrouaghia), un « établissement d’éducation pénitentiaire » pour jeunes (M’Zéra) et un dépôt de forçats servant également de dépôt pour les relégables outre-mer (El Harrach). Tous les habitants de l’Algérie, quel que soit leur statut, les « indigènes » comme les citoyens français et les étrangers, étaient susceptibles d’y être détenus. Ces prisons résultaient de l’application, en Algérie, des dispositions répressives en vigueur en territoire français, au premier rang desquelles celles du code pénal. Rien que de très ordinaire.

Une histoire de l’abomination coloniale ?
Cette carte assimilant les départements algériens au reste de la France pénitentiaire est muette sur les lieux d’enfermement spécifiques à la situation coloniale. Au même moment, pourtant, le gouverneur général disposait d’un pouvoir d’internement, sans intervention de la justice. Cet internement administratif prenait trois formes concrètes : la détention dans un pénitencier « indigène », sous administration militaire ; l’envoi au « dépôt des internés arabes » sis à Calvi, en Corse ; la « mise en surveillance spéciale » dans une localité, c’est-à-dire une assignation à résidence2. L’internement était l’une des mesures composant le régime pénal de l’indigénat, ce système de punitions réservé aux seuls sujets coloniaux. Outre l’internement, il comprenait les amendes collectives, le séquestre des biens ainsi que des peines d’amendes et de prison infligées sans aucune forme d’instruction, de défense ni de procès. Ces amendes et jours de prison étaient imposés par des agents de l’administration, pour réprimer une infraction inscrite sur une liste spéciale, dressée à cet effet.
La dénonciation de ce « monstre juridique3 », hideux de discrimination et d’arbitraire, n’attendit pas le développement de mouvements revendicatifs aux colonies ni celui de l’anticolonialisme métropolitain au xxe siècle. La métaphore de la monstruosité apparut dans les années 1890, dans le contexte des débats sur l’indigénat algérien4. La République était déjà dénoncée pour ses déclinaisons outre-mer, où elle était prise en flagrant délit de contradictions avec ses principes ; plus particulièrement, ceux de son droit répressif, devant assurer des garanties aux suspects, inculpés, accusés.
Avec l’indigénat, la violence coloniale se trouvait inscrite dans le droit. Légitimée, elle était banalisée. Sous cet angle, elle est moins spectaculaire que les violences militaires prenant les pires formes. En revanche, elle n’est pas cantonnée aux deux moments extrêmes de l’imposition puis du délitement du lien colonial : pendant la guerre de conquête et celle d’indépendance. Elle ne surgit pas non plus par brusques accentuations, dans la répression des soulèvements. Elle imprègne le temps long des années 1830-1962.
La différence de statut entre ceux qui bénéficiaient de la protection de leurs libertés individuelles, d’une part, et les « indigènes » soumis à l’arbitraire, d’autre part, traçait ainsi une frontière dans la société coloniale5. Vu des Algériens relevant de l’indigénat, ce temps long dépassant le siècle ne connut pas d’âge d’or pacifié. Car si toutes les mesures discriminatoires perdirent en intensité dans l’entre-deux-guerres avant d’être totalement abolies en 1944, la répression allait reprendre des formes arbitraires une dizaine d’années plus tard, au cours de la guerre d’indépendance.
C’est ce que raconte cette histoire de l’internement. Pour quoi faire ? Exhumer l’abomination coloniale ? Si les pratiques répressives coloniales suscitent l’effarement de celui qui s’y plonge, le ton des pages qui suivent n’est pas celui-là. L’objectif va au-delà. Une histoire de l’internement paraît nécessaire, alors que l’intérêt renouvelé pour la colonisation n’a abouti qu’à une redécouverte très superficielle de cette pratique, à travers les écrits des juristes – les spécialistes du droit colonial l’ont toujours connue. Cette histoire, surtout, prend tout son sens à l’heure où le fait colonial est devenu si présent. L’analyse des « camps d’étrangers6 » au xxe siècle cherche ainsi à faire la jonction entre le traitement des sujets coloniaux et celui des migrants venus de diverses nations. Le statut des « indigènes » émerge aussi des controverses sur la nature des discriminations contemporaines : leur dimension sociale est discutée, au profit de leur dimension raciale qui aurait été sous-estimée
7. Plus généralement, le fait colonial resurgit de la perception de la société française comme une société postcoloniale, portant les stigmates de ce passé, tant dans les représentations véhiculées que dans les pratiques des agents de l’État8 8. Dans ce contexte, l’internement colonial a été érigé en source de pratiques actuelles9. Qu’en est-il ? Cette question est à la source de ce livre.
Entre logique d’exception et généalogie coloniale
Les historiens se sont d’abord intéressés aux pratiques d’internement métropolitaines, au cours des guerres du xxe siècle. La Première Guerre mondiale, en effet, vit l’internement massif des étrangers ressortissant des puissances ennemies, dans des camps ouverts sur le sol métropolitain10. Puis, au moment de la Seconde Guerre mondiale, l’internement dans un camp exista au-delà du seul régime de Vichy. L’internement avait débuté avant 1940, sous la Ille République, qui avait fait aménager des camps pour les réfugiés de la guerre d’Espagne. La pratique s’était aussi prolongée après 1944, dans les circonstances – et les excès – de l’épuration des collaborateurs11. Après cette longue séquence, la guerre d’indépendance algérienne ouvrit un troisième volet. Les militants et les combattants de la lutte algérienne, eux aussi, furent internés, tant en métropole que dans l’Algérie en guerre12. En ce domaine comme en d’autres, la guerre d’indépendance algérienne vient s’ajouter à la Seconde Guerre mondiale comme séquence peu glorieuse du passé, une séquence aux enjeux toujours forts, que la société française doit affronter.
Abordé par le biais des pratiques métropolitaines en période de guerre au xxe siècle, l’internement dans un camp se trouve étroitement associé aux conjonctures d’exception qu’a traversées la France contemporaine. Il relèverait d’une « logique d’exception13 », selon laquelle, en République, le recours à des mesures contrevenant aux libertés essentielles devient légitime sous la menace de périls internes ou externes. Cette logique date des premiers temps du régime républicain, lorsque, le 17 septembre 1793, la « loi des suspects » permit l’arrestation, sur ordre administratif, de tous ceux qui étaient considérés comme des ennemis potentiels de la Révolution14. Cette logique d’exception, cependant, est aussi d’actualité. Elle fait toujours débat, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, au-delà même des frontières françaises : sa légitimité même, les conditions dans lesquelles des dérogations au droit commun peuvent être acceptées, les limites à leur poser pour éviter l’anéantissement des libertés individuelles et publiques, sont discutées. Ces questions sont centrales, notamment, dans l’acceptation ou le refus d’un centre de détention comme celui de Guantanamo15. Enraciné dans l’histoire longue des atteintes aux libertés en régime républicain, en tout cas, l’internement paraît cantonné aux périodes de crises incluant les guerres.
Vu d’Algérie, pourtant, il n’en est rien, sauf à dire qu’aux colonies, l’exception était la règle. L’interprétation de l’internement comme une mesure d’exception souffre d’une lacune majeure. Comme souvent – toujours ? – en histoire, les conclusions générales sont tirées de la seule situation métropolitaine. Il s’agit donc, avec cette histoire de l’internement en Algérie à la période coloniale, de déplacer le regard centré sur l’histoire politique de la France, vers celle de la colonisation. Il était impossible, cependant, de passer d’un tropisme à un autre, en remplaçant une grille de lecture fondée sur la seule métropole, par une grille de lecture tirée de la redécouverte du fait colonial. Ainsi la question du lien entre pratiques métropolitaines et pratiques coloniales est-elle posée : en refusant de penser les unes sans les autres. Ce parti pris se double d’une interrogation sur ce fait colonial devenu si présent : qu’est-ce qui différencie une pratique « coloniale » d’une pratique qui ne le serait pas ? L’enjeu de ce livre se décline donc en deux pans : quelles sont les continuités entre métropole et colonies, au cours du temps16 ? Qu’est-ce qui fait la spécificité du « colonial » ?
Répondre nécessite de garder en permanence la métropole à l’esprit, tout en tenant fermement la ligne d’une histoire sise en Algérie. La quête des origines de pratiques actuelles, par ailleurs, est une démarche risquée, tant l’histoire à rebours tire un fil, choisi d’emblée, dans l’épais tissu du passé17. C’est par conséquent à une histoire respectant le sens de la chronologie qu’il faut s’atteler, en tentant de ne rien omettre. En commençant au début de la présence française en Algérie, il s’agit de capter l’histoire d’une émergence, à la source, et non de partir en quête des origines, à partir du présent18. Cette histoire de l’internement colonial en Algérie s’attache à en reconstituer le processus de formation et de modification au cours du temps, en tenant compte des effets de cumul, de réinvestissement, de transformation suivant les époques et les circonstances. Elle ne peut être uniquement celle des voies abouties, perdurant au fil des décennies.
- Merci à Hélène Blais de m’avoir signalé cette carte et son caractère exceptionnel.
- Une première description a été donnée par Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France 1871-1919, Paris, PUF, 1968, rééditions Bouchene, 2005, ainsi que par Claude Collot, Les Institutions de l’Algérie à la période coloniale, Paris/Alger, CNRS/OPU, 1987.
- Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Paris, Zones, 2010.
- Jacques Aumont-Thiéville en fait état dans sa thèse : Du régime de l’indigénat en Algérie, Paris, Arthur Rousseau, 1906.
- Emmanuelle Saada, « Citoyens et sujets de l’Empire français. Les usages du droit en situation coloniale », Genèses, 2003/4, n° 53, p. 4-24.
- Marc Bernardot, Camps d’étrangers, Broissieux, Éditions du Croquant, 2008.
- Cf. notamment Didier Fassin et Éric Fassin, De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, 2006. Voir aussi la discussion entre Pap N’Diaye et Philippe Rygiel dans Le Mouvement social : « Pour une histoire des populations noires en France. Préalables théoriques », 2005, octobre-décembre, n° 213, p. 91-108 ; « Histoire des populations noires ou histoire des rapports sociaux de race ? », 2006, avril-juin, n° 215, p. 81-86.
- Pour une approche synthétique : Marie-Claude Smouts, La Situation post-coloniale, Paris, Presses de Sciences Po, 2007.
- Olivier Le Cour Grandmaison, Gilles Lhuilier et Jérôme Valluy (dir.), Le retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo…, Paris, Autrement, 2007. Olivier Le Cour Grandmaison reprend dans cet ouvrage les pages 210-211 de Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Paris, Fayard, 2005.
- Jean-Claude Farcy, Les Camps de concentration français de la Première guerre mondiale (1914-1920), Paris, Anthropos, 1995.
- Denis Peschanski, La France des camps. L’internement 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002.
- Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, 2001. Ainsi que : Sylvie Thénault (dir.), « L’internement en France pendant la guerre d’indépendance algérienne. Vadenay, Saint-Maurice-l’Ardoise, Thol, le Larzac », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2008, octobre-décembre, n° 92.
- L’expression est de Denis Peschanski dans La France des camps, op. cit.
- Pour une première approche : Jean-Claude Farcy, L’Histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, 2001.
- On trouve une analyse détaillée de ces problématiques à l’échelle internationale dans : Élisabeth Lambert-Abdelgawad (dir.), Juridictions militaires et tribunaux d’exception en mutation. Perspectives comparées et internationales, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2007.
- Dans l’historiographie, le débat sur les continuités concerne l’ensemble des pratiques administratives. Abordent cette question, en particulier : Alexis Spire, Étrangers à la carte. L’administration de l’immigration en France (1945- 1975), Paris, Grasset, 2005 ; « La colonie rapatriée », Politix, 2006/4, vol. 19, n° 76 ; Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire, Paris, Tallandier, 2008 (pour la carrière de Maurice Papon). Pour un bilan synthétique et plus large : Romain Bertrand, « Histoires d’empires. La question des « continuités du colonial » au prisme de l’histoire impériale comparée », in Pierre Robert Baduel (dir.), Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Paris/Tunis, Karthala/IRMC, 2009, p. 537-562.
- Une démarche courante dans une perspective postcoloniale, partant de l’héritage du passé colonial dans le présent, que critique Frederick Cooper, dans Colonialism in question. Theory, Knowledge, History, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 2005, p. 18-19.
- Sur la notion d’émergence et son opposition à une recherche des origines : Jean-François Bayart, « Les chemins de traverse de l’hégémonie coloniale en Afrique de l’Ouest francophone : anciens esclaves, anciens combattants, nouveaux musulmans », Politique africaine, 2007, mars, n° 105, p. 203.