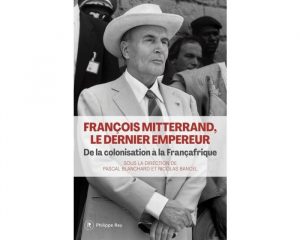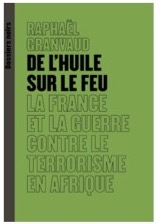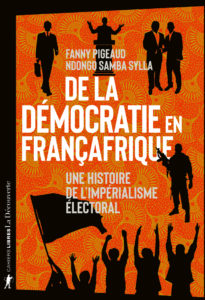Les Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique a publié en ligne en 2023, dans son numéro 157, un dossier intitulé « La Françafrique, un colonialisme français ». On peut y lire les contributions de Tiémoko Diallo, Catherine Coquery-Vidrovitch, François Graner, Armelle Mabon, Alain Gabet et Sébastien Jahan. De ce dossier entièrement en libre accès, nous publions ici le sommaire et le texte introductif. Celui-ci revient notamment sur l’histoire du concept de Françafrique comme système de domination postcoloniale spécifiquement français, popularisé en 1998 par François-Xavier Verschave, et sur son insertion dans le champ académique et dans le débat public. Question pertinente, alors que les relations entre la France et ses anciennes colonies d’Afrique sont au centre de l’actualité.