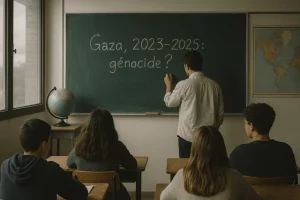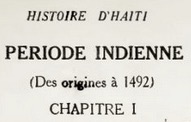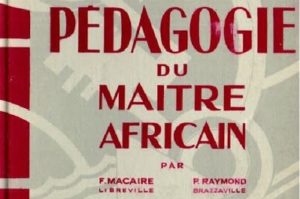L’histoire des traites, esclavages, abolitions et de leurs héritages est trop mal connue. La demande sociale est pourtant forte et de grandes enquêtes scientifiques éclairent les questions d’aujourd’hui autour de la construction des identités politiques et des discriminations. Mais beaucoup reste à faire car les avancées de l’histoire scolaire ne sont jamais acquises. Enseigner les traites, les esclavages, les abolitions et leurs héritages, publié en janvier 2021 aux éditions Karthala, offre un tour d’horizon international sur les programmes scolaires et les pratiques pédagogiques de l’école élémentaire au lycée, en Afrique, en Amériques et en Europe. De nombreux retours d’expérience et des propositions pédagogiques pluridisciplinaires enracinées dans la recherche sont présentées. Un livre qui s’adresse aux spécialistes de l’école ainsi qu’à un large public intéressé par le croisement des regards sur les représentations de l’esclavage dans le monde. Ci-dessous l’introduction et la table des matières.