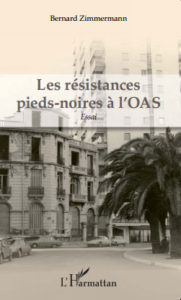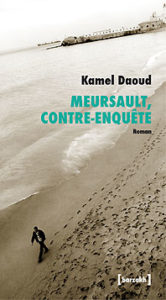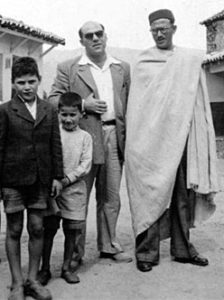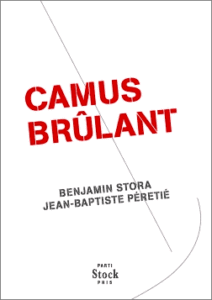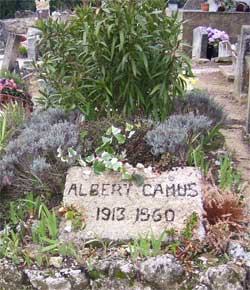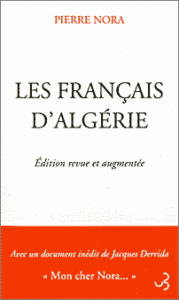Les Européens d’Algérie, par Michèle Villanueva
Durant huit années, du 1er novembre 1954 aux 19 mars (accords d’Evian) et 3 juillet 1962 (reconnaissance par la France de l’indépendance), la guerre d’Algérie opposa l’Etat colonial français à la population algérienne, mais aussi, plus insidieusement, les Algériens qui étaient chez eux et les Européens qui se croyaient chez eux.
Née à Oran dans les quartiers populaires espagnols d’Eckmühl, Michèle Villanueva a raconté, trente ans plus tard, dans un livre attachant L’Écharde, chronique d’une mémoire d’Algérie (éd. Maurice Nadeau, 1992, réédition 1998), la vie pendant la guerre d’Algérie et la complexité des rapports entre les communautés.
Dans un texte écrit en 2014, cette historienne brosse ci-dessous, à grands traits, l’histoire des Européens d’Algérie, en s’attardant sur la période de la présence française.