Gilles Manceron, historien, à L’Expression :
« Le colonialisme est un attentat contre l’humanité »

par Gilles Manceron, entretien avec Kamel Lakhdar Chaouche publié dans L’Expression le 29 septembre 2022.
Source

L’Expression : Pourquoi y a-t-il souvent cette attraction et répulsion des mémoires algéro-françaises ?
Gilles Manceron : Si la colonisation doit être condamnée dans son principe comme un crime contre l’humanité et la civilisation, ou encore, selon l’expression de Jean Jaurès, comme un «attentat contre l’humanité», celle de l’Algérie par la France a eu aussi des conséquences multiples. «Le colonialisme est un système», a écrit Jean-Paul Sartre, et dans ce système on ne peut distinguer aucun «aspect positif». Il a été générateur à l’infini d’injustices, d’inégalités, de crimes et de drames. Mais tout phénomène historique, même le plus meurtrier, a des conséquences dans différents domaines. Prenons le nazisme, il a tué des millions de personnes et peut être considéré comme un exemple du mal absolu. Mais les savants criminels qui ont travaillé à fabriquer des instruments de mort ont aussi fait des découvertes scientifiques qui, ensuite, ont pu être utilisées pour servir à des inventions bénéfiques, du domaine de la médecine à celui des transports aériens.
L’histoire est ainsi. Après les pires crimes, la vie des survivants continue. Ils ont besoin à la fois d’en perpétuer le souvenir, et, paradoxalement, pour continuer à vivre, ils ont aussi besoin d’oublier les pires crimes et de conserver le souvenir des choses qui, dans la civilisation des criminels, peuvent leur être utiles dans leur développement. Prenons l’idée de République. Lors du Hirak, les manifestants algériens criaient pour rejeter le système symbolisé par Bouteflika « l’Algérie est une République, pas une monarchie ». Or, si l’idée d’Al Joumhouria plonge aussi ses racines dans l’histoire du monde arabo-islamique, l’idée de République s’est surtout affirmée au début de l’antiquité romaine et surtout lors de la Révolution française, qui a aussi, comme la Révolution algérienne, suscité de l’admiration dans le monde entier. La France a été coloniale, mais elle a aussi été le pays qui a rejeté la monarchie et proclamé la République, et le pays qui a proclamé les droits de l’homme. Elle les a aussi souvent violés par la suite, bien entendu. Mais ça a aussi conduit des Français, au nom des droits de l’homme, à soutenir la guerre d’indépendance des Algériens.
Personnellement, j’ai une grande admiration pour certains d’entre eux que j’ai connus. C’est en raison de ce caractère très complexe et très pluriel de l’histoire française qu’il peut y avoir à la fois en Algérie, un rejet catégorique de la colonisation du pays par la France et une attraction exercée par certains aspects de la civilisation française ou de la vie en France. D’où, par exemple, les cris contradictoires qui sont lancés dans les rues par des Algériens à des présidents français lorsqu’ils se rendent en visite en Algérie.

Réserver l’accès et l’ouverture des archives uniquement aux historiens composant la commission mixte d’historiens algéro-français, tout en excluant les autres catégories en l’occurrence les étudiants en histoire, les journalistes, les chercheurs, ne constitue-t-il pas un mauvais départ pour l’écriture d’un récit mémoriel et historique des deux pays ?
Il est sûr qu’il ne faudrait pas qu’un petit nombre d’experts désignés par les responsables politiques aient le monopole de l’accès aux archives. Le travail historique implique qu’on indique ses sources et que d’autres puissent aller les consulter pour dire à leur tour les conclusions qu’ils en tirent. S’il y a une ouverture des archives dans les deux pays, il faut qu’elle ne soit pas réservée à quelques-uns. Mais cette ouverture ne peut pas être instantanée. C’est un processus. Une commission d’historiens des deux pays peut entamer ce processus d’ouverture des archives à tous les chercheurs.
Le travail est immense dans les deux pays. En France, il faut combattre la tradition de fermeture qui se fonde sur l’idée de « secret défense » invoquée pour cacher des faits historiques. Il en existe de nombreux exemples. Le chercheur Christophe Lafaye, qui a travaillé sur les « sections de grottes » inventées en 1956 par l’armée française pour asphyxier les combattants algériens ou les civils qui aidaient les réfugiés dans des grottes, se heurte dans ses recherches à des obstacles dressés par certains milieux de l’armée et de la haute administration.
L’accès aux archives nécessaires pour faire la lumière sur l’assassinat du leader du tiers-monde, Mehdi Ben Barka, près de Paris, en octobre 1965, par une équipe de tueurs envoyés par la monarchie marocaine avec la complicité de hauts responsables français de l’époque, un assassinat qui avait provoqué l’indignation du général de Gaulle lorsqu’il l’a appris, cet accès aux archives est encore entravé.
Y compris pour la justice française qui est encore saisie de cette affaire et qui ne peut pas enquêter librement. Il y a beaucoup de travail à faire en France, où des chercheurs algériens doivent aussi avoir accès aux archives nécessaires à l’établissement de la vérité historique. En Algérie, les historiens se heurtent notamment à l’insuffisance, voire à l’inexistence, des inventaires. Ce qui implique un énorme travail de formation d’archivistes capables de pratiquer les méthodes les plus modernes de classement et de reproduction des documents. Il faudrait développer les moyens dont disposent les centres d’archives. Soutenir les institutions universitaires qui travaillent déjà sur cette histoire. C’est donc un important processus, qui doit bénéficier progressivement à tous les chercheurs, qu’une commission d’historiens franco-algérienne pourrait impulser.
Comment faire pour que cette commission soit autonome des pouvoirs politiques ? Ne doit-elle pas être choisie par les historiens des deux pays autrement par exemple ?
Ce n’est pas aux responsables politiques qu’il revient d’écrire l’histoire. C’est à ceux, quelle que soit leur nationalité, qui travaillent selon les règles et les méthodes qui se sont imposées dans leur profession. Les historiens algériens et français travaillent depuis des décennies sur l’histoire de la colonisation et de la guerre d’indépendance algérienne et ils ont souvent recherché les occasions de rencontres scientifiques. Il faut signaler notamment les livres codirigés, dès les années 1980, par Mohammed Harbi et Benjamin Stora.

Celui intitulé D’une rive à l’autre, la guerre d’Algérie de la mémoire à l’histoire1, que mon collègue Hassan Remaoun et moi-même avons publié en 1993, ainsi que l’ouvrage collectif paru en 2012, Histoire de l’Algérie à la période coloniale, que deux auteurs algériens, Abderrahmane Bouchène et Ouanassa Siari Tengour et deux historiens français, Sylvie Thénault et Jean-Pierre Peyroulou ont dirigé et qui a été édité à Paris et à Alger.
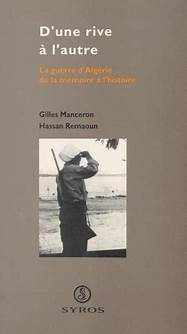
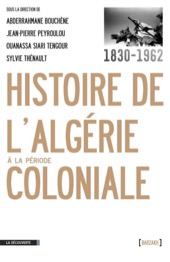
Les historiens des deux pays n’ont pas attendu une décision des autorités politiques pour travailler ensemble, et aussi avec des historiens d’autres pays. Il ne faut pas imaginer cette commission comme rassemblant deux équipes concurrentes, comme une compétition sportive réunissant deux équipes portant le maillot de leur pays…
Les historiens algériens sont les collègues des historiens français. Ils partagent les mêmes règles et la même méthodologie et tous poursuivent le même objectif d’approcher, autant que faire se peut, la vérité historique. Il faut que cette commission soit autonome des pouvoirs politiques. Mais les institutions éducatives des deux pays ont un rôle à jouer dans sa nomination. En tenant compte des travaux et des publications de chacun, de leurs compétences reconnues par les universités, et de leurs expériences dans les domaines de l’enseignement secondaire, supérieur et de la recherche.
Le débat et les tensions politiques opposant de temps à autre Alger et Paris n’auront-ils pas une influence sur le travail des historiens des deux côtés ?
C’est probable. Il y a un grave écueil possible : que le travail des historiens se trouve dirigé par les responsables politiques des deux pays, qui définiraient des sujets autorisés et d’autres à ne pas aborder.
Et l’évolution de leurs relations pourrait peser sur les travaux d’une telle commission. Le travail des historiens doit rester autonome par rapport aux enjeux politiques, économiques et diplomatiques. Il faudrait que l’autonomie de la démarche d’une telle commission soit préservée et qu’elle se tienne à l’écart des enjeux de la diplomatie. Il faudrait aussi, à mon avis, qu’elle ne se referme pas sur elle-même. Qu’elle parvienne assez vite à donner des moyens supplémentaires aux chercheurs des deux pays, qu’elle facilite l’accès de tous aux archives en France et en Algérie et qu’elle parvienne à des résultats concrets quant aux déplacements de chercheurs algériens pour des séjours de travail en France.
Travailler uniquement sur les archives étatiques officielles suffit-il pour réconcilier les mémoires ?
Non. L’histoire ne s’écrit pas uniquement à partir des archives conservées dans les institutions officielles. Beaucoup d’archives ont été conservées par des personnes privées ou des associations et n’y ont pas été déposées. Il faudrait que la commission envisagée se préoccupe d’en prendre connaissance et de les rassembler. Par ailleurs, il n’y a pas que les archives écrites.
Il faut aussi recueillir les témoignages des acteurs en constituant des archives audio-visuelles. Avec la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), qui s’appelle désormais La Contemporaine et qui est située sur le campus de l’université de Nanterre, j’ai eu l’occasion, avec des équipes de chercheurs français et algériens, de recueillir de longs entretiens avec des personnalités comme Hocine Ait Ahmed, ou le militant du PPA puis du Parti communiste algérien Sadek Hadjerès, ou encore avec l’avocat Jean-Jacques de Félice, qui a défendu des militants indépendantistes à Alger au sein du collectif d’avocats constitué par le FLN.
La Contemporaine rassemble aussi les rushes déposés par des cinéastes documentaristes qui ont interrogé et filmé des acteurs de cette histoire. Elle est en train de constituer un groupe de travail pour rassembler un fonds le plus large possible d’archives écrites et audiovisuelles sur la guerre d’indépendance algérienne et l’Algérie contemporaine, qui pourraient être mises à la disposition de cette éventuelle commission.







