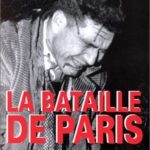Ici on noya les Algériens par Fabrice Riceputi
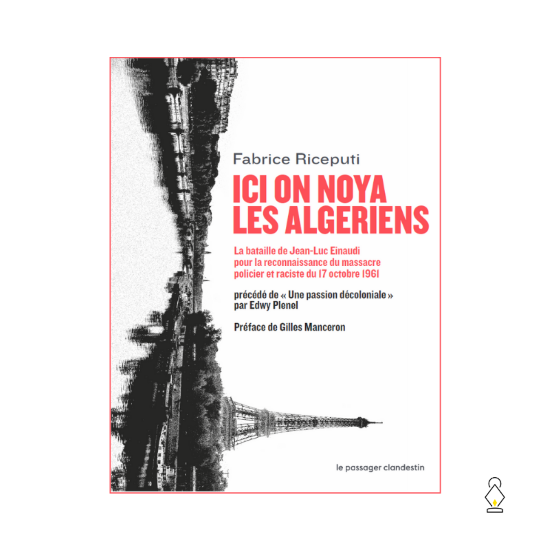
Fabrice Riceputi est co-animateur du site histoirecoloniale.net ainsi que de 1000autres.org, consacré aux disparitions forcées durant la guerre d’Indépendance algérienne. Il est chercheur associé à l’Institut d’histoire du temps présent.
Une passion décoloniale, par Edwy Plenel (extraits)
« Sous le pont Saint-Michel coule le sang » : chaque fois que je franchis la Seine à cet endroit de Paris, que dominent la Préfecture de police et le vieux Palais de justice, j’improvise cette rengaine, dérivée du vers qui ouvre Le Pont Mirabeau, le célèbre poème de Guillaume Apollinaire. Apposée sur l’un des parapets, une plaque discrète témoigne désormais de cette tragédie, moins visible que les grandes lettres noires peintes à l’époque par des militants solidaires de la cause anticolonialiste algérienne, dont une photographie anonyme garde le souvenir : « Ici on noie les Algériens ».
La date du 17 octobre 1961 fait partie de notre histoire, et nous devons la regarder en face. C’est à Paris qu’une manifestation pacifique de travailleurs alors français – « Français musulmans d’Algérie », selon la dénomination officielle –, venus protester avec leurs familles contre le couvre-feu raciste qui les visait, eux et eux seuls, fut sauvagement réprimée par la police de la capitale, sur ordre de son chef, le préfet Maurice Papon. Une Saint-Barthélemy coloniale dont les historiens évaluent aujourd’hui les victimes à près de 300 morts, sans compter de nombreux blessés et des milliers d’interpellés, souvent expulsés vers des camps d’internement en Algérie. […]
À travers la figure exemplaire de Jean-Luc Einaudi, ce livre de Fabrice Riceputi (Ici on noya les Algériens, aux éditions Le passager clandestin, 18 euros) rend hommage à celles et ceux, historien·nes et militant·es, militant·es devenus historien·nes, qui ne se sont pas tus et qui ont choisi de parler. Et de parler clair et franc. Car, dans cette longue bataille mémorielle qui se poursuit encore, il ne s’agit pas seulement d’entendre l’appel à la vérité de l’histoire mais d’être au rendez-vous, aujourd’hui même, d’un passé plein d’à présent.
Le 17 octobre 1961 est une date française aussi bien qu’algérienne. Cette manifestation est certes un des jalons de la conquête de son indépendance, si chèrement payée, par le peuple algérien : organisée par la Fédération de France du FLN, le Front de libération nationale qui menait la lutte pour l’indépendance, elle entendait consolider le rapport de force face à un pouvoir gaulliste qui, tout en engageant des pourparlers de paix, voulait affaiblir et diviser son interlocuteur indépendantiste. Mais elle est aussi un moment essentiel de notre propre histoire nationale, de ces moments dont le souvenir fonde, pour l’avenir, une mémoire éveillée, empreinte de lucidité et de fraternité.
La plus terrible répression policière d’une manifestation pacifique de notre histoire
Le 17 octobre 1961 est d’abord une manifestation légitime contre une décision administrative sans précédent depuis le régime de Vichy : un couvre-feu raciste, fondé sur des critères ethniques. Le 5 octobre 1961, le préfet de police de la Seine, Maurice Papon (dont on découvrira plus tard le rôle dans la déportation des Juifs à la préfecture de Gironde, en tant que membre de l’administration française collaborant avec les nazis), impose, au prétexte de la lutte contre les indépendantistes algériens assimilés à des « terroristes », un couvre-feu visant les « Français musulmans d’Algérie ». Ils doivent s’abstenir de circuler de 20 h 30 à 5 h 30 du matin, et les débits de boissons qu’ils tiennent ou qu’ils fréquentent doivent fermer chaque jour à 19 heures.
Le 17 octobre 1961 est ensuite une manifestation du peuple travailleur de la région parisienne, d’ouvriers et d’employés accompagnés de leurs familles, venus souvent des bidonvilles, notamment celui de Nanterre, immense, où cette main-d’œuvre industrielle était en quelque sorte parquée. Ce soir-là, c’est une partie de la classe ouvrière française, dont les cohortes ont toujours été renouvelées par l’immigration, qui défilait pacifiquement sur les boulevards de la capitale, avec cette joie d’avoir su braver l’interdit, la honte et l’humiliation. Avec surtout une grande dignité, celle de ceux qui n’ont d’autre richesse que leur travail, portée jusque dans l’habillement soigné des manifestants. D’ailleurs, le couvre-feu de Maurice Papon prévoyait une seule exception, celle des ouvriers travaillant en trois-huit, contraints d’embaucher en pleine nuit, qui devaient produire une attestation pour pouvoir circuler.
Le 17 octobre 1961 est enfin la plus terrible répression policière d’une manifestation pacifique dans l’histoire moderne de notre République. Les consignes des organisateurs étaient strictes, au point de se traduire par des fouilles préalables des manifestants : pas de violences, pas d’armes, pas même de simples canifs. La violence qui s’est abattue sur les manifestants, parfois même avant qu’ils ne se constituent en cortèges, dès leur interpellation sur la base d’un tri ethnique à la sortie du métro, fut d’une férocité inimaginable. Il n’y eut pas seulement les dizaines de disparus – frappés à mort, jetés à la Seine, tués par balles –, mais aussi onze mille arrestations, et une foultitude d’hommes parqués plusieurs jours durant, sans aucune assistance, dans l’enceinte du Palais des sports de la Porte de Versailles. […]
Quelques mois plus tard, le 8 février 1962, cette violence s’abattait de nouveau, au métro Charonne, sur une manifestation non violente pour la paix en Algérie dont le Parti communiste et la CGT furent les initiateurs. Or l’immense émotion soulevée par les neuf morts de Charonne a longtemps fait écran au souvenir des dizaines de victimes du 17 octobre 1961. Comme si les seconds faisaient partie de notre histoire française, tandis que les premiers étaient assignés à la seule cause algérienne. Suivant pas à pas la route arpentée par Jean-Luc Einaudi, Fabrice Riceputi déploie avec autant de pédagogie que de rigueur historiennes tous les enjeux politiques de cette occultation. Et nous fait comprendre pourquoi le combat mené pour y mettre fin dépasse le seul événement lui-même et recouvre l’actualité persistante, en France, du passé colonial.
« La bataille d’Einaudi », titre initial de son livre dans sa première édition de 2015, fut celle d’un homme et d’un militant emblématique d’une génération venue au souci du monde et des autres à travers la solidarité avec les peuples opprimés et les minorités dominées. Rendre visible le 17 octobre 1961, c’était obliger la France et sa République à affronter et à assumer une vérité douloureuse qui bat au cœur de la part algérienne de notre histoire et de notre peuple. Tel fut le sens de l’appel lancé en 2011, pour son cinquantenaire, par Mediapart, réclamant la reconnaissance officielle de ce massacre colonialiste et raciste commis sur ordre de l’autorité gouvernementale par des policiers de la République française. En voici le texte :
Il y a cinquante ans, le préfet de Police de la Seine, Maurice Papon, avec l’accord du gouvernement, imposa un couvre-feu visant exclusivement tous les Français musulmans d’Algérie.
Ce couvre-feu raciste entraîna une réaction pacifique des Algériens, sous la forme d’une manifestation dans les rues de Paris. Au soir du mardi 17 octobre 1961, ils furent près de trente mille, hommes, femmes et enfants, à défiler pacifiquement sur les grandes artères de la capitale pour revendiquer le droit à l’égalité et défendre l’indépendance de l’Algérie.
La répression policière de cette protestation non violente est une des pages les plus sombres de notre histoire. Longtemps dissimulée à l’opinion et désormais établie par les historiens, elle fut féroce : onze mille arrestations, des dizaines d’assassinats, dont de nombreux manifestants noyés dans la Seine, tués par balles, frappés à mort.
Le temps est venu d’une reconnaissance officielle de cette tragédie dont la mémoire est aussi bien française qu’algérienne. Les victimes oubliées du 17 octobre 1961 travaillaient, habitaient et vivaient en France. Nous leur devons cette justice élémentaire, celle du souvenir.
Reconnaître les crimes du 17 octobre 1961, c’est aussi ouvrir les pages d’une histoire apaisée entre les deux rives de la Méditerranée. En 2012, l’Algérie fêtera cinquante ans d’une indépendance qui fut aussi une déchirure française. A l’orée de cette commémoration, seule la vérité est gage de réconciliation.
Ni vengeance, ni repentance, mais justice de la vérité et réconciliation des peuples : c’est ainsi que nous construirons une nouvelle fraternité franco-algérienne.
Dix ans ont passé qui prouvent que nous ne sommes pas au bout de nos peines et que, plus que jamais, nous devons poursuivre « la bataille d’Einaudi » ainsi que l’explique Fabrice Riceputi dans un dernier chapitre inédit. Aujourd’hui, alors que paraît cette nouvelle édition, les nombreux signataires de l’appel lancé par Mediapart seraient officiellement voués aux gémonies et cloués au pilori, symboles du « séparatisme », supposés « islamo-gauchistes » et incarnation de « l’anti-France ».
Dix années marquées par des régressions
Que de régression en une décennie quand l’on compare la grande diversité des signatures de cet appel de 2011, soutenu à l’époque par toutes les forces politiques de la gauche française, à l’actuel climat idéologique, aussi politiquement nauséabond, que médiatiquement dominant ! La chasse aux sorcières décoloniales est officiellement ouverte à l’Université par un pouvoir macronien qui, avec le soutien de l’intelligentsia néoconservatrice, fait la courte échelle à l’extrême droite tandis qu’au Parlement, les député·s socialistes s’abstiennent (en première lecture) sur un projet de loi qui, pourtant, porte atteinte à nos libertés fondamentales au prétexte de la lutte contre un « séparatisme » imaginaire visant, en réalité, toute dissidence, toute radicalité, toute audace émancipatrice.
Trop tôt disparu, trois ans après, le 22 mars 2014, Jean-Luc Einaudi figurait évidemment au nombre des signataires de cet appel de Mediapart. C’est peu dire qu’il y avait toute sa place. Vingt ans auparavant, lors du trentième anniversaire du massacre, la parution en octobre 1991 de son livre, La bataille de Paris au Seuil, avait radicalement modifié le rapport de force dans l’affrontement entre le déni officiel et l’exigence de vérité.
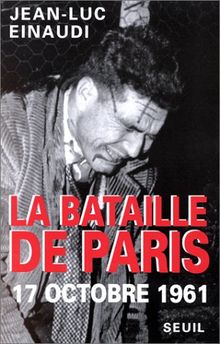
Non pas qu’Einaudi fut le premier ou le seul, bien au contraire. Il y avait eu, dès novembre 1961, Ratonnades à Paris de Paulette Péju, aux éditions François Maspero, immédiatement saisi par la police – Paulette Péju dont Gilles Manceron exhumera, en 2011, un manuscrit inédit, co-écrit avec son compagnon Marcel Péju, Le 17 octobre des Algériens. En 1983, le roman Meurtres pour mémoire, paru dans la « Série noire » de Gallimard, propulsait le massacre dans l’imaginaire national en même temps qu’il imposait un jeune écrivain, Didier Daeninckx.
En 1985, six ans avant La bataille de Paris, Michel Levine publiait, chez Ramsay, Les ratonnades d’octobre avec ce sous-titre : Un meurtre collectif à Paris en 1961. Enfin, en octobre 1991, en même temps que paraissait le livre de Jean-Luc Einaudi, l’association « Au nom de la mémoire » animée par Mehdi Lallaoui, éditait Le silence du fleuve sous la signature d’Anne Tristan, dont le texte poignant était accompagné d’une exhaustive recherche iconographique des preuves photographiques, notamment de l’indomptable reporter Elie Kagan, portant témoignage de la violence de la répression.
Mais ce n’est pas parce que la vérité était connue, établie par des témoins, illustrée par des écrivains, racontée par des associations, qu’elle était audible et, encore moins, entendue. L’événement Einaudi, c’est d’avoir mis fin à cette surdité dominante. Et de l’avoir fait grâce à un travail de recherche d’une ampleur alors inégalée, dont Riceputi raconte la genèse. Avec une infinie modestie devant l’ampleur de la tâche, doublée du fier sentiment d’accomplir une mission décisive, cet éducateur de métier s’est fait historien en forçant absences et silences. Absences des témoins survivants du massacre qu’il alla patiemment retrouver puis longuement écouter en Algérie même, mettant en œuvre une pratique sensible de l’histoire orale qui donnait corps et chair à l’événement. Silences des archives, verrouillées et cadenassées, qu’il réussit à percer avec l’aide de deux archivistes révoltés par l’imposition de la raison d’État à la vérité historique, lesquels payèrent le tribut de leur audace, tels des lanceurs d’alerte en avance sur leurs institutions.

Ce faisant, Jean-Luc Einaudi est de ceux qui ont sauvé une génération, celle des engagements de 1968 et d’après. Militant communiste oppositionnel, ayant rejoint autour de Jacques Jurquet (1922-2020) la dissidence du Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF), il aurait pu, comme certaines figures notables de cette époque où « le fond de l’air était rouge », pour reprendre une formule du cinéaste Chris Marker, jeter ses idéaux aux orties des illusions dès lors qu’au tournant des années 1980, ils n’étaient plus portés par le vent favorable des mobilisations populaires et des contestations juvéniles. Ce fut tout l’inverse : refusant les tentations du reniement et du carriérisme, il transforma son militantisme partisan en engagement vital. De l’un à l’autre, il conserva la pratique de l’enquête de terrain, c’est-à-dire le souci de la parole des premiers concernés, la méfiance pour les généralisations abstraites et la recherche entêtée de la vérité des faits. […]
Ici on noya les Algériens de Fabrice Riceputi
Sous-titre : La bataille de Jean Luc Einaudi pour faire reconnaître le massacre policier et raciste du 17 octobre 1961.
Rapide rappel des faits : Le 17 octobre 1961, pendant que se déroulaient entre Français et Algériens des négociations qui devaient aboutir quelques mois plus tard à la fin de la guerre d’Algérie et à l’indépendance de ce pays, la police parisienne réprima avec une extrême violence une manifestation pacifique de civils algériens qui protestaient contre l’instauration d’un couvre-feu imposée aux seuls Maghrébins. La manifestation, les violences policières se déroulèrent en début de soirée, dans de grands axes de la capitale, devant des dizaines de milliers de témoins potentiels. Il y eut des photos prises en direct d’hommes ensanglantés, de corps inanimés allongés sur les grands boulevards. Et dans les mois qui suivirent, quelques témoignages, quelques analyses circulèrent entre les mailles de la censure, très virulente à l’époque. Mais ni grands débats politiques, ni vagues d’indignation populaires. Pas de bronca non plus dans les médias quand la Préfecture de Police de Paris annonça officiellement le chiffre de deux morts parmi les manifestants, accompagné de ce commentaire oral : Pas de quoi en faire un drame. Les Français, dans leur très grande majorité, attendaient avec impatience la fin de la guerre, le drame du 17 octobre, en pleine négociations de paix, leur semblait fâcheux et incompréhensible. Ils l’oublièrent. Riceputi raconte dans ce livre le long combat (une quinzaine d’années, de 1986 aux années 2000) d’un homme, Jean-Luc Einaudi, pour briser l’oubli et faire entrer cette date dans notre Histoire.
Einaudi est d’abord un homme seul. Éducateur au service de la Justice des mineurs, historien autodidacte, il est largement méprisé par le lobby des historiens professionnels, qui le traitent d’amateur incompétent. Son intérêt pour le 17 octobre 1961, sa certitude de toucher là à un moment important dans l’histoire de la France républicaine en pleine période de coup d’état militaire et de flambée de l’OAS lui viennent de ses années de militantisme dans l’extrême gauche des années 68. Pas de quoi s’attirer la sympathie des gouvernements successifs du pays, ni des diverses institutions concernées. Ni historien ni chercheur, il n’aura pas d’autorisations pour consulter les archives policières et judiciaires. Le petit éducateur devra affronter en face à face le préfet Papon, un poids lourd de l’administration française, depuis Vichy et jusqu’aux années quatre-vingts, avec tous les réseaux d’influence que cela suppose. Avant la fin des années quatre-vingt-dix, il n’a pas non plus suscité l’intérêt des médias. A force d’inventivité (un bon historien « invente » ses archives), de travail, d’obstination, il est parvenu à établir une histoire du 17 octobre 1961 qui fait aujourd’hui autorité auprès des historiens étrangers et que même les Français, à partir des années 2000, intègrent petit à petit, avec prudence, dans l’Histoire de la France. Le bilan des morts de la répression du 17 octobre que l’on évoque aujourd’hui est de 200 à 300 morts.
Riceputi raconte ce parcours d’Einaudi comme un roman noir, avec une écriture rapide et tendue. Il commence son récit par le premier face à face Papon – Einaudi, en 1997, au cours du procès intenté par les familles de déportés juifs de Bordeaux à Papon qui était alors le préfet, très actif dans la déportation des juifs. Et les familles prennent l’initiative de solliciter le témoignage d’Einaudi sur le rôle de Papon dans la répression du 17 octobre 1961. Les victimes juives tendent la main aux victimes algériennes, moment émouvant et fort, qui médiatise pour la première fois le travail d’Einaudi. Le récit de Riceputi replonge ensuite dans le passé et se déroule jusqu’à la victoire d’Einaudi, à travers de multiples croisements, rebondissements, que le lecteur découvrira avec un vrai plaisir de lecture.
Après ce récit factuel, Riceputi formule quelques questions, qui touchent à notre actualité la plus brûlante. Qu’est-ce que l’Histoire ? Une science exacte, sur le modèle des mathématiques, développée par des chercheurs sans affect ni engagement, comme l’affirment nos ministres ? Ou une interrogation du passé par des hommes enracinés dans leur présent, une reconstruction permanente ? Qui sont les historiens ? Dans leur grande majorité, des enseignants chercheurs fonctionnaires ou aspirant à l’être, logiquement soucieux de leur carrière, de l’extension de leur zone de pouvoir, à la recherche de ressources financières et de réseaux pour la faire vivre, ce qui a des conséquences sur la façon dont ils orientent leurs recherches. Objectifs les historiens qui s’empressent de valider le chiffre de deux morts annoncé par la Préfecture de Police peu après les évènements ? A partir des seules archives de la Préfecture de Police, et sans même prendre la peine de signaler les dossiers manquants ? Sont-ils moins « engagés » qu’Einaudi ? Non, bien sûr. Mais ce qui distingue Einaudi, c’est le sérieux et l’ampleur du travail qu’il réalise ensuite, pour établir les faits. Il cherche les sources les plus diverses, y compris les archives de la Fédération de France du FLN ou les registres d’entrée des cimetières, il recueille des témoignages multiples, les confronte. Certains témoins lui sont présentés par Didier Daeninckx qui fut le premier, dans son roman Meurtres pour mémoire (1983), à « faire entendre » de façon assez large la tragédie du 17 octobre. Souvent les romanciers sont les premiers à briser les silences, avant les historiens.
La bataille d’Einaudi pose aussi la question de l’accès aux archives. Un droit ? Et qui en contrôle l’usage ? Deux archivistes ont témoigné au procès que Papon a intenté à Einaudi pour diffamation. Ils ont confirmé que le contenu des archives qu’ils avaient classées et dont la communication avait été refusée à Einaudi confirmait ses recherches. Ils ont été lourdement sanctionnés par leur hiérarchie. Conserver le contrôle des archives est un enjeu directement politique. C’est bien ce qu’a compris Macron qui, au moment où il déclenche la chasse aux chercheurs « décoloniaux », « islamo gauchistes », « séparatistes », repousse les délais de consultation de certains dossiers de cinquante à cent ans, et soumet toute une série d’autres à la décision arbitraire des services émetteurs.
L’histoire de la colonisation et de la décolonisation est importante, pas pour une repentance quelconque, mais pour comprendre d’où vient notre constitution, la violence de notre police, la nouvelle version de notre racisme, les fractures de notre société. Des questions importantes. La conclusion de Riceputi est optimiste : la vigueur de la réaction actuelle est proportionnelle aux avancées de la réflexion et de l’audience des travaux sur la décolonisation, dont la bataille d’Einaudi fut une date marquante.
Dominique Manotti
Fabrice Riceputi :
« Le 17 octobre 61 reste un clou rouillé dans la voûte plantaire
de la République »
Propos recueillis par Hassina Mechaï. Source
Middle East Eye : Vous montrez que le 17 octobre 61 a été soit occulté des mémoires, soit rangé derrière « l’autre » manifestation réprimée au métro Charonne, le 8 février 1962. Neuf personnes furent tuées par les force de l’ordre lors de cette manifestation interdite contre l’Organisation de l’armée secrète (OAS) hostile à l’indépendance et contre la guerre d’Algérie. Pourquoi ?
Fabrice Riceputi : Cela tient essentiellement au rapport qu’entretenait une certaine gauche française, celle qu’on a pu qualifier de « gauche respectueuse », avec le FLN. La SFIO [Section française de l’Internationale ouvrière] d’abord, compromise jusqu’au cou dans la répression coloniale sous la direction [du président du Conseil de 56 à 57] Guy Mollet. Le Parti communiste français (PCF), quant à lui, avait en 61 des rapports très tendus avec la Fédération de France du FLN. Le PCF s’est converti très tard à l’indépendance algérienne, ne réclamant longtemps que la « paix en Algérie ».
Les Algériens ont donc manifesté contre le couvre-feu sans l’appui de cette gauche française dont ils se méfiaient. Seuls le PSU [Parti socialiste unifié] et l’extrême gauche, ultra-minoritaires, manifestèrent ensuite pour protester contre ce massacre.
C’est dans la répression meurtrière de la manifestation anti-OAS de Charonne que la gauche anti-guerre d’Algérie reconnut ses martyrs. Les obsèques des neuf morts de Charonne, tous français, furent l’une des manifestations les plus massives de l’histoire.
Une seule allusion aux morts algériens du 17 octobre fut faite ce jour-là à la tribune, par un syndicaliste de la CFTC [Confédération française des travailleurs chrétiens]. Nous étions pourtant quatre mois après. Il n’y eut pas d’acte commémoratif fondateur qui aurait pu inscrire le pogrom anti-algérien du 17 octobre dans la mémoire collective.
Puis pendant longtemps, parmi des dirigeants politiques tous liés à cette affaire, il y eut un consensus tacite pour ne pas en parler.
MEE : Et pour la droite ? Vous expliquez que la gestion sécuritaire de ce qu’on appelait les Français musulmans d’Algérie a été l’occasion pour Michel Debré, alors Premier ministre de Charles de Gaulle, de manifester son opposition à l’indépendance algérienne, voire de saboter les efforts dans ce but…
FR : L’historien Pierre Vidal-Naquet a dit que la répression du 17 octobre restait pour lui une énigme politique. Ce massacre intervient au moment où l’indépendance algérienne [qui a lieu le 5 juillet 1962] n’est plus qu’une question de date et de modalités. Mais le pouvoir gaulliste est divisé. De Gaulle, après avoir mené les quatre pires années de répression contre l’indépendance algérienne, s’est résolu à négocier avec le FLN. Mais le Premier ministre Debré est l’homme des ultras de l’Algérie française, opposé à l’indépendance. La répression féroce du 17 octobre s’inscrit probablement dans une volonté de perturber le processus en cours, alors que les négociations avec le FLN sont suspendues. Papon était en lien direct avec Matignon et non avec l’Élysée. De Gaulle aurait qualifié cette répression d’« inadmissible mais secondaire ». Au-delà du cynisme de cette phrase, le 17 octobre n’est effectivement pas un tournant dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Il est en revanche un événement majeur dans celle de l’immigration, de ses propres luttes contre le racisme et les violences policières.
MEE : Mais cela s’est passé en plein Paris…
FR : Oui, cela s’est produit à l’heure où les restaurant se remplissent et où les gens vont au cinéma. Devant des milliers de témoins potentiels, dans une indifférence quasi générale. La société française est alors profondément travaillée par le racisme colonial, les Algériens y sont des gibiers de police et la vie de ces indigènes immigrés ne compte guère. Dès avant la guerre d’indépendance algérienne [1954-1962], la police tue des manifestants algériens et l’impunité lui est garantie, tant par sa hiérarchie que par la justice et aussi par la presse, qui diffuse une version officielle mensongère.
Pourtant, dans les premiers jours qui suivent les événements d’octobre 61, il y a des réactions, surtout à la gauche de la gauche. La revue de Jean-Paul Sartre, Les Temps modernes, publie une protestation d’intellectuels. La presse à grand tirage reprend la version officielle – seulement deux morts algériens dans une manifestation « violente ».
Mais très vite sont posées des questions gênantes, mettant en doute cette version, même dans Le Figaro. Cela durera quelques semaines, mais le gouvernement fait saisir certaines publications et empêche l’ouverture d’une commission parlementaire d’enquête en ouvrant une instruction judiciaire. La justice est saisie de certaines morts suspectes, mais ne fait rien, jusqu’à l’amnistie de mars 1962 qui stoppe toute instruction judiciaire contre les militaires et fonctionnaires français ayant pris part à la répression de l’indépendance algérienne.
De plus, si nul n’a cru à la version officielle, le bilan humain véritable restera incertain car comme dans toute répression de type colonial, les corps ne sont jamais vraiment dénombrables et restent souvent anonymes, les familles, souvent restées en Algérie, n’ayant pas accès à la presse. Certains ont été jetés à la Seine et dans les canaux, d’autres enterrés à la sauvette, d’autres encore « renvoyés dans leur douar d’origine », c’est-à-dire dans des camps où ils ont pu parfois disparaître.
MEE : Et côté algérien ? Comment le 17 octobre 61 a-t-il été considéré ?
FR : Cet événement n’a été intégré que très tardivement à l’histoire officielle de la lutte pour l’indépendance. La raison tient au fait qu’à l’indépendance, la Fédération de France du FLN a été marginalisée, ses membres étant devenus des opposants au pouvoir algérien. Au sein des familles concernées, les pères ont rarement raconté la façon dont ils avaient été traités par le pays où leurs enfants allaient vivre.
MEE : Maurice Papon est alors préfet de police de Paris… le même Papon qui avait collaboré avec l’Allemagne nazie sous le régime de Vichy.
FR : Aussitôt après avoir réussi à faire oublier son passé vichyste, Papon est devenu un « pacificateur » colonial de premier plan. Avant d’être nommé préfet de police de Paris, il avait fait ses armes d’abord au Maroc, puis en Algérie, à Constantine, entre 1949 et 1958. Il estime dans ses Mémoires qu’il a fait à Paris en octobre 1961 ce que [le général] Massu avait fait à Alger durant la prétendue « Bataille d’Alger » [il avait reçu les pleins pouvoirs pour mettre fin à l’insurrection indépendantiste], assumant parfaitement une militarisation du maintien de l’ordre dans une manifestation qu’on sait absolument pacifique mais qui est présentée par lui comme menaçant la sûreté de l’État, du simple fait du « fanatisme » caractérisant les Algériens.
Et il y a une continuité des méthodes policières avec l’époque de l’Occupation. Par exemple, il fait rafler des centaines d’Algériens en août 1958 – le mot « rafle » est alors d’usage courant dans la police – et les fait enfermer au Vel d’Hiv [utilisé en juillet 1942 par les autorités françaises pour enfermer plus de 13 000 juifs], sans que cela ne provoque beaucoup de remous. Le 17 octobre 1961, ce sont près de 12 000 manifestants (sur 20 000 ou 30 000 selon la police) qu’il fait cueillir dans Paris et enfermer à Vincennes ou au Palais des Sports de la porte de Versailles, le Vel D’Hiv n’existant plus.
MEE : Au cœur de votre livre, Jean-Luc Einaudi, celui qui documentera ce massacre. Sa personnalité s’oppose à la figure toute puissante du fonctionnaire Papon. Qui était-il ?
FR : L’historien algérien Mohammed Harbi l’a qualifié de « héros moral ». Cet homme, alors éducateur, a fait un travail colossal et pas seulement sur le 17 octobre 61. Éducateur à la PJJ [Protection judiciaire de la jeunesse], il le fait à ses propres frais, sur son temps libre. Il n’est pas historien de formation. Or il a été un véritable pionnier dans l’historiographie de la guerre d’Algérie, notamment par son travail de collecte de témoignages.
Son parcours intellectuel illustre l’idée que le retour du 17 octobre dans la mémoire collective est un effet indirect de Mai 1968. Enfant durant la guerre d’Algérie, il devient militant dans un parti marxiste-léniniste, qu’il quitte en 1982.
Les prolongements de son engagement sont, d’une part, de devenir éducateur auprès des jeunes des quartiers populaires et, d’autre part, de s’attaquer aux tabous de cette époque, notamment avec l’affaire Fernand Iveton, dont il est à ce jour le seul historien, la torture en Algérie avec la ferme Ameziane et enfin le 17 octobre.
MEE : Vous montrez qu’on lui refusera constamment l’accès aux archives officielles mais que deux archivistes réfractaires l’aideront malgré tout. Pourquoi ces refus officiels ?
FR : Pour accéder aux archives dont le délai de non-communicabilité n’était pas encore expiré, il fallait demander des dérogations. Or celles-ci n’étaient accordées qu’aux historiens reconnus comme tels et qui en outre avaient montré « patte blanche » dans leurs travaux. S’agissant de faire l’histoire de crimes dissimulés par l’État, le recours aux témoins s’imposait aussi comme une nécessité pour approcher de la vérité.
Deux archivistes, Brigitte Lainé et Philippe Grand, aidèrent effectivement Einaudi. Pour avoir dit en 1999 devant la justice, face à Papon, que les archives judiciaires dont l’accès était refusé à Einaudi prouvaient l’existence d’un massacre le 17 octobre 1961, ils ont vécu six années d’une véritable persécution professionnelle aux archives de Paris. L’institution des Archives de France n’a jamais exprimé de regrets sur le traitement infligé à ses deux fonctionnaires.
MEE : L’accès aux archives n’est-il pas facilité désormais ?
FR : Au contraire. Le ministère des Armées vient d’obtenir que les services de renseignement puissent, à leur guise, interdire l’accès à certaines archives publiques, même si elles ont plus de 50 ans. La recherche sur des pans entiers de l’histoire contemporaine se trouve gravement empêchée par cette décision. Elle a provoqué un tollé chez les historiens et archivistes, qui soulignent à raison qu’elle intervient sous une présidence qui ne cesse de prôner « la transparence ». Le combat mené actuellement par l’Association des archivistes français en faveur de la liberté d’accès aux archives publiques, remise en cause par le gouvernement Macron, montre toutefois que les archivistes ne se considèrent plus comme les gardiens de la raison d’État.
MEE : Vous écrivez que « l’aphasie a succédé à l’amnésie ». Cette aphasie peut-elle cesser et la parole peut-elle se faire sur d’autres massacres ?
FR : Le massacre du 17 octobre est colonial mais il se produit en métropole. Paradoxalement, il est plus facile à la République française de reconnaître les massacres qui se sont passés dans les colonies, même de bien plus grande ampleur que celui d’octobre 61, car précisément ce dernier s’est passé en métropole, en plein Paris, sous de Gaulle, et a été perpétré par une police supposément républicaine, à l’encontre de manifestants entièrement pacifiques. C’est ce qui rend cet événement indicible, inavouable par le sommet de la République.
Soixante ans plus tard, cette histoire est un gros clou rouillé dans la voûte plantaire de la République française. Dans le rapport commandé par le président français Emmanuel Macron à Benjamin Stora [sur la colonisation et la guerre d’Algérie], toute la bataille autour de la redécouverte de cet événement, dans laquelle Stora a pourtant joué un rôle important en tant qu’historien, n’est pas rappelée. Mettant en cause la République et sa police, elle sent sans doute encore le souffre. Le rapport préconise néanmoins un geste symbolique du chef de l’État sur le 17 octobre. Nous verrons bien, mais je doute fort qu’il y ait, le 17 octobre 2021, une reconnaissance pleine et entière de cet événement, car je vois mal Emmanuel Macron en campagne électorale indisposer les syndicats de policiers et autres prétendus défenseurs de l’« honneur » de la police, qui s’indignent depuis les années 1990 que l’on puisse songer à une telle reconnaissance. Sans parler du fait qu’il risquerait ainsi d’alimenter ceux qu’il stigmatise depuis quelques temps comme « séparatistes » ou « islamogauchistes ».
MEE : Comment jugez-vous justement les positions d’Emmanuel Macron par rapport à tous ces enjeux mémoriels, notamment algériens ?
FR : Emmanuel Macron a fait campagne en 2017 sur l’idée qu’il serait le premier président quasiment décolonial de France. Il a déclaré à Alger que la colonisation avait été un « crime contre l’humanité ». Quatre ans après, il s’inscrit dans une gestion clientéliste, cédant par exemple au lobby sécuritaire sur la question des archives. On peut aussi noter que le rapport Stora est rendu au moment où son gouvernement conspue les études « décoloniales » universitaires.
Mais je pense que la société française est très en avance sur ces questions par rapport à ses « élites » politiques et médiatiques. Le véritable printemps décolonial de 2020, avec la « génération Adama » et le mouvement des « déboulonneurs de statues » visant à décolonialiser l’espace public, l’a montré. C’est là une vague mondiale comparable au mouvement féministe Me Too.
MEE : Pour conclure, vous rappelez que Pierre Vidal-Naquet avait qualifié le 17 octobre 1961 d’événement matrice. En quoi et de quoi est-il la matrice ?
FR : Plus précisément, lorsqu’on lui demanda ce qu’il restait du 17 octobre, l’historien déclara que de cet événement matrice allait rester le mot « ratonnade ». Dans cette matrice, on peut voir l’origine d’un véritable système français d’impunité des crimes racistes d’État. Ce système s’est perpétué. Après la guerre d’Algérie, les années 70 et 80 furent des années de crimes racistes impunis en France. C’est contre ce système d’impunité que s’éleva la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983.
Bien sûr, l’intensité meurtrière n’a plus rien à voir avec celle de l’ère coloniale. Et ce système d’impunité est entré en crise, avec le « copwatching » qui rend publiques les violences policières racistes et que certains voudraient interdire. Mais c’est bien toujours contre lui que s’est élevée à nouveau en 2020 encore la « génération Adama ».