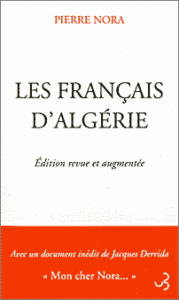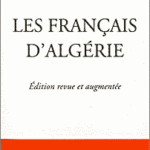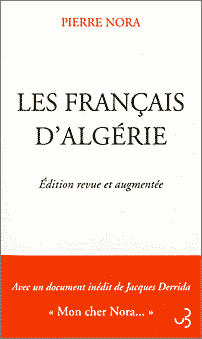
CINQUANTE ANS APRÈS
Il est presque impossible aujourd’hui, pour qui n’a pas vécu ces sept interminables années, de comprendre l’intensité des passions investies dans l’affaire algérienne. Un demi-siècle plus tard, l’indépendance paraît un acquis naturel, une évidence historique à laquelle seuls s’opposaient quelques gros colons récalcitrants et une poignée de militaires prêts à tout pour conserver leur conquête.
C’est d’abord ne pas tenir compte, au niveau local, des trois dimensions capitales du conflit : les rapports avec le monde arabe et avec l’islam, dont l’Algérie, bien plus que la Tunisie ou le Maroc, constituait le point de contact et l’entremêlement intime ; les rapports avec la métropole, dont l’Algérie représentait à la fois trois départements et le dernier morceau de ce qui avait été l’Empire, la dernière figure, donc, d’une projection mondiale de la France ; les rapports enfin avec une armée dont on a maintenant oublié le poids traditionnel, l’omniprésence, le modèle social — une armée où se côtoyaient la jeunesse mobilisée du contingent et un encadrement colonial professionnel qui avait trouvé sur ce théâtre d’opérations le dernier combat à sa mesure, un combat qu’elle avait gagné sur le terrain au moment où la politique, où Paris, où un général félon la contraignaient à lâcher prise et à renier ses engagements à l’égard du peuple algérien ; une armée qui se considérait comme la dépositaire des traditions les plus sacrées de la nation.
C’est ensuite ne pas mesurer la multiplicité des enjeux politiques et nationaux. On ne peut comparer leur importance qu’à l’affaire Dreyfus, à la défaire de 1940 ou à la Résistance. En plus inextricable et compliqué. L’affaire Dreyfus, en effet, permit en définitive l’affermissement du régime et l’établissement sans retour de la République, alors que la guerre d’Algérie a provoqué l’effondrement de la République et, à travers une forme à peine déguisée de coup d’État, l’avènement d’une Ve République qui, au départ, n’avait rien d’apparemment républicain. Si profond, si durable qu’ait été le traumatisme de la défaite de 1940, sa honte a été immédiatement compensée par l’action du général de Gaulle, l’existence de la France Libre et l’incorporation finale du pays dans le camp des vainqueurs. Quant à la Résistance, qui, par la place qu’y tenaient les communistes, avait pu paraître sur le moment comporter un risque révolutionnaire et une menace de guerre civile, elle s’est vite révélée, dans les faits comme dans la mémoire, une réalité unificatrice. La mutilation algérienne de la France a représenté dans son histoire une coupure à tous égards infiniment plus douloureuse, plus profonde, une blessure loin d’être encore cicatrisée.
C’est qu’au-delà de ses enjeux militaires, politiques, économiques, humains, internationaux, la guerre d’Algérie a engagé bien davantage, rien moins que l’identité nationale et ce qu’il faut bien appeler, comme dit justement Jacques Julliard, d’un terme à la Péguy : le destin spirituel de la France1.
______________________
La gauche a eu du mal à accepter l’indépendance de l’Algérie»
Le grand historien Pierre Nora réédite son très polémique premier livre, les Français d’Algérie, avec l’étrange lettre inédite que Jacques Derrida lui adressa à l’époque.
- Pourquoi avoir attendu cinquante ans pour republier votre livre?
Pierre Nora – Quand j’ai retrouvé dans mes archives l’étrange et magnifique lettre, longue de 52 pages, que Jacques Derrida m’avait adressée à la parution des «Français d’Algérie», j’en ai parlé à celui qui l’avait édité en 1961, Christian Bourgois. C’est lui qui eut l’idée de le rééditer avec cette lettre. La maladie l’a emporté, mais sa femme, Dominique, a réalisé le projet pour l’année du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie.
- Dans sa lettre, Derrida, votre ancien camarade de khâgne à Louis-le-Grand, est amicalement critique…
J’étais alors un jeune professeur d’histoire qui avait enseigné à Oran. Mon livre était un mélange d’analyse historique et de féroce polémique. Je comprends que Derrida, d’accord avec moi sur le portrait historique, ait été choqué par la violence et la sévérité du jugement. Et puis je m’en étais pris à ceux qu’on appelait les «libéraux», dont Germaine Tillion, la grande résistante, et Camus, qui était mort depuis peu, étaient les figures emblématiques. Je conçois que Derrida, qui était sur leurs positions, se soit senti particulièrement touché.
- Vous êtes le premier à remarquer que «l’Etranger» est moins le roman de l’existentialisme que celui de l’Algérie.
J’avais en effet avancé l’hypothèse que Camus, à travers son héros, Meursault, qui tire sur un Arabe anonyme, exprimait, malgré son passé progressiste et généreux, l’inconscient collectif du Français d’Algérie. Sur ce point, Derrida était d’accord. Il avait le courage de défendre les positions de Camus qui, depuis le prix Nobel – «Je préfère ma mère à la justice» –, semblait basculer vers l’Algérie française.
- Vous y alliez un peu fort en vous moquant de Français fiers de se proclamer de bons «Froncés».
Je suis bien conscient de la charge outrancière. Même le titre, aujourd’hui très plat, était provocant au moment où l’on ne parlait que de nos «compatriotes d’Algérie» ou des «Européens d’Algérie». Il exprimait une forme de ségrégation, et donc d’abandon, alors que nous étions à la veille des premières négociations d’Evian. Je me souviens du commentaire lapidaire de Raymond Aron: «18/20 pour l’écrivain, 0 pour le citoyen.»
Mais pour moi, c’était une manière de sortir d’un sentimentalisme qui nous enfermait dans le piège d’une fausse solidarité et nous enlisait dans le tragique. Jules Roy avait utilisé le même procédé en désignant par «guerre d’Algérie» ce qu’on appelait encore les «événements».
- Mars 1961 : la date de parution est importante.
Capitale! C’était quelques jours avant le putsch de Salan et le discours de De Gaulle sur le «quarteron de généraux en retraite». C’est le tournant le plus dramatique de la guerre d’Algérie, à la veille de l’émergence de l’OAS. Une atmosphère de guerre civile.
- Ce livre, c’était aussi un coup de gueule?
Oui, un livre de colère d’homme de gauche qui n’admettait pas que la gauche n’ait pas réglé cette affaire. Assimilationniste, elle eut le plus grand mal à se convertir à l’idée d’indépendance, d’autant qu’elle se trouvait majoritairement non pas devant de gros colons mais devant son électorat.
- Vous en avez reparlé avec Derrida?
Non. Nous nous sommes revus plus tard, en particulier à l’Ecole des Hautes Etudes. Je reste fer que mon livre ait déclenché chez lui cette mise à jour avec son Algérie natale, avec la guerre et sans doute avec lui-même. C’est son seul texte sur le sujet, ce qui lui donne tout son prix.
- Dans votre livre, on voit un jeune historien utiliser les méthodes d’analyse du passé pour parler du présent. L’expérience est inédite.
C’était en effet une des premières tentatives de faire une histoire du temps présent, avec tous les risques du genre. J’ai pensé après m’orienter vers le journalisme ou la littérature. Les 35.000 exemplaires des «Français d’Algérie» m’avaient donné une visibilité et une reconnaissance. J’ai même envisagé de devenir une sorte d’historien-reporter, un mélange de Braudel et d’Albert Londres! Mais la vie m’a entraîné vers l’enseignement et l’édition.
- Avec le recul, que bilan tirez-vous de votre premier livre?
Il exprime l’expérience politique la plus importante de ma génération. Nous avons pris conscience de nous comme intellectuels, car plus qu’une guerre militaire ou politique la guerre d’Algérie fut une guerre intellectuelle. Ce fut aussi pour moi la matrice de ma réflexion sur l’identité française qui allait me conduire aux «Lieux de mémoire». Cet essai à vocation littéraire a aussi fait que mon travail s’est émancipé du cadre strictement universitaire pour s’adresser au public. En somme, ce petit livre m’a fondé.