« La fiction de la race, c’est ce qui reste de l’ordre esclavagiste »
par Sonya Faure et Thibaut Sardier, publié dans Libération le 16 juin 2020
Source
Aurélia Michel, née en 1975, est historienne, maîtresse de conférences en histoire des Amériques noires à l’université Paris-Diderot et chercheure au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). Elle a notamment contribué au scénario du documentaire Les Routes de l’esclavage diffusé sur Arte en 2018.
Déboulonner les statues de personnages historiques liés à l’esclavage ou à la colonisation, et en même temps, manifester pour dénoncer le racisme dans la police : la simultanéité de ces deux actions dans les mobilisations antiracistes de ces dernières semaines, notamment en France et aux Etats-Unis, télescope l’histoire et l’actualité. Qu’a produit notre passé esclavagiste et colonial sur nos Etats et nos sociétés ? La question est au centre du livre d’Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc (Seuil, mars 2020). Retraçant l’histoire des mots « nègre » et « race » depuis le XVIe siècle, elle montre comment les « Blancs » se sont construit une place à part du point de vue politique, juridique, économique ou social. L’historienne, maîtresse de conférences en histoire des Amériques noires à l’université Paris-Diderot, convoque l’anthropologie et la psychologie pour expliquer les traces qu’il en reste aujourd’hui.

Quand le concept de « race » apparaît-il ?
Il est construit à la fin du XVIIIe siècle dans le monde atlantique, et plus particulièrement en France et aux Etats-Unis, des sociétés où l’esclavage tient une place très importante dans l’économie comme dans la pensée politique. Ce sont aussi des pays où naissent les révolutions démocratiques. C’est de cette double configuration que naît puis s’installe la notion de race, dans le long processus de l’abolition de l’esclavage de la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle.
Comment expliquez-vous ce paradoxe entre révolutions démocratiques et formalisation du concept de « race » à la fin du XVIIIe siècle ?
En formulant la liberté et l’égalité entre les hommes, ces deux sociétés ont rendu l’ordre esclavagiste intenable moralement. Dès lors que cette citoyenneté est théoriquement accessible à tout humain, la difficulté, c’est de restaurer la hiérarchie qui se trouve bouleversée. Que va-t-on faire des Noirs libres, affranchis ? De leurs enfants, cousins, neveux, issus des métissages, que le stigmate de l’esclavage éloigne de la citoyenneté ? Puisqu’il n’y a pas véritablement de justification, les élites utilisent la notion de race pour répondre à ce besoin de mise en ordre des sociétés. Au moment où se redéfinit le système de parenté de l’Europe moderne et de l’occident [en France, le Code civil est adopté en 1804, ndlr], elles comptent décider qui est «blanc» et donc membre du groupe, qui a des droits, et qui en est exclu. C’est un état de fait qui n’est ni justifié ni argumenté et qui pourtant s’impose parmi les élites, y compris savantes. Mais il n’y a pas d’élaboration du contenu de la race. C’est ce qui reste de l’ordre esclavagiste, tellement imprégné parmi les élites qu’il est impossible d’aller au bout de l’égalité révolutionnaire. Cette logique serait aussi valable pour les femmes, les domestiques, les vagabonds.
Quelle est l’influence de l’économie dans cette évolution ?
L’abolition de l’esclavage a d’abord été une question économique. Mis en place à partir du XVe siècle, le système esclavagiste avait des failles, et la première d’entre elles, c’était la traite même des populations : elle est très chère, représente beaucoup de risques et demande toute une logistique. De nouvelles questions émergent alors : comment exploiter les plantations sur le continent américain sans faire venir des esclaves d’Afrique ? Comment trouver une main d’œuvre qui se déplace volontairement, s’installe sur place et se reproduit d’elle-même ? Le capitalisme doit trouver des solutions de production qui prolongent l’économie de plantation. C’est ce qui ouvre la voie à la colonisation de l’Afrique et de l’Asie. L’idée de race accompagne une conversion du colonialisme qui se réoriente sur d’autres terrains de production et produit «sur place», là où il y a des « nègres ». La « science des races » qui se développe au XIXe siècle détermine des catégories raciales assez larges pour déterminer qui s’installe, qui se déplace, qui travaille pour soi, qui travaille pour autrui, et garantir les investissements du capitalisme international.
Mais dans les discours coloniaux, les populations indigènes étaient censées pouvoir changer de catégorie une fois le travail de «civilisation» terminé.
En théorie oui, dans cette perspective, on voit défendue l’idée que les races vivent harmonieusement ensemble, pour le bien les unes et des autres, et que chacun trouve sa place de travailleur, domestique, producteur, etc. Le projet de civilisation des peuples colonisés se présente comme un projet humaniste et généreux. Mais comme il est aussi justification, tout est fait pour qu’il soit éternel : une grande partie des expérimentations scientifiques de la période s’efforce de montrer que le nègre, le sauvage, s’éloigne toujours plus de toute possibilité de civilisation.
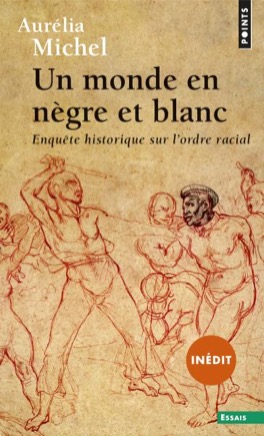
Alors que le mot « nègre » apparaît avec la traite transatlantique au XVIe siècle, vous expliquez que la « fiction du Blanc » ne s’élabore qu’au XVIIIe siècle. Pourquoi ce décalage ?
Avec la traite, les sociétés des colonies connaissent une croissance démographique rapide au XVIIIe siècle. Alors que certains planteurs n’hésitent pas à affranchir ou à faire hériter certains de leurs enfants qu’ils ont eus avec leurs esclaves, d’autres tiennent à se distinguer de cette population. C’est dans ce contexte que le mot « Blanc » apparaît et se diffuse parmi les élites, jusqu’en Europe. C’est un mot politique, qui n’a pas de consistance scientifique ou philosophique. Tout à coup, au moment où l’on formule que « les hommes naissent libres et égaux », cette catégorie apparaît dans l’administration, la législation, comme dans le décret d’application du Code civil aux colonies en 1805. C’est la raison pour laquelle je parle de « fiction du Blanc» car, comme par magie, le terme entre dans la loi, et par un tour de passe-passe, restreint l’accès à la citoyenneté. Cette vision emprisonne aussi les femmes blanches en leur assignant le rôle de reproductrices, car on ne devient blanc que par naissance. La filiation naturelle vient alors nourrir une conception de la communauté nationale biologique, qui contribue à la construction de la nation.
En quoi toutes ces fictions – celle du « nègre » au XVIe siècle, celle du « Blanc » au XVIIIe, celle de la « race » au XIXe – prennent-elles racine dans la figure de l’esclave ?
Etre esclave est une condition qui ne repose pas uniquement sur l’absence de liberté. Etre esclave, c’est d’abord ne pas être parent, comme l’a montré l’anthropologue Claude Meillassoux dans ses travaux sur les sociétés ouest-africaines. Tout esclave est extrait de sa société d’origine, il vit et travaille dans une nouvelle société où il n’a plus aucun lien de civilité, aucune affiliation identitaire. Il est donc exploitable à merci, et on peut lui infliger toutes les violences : aucun interdit ne protège son corps. L’esclave comme « anti-parent » est une caractéristique qu’on retrouve dans toutes les sociétés esclavagistes de l’histoire, mais ce qui rend singulière la traite atlantique, c’est que les Européens qui n’avaient plus recours à l’esclavage depuis la fin de l’Antiquité reviennent à cette institution au moment où se déploie le capitalisme. Le résultat est le modèle de la plantation atlantique. Le capitalisme se développe grâce à la convergence de cette force de travail quasi-illimitée, des techniques de réduction de la distance que permettent les progrès de la navigation et de la découverte des terres américaines, qui sont un immense espace d’exploitation possible.
Est-ce parce qu’elle est couplée au capitalisme que l’institution de l’esclavage prend alors une dimension inédite ?
En deux siècles et demi, du XVIe au milieu du XVIIIe siècle, elle atteint un paroxysme, une échelle industrielle qui fait toute la singularité de la violence esclavagiste européenne. C’est cette violence qu’on perçoit dans le mot «nègre» : il est frappant de l’entendre de manière compulsive dans les messages entre certains officiers de police de Rouen, au sein d’un groupe privé WhatsApp [ils ont été révélés par Arte et Mediapart, ndlr]. Pourquoi relève-t-il de l’insulte ? C’est parce qu’il est la manifestation de cet ordre qui certes a évolué, mais dont nous sommes encore les héritiers et les porteurs. C’est la meilleure preuve que nous sommes organisés dans nos relations sociales, nos dispositifs de domination, par cet ordre racial, que ces insultes traduisent.
Dans votre livre, vous montrez à quel point la question raciale se construit comme une réponse aux besoins des économies coloniales. Pourquoi est-elle alors toujours actuelle ?
La violence raciale a tellement imprégné les rapports sociaux qu’elle reste un ressort parmi d’autres de l’économie capitaliste pour faire pression sur le travail, comme dans les emplois domestiques par exemple où les employés racisés, hommes comme femmes, subissent des pressions quant à leurs horaires et leurs conditions de travail, leur niveau de rémunération etc. Par ailleurs, si la race reste si active, c’est qu’elle ne se limite pas à une dimension économique. Elle continue d’irriguer nos rapports sociaux : elle s’insinue dans les relations entre la police et la population, dans la question des banlieues, de l’école, etc. On y a tout le temps recours, notamment pour supporter ou mettre à distance cette violence qui nous serait, sans cela, insoutenable. C’est parce qu’on supporte cette dernière qu’elle se prolonge, et c’est bien sûr le piège. C’est ce que nous faisons par exemple à propos des migrants : pouvoir se dire que des «vies qui ne comptent pas» se noient en Méditerranée, c’est éviter d’y voir des semblables, des cousins, des proches. Tout cet assemblage-là constitué à la fin du XVIIIe siècle est malmené, bouleversé par les revendications que l’on entend depuis lors. C’est aussi la raison pour laquelle le simple fait de dire qu’il y a du racisme dans les institutions, la police, provoque des réactions violentes, comme si on mettait en péril l’existence du groupe. Or en face, les enjeux de survie, de sécurité des corps, sont bien réels.





