Décoloniser la nature
par Laurie Gagnon-Bouchard, publié par La vie des idées le 7 novembre 2022.
Source
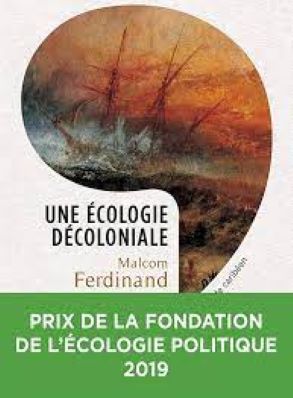
Auteur de Decolonial Ecology : Thinking from the Caribbean World, Cambridge, Polity press, 2022, paru au Seuil en 2019 sous le titre, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Malcom Ferdinand est un ingénieur en environnement, docteur en science politique à l’université Paris Diderot et chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à l’IRISSO (Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, science politique, économie et sociologie des organisations – Université Paris-Dauphine). Ses travaux portent principalement sur l’écologie politique, la justice environnementale et les problématiques décoloniales. Il étudie en particulier les interactions entre l’histoire coloniale et les problématiques environnementales dans le cadre caribéen.
Pour Malcom Ferdinand, l’exploitation de la nature a autant partie liée avec le colonialisme et l’esclavagisme qu’avec le paradigme techniciste des Modernes. Récemment traduit en anglais, son livre invite à « penser la crise écologique depuis la Caraïbe ».
Dans Decolonial Ecology : Thinking from the Caribbean World (traduction de Une écologie décoloniale paru au Seuil en 2019), Malcom Ferdinand avance que le monde contemporain est le résultat d’une double fracture, environnementale et coloniale1. On associe généralement la domination de la nature au paradigme techniciste de la modernité, sans la relier aux entreprises d’exploitation humaine qu’ont été le colonialisme et l’esclavagisme. L’auteur, chercheur au CNRS, philosophe et docteur en science politique, défend qu’il existe au contraire un lien inextricable entre ces histoires. La crise écologique est la continuation de la sombre aventure coloniale moderne des Amériques qui a engendré la destruction des mondes épistémiques, ontologiques et écologiques des Suds, notamment du monde caribéen. Ferdinand nous invite ainsi à penser l’écologie à partir de la Caraïbe. Il s’agit d’un espace privilégié, car il est frappé de plein fouet par les conséquences des changements climatiques alors que l’empreinte écologique des pays qui l’occupent est bien inférieure à celle des pays dits « développés ». Le monde caribéen met en lumière les inégalités matérielles et écologiques liées de près à l’histoire coloniale. En effet, les terres du monde caribéen ont été façonnées, défrichées et appauvries suivant le modèle de la plantation coloniale. Cela a aujourd’hui pour effet de rendre ces territoires et les personnes qui y habitent d’autant plus vulnérables face aux aléas (ouragans, tempêtes, montée des eaux, tremblements de terre) qui découlent des changements climatiques. En pensant à partir de la Caraïbe, mais aussi à travers les symboles de la crise écologique et décoloniale que sont le bateau esclavagiste et la tempête, Ferdinand nous invite à penser depuis les lieux et les expériences des personnes qui ont été réduites à un silence épistémique, politique, identitaire et cosmogonique tout à la fois.
L’habiter colonial
Les sociétés européennes modernes se sont développées et enrichies grâce à la mise en esclavage, la dépossession et l’exploitation des corps et des terres : un habiter colonial. Ferdinand montre que cet habiter se fonde sur une subordination géographique, une dépendance ontologique, et un « altéricide » (p. 28). La subordination géographique et la dépendance ontologique signifient que la colonie n’existe comme entité que dans son rapport de subordination vis-à-vis de la métropole coloniale. L’habiter colonial a pour but ultime l’appropriation des ressources, des terres et l’accumulation des richesses de la métropole via l’exploitation du travail des esclaves et la dépossession matérielle et territoriale des colonies (p. 30). Enfin, l’altéricide se produit à travers la négation de l’autre (des personnes qui vivaient à cet endroit avant l’arrivée des colons) et l’impossibilité d’habiter avec cet·te autre. Il se réalise notamment à travers la doctrine de la terra nullius, qui ne reconnait pas le droit des peuples autochtones sur les terres colonisées, et par le génocide humain et culturel de ces peuples, en vue d’annihiler la différence (p. 41). Ainsi, le colonialisme a signifié, bien avant la crise écologique actuelle, la fin du monde, de leurs mondes, pour plusieurs peuples, notamment ceux qui ont été déracinés et soumis à l’esclavage2.
L’écologie décoloniale
Malcom Ferdinand propose une « écologie décoloniale ». L’écologie décoloniale est d’abord une critique adressée aux environnementalistes qui souhaitent sauver la planète et l’humanité tout en refusant le monde : en ne mettant pas au centre de leur écologie les personnes qui se trouvent dans la « cale » de la modernité – celles dont l’exploitation a rendu possible l’avènement et le progrès de la modernité. Il s’agit de regarder le monde tel qu’il est, avec ses injustices et ses oppressions. C’est alors que l’écologie décoloniale peut se présenter comme une alternative.
By recognizing that colonization, racism, and gender discrimination are also ways of inhabiting the Earth, landscape relations, and geological forces at the heart of the ecological crisis, challenging the colonial divide becomes the fundamental issue of the ecological struggle. In bridging [panser] this double divide, decolonial ecology turns the degradation of social life, the extractivism of Negro skins, and environmental racism into the primary targets of ecological action. Yes, antiracism and decolonial critique are the keys to the ecological struggle. (p. 178)
En reconnaissant que les colonisations, les racismes et les discriminations de genre sont aussi des manières d’habiter la Terre, des relations paysagères, des forces géologiques au cœur de la crise écologique, la remise en cause de la fracture coloniale devient l’enjeu fondamental de la lutte écologiste. (p. 299)
La solution à la crise écologique ne peut donc être pensée sans détruire les rapports de pouvoir qui ont asservi les personnes afrodescendantes, autochtones, racisées et les femmes.
Faire monde
Ferdinand nous invite à tirer hors de la cale du bateau esclavagiste tous les vivants, tant humains que non humains, qui ont été asservis par une manière violente et destructrice d’habiter la terre. Plutôt que de bâtir une arche de Noé, dans laquelle tou·t·es n’entrent pas, mais où l’on sélectionne ceux et celles qui survivront à la crise écologique, Malcom Ferdinand propose de construire un « navire-monde » (p. 189). Dans ce navire-monde, un « pont de la justice » doit nécessairement être érigé sur lequel une rencontre entre égaux et égales est possible. Ce pont de la justice permet de faire monde à partir des blessures historiques et des conflictualités : une rencontre où les vivants peuvent être « compagnons de bord » face à la crise écologique. Telle est la proposition de Ferdinand : partir du diagnostic, rendre visibles les oppressions actuelles et historiques et tenter de construire une cohabitation en dehors des modes de relation coloniaux – l’esclavagisme et l’exploitation des humains et non-humains.
L’écologie décoloniale prend ainsi le contrepied de l’homogénéisation à l’œuvre dans les tentatives de mobilisation d’un « nous » face à la crise écologique (p. 179). D’abord, le nous n’est pas homogène, il est pluriel et contient des différences radicales dans la façon dont les personnes différemment situées ont contribué à la crise écologique (p. 179). Ensuite, ce nous n’est pas donné d’avance, il est à construire et demande d’aller vers l’autre sans reproduire l’habiter colonial par la dépossession et l’assimilation : l’altéricide.
Ainsi, Ferdinand critique les penseurs et les écologistes tels que James Lovelock, Michel Serres ou Yann Arthus Bertrandqui voient la Terre comme leur oîkos. La Terre n’est pas notre demeure :
To say that the Earth is humanity’s home is to reproduce across the whole of the Earth the exclusionary fantasy that aims to hide the plurality of actors and avoid the human political task of composing a world with other people : living together. (p. 82).
Dire que la Terre est la maison de l’humanité, c’est reproduire à la totalité de la Terre le fantasme excluant qui vise à cacher la pluralité d’acteurs et à éviter cette humaine tâche politique de composer un monde avec autrui : vivre ensemble. (p. 141).
Pour Ferdinand, l’écologie est fondamentalement la rencontre de la pluralité et de l’altérité : la capacité de se confronter à la différence sans la tuer, l’effacer, l’exploiter et/ou l’assimiler (p. 233). L’écologie décoloniale, c’est la possibilité d’une pluralité de vivants humains et non humains qui ont la Terre en commun et qui arrivent à une organisation cosmopolitique plurielle (Ferdinand, 2022 ; Escobar, 2018).
Une écologie décoloniale doit, selon Malcom Ferdinand, mettre en lumière les résistances historiques et actuelles dans des visées écologistes et décoloniales déployées par des femmes, des personnes racisées, afrodescendantes et autochtones face à la tempête coloniale et environnementale (p. 179). Elle requiert également de visibiliser et de valoriser le travail des personnes (souvent femmes ou racisées) qui prennent soin de notre monde en s’occupant du ramassage des déchets, du nettoyage des rues, etc.) (p. 85).
Oikos
On pourrait émettre une réserve à propos de la critique de l’oikos que propose Malcom Ferdinand. Plusieurs féministes, notamment bell hooks et Virginia Woolf, ont montré que, bien que l’oikos, la maison, soit parfois le lieu de grandes violences, il peut, s’il est politisé et émancipé des violences genrées et sexuelles, devenir un lieu privilégié, bien que circonscrit, pour réfléchir et résister aux rapports de pouvoir et construire les solidarités et les coalitions dont le monde a besoin. La maison, le refuge, la chambre à soi, permet de rétablir un rapport positif au je (la subjectivité niée par les systèmes patriarcaux et racistes) qui permet ensuite la rencontre du monde. Un lieu de sécurité permet d’emmagasiner la force d’affronter les violences du monde et de le transformer.
Néanmoins, prendre au sérieux les critiques décoloniales qu’adresse Malcom Ferdinand à l’oikos permet de mesurer le déplacement important que représente le faire monde par rapport aux solutions de certain·es philosophes de l’environnement comme les écocentristes (par exemple Aldo Leopold) ou certaines écoféministes qui proposent de leur côté de « faire partie du monde » (Casselot et Lefebvre-Faucher, 2017). Sans rejeter l’aspect inéluctable de l’acte de se réinsérer dans le monde, d’en faire partie et de retrouver une forme d’humilité pour faire face à la crise écologique, l’avantage de la proposition de Ferdinand est de nous rediriger ver le mode de l’action, vers l’agir. Le constat d’exister sur une même terre ne veut pas dire que nous faisons monde, que le monde est l’horizon de pensée de l’écologie. Ferdinand écrit :
The world would seem to be given from the outset, with the physical interdependence of the globe and the ecosystems of the Earth taken as proof. But, unlike the Earth, the world is not self-evident. (p. 17)
Contrairement à la Terre, le monde ne va pas de soi (p. 37).
Faire monde demande cet effort politique et l’engagement de le construire différemment ici et maintenant. L’écoféministe queer Catriona Sandilands exposait précisément dans ses écrits que les coalitions écologiques et féministes se bâtissent dans le processus de construction politique d’un monde commun viable pour tous et toutes (Sandilands, 1999, p.165). Ainsi, la proposition de Ferdinand demande de ne pas présumer qu’il existe un tout relationnel, dont les relations seraient déjà pacifiées et dans lequel il suffirait de s’insérer et duquel on ferait immédiatement partie. En cherchant à faire monde, nous déplaçons notre regard, en vue de transformer les relations d’exploitation actuelles en des relations viables.
Et la fracture patriarcale ?
Malcom Ferdinand reconnaît à de multiples reprises dans son œuvre la situation spécifique des femmes dans l’habiter colonial, en particulier des femmes réduites en esclavage et racisées, qui subissent les différentes violences coloniales genrées. La fracture patriarcale du monde reste néanmoins reléguée au second plan dans l’ouvrage de Ferdinand. L’analyse aurait sans doute gagné en nuance en incluant, aux côtés des fractures environnementale et coloniale, celle du genre. Le geste aurait permis de décrire l’expérience particulière des femmes dans l’habiter colonial, en s’arrêtant, par exemple, sur le nombre bien moins élevé de marronnes qui se sont échappées, « because of their position as women and mothers, they encountered even more obstacles to their freedom of movement than enslaved men did. » (p. 155 : « du fait de leur position de femmes et de mères, elles ont rencontré plus d’obstacles encore à leur liberté de mouvement que les esclaves hommes. »)
Ces réserves n’ôtent rien à l’importance d’Une écologie décoloniale tant pour l’écologie sociale que pour la pensée décoloniale. L’ouvrage de Ferdinand a le grand mérite d’éclairer les angles morts respectifs de ces champs de recherche et d’ouvrir un dialogue entre eux. Suivant les traces de la pensée décoloniale écologique élaborée par Arturo Escobar dans Sentir et penser avec la Terre, Ferdinand développe ici des réflexions politiques, philosophiques, historiques et sociales originales dans une écriture libre, poétique et sensible. Il propose ainsi de penser différemment l’écologie au plus près des réalités historiques et actuelles et des inégalités matérielles, épistémiques et existentielles dans leur pluralité.
Penser l’écologie depuis le monde caribéen,
entretien avec Malcolm Ferdinand
par Philippe Triay, publié par 1 le portail des Outre-Mers le 1er octobre 2019.
Source
Qu’entendez-vous par l’expression « écologie décoloniale », titre de votre ouvrage ?
Par « écologie décoloniale », j’entends une écologie qui articule l’exigence de préservation des équilibres écosystémiques de la Terre et l’exigence décoloniale. L’urgence climatique est ainsi imbriquée à l’urgence des luttes pour la justice sociale, des luttes antiracistes et féministes, et à la quête d’un monde au sortir de la colonisation et de l’esclavage. Cette proposition vient répondre à une histoire de la pensée environnementale qui ne s’est pas fondamentalement intéressée à l’histoire coloniale et esclavagiste de la modernité. Cette absence patente depuis les premiers mouvements de conservation d’espaces dits « naturels » au XVIIIe et XIXe siècle et les premières associations écologistes du XXe siècle est encore importante aujourd’hui. Dans sa genèse classique, l’environnementalisme a inventé un récit de la Terre et une manière de parler des changements climatiques et écosystémiques qui occultent totalement les destructions humaines et environnementales qui ont été causées par les colonisations, les impérialismes et les esclavages. Comme si, pour parler d’écologie, il fallait mettre de côté le vécu d’une grande partie de la population de la Terre, celle pour qui le legs colonial est moins un sujet d’histoire que l’expérience quotidienne de racisme, de discriminations et d’injustes inégalités entre Nord et Sud.
Il en résulte une fracture où les mouvements écologistes mais aussi les conceptualisations qui les accompagnent ne se soucient guère de cette histoire pourtant constitutive de la modernité. Aujourd’hui, de nombreuses associations et partis politiques écologistes se rendent compte qu’au sein de pays multiculturels et pluriethniques comme la France et les États-Unis, ils ont créé, de fait, des espaces majoritairement blancs et masculins. On constate alors l’absurdité suivante, où dans des associations, des rassemblements, des manifestations, des salles de classes, des colloques universitaires, des conférences intergouvernementales, des réflexions se mènent sur l’histoire de la Terre et la préservation des écosystèmes à l’échelle globale sans la présence de ceux, rappelait Aimé Césaire, « sans qui la terre ne serait pas la terre ». En déconstruisant cette fracture, l’écologie décoloniale propose une autre conceptualisation de l’écologie, une qui prend en charge doublement la question écologique et la question coloniale.
Quelles seraient les pistes pour décoloniser l’écologie politique selon vous ? Plus de diversité dans ses représentants ?
Je n’emploie jamais cette expression dans mon livre. Je veux montrer que le fait d’occulter les questions coloniales et esclavagistes ont produit en retour une écologie coloniale, c’est-à-dire une préservation de l’environnement qui va se manifester par l’exacerbation de la domination des pauvres, des racisés et des femmes. On retrouve cela dans la préservation des premiers parcs nationaux créés aux Etats-Unis, qui ont eu pour conséquence l’éviction des Amérindiens de ces espaces. On voit aussi cela dans des projets de conservation en Afrique. On a inventé une idée de la nature vierge qui s’est traduit littéralement par l’expulsion des autochtones.
Ceci dit, je pense que l’absence de diversité a été remarquée dans les milieux écologistes. Mais il faut que cette absence soit prise non pas comme une simple question de diversité, mais comme quelque chose qui pousse à interroger les objets mêmes de l’écologie politique, dans les partis et les mouvements. Qu’est ce qui fait que dans ces objets-là, mis en avant comme des actions à réaliser, une partie de la population ne s’y retrouve pas ? Le problème est un problème conceptuel, de ce que l’on a pensé comme relevant de l’écologie politique. On en arrive à une situation où l’antiracisme n’est pas pensé comme une action écologique, et où ce mot même est peu utilisé dans le vocabulaire écologiste. Il faut donc repenser les alliances et changer les termes mêmes du débat.
Vous avez récemment publié avec le docteur Luc Multigner, directeur de recherche à l’Inserm, une tribune dans The Conversation intitulée « Chlordécone et cancer : à qui profite le doute ? ». A-t-on justement pris la mesure des ravages engendrés par ce pesticide aux Antilles ?
Ma réponse est non. J’ai d’ailleurs été auditionné par la commission d’enquête parlementaire sur le chlordécone à l’Assemblée nationale, et je vais dire que le chlordécone participe d’un problème plus large, qui est celui de la relation des Outre-mer à la France hexagonale. Aujourd’hui on se rend compte que 80% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer, mais dans le même temps la question de l’égalité sociale, des droits, des infrastructures etc., des citoyens ultramarins n’est pas posée. On s’enquiert de ce qui advient aux écosystèmes ultramarins, sans questionner le fait que les Ultramarins sont cantonnés encore aujourd’hui aux marges de l’imaginaire politique de ce qu’est la France.
Mais il ne faut pas oublier que les bananes qui ont été produite avec le chlordécone ont atterri en France hexagonale principalement. Ces citoyens sont donc concernés en premier lieu. Le chlordécone ne devrait donc pas être une affaire strictement ultramarine, mais devrait être compris comme mode de production issu de la culture coloniale et donc remis en cause. Environ 95% de la production de bananes sont exportées. C’est donc une production qui ne nourrit pas les Antillais, mais ce sont eux qui ont subi les conséquences violentes, la souffrance, les maladies, et l’angoisse que cela suscite en pensant à nos enfants, en se disant que l’on a une terre contaminée pour plusieurs siècles. Cet ensemble de questions paraît malheureusement bien éloignée des préoccupations hexagonales.
Penser l’Anthropocène avec Malcom Ferdinand
- Une première version de ce texte a bénéficié des commentaires et de l’édition de l’équipe de Post-Scriptum, notamment Miriam Sbih et Renato Rodriguez-Lefebvre, ainsi que de Marie-Anne Casselot. Je les remercie pour leur travail et leurs apports.
- Nous reprenons ici l’analyse de l’œuvre de Ferdinand offerte par Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés du Québec, lors de la conférence « La transition socio-écologique : un enjeu féministe de Mères au front », le 20 octobre 2021, en ligne.



