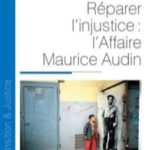Préface de Michel Wieviorka
à Un tortionnaire ordinaire ? Rencontre avec un ancien appelé de la guerre d’Algérie, éditions du Croquant, 2019.
Quelle belle rencontre que celle de Claude Juin, et de Muriel Montagut !
Lui a été soldat en Algérie, appelé pour participer à ce que les autorités françaises se refusaient à qualifier de « guerre » — il faudra attendre la présidence de Jacques Chirac, beaucoup plus tard, pour que les « évènements » trouvent enfin officiellement leur bonne appellation. Jamais, depuis son retour, en 1958, Claude Juin n’a cessé de s’interroger : comment a-t-il été possible que tant de jeunes aient pu alors se livrer à tant de crimes, ou à en être au minimum témoin passifs ? D’autres reviennent d’une guerre aussi meurtrière traumatisés à jamais, brisés — on le voit dans nombre de films américains où apparaissent des « vétérans » de la guerre du Vietnam. Claude Juin, lui, est sorti par le haut de cette terrible expérience, conjuguant indignation et effort soutenu pour comprendre et analyser. Sur place, il tenait un journal, consignant ses observations, et ce qu’elles lui inspiraient, formidable matériau qu’il saura utiliser plutôt en militant, avec notamment son livre sur Le Gâchis, publié sous pseudonyme en 1960, ou plutôt en chercheur, avec une thèse sous ma direction soutenue en 2011, et dont il a tiré un livre que j’ai tenu à publier dans une collection que je dirige.

Muriel Montagut est beaucoup plus jeune que Claude Juin, et son expérience est autre : c’est celle non pas d’une participante à une guerre, mais d’une thérapeute qui a eu à connaître aussi bien des victimes que des coupables des pires horreurs — parfois d’ailleurs, une même personne a été l’un et l’autre. Elle a accompagné en thérapeute des tortionnaires, et elle a tiré elle aussi une thèse d’une longue pratique, mais aussi d’un effort impressionnant pour maîtriser les divers outils théoriques qui peuvent permettre d’aborder de tels enjeux. C’est d’ailleurs parce que j’ai été invité à la soutenance de sa thèse, publiée peu après, en 2014, que j’ai pu faire sa connaissance.
Peut-être faut-il ici introduire celui qui a rendu possible la rencontre de Claude Juin et de Muriel Montagut : Vincent de Gaulejac. Cet ami de longue date (nous étions étudiants ensemble au début des années 70, et avons été longtemps collègues dans la même université, Paris Dauphine) était membre du jury de thèse de Claude Juin, et a eu la bonne idée de m‘inviter, comme en retour, à celui de Muriel Montagut. Il n’y avait plus qu’à suggérer aux deux docteurs, à Claude Juin et Muriel Montagut, de se parler, compte tenu de la teneur de leurs recherches : ce fut chose faite très rapidement.
C’est donc quatre personnes que rassemblent la même préoccupation : comprendre la violence, la capacité de l’être humain de la pratiquer, y compris sous des formes extrêmes, directement et explicitement négatives de l’humanité des victimes. On ne remerciera jamais assez l’université, en général, de rendre possible de telles rencontres, qui sont sinon bien improbables.
« Jean », le tortionnaire qui raconte ses crimes avec bonne conscience
Claude Juin avait connu en Allemagne, où il commençait son service militaire, en 1955 un autre appelé, « Jean », qu’il avait retrouvé en Algérie. Jean et lui ont été « copains » de régiment ; mais Jean avait été aussi activement tortionnaire, il avait commis des atrocités. Et un demi-siècle plus tard, au moment de sa consécration académique, en cours même de soutenance de sa thèse, Claude Juin, encouragé par de Gaulejac et moi-même, a pris conscience de ce qui est devenu une sorte d’urgence pour lui : revoir Jean, essayer de le comprendre, et peut-être de le mettre en position de s’expliquer.
Le livre qu’on va lire est d’abord le récit de leurs rencontres, alors qu’ils ne s’étaient pas vus depuis la guerre. Je ne le déflorerai évidemment pas. J’en dirais, simplement, qu’il y a là un matériau exceptionnel, où l’on voit dialoguer les deux anciens combattants, l’un essayant de comprendre l’autre, qui y résiste. Et essayant aussi de se comprendre lui-même, avec une vague culpabilité : il n’a pas pu empêcher à l’époque Jean, et d’autres, de commettre leurs atrocités.
Et ce livre est ensuite le fruit de réflexions que suscite de la part de Muriel Montagut le récit des rencontres entre Claude Juin et Jean, ce personnage, comme elle dit, dont la mémoire est privée de honte, et dont on pourrait se demander s’il n’est pas amoral, un peu comme Adolph Eichmann expliquant que si Hitler, le chef légal et légitime, lui avait demandé de tuer son propre père, il aurait obéi.
C’est donc un ouvrage exceptionnel que nous proposent Claude Juin et Muriel Montagut, puisque sur la base d’une expérience très concrète, et dont il est rendu compte très précisément, nous sommes invités à entrer dans la complexité de grandes questions qui touchent aussi bien à l‘histoire et à la politique, qu’aux processus individuels de subjectivation et de dé-subjectivation qui font que certains d’entre nous se révèlent capables de résister au mal, et de le combattre, et d’autres au contraire de s’y livrer.
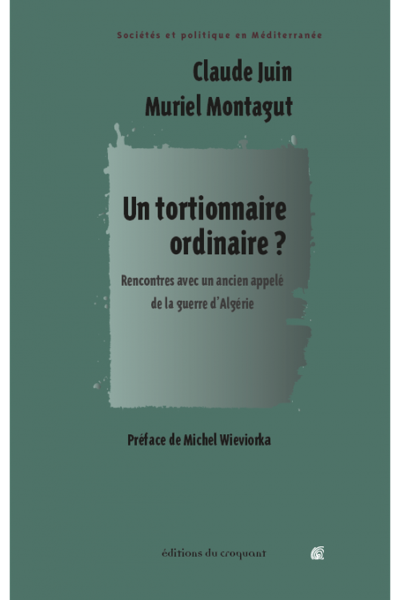
Les auteurs
Claude Juin né en 1935, ancien sous-officier du contingent en Algérie en 1957 et 1958, a publié en 1960 Le Gâchis sous le pseudonyme de Jacques Tissier (Paris, Les Éditeurs français réunis). En mars 2011, il a soutenu à l’EHESS une thèse de doctorat en sociologie : Guerre d’Algérie : la mémoire enfouie des soldats du contingent de laquelle il a tiré un livre : Des soldats tortionnaires. Guerre d’Algérie : des jeunes gens ordinaires confrontés à l’intolérable (Paris, Robert Laffont, 2012). Après son retour de la guerre d’Algérie, il s’était engagé au PSA/PSU et était devenu ami de Daniel Mayer, élu président de la Ligue des droits de l’homme en 1958.
Muriel Montagut actuellement coordinatrice de Centre de soins et de ressources Frantz Fanon à Montpellier (qui vise à améliorer l’accès aux soins psychiques des personnes exilées), est psychologue clinicienne, docteure en sociologie clinique, chercheure associée au Laboratoire de Changement Social et Politique de l’université Paris Diderot.
La torture du silence
par Fabrice Tassel, publié dans Libération, le 12 mars 2012 Source
lors de la publication du précédent livre de Claude Juin, Des soldats tortionnaires. Guerre d’Algérie : des jeunes gens ordinaires confrontés à l’intolérable (Robert Laffont).
Voir aussi cet article sur ce site
Le livre n’avait pas encore paru que le téléphone de Claude Juin sonnait déjà : « Pourquoi tu racontes ces conneries ? T’étais dans quel régiment, hein, dans quel régiment ? » Puis c’est une discussion avec le représentant local de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (Fnaca) qui le rappelle le lendemain : « Claude, il y a le feu dans la baraque : il faut que tu changes le titre de ton bouquin ! » Le titre est resté : Des soldats tortionnaires. Guerre d’Algérie : des jeunes gens ordinaires confrontés à l’intolérable1.
Cinquante ans n’ont pas suffi à apaiser les tourments liés au tabou de la torture pratiquée par certains soldats français. Lui-même sous-officier en Algérie entre mai 1957 et janvier 1958, Claude Juin a voulu briser le silence qui hante la mémoire de bien des appelés, mais aussi de militaires de carrière, sur ce qu’ils ont vu ou commis en Algérie. Des actes souvent à l’opposé de la mission de « pacification » que l’Etat leur avait officiellement, et de façon ambiguë, ordonnée. Il a mené une vingtaine d’entretiens avec des « copains » de la guerre. « L’un deux m’a raconté que sa femme a découvert en 2000 seulement qu’il avait fait la guerre, et c’est loin d’être un cas isolé. »
Trois petits carnets bleus
Dans sa jolie maison des environs de Niort (Deux-Sèvres) entourée de dizaines d’arbres qu’il a lui-même plantés, Claude Juin, 77 ans, yeux vifs et tignasse grise, ponctue certaines phrases d’un long silence. Lui aussi a joué à cache-cache avec ses souvenirs. De 1965 à 2005, il n’a pas ouvert ses trois petits carnets bleus à carreaux, lissés par le temps et couverts d’une fine écriture noire. Durant ses neuf mois en Algérie, le sergent Juin s’est secrètement mué en greffier de la guerre. Comme en ce 21 juin 1957 : « Un autre jour, un prisonnier tombe entre nos mains. Le lieutenant S. s’avance vers lui avec sa MAT [pistolet-mitrailleur, ndlr] et le frappe violemment avec la crosse de part et d’autre de la tête. Le type tombe mort. Assassiné ! »
Quelques semaines plus tôt, Claude Juin n’était qu’un jeune homme banal de 22 ans, originaire de la banlieue parisienne, sans idée claire sur son avenir. Il achevait son service militaire dans une caserne de Coblence, en Allemagne, lorsqu’a sonné l’appel vers l’Algérie. A deux mois de la quille, en route pour Marseille, puis Alger. Comme ses copains, il bascule en quelques jours dans un univers de violence absolument méconnu, tout autant que cette terre ensoleillée « car notre génération ne voyageait pas, nous n’avions aucune image en tête de l’Algérie ».
Ces jeunes gens ordinaires savent vaguement qu’ils doivent mater « des rebelles », « des bandits ». En mai 1957, le mot « terroriste » existe à peine dans le langage officiel. Sur le port d’Alger, l’accueil par des soldats à la ceinture garnie de grenades change d’emblée l’ambiance. Le premier soir, les anciens racontent que « la nuit, on attrape des Arabes et on leur coupe la tête ». Les appelés dorment mal. A peine une dizaine de jours plus tard, au terme d’une patrouille soldée par un affrontement avec des fellaghas, Claude Juin voit, impuissant, un de ses hommes achever d’une balle dans la tête un « fell » blessé. A Claude, qui s’offusque mais qui doit s’incliner devant le feu vert d’un lieutenant, la réplique du tireur claque comme une détonation : « Quand tu auras vu des copains tués, tu réagiras autrement. »
En six mois, le 435e régiment d’artillerie antiaérienne (RAA), auquel Claude Juin appartient, aurait fait « disparaître » environ 2 000 Algériens — hommes, femmes, enfants —, notamment lors des tristement célèbres « corvées de bois » (l’exécution d’un fellagha) commises nuitamment dans la ferme du colon Moll, voisine du baraquement. Le 435e RAA, d’abord basé à 80 kilomètres à l’est d’Alger, finit par être accusé d’exactions massives, et son capitaine est sanctionné par soixante jours d’arrêt. En novembre 1957, le régiment est expédié vers le sud, dans le massif de l’Ouarsenis. « Là-bas, c’était clair, on devait tirer sur tout ce qui bougeait ! » se souvient Claude Juin, qui « n’a jamais torturé, et on ne [le lui] a jamais demandé ». Il pense que ce chiffre de 2 000 Algériens tués est « plausible », et que bien d’autres régiments ont un bilan comparable.
Ces odeurs de sang
En janvier 1958, Claude Juin savoure quelques cannettes de bière sur le bateau qui le ramène à Marseille. Mais comment vivre avec ces récits, ces odeurs de cadavres et de sang, ce goût de cendres après avoir incendié une mechta (« hameau ») ? « Je n’osais pas en parler à ma famille, je ne voulais pas que ma mère ait de la peine », se souvient-il. Difficile, aussi, de raconter à son frère, de quinze ans son aîné et ancien résistant en 1940-45, son combat contre d’autres résistants, algériens cette fois.
Finalement, Claude Juin ne confie ses secrets de torture qu’à son grand-père. Dans la vie de tous les jours ainsi qu’au travail, l’ancien appelé se heurte, comme tant d’autres, à une indifférence teintée de scepticisme que nombre d’anciens appelés comparent eux-mêmes à ce qu’ont vécu les rescapés des camps de concentration. Au mieux l’écoute-t-on poliment, mais pour l’encourager « à oublier tout ça ».« Profite de la vie et des filles ! » entend-il. En métropole, estime-t-il, les habitants n’ont pas eu l’impression que l’Algérie était une « vraie » guerre, avec des canons, du sang et des morts, comme celle de 39-45. La plupart ignorent que 2 millions de jeunes ont été appelés ou rappelés entre 1955 et 1962, que 30 000 ont été tués et 200 000 blessés.
« Les gars » sont rentrés vaincus, sans l’aura des résistants, ce qui ne renforce pas la crédibilité de leurs propos. Militant au Parti socialiste unifié (PSU), Claude Juin raconte dès son retour la torture à Pierre Mauroy, « mais même lui n’y croyait pas trop ». Bien plus tard, en mars 2011, Michel Rocard déclarera « que les politiques ne connaissaient pas à l’époque cette facette de l’action de l’armée française ». « Si, ils savaient, persiste Claude Juin, mais c’était tabou. »
Contrairement à l’immense majorité de ses congénères, Claude s’appuie sur sa vie militante et politique pour briser le silence. Dès 1960, il publie sous le pseudonyme de Jacques Tissier un livre, le Gâchis, version romancée de ses trois petits carnets bleus, vendu sous le manteau à environ 4 000 exemplaires. En raison des risques de censure et de saisie, très peu d’ouvrages dénonçant la torture sont alors rédigés, et seul la Question, écrit par le journaliste communiste Henri Alleg et publié par Jérôme Lindon aux éditions de Minuit, connaît une diffusion d’environ 150 000 exemplaires, grâce à une réédition en Suisse, après la saisie du livre en France (Libération du 9 février).
« La plupart des appelés, une fois rentrés, ont voulu tout oublier et se sont tus. » Une fois le Gâchis écrit et ses tourments temporairement apaisés, Claude Juin, qui a compris qu’il « ne ferai[t] pas de la politique [son] métier », entame une brillante carrière dans les ressources humaines, jusqu’à devenir directeur adjoint de l’ANPE. Il remise ses carnets bleus jusqu’en 2005, année où il décide de se lancer dans l’écriture d’une thèse de doctorat2, encouragé par sa femme psychologue. De ce travail il tirera Des soldats tortionnaires. Ce n’est alors toujours pas simple d’en parler, et d’être compris. Claude Juin a deux fils. « J’ai profité de leur service militaire pour comparer nos expériences. J’aimerais aujourd’hui reprendre le fil de ces souvenirs, mais c’est tellement loin de leur vécu. J’ai peur qu’ils s’imaginent que je baratine un peu, et je crains de troubler leur vie. » Sa belle-fille a lu Des soldats tortionnaires. « Elle m’a dit que c’était bien écrit, mais sans parler du sujet… »
Si la torture a été sa pire expression, la face sombre de l’armée française en Algérie a pris d’autres formes. Dont la plus banale, le racisme. Claude Juin a « fait » l’Algérie avec Bernard, un de ses meilleurs copains à Coblence. On repense aux anciens appelés d’Algérie évoqués dans le magnifique roman de Laurent Mauvignier, Des hommes, paru en 20093. « Bernard a tout de suite exprimé son racisme. Il voulait « bouffer » de l’Arabe, il les frappait en disant : « Regarde ! Il ne sent rien de plus que mes vaches », car c’était un paysan. En fait, il était la victime de tout une politique », confie Claude Juin. Lui qui avait trompé l’ennui en Allemagne en lisant énormément avait commencé, explique-t-il, à dominer ses préjugés. Il savait que Jules Ferry, le père de l’école publique gratuite, avait écrit au sujet du jeune Arabe « que jusqu’à l’âge de 12 ou de 13 ans [il] montre tous les signes d’une vive intelligence, mais à ce moment, il se produit dans son organisation une crise et dans son intelligence un arrêt de développement. Il se marie jeune et il est perdu non seulement pour l’école, mais même, ajoute-t-on, pour la civilisation française4 ».
« Une civilisation supérieure »
« L’essentiel de la troupe était fier d’appartenir à une grande nation, à un empire même ! analyse aujourd’hui Claude Juin. Bernard, encore, disait souvent : « On n’est pas de la même race ! » Nous étions des outils au service d’une guerre coloniale, puisqu’il s’agissait bien de cela sans que jamais l’Etat l’admette. » « Persuadés d’être issus d’une civilisation supérieure », les appelés giflent, raillent. Un jour, ils emmènent un paysan à 10 kilomètres de chez lui juste pour qu’il rentre à pied.
Encore plus tabous que la torture, les viols « ont existé, c’est très probable, estime l’ancien sous-officier, mais les hommes ne s’en vantaient pas ». Un jour, Bernard oblige un gamin de 12 ans à porter une énorme radio de 8 kilos. Claude s’échauffe et les deux copains en viennent aux mains. « J’ai toujours tenté, lors de nos patrouilles, d’aller vers les gens, de leur serrer la main, de boire le café. Je sais que cela troublait les gars, au moins ils y réfléchissaient un peu », se console Juin. Mais le plus souvent, il encaisse, impuissant, mais aussi pragmatique : il s’inquiète de la suppression possible de sa permission libérable s’il conteste trop les ordres. Cela n’empêche pas « le vieux », son supérieur, de finir par l’engueuler, lui reprochant de vouloir trop comprendre les autochtones. Car les militaires de carrière supportent mal de perdre une troisième fois, « après la défaite de 1940 et l’Indochine ». Lorsque Claude Juin rend son paquetage, un officier lui tend son livret militaire en lui disant : « Toi, c’est sûr, tu ne seras jamais rappelé. » « J’étais si content ! » se souvient l’ex-sous-officier.
Il y a quatre ans, Claude Juin est retourné en Algérie. Il a croisé le maire du village où était basé son régiment. Son père a été tué pendant la guerre. « Cela m’a fait drôle, c’était peut-être nous… Puis l’homme a ajouté, fataliste : “Que voulez-vous, c’était la guerre…” »
Extraits du dialogue de Claude Juin avec « Jean »
— Tu vois, à la page du 12 juin 1957, j’ai écrit une phrase que je lis lentement, il s’approche, il est à côté de moi, il regarde mon carnet par dessus mon bras :
« Hier soir, exécutions de quatre suspects. Jean (je lis son nom de famille) leur tenait la tête avant qu’elle ne soit tranchée, le sang coulait inondait ses mains »
[…]
— C’était l’ambiance. Il fallait bien supprimer les bougnoules, on avait peur qu’il nous tuent dans les embuscades.
— Tu penses à tout ça, tu regrettes ?
— Je ne sais pas. C’était l’ambiance. C’était comme ça.
[…]
C’était l’ambiance. Et puis c’était le sous-lieutenant qui nous poussait à faire tout cela. Et c’était C… qui les exécutait…
[…]
Il y avait toujours cinq ou six fellaghas dans la cave. On les passait à la “magnéto”, avec les fils dans les couilles, dans la bouche… Ils faisaient des bonds sur la table. Pour qu’ils avouent… Même ceux qui avouaient sous la douleur, on savait qu’ils nous racontaient des histoires…
[…]
On ne les relâchait pas. Ils allaient directement à l’abattoir…
[…]
Nous faisions des patrouilles dans les rues, en file indienne, le dernier marchait à reculons, sa mitraillette armée et pointée, pour nous protéger. Dès qu’il apercevait un Arabe suspect derrière nous, il tirait et l’abattait. Les gars en arrêtaient chez eux au cour des fouilles. Ils les emmenaient au poste, et après les interrogatoires ils les tuaient à l’arme blanche.
[…]
— Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, tu as bien confirmé que toi tu assistais à la ferme Moll aux tortures et aux exécutions… Que tu étais présent ?
— Une seule fois, j’y étais, on les emmenait sur la plage, ils étaient tués à l’arme blanche, c’était C… qui le faisait… et le sous-lieutenant F… qui donnait les ordres…
[…]
C’était l’ambiance. Tu étais pris par l’ambiance. Tu n’étais pas grand-chose. Il fallait suivre. Ce n’était pas moi qui commandais, c’était le lieutenant.
Comment faire justice
sans passer par le tribunal ?
L’expérience de la justice transitionnelle
par Gilles Manceron
Claude Juin avait connu Jean en décembre 1955 lorsqu’ils faisaient, à 20 ans, leur service militaire en Allemagne et ils avaient alors sympathisé. Puis, quand leur régiment a été envoyé en Algérie, leurs relations se sont modifiées dès que Jean a participé à des actes barbares, à des tortures et des exécutions sommaires. Plus de cinquante ans après leur retour d’Algérie, incité, en 2011, par le président du jury de sa thèse, Guerre d’Algérie : la mémoire enfouie des soldats du contingent, Vincent de Gaulejac, et par Michel Wieviorka, le directeur de sa thèse, Claude Juin a voulu revoir Jean pour qu’il lui dise ce qu’il pensait de ce qu’il avait fait : avait-il des regrets ? avait-il honte ? Et dans le livre Un tortionnaire ordinaire ? Rencontre avec un ancien appelé de la guerre d’Algérie qu’il a publié en 2019, il a relaté leurs trois rencontres étalées sur dix-huit mois.
Un dialogue qui doit interpeler la société française
Ce livre est écrit avec la psychologue clinicienne Muriel Montagut, qui s’attache à décrypter le fait que Jean a conservé la mémoire de ses actes, qu’il ne les nie pas, mais qu’il n’en éprouve aucune honte. Son étude conclut à la dilution de sa responsabilité dans le contexte de l’époque, dans ce qu’il appelle « l’ambiance ». Elle le qualifie de tortionnaire « absent à lui-même ».
Mais c’est sur une autre question que ce texte veut se situer. Alors que Jean a relaté ses crimes et ne s’en sent pas coupable, aucune institution française aujourd’hui ne les qualifie, ne lui demande de reconnaître que c’était des crimes. Claude Juin lui-même, pour le faire s’exprimer à leur sujet, s’est abstenu de lui dire ce qu’il en pensait. Au terme de leur troisième entretien, il n’avait plus rien à lui dire. Dans cette autre « ambiance » qui est celle de la France postcoloniale du XXIe siècle, il n’a pu s’appuyer sur rien pour formuler une condamnation publique. Il a sollicité son autorisation de publier le livre, il a changé son prénom et il n’y a mentionné ni lieu, ni patronyme qui permettrait de l’identifier. Les choses en sont restées là.
Vu le silence, depuis plus d’un demi-siècle, des institutions françaises sur ces crimes commis alors par des hommes placés sous leur autorité, son attitude était la seule possible. Exprimer son avis personnel n’aurait conduit à rien. Mais cette situation peut-elle satisfaire la société française du XXIe siècle ?
Les amnisties
Ces actes sont couverts par l’amnistie. Aucune poursuite judiciaire n’est possible à leur sujet. Et, contrairement à d’autres amnisties qui, en Amérique latine, ont été remises en cause pour permettre le châtiment de criminels, cette amnistie-là, qui a évité que le terrorisme des jusqu’au-boutistes de l’Algérie française ne débouche sur une guerre civile en France, fait partie de l’histoire et il serait absurde de la remettre en cause pour condamner et punir, plus de cinquante ans plus tard, quelques « sous-fifres » encore vivants.
Mais n’y a-t-il pas des moyens, néanmoins, malgré cela, de « dire la justice » ?
L’expérience de l’Afrique du Sud
Pour mettre fin au système d’apartheid et écarter le risque d’une guerre civile, l’Afrique du Sud a eu recours, avec la Commission Vérité et Réconciliation, à un processus différent de l’amnistie générale, comme il y en a eu une en France pour les crimes de la guerre d’Algérie, qui dispense, de manière indistincte et automatique, les criminels de tout jugement et de toute condamnation. L’Afrique du Sud a voulu éviter cette « politique de l’oubli » qui a le grave inconvénient d’être aussi une « politique de l’impunité ». Le bénéfice de l’amnistie n’a pas été accordé de manière automatique aux auteurs de graves violations des droits de l’homme pendant la période de l’apartheid, mais accordé acte par acte, à la condition qu’ils reconnaissent pleinement (full disclosure) les faits criminels qu’ils ont commis et s’inscrivent dans le processus de réconciliation.
Puisqu’il y a eu une amnistie générale en France après les Accords d’Evian (amnistie encore renforcée par la suite), le recours au processus sud-africain est exclu. Mais peut-être y a-t-il dans ce processus des éléments dont la France pourrait s’inspirer pour mettre fin aux « poches de silence » et aux « poches d’impunité » créées à la fin de la guerre d’Algérie.
Les principes de la justice transitionnelle
Dans le livre Réparer l’injustice : l’affaire Maurice Audin, dirigé par Sylvie Thénault et Magalie Besse, cette dernière explique que la justice transitionnelle dépasse le seul cas de l’Afrique du Sud et qu’elle est définie par les Nations Unies comme « l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation ». Elle est compatible avec l’absence de condamnation pénale des criminels de guerre si des mesures d’amnistie ont été prises pour mettre fin au conflit, mais implique un processus de « Vérité et Réconciliation » comportant une reconnaissance des crimes, une prise en comte des victimes et un travail sur la mémoire.
La justice transitionnelle repose sur trois piliers, dégagés par Louis Joinet dans son Rapport destiné à lutter contre l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme : les droits à la vérité, à la justice, à la réparation, qui appartiennent autant aux victimes qu’à la société concernée dans son ensemble. Elle « s’inscrit dans la perspective du droit à la vérité, mais aussi du devoir de mémoire, qui en est le corollaire », et du droit à la réparation du préjudice résultant des violations commises.
Si le recours au principe de la justice transitionnelle s’impose suite à une dictature, il peut peut-être aussi s’appliquer d’une certaine manière dans des démocraties lorsque des violations graves des droits de l’homme n’ont pu être traitées par les voies judiciaires en raison de la prescription et de l’amnistie. C’est le cas pour les violations commises en lien avec la guerre d’indépendance algérienne par des hommes appartenant aux forces de l’ordre françaises.
Il existe au sein de la démocratie française une « poche d’impunité », irréductible, depuis plus de cinquante ans concernant les violations des droits de l’homme commises durant la guerre d’Algérie. L’amnésie — celle des individus comme celle des institutions —, qui est une conséquence de l’amnistie, est la pire des choses. Elle élude l’établissement de la vérité (pour laquelle l’accessibilité des archives est un enjeu central) qui est le socle indispensable de la réconciliation et de la reconstruction.
La société française postcoloniale doit trouver les moyens de « sortir du colonialisme », ce qui implique, même si ce n’est pas dans le cadre des tribunaux, que ses institutions puissent « dire la justice » sur les crimes commis alors par des membres de ses forces de l’ordre.
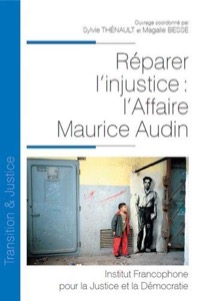
Voir cet entretien de Sylvie Thénault au quotidien El Watan