La volonté de réécriture de l’histoire coloniale dans une optique de réhabilitation s’est indéniablement développée ces derniers temps, en réponse aux prises de conscience partielles de l’opinion, que révèlent le débat sur la torture durant la guerre d’Algérie et le vote de la loi dite Taubira à propos de la mémoire de l’esclavage.
Révisionnisme ou négationnisme ?
Rien de vraiment nouveau quant aux thèmes : depuis de nombreuses années l’universitaire Bernard Lugan expose que « la colonisation fut une chance historique pour l’Afrique noire qui n’a pas toujours su la saisir » (Afrique, histoire à l’endroit, Perrin, 1989) et d’autres s’évertuent à conjurer les souvenirs de leur jeunesse anticolonialiste en répétant à satiété leur grande découverte : « la France n’a tiré aucun profit de son empire colonial ». On a longtemps dénoncé leur « révisionnisme » parallèle à celui des négateurs des massacres nazis, terme impropre, puisqu’il est dans la fonction de l’historien de réviser le récit historique quand l’apport de sources nouvelles exige de le faire. C’est de « négationnisme » qu’il s’agit : sous prétexte de relire le passé, ce type de lecture met en doute les camps d’extermination de 1943 ou les crimes commis et avérés au nom de l’ordre colonial. Rien de plus antiscientifique que cette attitude qui nie ou déforme les faits pour un objectif idéologique tacite réactionnaire ou d’extrême droite.
Le négationnisme colonial originel
En fait, les auteurs négationnistes actuels en histoire coloniale se contentent de répéter les arguments développés par les partisans de l’expansion française outre-mer, dès le départ. Rappelons que la France s’est lancée dans l’aventure coloniale il y a au moins trois siècles et que cet empire colonial a reposé, dès le départ, sur l’esclavage et la traite des esclaves arrachés à l’Afrique et exportés vers les plantations sucrières des îles d’Amérique tropicale, préalablement dépeuplées de leurs populations caraïbes. Dès le départ, l’entreprise a trouvé ses justifications dans la nécessité économique, dans la mission religieuse, dans le racisme.
En 1680, l’évêque Bossuet apportait au trafic esclavagiste l’appui de la théologie catholique : « condamner l’esclavage, ce serait condamner le Saint Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état et n’oblige point les maîtres à les affranchir ».
Un siècle après, en 1750, Savary des Bruslons, dans son Dictionnaire universel de commerce, définit ainsi le mot « nègre » :… « Ces misérables esclaves trouvent ordinairement leur salut dans la perte de leur liberté… l’instruction chrétienne qu’on leur donne, jointe au besoin indispensable qu’on a d’eux pour la culture des sucres, des tabacs, des indigos, etc., adoucissent ce qui paraît inhumain dans un négoce où des hommes sont les marchands d’autres hommes et les achètent, de même que des bestiaux, pour cultiver leurs terres. »
Un siècle plus tard, après que la Révolution française eut proclamé les Droits de l’Homme et même avorté d’une première abolition de l’esclavage aux colonies, alors que le peuple de Saint-Domingue avait arraché par les armes sa liberté et proclamé la République d’Haïti, l’esclavage était encore la règle en 1848 en Martinique, Guadeloupe et Réunion. Les défenseurs de l’esclavage ne manquaient pas en France et ce sont en partie leurs arguments que l’on retrouve dans les « démonstrations » de nos négationnistes contemporains. Deux exemples illustreront l’étonnante permanence de l’argumentaire.
En 1820 paraît le Voyage de Sénégambie de Gaspard Théodore Mollien, l’un des premiers et l’un des meilleurs récits français d’exploration en Afrique occidentale. Mollien justifie l’esclavage des Africains avec un argument largement répandu déjà et appelé à se répandre encore : « La vue de ce village me prouva combien était sans fruit pour l’humanité le principe généreux qui, en Europe, porte des philanthropes à provoquer l’abolition de la traite des nègres. Ceux-ci peuvent-ils goûter quelque bonheur dans leur pays, sous le joug de princes qui peuvent, à chaque instant, les enlever à leur famille, à leur patrie, les vendre ou les faire égorger, suivant leur caprice. »
Les Réflexions sur les colonies, d’un certain Foignet, éditées à Paris en 1831, décrivent aux Antilles françaises une sorte d’eden esclavagiste avec un tel luxe de détails que le tableau mérite d’être cité : « J’en appelle à toutes les personnes impartiales qui, depuis dix ou vingt ans, ont visité nos Antilles. Elles diront comme moi que les Noirs sont mieux vêtus, mieux nourris, mieux logés ; que la journée de travail est moins prolongée qu’en Europe ; que leurs heures de repas, plus un jour entier par semaine, leur sont exactement accordés, pour les mettre à même de cultiver le jardin qu’on donne à chacun d’eux, et soigner le bétail qu’on leur permet d’élever ; que les samedis, les jours de marché et dimanches, ils sont libres d’aller vendre leurs petites denrées et de se livrer à leurs plaisirs habituels, la danse surtout, qui se prolonge ordinairement jusqu’au lendemain matin. Le plus léger service rendu dans ces jours est généreusement payé par le maître. Ils achètent presque toujours ce que leurs esclaves n’ont pu vendre au marché. Aussi, excepté aux heures de travaux où, par une ancienne habitude, ils sont à peine vêtus, voit-on les Noirs habillés avec une propreté, une recherche et l’on pourrait dire avec un luxe de bijoux qui annoncent leur aisance, de même que leur belle santé et leur joie démentent toutes les absurdités qu’on débite sur leur compte. »
Dans la France laïcisée de 2005, on n’utilise guère la défense de l’esclavage selon Bossuet. Mais ces textes de 1820 et de 1831 pourraient être signés de Messieurs Lugan et quelques autres, nos négationnistes du XXIe siècle.
Négationnisme colonial à l’université
L’Université n’est évidemment pas à l’abri de cette vague ; elle a subi, elle aussi, de plein fouet le délitement des idéologies progressistes et révolutionnaires succédant à l’effondrement de l’univers soviétique, comme l’ensemble des sociétés occidentales. J’ai cité tout à l’heure Bernard Lugan, universitaire à Lyon-III, mais aussi militant du parti fasciste MNR : il est très présent dans de nombreuses revues, stations de radio comme Radio-Courtoisie ; souvent présenté comme spécialiste de l’Afrique et du Maghreb, il a été très lié aux partisans de l’Apartheid en Afrique australe. Ses nombreux livres défendent une version très précise de l’histoire de l’Afrique : les difficultés actuelles de l’Afrique viennent selon lui de la décolonisation, succédant aux progrès de la période coloniale. Les responsabilités de l’Occident sont inventées par de méchants « tiers-mondistes » ; les avatars de l’histoire en Afrique, guerres, famines, etc. sont exclusivement de la faute des Africains, dont les conduites sont liées à leurs divisions en ethnies multiples et ennemies. Le mot « race », trop sulfureux, est absent, mais c’est bien d’une explication du cours de l’histoire par les caractéristiques ethniques, génétiques, qu’il s’agit.
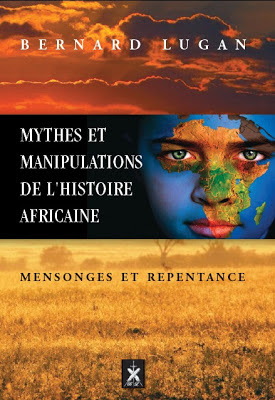
Dans son livre le plus connu, L’Afrique, l’histoire à l’endroit, Lugan parle abondamment de la traite et de l’esclavage. Dans le chapitre VII (« quand les Noirs vendaient d’autres Noirs »), il insiste sur tout ce qui peut évacuer les responsabilités du mécanisme colonial : « l’esclavage a toujours existé en Afrique… Les Européens n’ont fait que détourner à leur profit une large part de cette pratique africaine traditionnelle » (p. 127). Il dénonce comme « première erreur » que la traite atlantique ait résulté d’une sollicitation extérieure (p. 130), comme « autre idée reçue, celle des profits tirés de la traite » (p. 133), réfute l’idée d’une ponction démographique dommageable en Afrique (« beaucoup moins que les pertes européennes lors des grandes épidémies de peste », p. 135), tout cela pour aboutir à la conclusion suivante : « le retard de l’Afrique n’est pas dû à la traite… l’abolition ruina les États structurés de l’Ouest africain… Les Africains perdirent subitement leur unique source de revenus. La fin de la traite provoqua même leur effondrement » (p. 140) ! Ce qui revient à affirmer que la colonisation esclavagiste, sans profit pour les négriers, fut tout bénéfice pour ses victimes. Lugan ne s’embarrasse guère de logique. Tout attaché à démontrer l’innocuité de la traite faite par des Européens, il insiste beaucoup sur l’importance et le rapport de celle pratiquée par des Arabes à l’est du continent, en faisant d’ailleurs de l’Islam la cause de ce trafic, dans un chapitre VIII intitulé « L’Afrique noire, vivier humain des musulmans ». Ce qui lui permet de justifier « la conquête coloniale (sans laquelle) des millions de noirs auraient continué à prendre le chemin des marchés d’esclaves » (p. 155). Comme si les crimes des uns excusaient en quoi que ce soit ceux des autres…
Bernard Lugan n’est pas qu’un des éléments les plus efficaces de ce « noyau dur » bien connu qui a donné une fâcheuse célébrité à l’université Lyon-III. Il est aussi vulgarisateur et publie une revue par abonnement, l’Afrique réelle. Le numéro 33 de l’automne 2001, à côté de diatribes contre la conférence de Durban (« grotesque mascarade…, gigantesque défouloir…, appel à la haine contre les Européens et les Israéliens »), à côté de l’article d’un lieutenant-colonel Montaner niant le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961, contient un dossier de 23 pages, « Vérités et légendes sur l’esclavage », signé Bernard Lugan. Les arguments avancés sont exactement les mêmes que dans le livre déjà cité, agrémentés d’images chocs et actualisés par des citations, avec d’ailleurs les mêmes contradictions, puisque Lugan dénonce avec force la traite orientale « arabe » à la fois dévastatrice et « profitable », alors que celle conduite en Atlantique ne fut, selon lui, ni l’une ni l’autre.
Le négationnisme colonial à l’usage du grand public
Si le milieu universitaire français est en fait plus gravement contaminé par les nostalgies coloniales que ne semble le montrer la fixation de la presse sur la seule université de Lyon-III, ses publications, confinées à un public somme toute restreint en nombre, ne sont pas l’essentiel : elles ne forment que la partie émergée de l’iceberg. L’essentiel de la campagne négationniste qui se déploie aujourd’hui en matière coloniale taraude le grand public par le biais d’ouvrages de vulgarisation, voire de récits romancés autobiographiques ; la qualité littéraire est souvent absente, mais l’édition et la distribution étant en France ce qu’elles sont, ces ouvrages sont présents dans les librairies de quartier et les kiosques de gare et se vendent à des dizaines de milliers d’exemplaires, quand les publications scientifiques plafonnent à 200 ou 300 pour la plupart. Le constat est le même pour les articles, les dossiers sur la colonisation qui fleurissent dans nombre de magazines grand public et qui répandent souvent des visions réductrices et plus qu’édulcorées de l’histoire coloniale : un véritable « négationnisme du pauvre », qui sait utiliser les références universitaires à titre de caution, mais dépasse largement les débats feutrés qui agitent les amphithéâtres.
Le phénomène n’est pas récent ; il s’est développé dès la décennie 60 à 70, parallèlement à la décolonisation. Le grand ancêtre en la matière se nommait Jean Lartéguy, qui multiplia les best-sellers, récits d’aventures exotiques aux quatre coins du globe, bâtis grâce à quelques ficelles littéraires en usage depuis Eugène Sue: une action hachée de retournements, un scénario très inspiré de l’actualité, des révélations qui trouvent leur source dans les services de renseignements, des scènes érotiques pimentant le récit. La forme explique le nombre de lecteurs et permet de diffuser à grande échelle une idéologie très claire, par exemple dans Les chimères noires (Presses de la cité, 1963), lecture raciste de la décolonisation du Congo, glorification des mercenaires blancs du Katanga :
« Le Congo, c’est un rassemblement invraisemblable d’ethnies et de clans dont aucun ne parle la même langue et qui, tous, rêvent de s’étriper au nom de vieilles querelles dont l’origine se perd… dans la nuit des temps… Les belges avaient cru tout arranger en baptisant indistinctement ces anciens anthropophages du nom rassurant de « pupilles ». Ils considéraient que l’âge mental de ces nègres ne dépassait pas douze ans et qu’avec des soins éclairés – les leurs – ils mettraient au moins un siècle à devenir adultes. En vertu de ce principe, ils leur avaient donné une éducation intellectuelle et technique qui ne dépassait pas ce niveau. Ce fut à ces enfants qu’un beau jour, sans précautions, ils accordèrent l’indépendance ! Les nègres se sont conduits comme des enfants de douze ans. Pour se venger de leurs maîtres, ils violèrent les femmes blanches et firent quitter leurs chaussures aux hommes. On a beaucoup parlé des viols, pas assez des godasses. Pour tous les pupilles, le symbole de la puissance du Blanc, c’était ses chaussures. Le premier achat que faisait un Noir évolué, c’était une paire de souliers ! Il marchait en canard, elles lui faisaient mal aux pieds, mais il avait gravi un échelon…
« Seulement, à la moindre incartade, on lui faisait quitter ses godasses et mettre les bras en l’air. Devenu indépendant, il a voulu faire la même chose : humilier le Blanc en lui faisant perdre la face. Il l’a d’abord obligé à quitter ses godillots, puis à mettre les bras en l’air et enfin il a violé sa femme » (p. 29).
Le même filon a été repris depuis trente-cinq ans par Gérard de Villiers, avec la parution mensuelle de ses SAS chez Plon. Une excellente affaire, des lecteurs par millions, pour cette incroyable série dont le héros est un aristocrate baroudeur et « surmâle » au service de la CIA. Le secret du succès tient aux liens de l’auteur et de son équipe avec les services secrets et ses informations sur l’actualité sont souvent de meilleure qualité que celle des quotidiens. Les pays d’Afrique et leur mouvements et gouvernements progressistes ont fait souvent l’objet de SAS.
– Mourir pour Zanzibar (1973) s’en prend au régime de Kenyatta en Tanzanie, dont les deux mamelles sont « la nationalisation des noix de coco et la liquidation de la communauté hindoue ». Les Noirs au pouvoir y sont décrits comme des abrutis analphabètes, manipulés par les Chinois.
– Compte à rebours en Rhodésie (1976) pourfend les mouvements de libération du Zimbabwe et du Mozambique au profit du raciste Ian Smith.
– Le trésor du Négus (1977) décrit le gouvernement révolutionnaire de l’Éthiopie comme « inspiré des principes d’Ubu et de Kafka ».
– Dans Panique au Zaïre (1978), le pro-occidental Mobutu est menacé par des opposants à la solde de Moscou et des Cubains.
– Des armes pour Khartoum (1981) décrit le régime Nimeiry, loué pour avoir massacré les communistes soudanais, menacé de déstabilisation par la Libye et Cuba.
– Dans Commando sur Tunis (1982), « un plan de déstabilisation de la Tunisie » pro-occidentale est « en cours de réalisation », mené par l’Algérie et la Libye.
– Putsch à Ouagadougou (1984) décrit les crimes supposés du régime Sankara, entouré de « dangereux salauds ». Il affirme au passage que « 90 % de la population est contre Sankara » qui règne par le meurtre, multiplie la pauvreté en prétendant combattre « le monstre né de l’union de l’impérialisme et du colonialisme ».
– La blonde de Pretoria (1985) dénonce l’ANC, « le groupe terroriste le plus virulent d’Afrique australe », ses dirigeants, parmi lesquels Joe Slovo (« Joe Grodno »), « ancien du Kominterm, un homme redoutable » qui utilise « le prétexte de libération de deux leaders anti-apartheid pour déstabiliser l’Afrique du Sud ».
Les SAS poursuivent aujourd’hui leur carrière. Tous les mois, les mêmes ingrédients, la même idéologie, les mêmes révélations sur les points chauds de l’actualité ! L’un des derniers, Otages en Irak, affirme que « l’islam n’est définitivement pas soluble dans la civilisation » ; le racisme y pimente l’érotisme, quand le héros côtoie « une authentique salope orientale ».
Même des livres sérieux, à dimension universitaire, ne s’interdisent pas de glisser au fil des pages un message qui relève de la réhabilitation du mécanisme colonial. Ainsi, dans l’ouvrage de Daniel Lefeuvre issu de sa thèse, publié sous le titre volontairement ambigu de Chère Algérie 1930-1932 (Ed. SFHOM, 1997), les faits cités sont organisés vers des conclusions qui constituent la thèse de l’auteur, que l’on peut discuter, mais qui sont les éléments d’un débat scientifique. Par contre, la préface de Jacques Marseille assène une série d’affirmations péremptoires qui, telles quelles, relèvent strictement du parti pris idéologique : « La France a plutôt secouru l’Algérie qu’elle ne l’a exploitée… » « L’immigration algérienne n’a correspondu à aucune nécessité économique »… Contrairement à une idée généralement répandue, la main-d’œuvre était plus chère en Algérie qu’en France »… Tout cela en une page.
La période récente a vu la publication de nombreux ouvrages traitant de la guerre d’Algérie. Les plus lus ne sont pas les plus gros ni les plus chers. Le plus vendu – parmi les livres historiquement fiables – est La guerre d’Algérie de Pierre Montagnon (Ed. Pygmalion), réédition en 2004 d’un texte de 1984. L’auteur place d’emblée son récit sous l’égide du 2e REP, le régiment de la légion qui fut le fer de lance de tous les soulèvements militaires. Il y était capitaine, et fut l’un des dirigeants de l’OAS. Paradoxalement, si Montagnon ne cache pas ses choix politiques, l’approche événementielle est plutôt conservatrice et consensuelle.
Plus virulent est le discours de Raphaël Delpard dans Les oubliés de la guerre d’Algérie (éd. Laffont, 2003), en promotion à 12 euros dans toutes les grandes surfaces. Le livre est une succession d’exagérations dont on ne peut citer que quelques-unes, concernant notamment les Français prisonniers du FLN : « Durant leur détention, soumis à des épreuves inhumaines que les nazis n’auraient pas désavouées, ils furent parqués dans des grottes, des trous insalubres, vivant dans le noir absolu. Entassés à quinze, parfois plus, dans des pièces de trois mètres sur quatre privées de lumière. Couchant à même le sol, se partageant une couverture pour deux, restant des mois sans pouvoir se laver. Des prisonniers ont été torturés, enchaînés comme du bétail, utilisés à des travaux de bagnards, obligés d’enterrer les camarades assassinés, subissant chaque jour d’odieux sévices ou fouettés jusqu’à l’évanouissement » (p. 2).
Le négationnisme des témoins
La période récente a vu fleurir une série d’ouvrages qui se veulent des témoignages, à commencer par Toute une vie d’Hélie de Saint-Marc (éd. les Arènes et France-Inter 2004). Ici encore, le livre est assuré d’une promotion avantageuse dans les supermarchés, avec un CD en cadeau. L’auteur fut successivement résistant, déporté à Buchenwald, puis officier de l’armée et enfin animateur de l’OAS. Et tout cela, bien sûr, constitue « la même histoire », justifiée par la même rigueur morale, selon le commentaire de l’éditeur en quatrième de couverture.
D’autres témoignages sont plus virulents encore. Ainsi en est-il de Jean-Paul Angelelli (Une guerre au couteau, Algérie 60-62 , éd. Picollec, 2004), un auteur, pied-noir, qui fut membre actif de l’OAS. Ce livre a été écrit en 1962-63, refusé par l’édition de la Table Ronde, puis par bien d’autres. Il est édité aujourd’hui, après le débat sur la torture. Jean-Paul Angelelli ne nie rien. Au contraire, il décrit et revendique les faits pour lesquels Aussaresses a été condamné. Je me contenterai d’un extrait, mais on peut, dans les 320 pages, en relever des dizaines de la même teneur :
« La mechta (ce qu’il reste) est livrée au pillage, les cadavres sont dénudés et adossés au mur de façon ”à leur tirer le portrait” pour les archives. Je n’ose pas risquer une suggestion au lieutenant, mais s’il n’avait tenu qu’à Calatia et moi, nous aurions attaché Saad derrière une jeep et nous l’aurions trimbalé autour du village ou pendu sur place, la tête en bas, en forçant la population à défiler devant lui. Rythen vient d’arriver. Il a des principes et peu de goût pour ces spectacles corsés qui sont pourtant très “psychologiques”. Ce chacal de Saad fut enseveli par une corvée de requis de force qui n’en finissaient pas de frissonner en tassant la terre sur le cadavre, mais c’était de froid. Les filles vont passer quelques nuits à la gendarmerie où les harkis se feront un plaisir de leur procurer les émotions dont elles ont été frustrées. »
A ce niveau, il ne s’agit plus de négationnisme, mais d’apologie de crimes de guerre, si l’on se réfère aux termes des conventions internationales.
Autre exemple, l’ouvrage de Roger Soncarrieu (Ma vérité sur la guerre d’Algérie, éd. Page après page, 2004). Après le débat sur la torture, l’auteur dit réagir « devant l’accumulation des mensonges » pour « rétablir la vérité » que voici : « En Algérie, le nombre de morts civils, exécuté par l’Armée de libération nationale, se chiffre à plusieurs dizaines de milliers. Les harkis exécutés après l’indépendance ? Quatre-vingt mille selon les uns, cent cinquante mille selon d’autres. Dans la balance des tortures et des exactions, les quelques cas de “tortures” de l’armée française sont sans doute quantités bien négligeables. L’épisode tant décrié de la “bataille d’Alger” avait permis, dois-je le rappeler, la récupération d’une centaine de bombes. Pour un certain nombre d’officiers, le choix entre un interrogatoire quelque peu “musclé” et la mort de dizaines d’innocents était donc assez vite fait… Nous avons tout laissé : constructions, écoles, hôpitaux, routes, agriculture, richesses pétrolières. L’Algérie prospère des années 1960 est devenue aujourd’hui un pays sans travail qui ne survit pratiquement que grâce à son sous-sol. »
On peut trouver l’expression de ce courant négationniste également dans des romans historiques destinés au grand public, chez certains éditeurs spécialisés comme les Presses de la Cité. Ainsi, la saga des colons boers du Sud-Africain, Wilbur Smith, Le dernier safari, réédité plusieurs fois, apologie de l’apartheid et de ses dirigeants, vient d’être réédité en 2004.
Le négationnisme par les revues
C’est enfin par le biais de multiples périodiques que passe le message. Des revues à prétentions historiques d’abord. La Nouvelle Revue d’Histoire, à la présentation luxueuse, en est déjà à son 17e numéro. Vendue six euros – donc bien en deçà de son coût de fabrication –, elle est animée par des idéologues de la droite extrême, comme Dominique Venner et Jean Mabire. Son numéro de mars-avril 2005 multiplie les angles d’attaque. Il réécrit d’abord aux couleurs négationnistes l’histoire de la guerre d’Espagne : « La guerre commença en 1934 et fut décidée, consciemment et délibérément, par les principaux partis de gauche… Le franquisme a libéré l’Espagne de la révolution, de la guerre mondiale et de la pauvreté… » Dans le cadre des États-Unis d’Amérique, la guerre de Sécession est définie comme la conquête du Sud idyllique par le Nord yankee, industriel, brutal et barbare : l’esclavage n’a été, selon les auteurs, qu’un « prétexte de propagande ». Aucune allusion, bien sûr, aux soldats noirs qui ont combattu pour l’abolition au sein de l’armée de l’Union. Et dans ce même numéro, Bernard Lugan, à propos du grand massacre rwandais de 1994, exonère de toute responsabilité le pouvoir français de Mitterrand, lui reprochant seulement de ne pas avoir vu à quel point « tout placage démocratique » est absurde en Afrique, face à des haines qui n’ont d’autre origine que raciale : pour Lugan, la seule explication de l’histoire africaine est « ethnique ».
Une autre revue d’histoire, L’histoire mondiale des conflits, a publié un numéro spécial (n° 7 de janvier-février 2005) sur la guerre d’Algérie qui réunit tous les poncifs négationnistes sur le sujet. Un certain Philippe Richardot y met par exemple en exergue « l’aide apportée au FLN par des réseaux allemands pro-nazis et anti-français », ajoutant que « le Bloc de l’Est fournit également des armes, mais pas dans une proportion aussi importante ». Il assimile, en outre, le conflit algérien à « une guerre terroriste ethnique contre les colons français », mais aussi à « une guerre de religion contre les chrétiens dont les cathédrales seront rasées après l’indépendance ». Il conclut qu’« en France est cultivée la mémoire de la “sale guerre” et de la torture. La torture du côté français est une réalité, mais n’a pas eu l’extension systématique qu’on lui prête ».
Dans le même numéro, un certain Bernard Cabanes explique la formation du FLN par le parrainage de Nasser et de ses proches, définis comme un « groupe d’officiers égyptiens, nostalgiques panarabes du IIIe Reich qui a lui-même renversé le roi Farouk ». Le soulèvement de 1954 devient ainsi le fruit de « l’islamisme, sous sa forme panarabe, a adhéré au discours “impérialiste” et antisémite du IIIe Reich ». Apparenté ainsi au nazisme et à l’islamisme, par un anachronisme audacieux, le mouvement national algérien n’a grandi selon l’auteur que par la terreur qu’il exerce. Je cite :
« Fondé à l’étranger, développé par des idéologues manipulés de l’étranger, le FLN n’a pas initialement de prise sur la population qu’il se propose de “libérer”. La loi étant faite par des “mécréants”, le FLN n’a qu’un recours : la terreur. Le FLN interdit de boire et de fumer. Ses membres coupent le nez et les lèvres des fumeurs et buveurs. Ils mutilent les innocents et les passifs pour forcer le peuple à se soumettre aux interdits et au racket. Les mutilés porteront le message. »
Après l’indépendance, le FLN continue à exercer la terreur sur le peuple algérien : « les camps ouverts par le nouveau parti unique, sur le modèle des goulags, ne sont pas des camps de rééducation, mais d’extermination, destinés aux “valet de l’impérialisme”, mais aussi aux “impérialistes” qui n’ayant pas choisi “la valise” ont gagné le “cercueil” pour eux et leur famille ».
La percée négationniste s’est déployée aussi dans des revues de vulgarisation scientifique ou d’actualité, en des lieux parfois inattendus. Science et Vie a publié fin 2004 un hors série sur « l’Algérie 1954-62, la dernière guerre des Français ». Les articles formant ce dossier sont de qualité inégale, mais on y trouve en préalable une orientation ouvertement négationniste. « Dès le début, les moyens de ces hommes du FLN ont été affreusement violents, leur objectif aussi : épurer l’Algérie de son million d’Européens… De Gaulle a laissé les clés de l’Algérie au FLN, désireux de fermer coûte que coûte ce qu’il appelait “la boîte à chagrin”. Peut-être pouvait-il faire autrement. De toute façon, ce sont les Algériens qui ont payé le gros de la note : d’une seconde guerre civile. Mais de Gaulle n’est pas qu’un rêveur de grandeur pressé de tout lâcher. » Après ce discours introductif qui ressemble à ceux de l’OAS de 1960, les sous-titres accrocheurs renvoyant dos à dos les protagonistes paraissent anodins (« terreur contre terreur, Algériens contre Algériens… les crimes de l’OAS sont la réponse absurde, désespérée, aux crimes racistes et xénophobes commis durant sept longues années par le FLN »).
La contagion des nostalgies coloniales atteint même des secteurs de l’opinion qui devraient être immunisés contre elles. Le 25 décembre 2004, la revue Marianne publiait un numéro spécial, intitulé : « Il y a 50 ans, une histoire tragique et nostalgique, la chute de l’empire français ». À la suite de cette parution, l’AFASPA, association fondée par des scientifiques anticolonialistes comme l’historien Jean Suret-Canale et le géographe Jean Dresch, a publié le communiqué suivant :
« Ceux d’entre nous qui avons le souvenir des luttes menées contre les crimes du colonialisme français sont toujours satisfaits de voir rappeler cette période aux générations actuelles. Nous nous étions félicités de voir l’hebdomadaire Marianne publier un dossier sur “la chute de l’Empire français”, d’autant que cette publication est d’ordinaire honnête et progressiste. La lecture de ce dossier est affligeante, parce que celui-ci a été délibérément confié à quelques historiens spécialisés dans le “négationnisme colonial” : Jacques Marseille dont les publications depuis vingt ans s’efforcent de “démontrer” que l’exploitation coloniale fut une entreprise désintéressée de la part des autorités françaises ; Jean Fremigacci qui tente depuis des années de nier le caractère criminel de la répression française contre les Malgaches insurgés en 1947. Ce dernier met en doute le nombre de morts annoncés par les autorités coloniales et repris par le Parti communiste français : c’est le droit de tout historien, si la découverte de nouveaux témoignages le permet. Mais en profiter pour insulter les militants anticolonialistes comme Pierre Boiteau qui en 1947 dénoncèrent la répression au péril de leur vie, alors que la majorité des forces politiques françaises restaient muettes, ce n’est pas faire de l’histoire, c’est commettre une agression politicienne. »
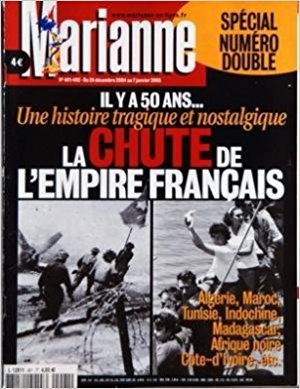
Le Nouvel Observateur a publié dans son numéro du 3 au 9 mars 2005 un dossier intitulé « la vérité sur l’esclavage ». On y nage en pleine ambiguïté : à côté d’articles rédigés par des journalistes et parlant à bon escient du « crime oublié », le seul historien convié es-qualité à s’exprimer est Olivier Pétré-Grenouilleau, qui exprimait en même temps, dans diverses émissions de radio, ses thèses sur l’importance de la traite arabe. Les autres, pourtant nombreux, ne sont pas consultés.

Ces dérives ne relèvent pas toujours de la droite extrême. Elles sont souvent tout simplement le fruit du nationalisme français : ses tenants occultent depuis longtemps les réalités historiques qui ne correspondent pas à ses certitudes. Ainsi il existe depuis deux siècles une véritable conspiration du silence autour de l’expédition Leclerc, qui échoua à reconquérir Saint-Domingue et son peuple d’esclaves libéré par eux-mêmes en 1801 : cette aventure esclavagiste, conclue par un désastre militaire, est contraire au mythe napoléonien, l’un des éléments constitutifs du nationalisme hexagonal. La dernière saga qui l’illustre pour le grand public, le Napoléon de Max Gallo, opus de quatre volumes publié en livre de poche, traite de l’expédition en quelques lignes allusives et pour le moins insuffisantes pour faire comprendre l’enjeu d’une guerre coloniale menée pour rétablir l’esclavage.
Les ruses du négationnisme colonial
Je voudrais enfin attirer l’attention sur les dangers d’une approche des méfaits des colonisations en termes exclusivement moraux, approche dominante aujourd’hui. En toute bonne foi, avec la plus grande compassion pour les victimes, une grande partie de l’opinion publique condamne ainsi la torture et les tortionnaires de la guerre d’Algérie ou la férocité des esclavagistes. Mais cette lecture occulte le fait que ces exactions étaient la conséquence inéluctable de la répression coloniale contre les résistances des colonisés. C’est oublier que toute sujétion coloniale, qu’elle repose sur l’esclavage ou le travail forcé, est une relation d’exploitation, fondée sur la recherche d’un profit par les uns au détriment des autres. Ce faisant, se cantonner dans la dénonciation des violences, c’est ne voir qu’une partie de la réalité historique.
Les négationnistes véritables, eux, utilisent sciemment cette lecture morale et sentimentale, pour excuser les crimes coloniaux : ils deviennent des excès isolés, tout au plus, attribués à des individus moralement condamnables, le maître sadique autrefois, le tortionnaire sadique aujourd’hui. Tenants du code libéral, les négationnistes sont les défenseurs acharnés des mécanismes du marché, de la liberté d’exploiter. Voilà pourquoi ils se refusent absolument à reconnaître un lien entre recherche du profit et esclavage, à admettre que la traite atlantique, le commerce né des plantations esclavagistes étaient l’appendice tropical du capitalisme européen en développement.
On ne peut se cacher aussi que l’attitude négationniste, la négation des faits quelle qu’en soit la motivation, s’accommodent bien d’une certaine démagogie, par exemple du gonflement outrancier du nombre de déportés africains atlantiques jusqu’aux centaines de millions : ainsi les chiffres vérifiés par les historiens, moins élevés, peuvent permettre de faire apparaître moindre le crime esclavagiste. Ces derniers temps, se propagent aussi des versions xénophobes, voire racistes de la traite et de l’esclavage aux Antilles qui en attribuent la responsabilité exclusive à une couleur de peau (« les Blancs ») ou même à une religion (« les Juifs »). C’est oublier le rôle progressiste des antiesclavagistes blancs et celui criminel de négriers noirs qui ont eux aussi tiré profit de l’esclavage.
En fait, toutes ces façons perverses d’opposer entre elles les victimes des systèmes de domination sont un service rendu aux négationnistes authentiques et aux idéologues d’extrême droite. Par ailleurs, les écrits négationnistes ne relèvent pas toujours de militants d’extrême droite, en milieu universitaire notamment. Certains auteurs s’y laissent aller, par goût obsessionnel de la notoriété ; ils veulent à tout prix démontrer la fausseté de tous les travaux précédents sur le sujet et valoriser leur découverte, enfin, de « la vérité » sur la question traitée. Le « scoop » n’est malheureusement pas qu’un procédé de presse, il est aussi parfois une dérive des publications historiques. Indéniablement, elle s’aggrave d’une conséquence perverse de l’autonomie universitaire : certaines publications n’ont pour but que de démontrer l’avancée exclusive de l’auteur sur un sujet, pour obtenir les crédits de recherche disputés entre tel ou tel institut scientifique. Cette concurrence acharnée ne favorise pas la rigueur scientifique, qui exige plus de sérénité.
Francis Arzalier
Docteur en histoire moderne et contemporaine, responsable de la revue Aujourd’hui l’Afrique




