Guide du Paris colonial et des banlieues
éditions Syllepse, Sortir du colonialisme, 2018, 144 p., 8 €. Format : 115×190 cm.
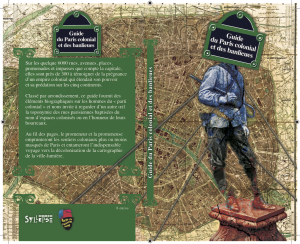
Présentation par l’éditeur :
Sur les quelque 5 000 artères et places parisiennes, elles sont plus de 200 à « parler colonial ». Qui se cachent derrière ces noms, pour la plupart inconnus de nos contemporains ? C’est ce que révèle ce livre, attentif au fait que ces rues ont été baptisées ainsi pour faire la leçon au peuple de Paris et lui inculquer une certaine mémoire historique. On n’y retrouve pas uniquement les officiers ayant fait leurs classes « aux colonies ». Il y a aussi des « explorateurs » — souvent officiers de marine en « mission » —, des bâtisseurs, des ministres et des députés. On croise également des littérateurs, des savants, des industriels, des banquiers, des « aventuriers ».
Laissons-nous guider, par exemple, dans le 12e arrondissement. Le regard se porte inévitablement sur le bâtiment de la Cité de l’histoire de l’immigration, l’ancien Musée des colonies construit en 1931 pour l’Exposition coloniale qui fut l’occasion d’honorer les agents du colonialisme et d’humilier ses victimes. Les alentours portent la marque de l’Empire colonial : rues et voies ont reçu le nom de ces « héros coloniaux » qui ont conquis à la pointe de l’épée des territoires immenses. Les alentours de l’École militaire sont également un lieu de mémoire très particulier, très « imprégné » de la culture coloniale. Dans le 16e, nous avons une avenue Bugeaud : Maréchal de France, gouverneur de l’Algérie, il pratique la terre brûlée et les « enfumades ». Il recommande d’incendier les villages, de détruire les récoltes et les troupeaux, « d’empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer ». Il faut, ordonne-t-il, « allez tous les ans leur brûler leurs récoltes », ou les « exterminer jusqu’au dernier ». S’ils se réfugient dans leurs cavernes, « fumez-les à outrance comme des renards ».
Un peu partout, dispersées dans la capitale, on traverse des rues et des avenues dont les noms qui, tout en ayant l’apparence de la neutralité d’un guide touristique, sont autant de points de la cartographie coloniale : rues de Constantine, de Kabylie, de Tahiti, du Tonkin, du Dahomey, de Pondichéry, de la Guadeloupe… Toutes célèbrent des conquêtes et des rapines coloniales que rappellent la nomenclature des rues de Paris.
Classés par arrondissement, les notices fournissent des éléments biographiques sur les personnages concernés, particulièrement sur leurs états de service dans les colonies. Des itinéraires de promenade sont proposés qui nous emmènent au travers des plaques bleues de nos rues en Guadeloupe et en Haïti, en Afrique, au Sahara, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, en Indochine, à Tahiti, etc. Un livre qui se veut un outil pour un mouvement de décolonisation des cartographies des villes et qui propose un voyage (presque) immobile dans la mémoire coloniale de Paris.
Extraits de l’introduction
Une toponymie qui tue
par Didier Epsztajn et Patrick Silberstein
[…] Rues, boulevards, avenues, places et autres voies, sans oublier collèges, lycées, statues et monuments, sont autant de témoins muets, mais ô combien parlants, de l’histoire telle qu’on nous la raconte et nous l’impose. Une histoire qui, comme l’écrit Robert Aldrich (1996) « reste marquée par cette volonté d’inscrire l’action coloniale sur les rues et les places de Paris ».
Pour quiconque a fréquenté l’école publique des années 1950 et 1960, les toponymes parisiens font penser à ces manuels d’histoire, à la fois risibles et tragiques, que les élèves en blouse grise transportaient dans leurs cartables et ouvraient sur leurs pupitres pour ânonner l’histoire-légende de l’œuvre coloniale et s’en imprégner. Des images d’Épinal à l’innocence trompeuse.
À l’heure où le général Lee et ses statues équestres tremblent sur leur piédestal et s’apprêtent à quitter les rues et les places pour gagner (lentement mais sûrement) les musées états-uniens, il serait grand temps que le vent de la justice toponyme venu des États-Unis souffle sur les bords de Seine et que les Parisien·nes regardent parler leurs murs. Des murs dont on a voulu, sciemment, délibérément et politiquement, qu’ils disent la gloire de l’empire colonial. Ces rues ont été baptisées ainsi pour faire la leçon au peuple de Paris et lui inculquer une mémoire historique très particulière. Il suffit pour s’en rendre compte de noter les dates des arrêtés de dénomination. Elles parlent d’elles-mêmes1.
Au demeurant, ces plaques bleues font bien plus que célébrer l’expansion coloniale française et son œuvre « civilisatrice » : elles montrent l’extraordinaire imbrication du fait colonial avec la construction et le fonctionnement de l’État. Les élites du pays, dont évidemment les élites militaires, ont été façonnées par le système colonial et impliquées dans son histoire : « De façon visible ou invisible, trois générations d’hommes politiques seront influencées, formées ou issues de cet espace colonial » (Blanchard et Lemaire, 2011). Contrairement aux enseignements diffusés, il n’y a pas d’un côté la République vertueuse — pour n’en rester qu’à ce régime politique — et de l’autre le colonialisme et les colons. Il n’y a pas non plus un Alexis de Tocqueville — qui a évidemment été récompensé par une rue dès 1877 — penseur de la démocratie et un autre Alexis de Tocqueville penseur des razzias2. Il y a bel et bien enchevêtrement, symbiose, imbrication. […]
Un peu partout, dispersées dans la capitale, on traverse des rues et des avenues dont les noms qui, tout en ayant l’apparence de la prétendue neutralité d’un guide touristique, sont autant de points de la cartographie coloniale qui sentent bon le sable chaud et qui font tintinnabuler les vieilles rengaines du « temps des colonies » (Liauzu, 2002). Les rues de Constantine, de Kabylie, de Taïti, de Nouvelle-Calédonie, d’Annam, du Tonkin, du Dahomey, de la Martinique, de la Guadeloupe ou du Congo ne sont pas une invitation au voyage, mais le rappel subliminal que ces terres étaient – ou sont encore pour certaines d’entre elles, comme la Kanaky, la Gwadloup et la Martinique – des possessions françaises et qu’elles ont été le théâtre de la force des armes et de la « mission civilisatrice » de l’universalisme à la française.
Dans les Damnés de la terre, Frantz Fanon note que « chaque statue, celle de Faidherbe ou de Lyautey, de Bugeaud ou du sergent Blandan, tous ces conquistadors juchés sur le sol colonial n’arrêtent pas de signifier une seule et même chose : “Nous sommes ici par la force des baïonnettes…” » (Fanon, 1970). Évidence en 1961 pour les contrées sous domination coloniale, il en est toujours de même de nos jours dans les villes de France, et notamment dans sa capitale.
Les moments d’expansion coloniale et d’affirmation de l’Empire donnent particulièrement lieu à cette imposition mémorielle. De ce point de vue, il y a une parenté forte avec les États-Unis, comme le rappelle James W. Loewen :
C’est le récit de son objet — dans le cas de la statue de Lee à Charlottesville, la guerre de Sécession —, mais c’est également le récit du moment pendant lequel la statue a été érigée — dans ce cas, la période que l’on appelle le « nadir des relations raciales américaines », qui va de 1890 à 1940. Ça a été une période terriblement raciste, un âge d’or de la suprématie blanche, de la ségrégation, et du Ku Klux Klan (James W. Loewen, Libération, 16 août 2017).
Ici il s’agit de statues « érigées dans le but de réécrire l’histoire, pour glorifier la Confédération et perpétuer l’idée de la suprématie blanche3 », là ce sont des plaques bleues imposées pour glorifier les sabres sanglants et pour perpétuer une certaine conception de la civilisation.
Ici comme là-bas, la résistance à l’égalité et à la liberté est extraordinairement forte. Pourtant, les trompettes de Jéricho commencent à faire trembler les murs de Paris qui ont acquis une certaine faculté d’adaptation4. À la faveur de la rénovation urbaine, on a pu voir apparaître des noms de rues, de places, tentant de corriger, de rééquilibrer, certes timidement, cette terrible inégalité toponymique. Depuis 2006, la rue de l’Isly et l’avenue Bugeaud — respectivement dénommées en 1846 et 1864 — coexistent (pacifiquement ?) avec la place de l’Émir-Abdelkader. Bonaparte, colonisateur (« malheureux ») de l’Égypte, indéboulonnable idole, trône désormais en compagnie de Victor Shœlcher, Toussaint Louverture et Louis Delgrès. Le premier, qui a rétabli l’esclavage en 1802 sur les décombres de la 1re République, a été honoré en 1852, à l’époque où la 2e République épousait les ambitions coloniales de la défunte Monarchie. Le second, abolitionniste pourtant modéré, « soucieux de ménager les intérêts des colons » (Manceron, 2006), ne l’a été qu’en 2000. Le troisième, le général des esclaves de la Révolution de Saint-Domingue, a dû attendre 2013. Quant au dernier, si la « Nomenclature des voies parisiennes » nous apprend qu’il « adhéra très tôt aux principes de la Révolution française », elle ne souffle mot de la désertion du colonel Delgrès, commandant de Basse-Terre, pour combattre les troupes envoyées par Bonaparte pour rétablir l’esclavage5 […]
Le passé colonial de la France est lourd à porter. Mais un héritage, cela s’accepte ou cela se refuse, en totalité, ou en partie. On peut aussi choisir de préférer de revendiquer un autre héritage, notamment celui des luttes anticoloniales. En tout cas, comme l’écrit Françoise Vergès (2011), si héritage il y a, il n’y a « pas de legs sans responsabilité, et cette responsabilité nous oblige à recevoir, mais aussi à choisir, à exclure, à préférer ». Ceux qui, tel le coq gaulois, se dressent sur leurs ergots pour empêcher que le moindre drapeau ne soit replié, que la moindre plaque ne soit dévissée ou reformulée, veulent nous contraindre à accepter leur patrimoine et à empêcher que la discussion sur le legs ne puisse déboucher sur un affichage public différent.
L’exploration des traces et des échos du Paris colonial à laquelle nous vous convions se veut à la fois un petit pavé parisien — un de ceux qui ont été recouverts d’une épaisse couche de bitume aux lendemains de Mai 68 — lancé sur les notaires du colonialisme français et une petite pierre pour que se construise une mémoire collective de libération et d’émancipation au travers d’une reconquête mémorielle des murs de notre ville, ce Paname où nous marchons, où nous travaillons, où nous nous promenons, où nous manifestons également, toutes et tous ensemble. […]
- Les instruments de navigation quelque peu primitifs dont nous disposons nous ont néanmoins permis d’établir un relevé approximatif de la fréquence des impositions toponymiques du « parti colonial » selon les époques. Deux conditions devaient être réunies pour pouvoir imprimer le domaine colonial dans la cartographie parisienne : les choix politiques des édiles et l’existence d’emplacements disponibles pour de tels baptêmes. Les époques de stagnation urbaine n’étaient évidemment guère propices à transposer l’expansion coloniale sur les plaques bleues, à moins de débaptiser/rebaptiser certains toponymes, valse de dénominations que confirme le Dictionnaire historique des rues de Paris (Hillairet, 1985). En dix-huit ans, à la faveur de la restructuration haussmannienne, le Second Empire (1852-1870) a imposé 30 marques coloniales pour 666 dénominations. Quant à la 3e République (1871-1940), pour un total de 1 401 dénominations, elle a infligé en soixante-neuf ans à la capitale 134 de ces marques, dont 64 entre l’exposition coloniale de 1907 et le Front populaire. Le territoire le plus marqué étant les 7e, 12e, 15e, 16e et 17e arrondissements qui concentrent 133 des 231 toponymes chers au « parti colonial » recensées dans ce guide. Pour se repérer, les passant·es pourront consulter une chronologie et un index des dates de dénomination et emprunter quelques itinéraires [u p. 109 et suiv.].
- « Je crois, écrit Tocqueville, que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l’époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides qu’on nomme razzias et qui ont pour objet de s’emparer des hommes et des troupeaux » (cité par Le Cour Grandmaison, 2005).
- Mitch Landrieu, maire de La Nouvelle-Orléans (http://mobile.lemonde.fr/charlottesville/article/2017/08/16/le-debat-enfle-autour-de-la-presence-de-monuments-confederes-aux-etats-unis_5172879_5172840.htm).
- On observe un processus similaire quand une rue du 10e arrondissement populaire est donnée en 1910 à Eugène Varlin, communard et membre de l’Association internationale des travailleurs, alors que le Maréchal fusilleur Mac Mahon a été honoré dès 1875 d’une belle et grande avenue dans le très rupin 17e arrondissement.
- On a vu apparaître en 1984 une rue du Commandant-Mortenol, cet officier de marine guadeloupéen, « premier homme de race noire a être admis à l’École polytechnique » (« Nomenclature des voies parisiennes ») qui, après avoir participé à la conquête de Madagascar sous les ordres de Gallieni, s’est engagé « dans les mouvements antiracistes, voire anticolonialistes » (www.une-autre-histoire.org/). Une avenue Mohamed ben Abdelkrim el-Khattabi serait pourtant du plus bel effet à côté de celle du Maréchal-Lyautey.



