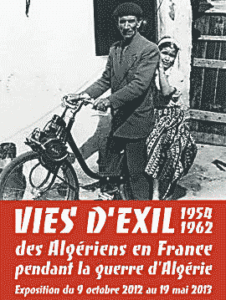L’immigration algérienne n’est pas une immigration récente
Contrairement à une idée reçue, l’immigration algérienne n’est pas une immigration récente. Les Algériens s’installent en France dès le début du XXe siècle. Ce sont essentiellement des paysans originaires de Kabylie envoyés par leur village avec, pour mission, de renvoyer des mandats postaux à leur famille.
C’est également dès les années 1920 et jusqu’aux années 50 que différentes organisations politiques se développent sur le territoire métropolitain. En 1926, Messali Hadj – le père fondateur du nationalisme algérien chez qui de nombreux responsables du Front de Libération Nationale (FLN) de la guerre d’Algérie feront leurs armes – crée l’Etoile Nord-Africaine (ENA). Interdite par les autorités françaises, l’ENA sera remplacée par le Parti du Peuple Algérien (PPA) en 1937, puis par le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD) en 1946, qui, à sa dissolution le 5 novembre 1954, donne naissance au Mouvement National Algérien (MNA).
Ces formations, qui se situent à mi-chemin entre l’idée républicaine et socialiste, et le sentiment d’appartenance à une identité religieuse, seront de formidables machines à rassembler et à sensibiliser les Algériens à l’injustice coloniale. Dans les baraquements du bassin minier du Nord de la France ou dans les cafés-hôtels des banlieues de la région parisienne, les hommes de Messali Hadj sont venus à la rencontre des immigrés pour leur prêcher la « bonne parole ». Dès les années 1930, les cafés-hôtels deviennent ainsi des lieux de vie et de mémoire. On y prend les nouvelles du « bled », on y écoute de la musique, on y recherche du travail ou on y fait la prière du vendredi. Le sentiment national va naître de l’exil. Loin de sa terre l’immigré algérien découvre l’entre soi, une connivence avec d’autres exilés. Dans le cadre colonial en Algérie, il est difficile de s’organiser : il est paradoxalement nécessaire de rejoindre cette France, à laquelle il va falloir s’opposer, pour être en mesure de mettre en place un mouvement politique.
Pourtant, tous ces hommes resteront longtemps des « hommes invisibles ». Car comment appeler ces Algériens, qui venant d’un territoire considéré comme français (l’Algérie est alors considérée comme intégré à la nation française) ne sont pas de « vrais » citoyens français, mais se trouvent relégués dans leur condition d’« indigènes musulmans » ?
La situation juridique évoluera avec une seconde vague qui arrive entre 1945 et 1954, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le déclenchement de la guerre d’Algérie. Les hommes viennent maintenant de toutes les régions : du Constantinois (Est), fuyant la famine de 1944-1945, et de l’Ouest algérien. Les années 1950-1952 voient surtout le début de l’immigration familiale. On assiste alors à une autre construction de l’exil algérien. Celui-ci va s’enraciner. Ces immigrés sont davantage formés que leurs prédécesseurs. Ils comptent de nombreux ouvriers qualifiés qui investiront notamment les grands bastions de la métallurgie. La grande majorité de ces ouvriers rejoignent les syndicats, essentiellement la CGT. Ils sont surtout fortement engagés politiquement dans la Fédération de France du Parti du Peuple Algérien-Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (PPA-MTLD), qui compte, avant 1954, près de 10 000 militants sur les 200 000 Algériens de France. Le FLN verra le jour à ce moment là, en 1954.
Mais c’est véritablement pendant la guerre d’Algérie que cette immigration prendra sa physionomie définitive. L’immigration familiale qui avait débuté timidement à la fin des années quarante connait en effet durant ces années de guerre une progression constante. Mais que sait-on réellement de la vie de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants ? Cinquante ans après l’indépendance, le temps est venu de lever le voile sur une histoire méconnue, celle de l’immigration algérienne pendant la guerre d’indépendance. Tel est le propos de l’exposition Vies d’exil, des Algériens en France pendant la guerre d’Algérie conçue par Benjamin Stora et Linda Amiri et produite par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
Autour d’une thématique inédite, l’exposition s’appuie sur une iconographie rare où archives, photographies, son, images et œuvres d’art s’unissent pour mettre en lumière une histoire où la beauté se mêle à la précarité, la joie à la nostalgie et à la violence. Cette musique douce-amère que les Algériens nomment El Ghorba, l’exil. Grâce à la richesse des œuvres mis à jour et aux nombreux témoignages de témoins de l’époque, le visiteur est plongé dans la société métropolitaine. Travail, logement et loisirs mais également combat indépendantiste rythment l’exposition.
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne s’attardent bien évidemment sur la séquence décisive de la guerre d’Algérie, et sur la façon dont elle a été vécue par les immigrés algériens en France. Entre les violences policières françaises, comme la nuit tragique du 17 octobre 1961 où périrent de nombreux Algériens en plein Paris, et les cruels règlements de compte entre nationalistes algériens, ceux du MNA de Messali Hadj et ceux du FLN, l’immigration algérienne a été confrontée a un moment terrible de son histoire. Les ouvriers exilés menaient pendant cette période une double existence. Une fois les sirènes des entreprises éteintes, la vie du militant débutait. Même si la plupart étaient d’un faible niveau d’instruction, les immigrés se passionnaient pour la politique. Ils discutaient ou écoutaient beaucoup la radio, lisaient ou se faisaient lire les journaux. L’image de l’immigré, ouvrier sans mémoire, sans politique, sans passé, malheureusement encore tenace aujourd’hui, ne correspond donc pas à la réalité.
Comme beaucoup de membres de mouvements clandestins, ces hommes et ces femmes ont nourri la culture du secret. Plusieurs décennies après la fin de la guerre d’Algérie, ils hésitent encore à parler. Certains, décédés, ont emmené avec eux des pans entiers d’une histoire tragique. L’exposition Vies d’exil raconte cette histoire peu connue, placent en pleine lumière ces hommes longtemps invisibles, dit leur quotidien fait de joies et de peines.
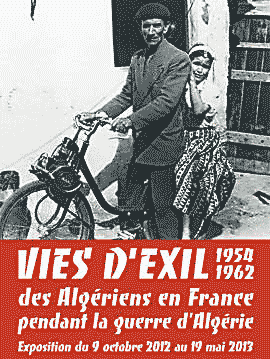
Linda Amiri : «Rendre visibles nos parents»2
Pour la commissaire, l’historienne Linda Amiri, c’est l’occasion de donner un autre regard sur l’immigration.
- Pourquoi «Vies d’exil» ? Quel est l’objectif de cette exposition ?
Cette exposition est le fruit d’un long travail que j’ai initié il y a trois ans. Cette histoire des Algériens en France, pendant la guerre d’indépendance, est aussi pour moi, avant tout, l’histoire de mon père, de mon grand-père et de mon oncle. Depuis quelques années, ce sujet est mon champ de recherche, mais j’étais lasse de constater que l’histoire de cette immigration avait peu de visibilité. Dans l’optique du cinquantenaire de l’indépendance, je veux éviter que l’on ne parle d’elle qu’à travers le prisme du 17 octobre 1961. Quels que soient les chemins politiques que les immigrés prirent pendant la guerre, ils sont avant tout des membres à part entière de la société française et ont contribué à sa modernisation.
Leur exil se confond avec leur jeunesse, il faut en finir avec le mythe des pères silencieux rasant les murs, faire entendre pleinement leur voix puisqu’à Paris comme à Alger on a du mal à les entendre. Car, avant d’être des militants indépendantistes, ce sont des hommes et des femmes qui quittent leur terre natale dans un contexte de guerre et découvrent une métropole en pleine mutation. Quelles étaient leurs conditions de vie ? Leur quotidien à l’usine et hors d’usine? Leurs relations avec la société française ? Leurs aspirations, leurs luttes politiques et syndicales ? Leur participation à la guerre d’indépendance ? Lorsque j’ai soumis le projet à Benjamin Stora, il a tout de suite accepté de travailler avec moi et nous avons ensuite pris contact avec la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. L’ensemble de l’équipe et de la direction de la CNHI s’est montrée enthousiaste et a accepté de porter avec nous ce projet, notamment Hedia Yellès-Chaouche, qui a joué un rôle important dans la réussite de l’exposition.
- A quand remonte l’immigration algérienne en France ?
Les premiers pas de l’histoire de l’immigration remontent à la fin du XIXe siècle. En 1905 on comptait déjà près de 5000 Algériens installés en France, à l’époque c’était une immigration saisonnière qui n’intéressait ni les pouvoirs publics, ni les partis politiques, ni les syndicats. Après la Première Guerre mondiale, les flux migratoires s’intensifient – la France a besoin de bras pour reconstruire le pays-, l’avènement du communisme va permettre à l’immigration de sortir de sa léthargie : le communisme s’engage contre le colonialisme, une brèche qui va permettre les débuts de la politisation des Algériens en France.
L’année 1926 marque, on le sait, la naissance de l’Etoile nord-africaine, mais rapidement, Messali Hadj rompt avec le PC-SFIC, aidé de Amar Imache, Radjef Belkacem et plus tard A. Filali. Il parvient à transformer une simple association en un parti politique de masse. Mais ce que j’aimerais souligner ici, c’est que ces premiers pas de l’immigration en France sont multiples : dans l’entre-deux guerres le pluralisme politique existe. Par ailleurs, l’histoire de l’immigration s’accompagne déjà d’une histoire culturelle très riche, qui se poursuit après 1945. Notre exposition rend également hommage à ces artistes algériens de l’immigration.
- Les cafés hôtels étaient des viviers du nationalisme algérien ?
Sans aucun doute oui! Ce sont des lieux de socialisation politique, déjà dans l’entre-deux guerres, les militants nationalistes l’avaient compris. Mais le café hôtel est avant tout un lieu de vie qui permet l’entre-soi. Le café est un lieu très important, on y vient pour retrouver des amis, prendre des nouvelles du pays, de la famille, jouer aux cartes ou aux dominos, écouter de la musique…et lire la presse nationaliste, se politiser. Ce n’est pas un hasard si, dès 1956, ils sont au cœur de la guerre civile à laquelle se livrent les militants du FLN et ceux du MNA.
- L’arrivée des femmes et des enfants a-t-elle chamboulé toute l’immigration ?
Le bouleversement s’est fait progressivement, car cette immigration familiale a doublé entre 1954 et 1962. L’arrivée des familles remonte au début des années cinquante, avec elles l’immigration s’enracine définitivement. On sous-estime à tort la présence de ces familles. Dans l’exposition, nous avons pu retrouver de nombreuses photos inédites de ces familles. Et notamment les très belles photographies de Monique Hervo. Je pense que pour beaucoup de visiteurs, la découverte de cette immigration familiale sera une surprise, car on a tendance à penser que l’immigration algérienne à cette époque était uniquement composée d’hommes seuls. Le catalogue de l’exposition, publié en coédition (Autrement-CNHI) permet aux visiteurs d’aller un peu plus loin dans la compréhension de l’histoire de l’immigration pendant la guerre d’indépendance, grâce à la contribution de nombreux chercheurs algériens, français et anglais.
_________________________
Benjamin Stora : «C’est un pan de l’histoire de France»
Il y a 20 ans, l’historien Benjamin Stora3 lançait avec La gangrène et l’oubli une alerte : la guerre d’Algérie semblait tombée dans un trou de la mémoire nationale.
- L’année dernière, on commémorait les 50 ans du massacre du 17 octobre 1961, qui s’est soldé par l’assassinat d’une centaine d’Algériens à Paris. A cette occasion, des témoignages inédits sont enfin parus, levant le voile sur une communauté méconnue. Que peut-on apprendre de plus sur les Algériens qui vivaient en France pendant la guerre d’Algérie dans l’exposition que vous présentez ?
L’exposition porte essentiellement sur la vie quotidienne des Algériens en France, dans les années 50, donc pendant la guerre d’Algérie (c’est-à-dire de 1954 et 1962). La vie quotidienne, c’est d’abord le travail, parce que ces Algériens étaient d’abord des ouvriers, au bas de l’échelle sociale, qui travaillaient énormément. Ils partaient très tôt le matin de chez eux et rentraient tard le soir. Un second aspect : le logement, parce que les conditions de logement des Algériens étaient catastrophiques. On a bien sûr en mémoire les images des bidonvilles, des grands bidonvilles de Gennevilliers ou de Nanterre, qui étaient des lieux de ghettoïsation …
- Ces bidonvilles aux rues pleines de boue qui ont marqué l’imagination populaire étaient-ils spécifiquement destinés aux Algériens ou correspondaient-ils à une réelle crise du logement ?
Il y avait à l’époque, effectivement, une très grave crise du logement au lendemain de la seconde guerre mondiale. C’est évident. Mais les Algériens étaient plus particulièrement touchés, dans la mesure où, jusqu’aux années 60, ils étaient plutôt des hommes seuls. Le nombre de foyers pour travailleurs était très faible, voire inexistant. Les foyers de travailleurs n’ont été véritablement créés qu’à partir de 1958 : c’étaient les premiers foyers Sonacotra, prévus pour les Algériens. Ces hommes seuls arrivaient d’abord dans des cafés-hôtels tenus par d’autres Algériens. Mais, très vite, ça ne suffisait pas. Il a fallu s’abriter (on ne peut pas trouver d’autre mot) du froid. Les bidonvilles ont alors commencé à apparaître à la périphérie des grandes métropoles industrielles. Un autre phénomène : l’immigration familiale a commencé à arriver, dans la seconde moitié des années 50. Là, il n’y avait pas du tout de logement. Les femmes et les enfants ont grossi la population de ces bidonvilles.
- Malgré la misère, cette communauté avait-elle une vie culturelle riche ?
En fait, la vie culturelle était d’abord et essentiellement politique. L’engagement politique était une façon de retrouver sa dignité, et donc d’exister dans la société. Cet engagement, qui est fondamental, a toujours existé : dès les années 20 ou 30. C’est une tradition qui s’est perpétuée. Par l’engagement politique, on va apprendre à écrire, à lire, parce que beaucoup sont des paysans analphabètes lorsqu’ils arrivent d’Algérie. Tout ça se fait par le biais de l’engagement, de l’organisation politique. L’exil, bien sûr, renforce le besoin du pays, le fait d’être dans un rapport très profond avec l’Algérie. C’est dans l’exil que le sentiment national se renforce. Ce sentiment est d’autant plus fort que c’est la plus importante, à l’époque, immigration coloniale en France. Par ailleurs, il y a eu des chanteurs, des musiciens. Dans ces fameux cafés-hôtels, il y avait des concerts. Il y avait quelques cabarets à Paris. Des écrivains circulaient dans le paysage littéraire français de l’époque : on pense naturellement à Kateb Yacine. Mais le gros de l’immigration algérienne est ouvrière.
- Quelle sera la trace de cette vie culturelle dans l’exposition ?
Il y aura des bornes qui présenteront des scopitones, qui existaient déjà à cette époque-là, de la dizaine ou de la quinzaine de groupes qui tournaient dans les cafés-hôtels. Il y aura aussi des tableaux réalisés à l’époque par des artistes algériens ou des tableaux réalisés par des peintres français qui représentent la misère algérienne des bidonvilles.
- La guerre d’Algérie s’est achevée il y a un demi-siècle. Cinquante ans, c’est deux générations entières. A qui destinez-vous en priorité cette exposition, aux petits-enfants des Algériens qui travaillaient en France dans les années 50 ?
C’est une exposition pour tout le monde, pour le grand public. J’espère que tous les Français pourront découvrir un pan d’une histoire qui est aussi leur histoire, parce que l’histoire de l’immigration, à mon sens, fait partie de l’histoire de France, tout simplement. Ca s’adresse à tous ceux qui connaissent mal ou peu cette histoire. Ils vont découvrir des choses surprenantes du point de vue de la misère sociale, de la volonté de vivre dans la dignité, … C’est tout un pan de l’histoire de France qui apparaît devant nos yeux. Dans ce public, il y aura bien sûr ceux qui cherchent les traces de leurs origines, qui remontent leur filiation, qui veulent s’inscrire dans une généalogie. Ils sont les petits-enfants ou les grands-enfants (ils ont âgés maintenant : ils ont quarante ans, cinquante ans) de ces grands-parents ou de ces parents. Ils veulent en savoir plus sur leur façon de vivre, d’arriver, de s’installer en France, de travailler dans des conditions très très difficiles mais, au final, de surmonter toutes ces difficultés. Cette exposition, elle leur est aussi destinée …
- L’exposition coïncide avec le cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie et de l’indépendance du pays. Quel est votre sentiment sur les commémorations qui s’organisent ? Les pouvoirs publics français y prêtent-ils autant d’attention qu’ils le devraient ?
A ma connaissance, c’est la seule exposition nationale ! Il y a aussi celle des Invalides mais elle n’est pas consacrée à la guerre d’Algérie, elle est consacrée à l’histoire de la présence française en Algérie. Sur la guerre d’Algérie ou cette période, à ma connaissance, notre exposition est la seule organisée par un établissement public national.
- Comment expliquez-vous cela ? C’est quand même un anniversaire extrêmement important …
La France a été obligée d’abandonner l’Algérie. Il n’est jamais facile pour une nation de commémorer ou de célébrer ce qui peut apparaître comme un retrait ou comme une défaite. La France ne célèbre pas Waterloo, c’est plutôt d’Austerlitz qu’elle parle … Par contre, on aurait dû mettre à l’ordre du jour une cérémonie ou une commémoration commune, entre la France et l’Algérie, pour essayer de dépasser les blessures du passé. Cela aurait pu se faire. Mais il y a des tas de contentieux historiques, politiques, mémoriels entre les deux pays. Il faut du temps. On ne peut pas tout régler à travers une exposition …
- Y a-t-il encore un combat à mener pour que les tabous autour de la guerre d’Algérie tombent ?
Les tabous sont déjà pour la plupart tombés. Le sujet au bac portait cette année sur la guerre d’Algérie. Tous les lycéens de France ont planché là-dessus. C’est un sujet qui est tombé dans tous les concours d’histoire. Il y a trente, quarante, cinquante chercheurs français qui travaillent sur l’Algérie. Il y a une dizaine de thèses qui sont soutenues chaque année. Quand on voit les travaux universitaires, les équipes de recherche, les publications, les films, les documentaires (il y en a eu dix qui ont été diffusés à la télévision française au mois de mars 2012), on ne peut plus parler de silence. La question maintenant, c’est qu’est-ce qu’on fait de tout ce savoir accumulé ? Dans quel sens ça va ? Dans le sens de la réconciliation ou de la poursuite de la guerre des mémoires ? C’est ça la vraie question …
- Source : la présentation de l’exposition par Linda Amiri et Benjamin Stora : http://www.histoire-immigration.fr/musee/expositions-temporaires/vies-d-exil-1954-1962-des-algeriens-en-france-pendant-la-guerre-d-algerie/le-mot-des-commissaires.
- Linda Amiri est enseignante et chercheure en Histoire. Elle a enseigné à l’université de Strasbourg (Institut d’Etudes Politiques et Faculté d’Histoire) et à la Business School of Pforzheim. Spécialiste de l’histoire de l’immigration et de l’histoire du mouvement ouvrier, elle prépare une thèse sur la Fédération de France du Front de libération nationale (1954-1962) à Sciences-Po Paris, sous la direction de Serge Berstein & Benjamin Stora.
- Benjamin Stora est né à Constantine en 1950. Docteur d’État en Histoire et Sociologie, il est Professeur des universités et enseigne à l’université Paris XIII et à l’INALCO (Langues orientales, Paris). Il a publié une trentaine d’ouvrages comme La gangrène et l’oubli, La mémoire de la guerre d’Algérie (La Découverte, 1991) ; Appelés en guerre d’Algérie (Gallimard, 1997) ; Les Trois exils. Juifs d’Algérie (Stock, 2006).