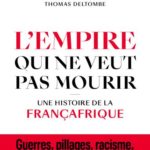Un livre majeur sur l’histoire de la Françafrique,
à lire impérativement
par François Gèze, publié par Mediapart dans le blog Histoire coloniale et postcoloniale le 24 janvier 2022.
Source
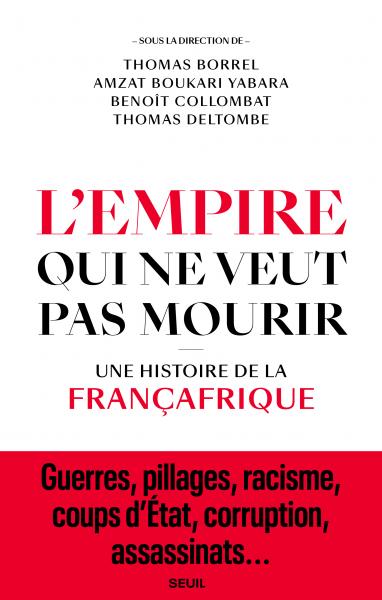
Thomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Benoît Collombat, Thomas Deltombe (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Seuil, Paris, 2021,
1 008 pages, 25 €.
« Si la France n’était pas intervenue, il n’y aurait plus [un seul] gouvernement en place au Sahel », aurait affirmé en privé le président Emmanuel Macron en novembre 2021, selon Le Canard enchaîné (24.11.21). Une déclaration qui fait singulièrement écho à celle de son prédécesseur Charles de Gaulle, qui expliquait, également en privé, en janvier 1963 : « Les Africains […] savent qu’ils ne peuvent rien faire sans le pays qui les a colonisés […] et qu’ils ont besoin de son aide pour développer leur technique, leur culture, leur population. » Ainsi, plus de soixante ans après les « indépendances » africaines, l’essentiel aurait-il été préservé au sein de la fameuse « Françafrique » postcoloniale – installée dans les années 1960 par Jacques Foccart, le conseiller Afrique de De Gaulle –, alors même que celle-ci, selon la vulgate médiatique, est réputée « morte » depuis les années 2000 ?
Comment comprendre ce paradoxe temporel ? En lisant le livre formidable publié au Seuil en octobre dernier, L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, sous la direction de Thomas Borrel (membre de Survie), Amzat Boukari-Yabara (historien), Benoît Collombat (journaliste) et Thomas Deltombe (éditeur).
Voir l’entretien vidéo de deux des auteurs
accordé à Mediapart le 7 octobre 2021.
Apprendre à voir ce qu’on ne regarde plus
Ce livre fera date. Car en proposant une « histoire de la Françafrique », ses auteurs apportent plus largement une vision globale de l’histoire coloniale et postcoloniale de la France qui marque un saut qualitatif d’envergure dans nos connaissances de ce passé trop méconnu, et des traces profondes qui en subsistent aujourd’hui. Cette somme donne à voir, pour la première fois de façon aussi complète, à quel point la « question coloniale » puis la « question néocoloniale » ont marqué la politique intérieure française depuis la Seconde Guerre mondiale – sans parler bien sûr des siècles précédents –, de la naissance de la Ve République suite au coup d’État d’Alger en mai 1958 jusqu’aux controverses sur la laïcité depuis les années 2000 en passant par la défaite électorale de Valéry Giscard d’Estaing en 1981 après son « affaire des diamants » dans la République centrafricaine de Bokassa.
Les quatre directeurs ont mobilisé pour ce livre, aussi pédagogique qu’accessible, vingt-deux contributeurs français et africains venus d’horizons différents, journalistes, universitaires ou militants anti-impérialistes – dont ceux de l’association Survie (créée en 1984 et présidée par François-Xavier Verschave de 1995 à 2005) –, y compris de brillants jeunes spécialistes encore peu connus et dont l’expertise témoigne du profond renouvellement du monde de la recherche sur ces questions. L’organisation retenue est simple et efficace : six parties chronologiques1, chacune ouverte par une longue synthèse de la période, suivie de chapitres (cinquante-trois au total) assortis de nombreux encadrés et portraits, édifiants voire croustillants.
Dès l’introduction, comme il se doit, le concept central est précisément défini : « La Françafrique est un système de domination fondé sur une alliance stratégique et asymétrique entre une partie des élites françaises et une partie de leurs homologues africaines. Cette alliance, héritée d’une longue histoire coloniale, mêle des mécanismes officiels, connus, visibles, assumés par les États, et des mécanismes occultes, souvent illégaux ; parfois criminels, toujours inavouables. » Ce que confirmera l’épilogue confié à la philosophe Nadia Yala Kisukidi : « Le système Françafrique définit tout un complexe de prédation multicausal, à la fois opaque et informel, reposant également sur la solidité de certaines relations d’État à État2. »
D’où un cahier des charges rigoureux, énoncé d’entrée de jeu et qui sera méthodiquement respecté : « La réduction de la Françafrique a sa dimension occulte et scandaleuse a beaucoup aidé les contempteurs du concept, qui en ont profité pour le caricaturer à l’excès et s’en débarrasser à peu de frais. Par un surprenant paradoxe, la face occulte de la Françafrique a fini par masquer sa face visible et officielle : les connexions militaires, le système monétaire, les dispositifs de coopération, le soft power linguistique, sans oublier le paternalisme latent – voire le racisme assumé – qui irrigue l’ensemble. La Françafrique a donc continué à prospérer, sous des formes renouvelées, laissant dans son sillage son flot de victimes. […] Les contributions réunies dans cet ouvrage […] montrent que les deux faces de la Françafrique ne font qu’une. S’il faut évidemment continuer à débusquer ce qui nous est caché, il faut aussi apprendre à voir ce qu’on ne regarde plus. »
À commencer par les circonstances historiques qui en quinze ans seulement, de 1945 à 1960, ont posé les fondations sophistiquées du futur « empire néocolonial » français d’Afrique. Lequel allait durablement succéder à l’empire colonial en place depuis les débuts de la IIIe République (et préfiguré par les colonies antillaises esclavagistes à partir du xvie siècle, puis par l’Algérie soumise à partir de 1830). Tel est l’objet des deux premières parties du livre, sans doute les plus novatrices tant l’historiographie de la période reste lacunaire (ou trop souvent « orientée »). Elles montrent que les origines de ce tournant sont plus anciennes encore : depuis le ministre des Colonies Albert Sarraut, qui soulignait dès les années 1920 l’importance d’anticiper les « sécessions coloniales », afin de préserver dans le futur « par les liens durables de la gratitude et de l’intérêt, des rapports économiques et politiques dont la métropole resterait la bénéficiaire privilégiée, sans supporter les charges et les responsabilités d’autrefois » ; et depuis le général Hubert Lyautey, résident général au Maroc, qui prévoyait en 1925 que pour que la future « séparation se fasse sans douleur », il faudra que « les regards des indigènes continuent à se tourner avec affection vers la France [et éviter] que les peuples africains se retournent contre elle. À ces fins, il faut dès aujourd’hui, notre point de départ, nous faire aimer d’eux ». Jusqu’au général de Gaulle, qui affirmait dans son fameux appel du 18 juin 1940 : « La France n’est pas seule ! Elle a un vaste empire derrière elle ! » De Gaulle y synthétisait, disent les auteurs, les « fondamentaux de l’idéologie impériale française », nourris de deux croyances : « La première veut que la puissance, l’existence, l’identité même de la France reposent sur ses assises ultra-marines. La seconde suppose que les nations rivales de la France seraient déterminées à lui retirer ce réservoir de puissance, qu’il faudrait donc jalousement conserver. »

Les choix de la France, « en faveur des dictateurs, contre les peuples »
Il est frappant de constater, en lisant les chapitres des deux premières parties du livre (très précisément documentés, comme les autres), à quel point les élites françaises ont été profondément animées par ces deux « croyances », des années 1940 aux années 1960, pour « jalousement conserver » cette puissance en mobilisant quatre grandes catégories d’acteurs :
• de rares hauts fonctionnaires au rôle aussi essentiel que méconnu – comme Henri Laurentie, cheville ouvrière de la fameuse « conférence africaine française » de Brazzaville en février 1944, ou Eirik Labonne, diplomate « prophète de l’Eurafrique » en 19533, fervent partisan de l’exploitation des ressources africaines en matières premières et mentor de Pierre Guillaumat, artisan majeur de la Françafrique ;
• des officiers supérieurs de l’armée, plus nombreux, convaincus de l’impérieuse nécessité de briser par les armes les mouvements anticolonialistes, identifiés à une « menace communiste » ; d’où, pendant près de vingt ans, une « interminable succession de bains de sang », de l’Indochine au Cameroun en passant par Madagascar, l’Algérie, etc. ;
• des hauts cadres africains intégrés de longue date au sein des instances gouvernementales françaises, comme Félix Houphouët-Boigny, ardent promoteur de « la voie de la coopération [avec la France] au lieu de celle de l’indépendance », soutenu successivement par François Mitterrand et par de Gaulle pour mettre au pas les authentiques nationalistes et devenir à la fois le premier président de la Côte d’Ivoire et le personnage central de la Françafrique des années 1960 ; ou encore Léopold Sédar Senghor, premier président au long cours (1960-1980) du Sénégal indépendant, qui, loin d’être le « héros africain “positif” » encore salué en 2021 par l’ancien journaliste du Monde Jean-Pierre Langellier dans une biographie hagiographique, fut surtout un « chantre du (néo)colonialisme français en Afrique », d’une férocité impitoyable contre ses opposants ;
• des responsables politiques enfin, de droite comme de gauche, comme François Mitterrand (qui déclarait dès mai 1952 : « Le premier impératif de la politique française est notre présence en Afrique partout où déjà nous sommes »), Gaston Defferre (défendant en 1956 une « politique d’évolution [qui] sait prévoir et agir en temps utile, qui permet à la colonisation d’atteindre son véritable objectif »), Pierre Messmer (grand ordonnateur de la terrible « guerre secrète » au Cameroun puis ministre des Armées de 1960 à 1969, chargé par de Gaulle de fournir aux « régimes amis » placés à la tête des anciennes colonies africaines les dispositifs juridiques et sécuritaires nécessaires à leur maintien), Michel Poniatowski et Claude Cheysson (« deux théoriciens du néocolonialisme français »), et bien sûr l’incontournable Jacques Foccart, secrétaire général aux affaires africaines et malgaches de 1960 à 1974, à qui de Gaulle a confié la fonction d’« assurer, en Afrique subsaharienne, une transition vers des “indépendances” favorables aux intérêts français ».
Le livre raconte comment les uns et les autres ont été à la manœuvre pour organiser, non sans tensions ni contradictions, cette transition en élaborant les « rails institutionnels du néocolonialisme » : création de l’Union française en 1946, adoption en 1956 de la « loi-cadre Defferre », préparant le passage en septembre 1958 à la « Communauté française », prélude ultime aux « indépendances » finalement octroyées en 1960 aux États artificiels issus des ex-AOF et AEF.
Très pertinemment, les auteurs rappellent que ce processus, loin d’avoir été un long fleuve tranquille, s’est heurté à de vives résistances africaines, de la part d’intellectuels ou d’artistes à la détermination sans faille (comme le Sénégalais Alioune Diop, fondateur en 1947 de Présence africaine, l’écrivain camerounais Mongo Beti, le cinéaste sénégalais Ousmane Sembène, etc.) ou de militants anticolonialistes courageux, dont beaucoup ont combattu au prix de leur vie. Mais en AOF et en AEF, le rapport de forces était trop inégal : entre censure, récupérations, manipulations, répressions brutales et assassinats ciblés, les espoirs de la jeunesse indépendantiste ont été durablement étouffés, même s’ils n’ont jamais été complètement brisés.
C’est en effet l’une des révélations de ce livre : les contestations populaires des autocrates et dictateurs soutenus par la France n’ont jamais cessé depuis soixante ans. Sporadiques et souterraines dans toute l’Afrique francophone, elles ont aussi connu des moments de généralisation éruptive, comme lors du mai 1968 sénégalais et ailleurs au début des années 1970 jusqu’à la multiplication des manifestations « antifrançaises » depuis les années 2010, en passant par les révoltes populaires des années 1988-1993 auxquelles, partout – Sénégal, Cameroun, Gabon, Burkina Faso, Bénin, Congo-Brazza, Mali, Togo, Côte d’Ivoire –, « la Françafrique reste sourde », ne répondant que par la répression ou la récupération (p. 577). Car, explique Mongo Beti après le discours de François Mitterrand à La Baule en 1990 prétendant promouvoir la démocratie en Afrique : « Rien n’a changé en réalité dans les dispositions de l’Élysée à l’égard de l’Afrique : c’est toujours le même choix, en faveur des dictateurs, contre les peuples. »
Tout changer pour que rien ne change
Mais revenons à la chronologie, essentielle pour comprendre l’histoire complexe efficacement relatée dans ce livre. Lesté du bagage historique novateur des deux premières parties, le lecteur dispose des clés pour découvrir ensuite avec profit, dans les quatre suivantes, le récit, souvent rocambolesque, des avatars de la Françafrique sous les mandats présidentiels de Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012), François Hollande (2012-2017) et Emmanuel Macron (2017-2022).
Et l’affaire est entendue : d’une présidence à l’autre, c’est le « changement » qui prévaut, mais toujours… dans la « continuité ». Avec un décalage toujours plus grand entre les paroles et les actes, jusqu’à François Hollande en 2012 (« Je romprai avec la “Françafrique” »), Manuel Valls en 2016 (« La Françafrique, c’est terminé ! ») et Emmanuel Macron en 2017 (« Nous allons sortir de la Françafrique ! »). Alors même que, au fil des décennies et jusqu’à ce jour, les auteurs démontrent, de façon implacable, que les dirigeants français et leurs obligés africains ont utilisé et adapté les mêmes outils pour « jalousement conserver » la puissance géopolitique et économique de la Françafrique.
On ne peut que renvoyer à la lecture du livre, dont les pages ont parfois des allures de roman ou de thriller, pour découvrir la diversité et la sophistication de ces multiples outils. Certains d’entre eux, on le découvrira, ont été élaborés et consolidés par les autocrates du « pré carré » eux-mêmes, comme Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Omar Bongo, Paul Biya, Mobutu Sese Seko, Denis Sassou Nguesso, Jean Bedel Bokassa, Hissène Habré, Idriss Deby ou Gnassingbé Eyadema, pour ne citer que les plus notoires, dont les turpitudes sont largement documentées, non sans de solides références bibliographiques.
Mais au fil des huit présidences de la Ve République, c’est bien l’État français qui n’a cessé d’exercer la tutelle de ses anciennes colonies d’Afrique subsaharienne, en mobilisant principalement cinq grandes catégories d’instruments, précisément documentés par les auteurs.



La « coopération »
En premier lieu, la « coopération » : dès le début, de 1959 à 1963, les « accords de coopération » et les coopérants vont assurer la « perpétuation de l’hégémonie française ». Puis, « dans les années 1960 et 1970, la coopération se déploie comme une gestion non seulement de la transition coloniale, mais aussi de la transition du personnel colonial lui-même ». Plusieurs chapitres soulignent le rôle majeur, jusqu’à ce jour, de « laisse monétaire » du franc CFA, créé dès 1945, qui, après les indépendances « permet à la France de garder le contrôle sur l’économie – et, à travers elle, la politique – de ses anciennes colonies sans presque rien débourser ; […] il les maintient dans le statut de pourvoyeurs de matières premières ». Certes, comme l’expliquent Olivier Blamangin et Thomas Borrel dans un chapitre vraiment décoiffant (p. 735), la Françafrique a su prendre le tournant de la « vague libérale » des années 1990 et 2000, mais elle « s’est fondue dans la mondialisation sans se dissoudre : la “normalisation” annoncée n’est pas venue » (p. 742). À la fois cause et effet de cette continuité : le maintien de l’« aide au développement » comme axe essentiel de la « coopération » française en Afrique, une « grande illusion », est-il démontré, au cœur de la « diplomatie du tiroir-caisse » poursuivie aujourd’hui grâce notamment à l’Agence française de développement (AFD).
En deuxième lieu, autre axe important (et le plus notoire) de la Françafrique, mais loin de la résumer : les « coups tordus » des services secrets français et les circuits de corruption où ils sont souvent impliqués. Ce singulier « habitus » d’État, commun aux hauts responsables politiques de droite comme de gauche, est évidemment largement documenté par les auteurs : depuis la déstabilisation de la Guinée indépendante en 1958-1960 jusqu’aux affaires de financements libyens des années 2000 (Sarkozy), en passant par le « système Foccart » et le « marigot du renseignement franco-africain », les milliards de la « République des mallettes » sous Giscard, Mitterrand et Chirac, le « système Elf », la « Corsafrique » ou l’« Angolagate » des années 2000.
Troisième axe, moins médiatisé, mais plus essentiel encore : la présence et les interventions militaires au sein du « pré carré » africain de la France. Ce point est en effet largement méconnu : depuis l’abandon officiel par l’armée française en 1960 de sa « doctrine de la guerre révolutionnaire » appliquée jusqu’alors en Indochine, au Cameroun et en Algérie (au profit de la « dissuasion nucléaire »), cette doctrine de domination des peuples, y compris par les pires moyens, est de fait restée en vigueur jusqu’à aujourd’hui au sein des unités de la Légion étrangère et des régiments d’« infanterie de marine » stationnés depuis les indépendances au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Tchad ou au Gabon4 (p. 367).
C’est bien ce qui ressort du rappel méthodique par les auteurs des dizaines d’« opex » (opérations extérieures) conduites à l’initiative de Paris par les troupes françaises pour venir au secours de dictateurs menacés par les contestations populaires et/ou pour préserver des intérêts économiques. Depuis l’obscure guerre du Biafra en 1967 jusqu’aux opérations Sangaris en Centrafrique en 2013 et Barkhane au Sahel en 2014, en passant par la Mauritanie (1977-1980), le Tchad (à de multiples reprises), le Zaïre (1977-1978), la Côte d’Ivoire ou la Libye, la mise en perspective détaillée de ces opérations est impressionnante : même dans la supposée « arrière-cour » latino-américaine des États-Unis, jamais ces derniers n’ont multiplié à ce point les opérations de police comme la France dans sa propre arrière-cour (désormais commodément justifiées par la nécessaire lutte antiterroriste) ; sans compter, ce qui est trop souvent négligé, qu’elles ont constitué un formidable moyen de formation pour des générations d’officiers nourris des « exploits » coloniaux de leurs aînés5.
Un quatrième axe est celui qui apparaît, in fine, comme une justification majeure des efforts déployés durant des décennies autour des trois axes précédents : le soutien constant apporté par l’appareil d’État françafricain aux entreprises françaises ayant choisi de faire fortune grâce à l’exploitation des ressources africaines, depuis les anciennes sociétés de négoce coloniales6 jusqu’aux fameuses « affaires africaines » du milliardaire Vincent Bolloré, en passant par le « système Elf ». Ainsi que par les « bonnes affaires africaines des retraités de la République » (dont « les anciens ministres Charles Millon, Dominique Perben, Michel Rocard, Michel Roussin, Gérard Longuet, Claude Guéant, Bernard Kouchner, Dominique Strauss-Kahn ou encore Dominique de Villepin »), rappelées dans l’un des encadrés les plus dévastateurs du livre, illustrant froidement la continuité, des années 1990 à aujourd’hui, de la collusion constante entre les « élites politiques » françaises et les dictateurs africains corrompus toujours présents au cœur de la Françafrique.
Un précieux antidote aux virus de la désinformation
Le cinquième axe, enfin, fait office de cerise sur le gâteau ayant servi – et servant toujours – à « habiller » les quatre précédents, ce que François-Xavier Verschave avait sobrement résumé en 2000 : « La logique de la Françafrique, c’est le double langage, le dualisme de l’officiel et du réel ». Là encore, au fil des décennies, on ne peut qu’être sidéré par la permanence – voire l’accentuation – du double discours français vis-à-vis des États francophones subsahariens, où la désinformation règne en vilaine habitude. Cela commence, on l’a dit, avec la fausse générosité de la décolonisation. Et cela se poursuit par la « façade tiers-mondiste » affichée par François Mitterrand avec l’éphémère ministre de la Coopération Jean-Pierre Cot (juin 1981-décembre 1982), derrière laquelle le Président a attribué des postes clés à des acteurs majeurs de la politique néocoloniale depuis les années 1950 comme Gaston Defferre, Claude Cheysson et Michel Jobert, ou Guy Penne, nommé dès mai 1981 responsable de la cellule africaine de l’Élysée, avec qui Foccart dira n’avoir « aucun désaccord profond ». Par la suite, les auteurs n’ont pas de peine à multiplier d’autres exemples de cette duplicité, constante des dirigeants de la Ve République, de la fausse rupture du discours de La Baule de François Mitterrand en 1990 à celle de Nicolas Sarkozy à Libreville en juillet 2007 (« La rupture, cela ne veut pas dire qu’on doit se fâcher avec des amis historiques de la France comme le Sénégal et le Gabon »).
Jusqu’à l’« activisme mémoriel » de la présidence Macron, enfin, justement critiqué par Nadia Yala Kisudiki, selon laquelle « il s’agit de transformer symboliquement les termes de la relation [France-Afrique] pour mieux perpétuer ce qui a été et assurer les attributs matériels de la puissance à un État qui doit maintenir son rang et son prestige mondial », en « masquant l’absence de changements politiques réels ». Cet activisme, dit-elle, « tente d’étouffer tout ce qui met en lumière ses obscurités, à commencer par les discours qui font retour sur l’histoire coloniale de la France, qu’ils soient portés par des voix citoyennes ou construits dans les universités ».
Et malheureusement, face à tous ces avatars du « dualisme de l’officiel et du réel », la plupart des médias français ont majoritairement joué, au mieux, la carte du silence et, trop souvent, celle de la complicité. Ce que documente en particulier le chapitre étonnant signé par le journaliste camerounais Jean-Bruno Tagne, « De la presse coloniale au journalisme sous contrôle : la fabrique de l’information » (où il pointe notamment le « goût prononcé de nombreux chefs d’État africains pour les gourous parisiens de la communication »). Et, tout aussi étonnants, les encadrés consacrés à Pierre Biarnès, correspondant du Monde à Dakar de 1959 à 1983 et aux petits soins avec le contre-espionnage français, ou à l’inamovible hebdomadaire Jeune Afrique, dont le fondateur Béchir Ben Yahmed fut pourtant dénoncé dès 1971 comme le « complice d’un système odieux qui méprise l’Afrique et les Africains ».
On l’aura compris, pour décrypter tout ce que cherche à masquer cette « fabrique de l’information », la lecture de ce livre offre le précieux antidote d’une « contre-histoire » dont on ne saurait trop recommander la prescription7. Comme l’a fait dans un tweet du 12 janvier 2022 l’écrivain Alain Mabanckou, qui voit très justement dans cet « ouvrage salutaire » le « procès le plus détaillé, avec les charges les plus argumentées contre la politique africaine de la France, mais aussi la complicité active des monarques du continent noir ». Mais il faut le souligner : cette réaction de bon sens isolée tranche avec le silence médiatique qui a massivement accueilli le livre (à l’exception de Mediapart). Un silence qui témoigne en creux à quel point la Françafrique n’est pas « morte » : pour l’immense majorité des médias français, malgré l’importance de la question, il s’agit au mieux d’un « nid d’embrouilles » trop compliqué à gérer ou, plus grave, d’un « non-sujet » puisqu’au fond les constantes « civilisatrices » de la belle époque du « temps des colonies » sont toujours là…
Et pourtant, ce livre offre toutes les clés pour comprendre la montée actuelle du « sentiment antifrançais » qu’expriment de plus en plus ouvertement les jeunes Africains qui manifestent aux cris de : « France dégage ! » Et pour comprendre aussi la stupéfiante permanence, au sein des élites françaises, du fameux « complexe de Fachoda », du nom de cette localité du nord-est de l’Afrique où les troupes françaises furent contraintes en 1898 de reculer face aux troupes britanniques, les unes et les autres engagées dans une féroce concurrence pour la conquête coloniale du continent. Près d’un siècle plus tard, l’obsession de cette défaite jamais digérée est à l’origine du soutien aveugle apporté par François Mitterrand au régime génocidaire rwandais, qu’il estimait menacé par les puissances anglo-saxonnes qui soutiendraient les rebelles tutsis. C’est ce que montre ce livre en rappelant que, dès 1957, François Mitterrand était convaincu que les colonies françaises d’Afrique étaient moins menacées par le « désir d’indépendance » de leurs populations que par la « rivalité entre les blocs français et britanniques ». Et en soulignant qu’en 2021 encore, les conclusions en demi-teinte de la commission Duclert chargée par Emmanuel Macron d’« analyser le rôle et l’engagement de la France au Rwanda » au cours de la période 1990-1994, ont attesté que les dirigeants de la Ve République n’étaient toujours pas libérés du « syndrome de Fachoda », au cœur des fondements inconscients de la Françafrique.
Un livre seul ne pourra évidemment en finir avec cet « empire qui ne veut pas mourir » (titre ô combien pertinent). Mais celui-là, plus que bien d’autres, apporte incontestablement une contribution majeure à tous ceux qui, en Afrique comme en France, continuent à se mobiliser contre cette obscène survivance d’un autre âge.
- [I) La Françafrique en germe (1940-1957) ; II) Des indépendances piégées (1957-1969) ; III) La folie des grandeurs (1969-1981) ; IV) La fausse alternance (1981-1995) ; V) Dévoilement et camouflages (1995-2010) ; VI) Le temps de la « reconquête » (2010-2021).
- Entre-temps, on aura appris que le terme de « Françafrique » n’est pas une invention, comme on le dit souvent, du futur premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny en 1955, mais, dix ans plus tôt, d’un journaliste de L’Aurore, préoccupé par le maintien d’une « communauté française » qui prolongerait l’essentiel de la puissance de l’empire colonial français, mise en cause par la volonté d’autonomie des peuples colonisés.
- Scoop ironique au passage : la reproduction (p. 97) d’une carte néocolonialiste sidérante illustrant le compte rendu, dans le premier numéro de l’hebdomadaire de gauche L’Express (16 mai 1953), d’un livre célébrant le projet d’« Eurafrique » et présentant l’Afrique comme le « Far-West de l’Europe ».
- Voir François Gèze, « La doctrine de la “guerre révolutionnaire”, genèse, mise en œuvre et postérité », blog Mediapart, 25 mars 2020.
- Voir Rémy Carayol, « Aux origines coloniales de Barkhane (1). Dans l’armée française, un imaginaire colonial omniprésent », AfriqueXXI, 10 janvier 2022.
- Voir à ce sujet l’édifiant témoignage de l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Choix de l’Afrique. Les combats d’une pionnière de l’histoire africaine, La Découverte, Paris, 2021.
- On ne saurait trop recommander à l’éditeur d’élargir l’audience de cet exemplaire travail collectif en publiant rapidement une édition de poche réunissant les introductions aux six parties, dont la lecture (plus facile et rapide que celle des 971 pages de l’édition princeps) permet d’accéder à une vertigineuse synthèse de l’histoire de cette Françafrique « qui ne veut pas mourir ».