Dans La première guerre d’Algérie. Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, à paraître à La Découverte le 3 octobre 2024, l’historien Alain Ruscio s’attaque à une séquence de l’histoire de l’Algérie coloniale beaucoup moins étudiée et commentée que celle de la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) : sa conquête militaire par la France au XIXe siècle, durant « deux décennies d’affrontements d’une intensité et d’une violence extrêmes », retracées en 784 pages s’appuyant sur une masse considérable de sources souvent inédites. Nous publions ici la conclusion de ce livre, dans laquelle l’historien dresse avec précision le terrible bilan de cette première guerre coloniale d’Algérie en soulignant qu’en 132 ans la France ne parvint jamais à soumettre entièrement la résistance des colonisés.
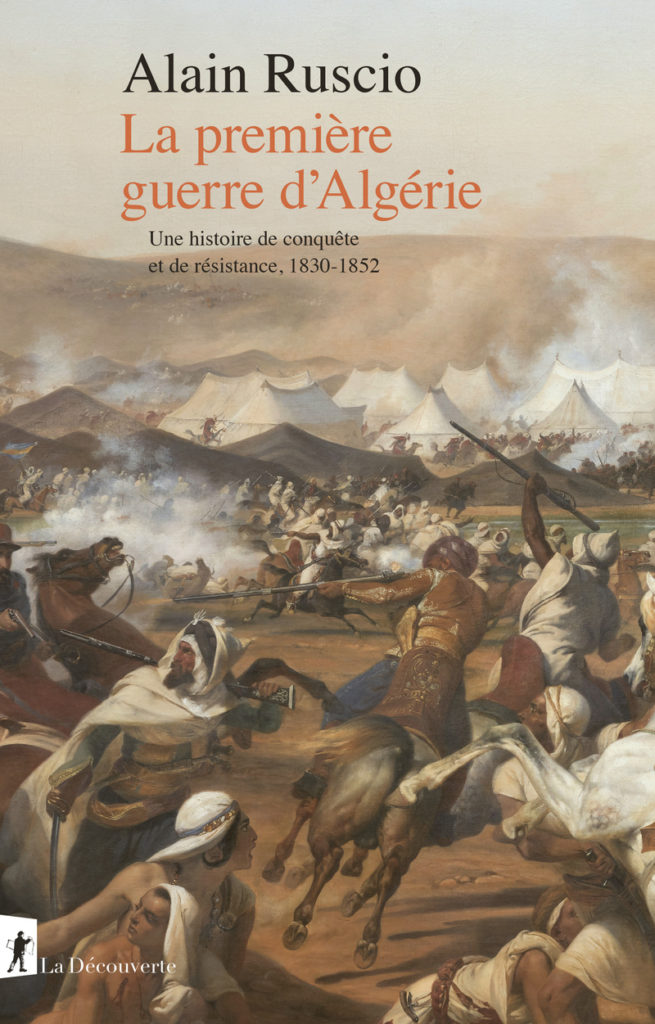
Extrait de La première guerre d’Algérie. Une histoire de conquête et de résistance (1830-1852)
(La Découverte, 2024) par Alain Ruscio
CONCLUSION
En 1891, une délégation d’honorables sénateurs, dirigée par le très colonialiste Jules Ferry, se rendit en mission en Algérie (délégation déjà citée). Elle auditionna un conseiller de Constantine, Taieb Morsly, médecin, moderniste, occidentalisé :
« Nous sommes en Algérie quatre millions d’indigènes musulmans. Nous vivons au milieu d’un demi-million d’Européens dont la moitié à peine de citoyens français. Or, ces derniers ont seuls la direction et, pour ainsi dire, le monopole des affaires du pays, portant tout le profit. À eux les conseils municipaux, généraux et le Conseil supérieur du gouvernement ; à eux les emplois, les offices, les gros et les petits traitements. À eux les finances, les budgets, les allocations, les millions que la munificence de la France jette chaque année en Algérie. À eux les concessions, les meilleures terres, les villes, les villages, les fermes. À eux tout, à nous rien. Pourtant, nous sommes seize fois plus nombreux et – toute proportion gardée – nous payons en contributions de toutes sortes au moins le double ou le triple[1]. »
Une telle situation pouvait-elle être marquée du sceau de l’éternité ?
Pour l’Algérie : Vingt années de guerre, une société frappée de plein fouet… « mais les Arabes restent debout » (Bugeaud)[2]
Il serait de la dernière indécence d’établir une liste des peuples qui ont le plus souffert des guerres et des occupations depuis les origines de l’humanité. Les massacres de masse, les éradications, les génocides – terme employé seulement à partir du XXe siècle – ont émaillé toute son histoire. Il n’est pas une région du monde qui y ait échappé, à un moment ou à un autre.
Dans cette triste liste, la population algérienne a pris une place dont elle se serait certes passée. Mais, à la grande surprise des nouveaux maîtres du pays, elle ne cessa d’envoyer des signaux de vitalité, de résistance.
La première guerre d’Algérie, ce fut, d’abord, pour les populations, un cataclysme démographique, dû évidemment aux combats, mais aussi, mais surtout, à leurs conséquences pour toute la société.
Il est – et il sera définitivement – impossible de savoir combien d’habitants vivaient sur la terre d’Algérie en 1830. La notion même de recensement était relativement récente en Europe, et les méthodes étaient rudimentaires. A fortiori en Algérie. L’Empire ottoman, puissance naguère dominante, avait bien un certain contrôle de la population, ne fût-ce que pour des raisons fiscales. Mais les liens avec les tribus éloignées des villes, en particulier des nomades, devaient être lâche. De plus, la brutalité et la soudaineté de la prise d’Alger fit qu’une grande partie des archives du dey disparut ou fut détruite. Lorsque la domination française s’y établit, la méfiance innée des dominés face à toutes les initiatives des dominants fut un facteur aggravant. Méfiance justifiée : ils savaient confusément que les recensements étaient un moyen de contrôle politique, associé à une arme économique, là aussi en particulier fiscale (et, plus tard, un outil de recrutement de soldats).
Dans ces conditions, il est normal de constater que les estimations globales de populations ont considérablement varié[3]. Pour l’Algérie de 1830, les chiffres avancés ont été de 780 à 800 000[4] jusqu’à 3 ou 4 millions[5]. Ces divergences n’étaient pas seulement techniques. Les militaires avaient tendance à surestimer le nombre des Algériens, sans doute pour justifier les appels incessants à de nouveaux renforts – et donc à de nouveaux crédits – et la difficulté qu’ils avaient à vaincre. Bugeaud en personne expliqua aux députés qu’il y avait « quatre millions d’Arabes, tous guerriers, tous parfaits cavaliers », de l’enfant au « vieillard de 93 ans[6]. » Légère exagération. D’autres avancèrent le chiffre de 8 millions et, donc, de 6 à 700 000 « guerriers redoutables »[7]. A contrario, les colons voulaient minimiser cette population, afin de présenter une Algérie peu habitée, terre quasiment vierge destinée en conséquence à accueillir un grand nombre de nouveaux arrivants européens. Il fallut attendre la fin du siècle pour parvenir à une étude documentée, menée par le Dr René Ricoux (1843-1933), chef des travaux de la statistique démographique et médicale auprès du gouvernement général de l’Algérie, qui retint une estimation de 3 millions d’Algériens en 1830[8]. Les travaux historiques ultérieurs approchèrent ou entérinèrent cette estimation (2,5 millions André Nouschi[9] ; 3 millions, Xavier Yacono[10]). L’étude la plus récente, la plus documentée (et la plus convaincante), due à Kamel Kateb (2002)[11], retient le chiffre de 4 millions.
Franchissons un quart de siècle, soit peu de temps après la période étudiée ici : le premier recensement qui mérite d’être retenu, bien que toujours approximatif et ne couvrant pas tout le territoire qui sera l’Algérie française à son apogée (il manquait le grand Sud et la grande Kabylie) date de 1856. Il y aurait eu à ce moment 2,310 millions d’habitants musulmans sur les territoires effectivement contrôlés[12]. André Nouschi, dans sa thèse sur le Constantinois, se livra à une méticuleuse reconstitution pour aboutir à la conclusion que la région étudiée était passée de 1,2 millions d’habitants à 934 210 en 1849[13]. Une diminution absolue en un quart de siècle, soit une génération, voilà un phénomène rare, d’autant qu’il y eut évidemment – et tout de même – des naissances durant ces décennies ; la natalité des populations algériennes était alors forte, même si la mortalité infantile fauchait bien des vies). Cela confirme combien la période fut une épreuve pour les populations, quoique ce recul ne puisse être attribué à la seule conquête : il y a eu, durant cette période, des migrations vers des terres musulmanes (hijra*), Maroc à l’ouest, Tunisie (puis départ vers le Levant) à l’est. Statistiques à jamais inaccessibles[14].
C’est tout de même très majoritairement l’état quasi permanent de guerre – avec ses effets directs et indirects – durant deux décennies qui peut expliquer cette baisse. À l’ère coloniale, où cet exercice fut rare, on trouve tout de même sous la plume du même Dr Ricoux un chiffre précis : entre 1830 et 1872, il y aurait eu 874 949 décès d’indigènes, soit 20 000 par an[15].
Chez les chercheurs contemporains, cet exercice a entraîné des controverses interminables. Daniel Lefeuvre a proposé de retenir une fourchette entre 250 et 300 000 morts pour la conquête, sans précision de dates[16] ; Jacques Frémeaux avance l’estimation de 400 000 victimes pour la période 1830-1856[17] ; Kamel Kateb a proposé, pour la période 1830-1872, un ordre de grandeur de 825 000[18] ; enfin, Djilali Sari est le seul à estimer qu’il y aurait eu un million de morts[19]. Une autre façon de procéder a été la (tentative) de comparaison entre la population de Tunisie et celle de l’Algérie, pour la période 1830-1880. Si la seconde avait connu une progression normale, semblable à celle de sa voisine, elle aurait été plus élevée, dans des proportions de 11[20] à 17 %[21].
Combien de ces Algériens perdirent-ils la vie lors des combats avec l’armée française, en quelque sorte dans les conditions normales d’une guerre ? Une stricte minorité, en tout état de cause. En 1960, André Prenant estimait qu’ils furent entre 20 et 30 000[22] ; Kamel Kateb pense qu’ils furent 75 000[23]. Pour ce dernier chercheur, il y aurait donc eu 750 000 Algériens non combattants morts soit lors des répressions, soit du fait de maladies ou famines. Une proportion rare dans les conflits au cours des temps : un mort au combat pour dix morts par effets collatéraux.
Revenons aux chiffres globaux. Nous avons choisi de retenir l’étude de Kamel Kateb, qui nous paraît solidement étayée : 825 000 morts de 1830 à 1872. Si l’on retient cette estimation, on peut penser que la période que nous étudions, plus courte, mais marquée par les violences de la conquête, a pu coûter la vie à 400 à 500 000 Algériens. Si l’on retient, comme Kateb, une estimation originelle 4 millions, cela représente tout de même entre 10 et 12,5 %. On est donc en présence de l’une des plus grandes pertes démographiques de l’histoire moderne. Dans les guerres classiques, opposant deux armées, les taux ont toujours été nettement inférieurs : ce que d’aucuns appellent l’épopée napoléonienne a coûté à la France de l’ordre de 900 000 à un million d’hommes, entre 3 % et 3,5 % de sa population ; la Première Guerre mondiale, épouvantable face à face de quatre années, coûta à la France 1 700 000 de ses enfants, 3,5 à 3,7 % ; quant à la seconde guerre d’Algérie, même si les chiffres sont l’objet aujourd’hui encore de controverses, une certitude s’impose : il y eut en proportion plus d’Algériens morts durant la phase de conquête que de 1954 à 1962.
Ajoutons-y une conséquence perverse tout aussi grave : la dispersion des tribus et des familles freina considérablement les processus naturels dans toutes les sociétés, la formation de couples et la naissance d’enfants. Bien des militaires français qui arrivaient dans les villages constataient qu’il y avait peu d’hommes adultes (cachés ou partisans de l’Émir ?) Un sondage portant sur les populations indigènes, durant les années 1845-1850 fait apparaître une nette excédent des taux de mortalité (48,8 ‰) sur les taux de natalité (32,4 ‰)[24]. De ce fait, le déficit démographique s’étala bien après la fin des combats[25].
Par souci de ne pas dépasser les limites chronologiques de notre essai, nous ne citerons que pour mémoire les grandes famines postérieures, dont la plus terrible, en 1867-1869. Le redressement vint après l’ère des calamités. Les progrès de la vaccination et de l’hygiène entraînèrent une chute de la mortalité, alors que la natalité était – ou redevenait – l’une des plus élevées du monde. Au recensement de 1886, la population indigène (3,9 millions) approcha – enfin – le chiffre de 1830.
Outre les effets directs des désastres de la guerre, il faut évidemment, et hélas, évoquer l’une des pires conséquences de la présence européenne : les épidémies galopantes.
Pour les Européens arrivés, puis installés, en Algérie, la faiblesse du réseau médical, tant militaire que civil, l’état épouvantable des hôpitaux, ont été un des grands drames des premières années[26]. Dans ces conditions, les populations autochtones furent quasi totalement abandonnées à l’état déplorable dans lequel elles vivaient avant la conquête. Il y eut toutefois une tentative de réaction des autorités. Un décret, le 12 avril 1845, instaura les infirmeries indigènes, qui se déplaçaient de tribu en tribu et commençaient à pratiquer la vaccination, en particulier antivariolique. Mais les consultations étaient encore rares : 4 143, par exemple, pour l’année 1848[27]. Il fallut attendre 1860 pour que paraisse un premier Vocabulaire français-arabe à l’usage des médecins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens, herboristes, etc., œuvre d’un médecin très attentif aux maux de la société algérienne, Émile-Louis Bertherand (1821-1890). De ce fait, des maladies endémiques, implantées depuis des siècles, malaria, typhus, syphilis, ne furent pas à ce moment combattues, encore moins endiguées. Les premiers médecins français ne purent que constater, désolés, les manquements criants à l’hygiène, source de surmortalité, en particulier infantile.
Mais il y eut pire. Un facteur aggravant de dépérissement démographique fut la propagation de maladies auparavant inconnues ou peu répandues en terre algérienne. Un mal nouveau répandit la terreur : le choléra, importé, on l’a vu, par des colons français et espagnols. Deux médecins, Vincent et Collardot, comptabilisèrent neuf épidémies entre son apparition en terre algérienne en 1834 et 1865 (l’ouvrage fut publié en 1867)[28].
Le 20 novembre 1849, le Journal des débats donna cette information étonnante à ses lecteurs à propos d’une épidémie à Oran : « Le choléra décime aussi les Arabes », suivie de cette formule maladroite – mais si révélatrice : « On parle de 700 décès militaires déclarés et 3 700 civils, sans y comprendre les décès non connus de la mosquée, des juifs et des Maures[29]. » Les conditions de vie et d’hygiène, la promiscuité dans des espaces clos et peu aérés, la méconnaissance des précautions élémentaires de protection, les déplacements de populations accentués par les campagnes de l’armée, firent que les indigènes furent plus frappés que les Européens. Phénomène accentué par l’absence d’assistance médicale. Les médecins, déjà impuissants lorsqu’il s’agissait de soigner les Européens, laissa les indigènes musulmans et juifs quasiment sans protection. Deux d’entre eux, les docteurs Vincent et Collardot, constatèrent qu’il y avait cinq fois plus de décès chez les juifs que chez les Européens ; on peut penser qu’il en fut de même chez les musulmans[30]. Lorsque la maladie se déclarait, apportée à son corps défendant dans un douar* isolé par un indigène de retour de la ville, elle fauchait parfois la quasi-totalité des habitants. Lors de la seconde grande pandémie, le fléau tourna « toute sa fureur contre les tribus arabes », certaines étaient « littéralement dépeuplées » (témoignage du Dr Paul)[31]. » Au même moment, le général commandant la division de Constantine était alarmiste : « Des douars entiers ont disparu, on a vu les gardiens des troupeaux tomber et mourir abandonnés au milieu des champs », certaines tribus sont anéanties, etc.[32].
Bien différent fut le cas de la tuberculose. Contrairement au choléra, la maladie existait en Afrique du Nord avant la colonisation, mais était peu développée, comme le notait un médecin militaire en poste depuis les premiers jours : « À population égale, la phtisie est plus rare à Alger que dans la plupart des villes de France[33]. ». Alger n’était d’ailleurs pas forcément le meilleur exemple, les zones rurales étant plus épargnées encore. D’après un autre médecin en poste à Alger, Casimir Broussais (1803-1847), fils du célèbre chirurgien, il y avait, dans la décennie 1840, moins de 1 % des décès d’indigènes dus à cette maladie[34]. Dans le Constantinois, le taux devait être de même niveau : André Nouschi, dans sa grande enquête sur la région, ne trouva aucune référence dans les premiers rapports des médecins français[35]. Une étude globale, portant sur 32 années de présence dans l’Algérie entière, comptabilisa, par tranche de 100 décès de la tuberculose, 85 morts d’Européens (dont 49 de Français) et 15 d’Algériens[36]. Cependant, de premiers cas de progressions du mal furent signalés par le professeur Guillaume Ferrus dès 1844. Lors de la période étudiée ici, les ravages seront pourtant limités. Ils seront par contre considérables dès les années 1860-1870[37], exploseront à la fin du XIXe siècle[38] et, plus encore, au suivant.
Autre conséquence, pour les indigènes, de l’état quasi ininterrompu de ce cycle d’affrontements guerriers : la faim, versant facilement, dans certaines régions et à certaines époques, vers les famines.
Avant la présence française, le phénomène existait certes en Algérie, mais il n’était ni généralisé, ni permanent. L’étude d’André Nouschi pour le Constantinois (il est vrai la région la plus riche de l’Algérie) précolonial montre que les paysans mangeaient à peu près à leur faim (les silos à grains y contribuaient grandement), consommaient de la viande à quelques occasions, trois fois par mois en moyenne[39].
La période étudiée ici fut pour l’alimentation au quotidien des populations conquises, parmi les pires : les terres, abandonnées, n’étaient pas encore cultivées par les colons, et ne le furent qu’à un rythme lent. De ce fait, des milliers d’hectares passèrent de l’état de cultures à celui de friches. Celles qui étaient restées cultivées étaient souvent la proie des flammes avant le passage des colonnes (lorsque les indigènes avaient le temps de les voir venir) ou après ce passage (les soldats ayant la consigne de brûler champs et rares réserves). Des milliers d’hectares de céréales devinrent des champs de cendres. Furent également la proie des prédateurs, par incendies ou abattages, les arbres fruitiers, les figuiers, les oliviers et les palmiers. Même des hauts fonctionnaires civils, par ailleurs fermes partisans de la conquête, s’en émurent. En une seule campagne, le général Baraguay d’Hilliers avait brûlé 5 000 oliviers ; le sous-directeur de la province de Philippeville et Constantine qui, lui, devait veiller à l’avenir de la région, au moins à moyen terme, se lamentait : « Si nous appauvrissons le pays d’avance, qu’en ferons-nous quand nous l’aurons ? ». Prudent, il ajoutait : « Si nous l’avons[40]. »
L’appauvrissement, et souvent la disparition, de l’approvisionnement en céréales furent un drame. La pratique de préserver une partie des récoltes dans des silos était dans toutes les régions méditerranéennes multiséculaire. Les archéologues en ont retrouvé des traces datant d’avant même la conquête romaine[41]. Cette pratique était certes une protection contre les raids de voleurs, mais aussi, mais surtout, permettait de surmonter les disettes dues à des périodes de mauvaises récoltes. Tous les témoins de l’ère de la conquête française constatèrent que, dans les plaines céréalières, les silos étaient nombreux et bien entretenus. Parcourant la région de Mascara en 1833, le duc d’Orléans y vit « des silos tous les cinq cents pas » sur des kilomètres[42]. Pellissier de Reynaud ne cacha pas son admiration devant ces collectivités agraires qui avaient construit « en grand nombre dans la même localité » ces silos « avec un art admirable », permettant la conservation des grains, mais aussi du beurre, de l’huile, de la graisse, du miel, du sel, etc.[43] Ce réseau fut l’objet de deux types de destruction. Souvent, lorsque les habitants d’un douar* virent une troupe ennemie s’approcher, ils incendièrent ces silos, afin de ne pas leur livrer de nourriture. Et effectivement, quand les Français en trouvèrent, ils s’en emparèrent pour leurs propres besoins. Les vivres et marchandises non consommés étaient ensuite détruits par le feu, pratique de toutes les armées d’occupation. Une génération entière de fellahs* vit disparaître la base de se nourriture, semoule ou galettes. Comme, de surcroît, les nouveaux maîtres accaparaient ce qui restait de nourriture carnée pour leurs propres besoins, il ne restait plus grand-chose pour les indigènes. La faim fut désormais la compagne de ces masses d’êtres faméliques. En 1841, Alexis de Tocqueville avait justifié les incendies de moissons et les réquisitions de silos (« Ce sont là des nécessités fâcheuses »)[44]. Cinq années plus tard, traversant la région du Dahra – encore traumatisée par les enfumades – il se lamentait des conséquences pourtant prévisibles de ces « nécessités » :
« De tous côtés on venait demander du grain. La famine règne dans la province d’Alger et sévit d’une manière horrible dans celle d’Oran. Vivre est le seul soin qui préoccupe en ce moment tous ces pauvres gens-là. Ils ne songent qu’à se procurer des semences et à cultiver[45]. »
Vingt années après la conquête, la situation était plus que précaire dans ces campagnes. Le gouverneur général, le général de Martimprey, le constata :
« La population meurt littéralement de faim. La population est devenue herbivore. Une mortalité affreuse en est la suite. Depuis les vieillards jusqu’aux enfants à la mamelle, on ne trouve partout que des visages extenués[46]. »
« Littéralement » morts de faim ? Non, réellement. La famine toucha un nombre considérable de familles paysannes. Les décès, survenus en zones pas ou peu contrôlées par l’occupant, ne purent être comptabilisés ; dans les zones françaises, les Algériens enterraient les leurs sans forcément le signaler aux responsables, et ces derniers n’avaient pas comme soucis prioritaires cette comptabilité macabre.
Car que pouvaient devenir ces paysans, de loin les plus nombreux au sein de la population algérienne ? Ils eurent le choix entre une mauvaise solution, un mal relatif et un mal absolu. La mauvaise solution fut une réimplantation dans les quelques zones non (encore) occupées par les colons. Le mal relatif était l’acceptation du rôle d’ouvriers agricoles dans les colonies européennes, parfois sur leurs anciennes propriétés, pour quelques bas salaires. La troisième était l’exil vers le sud, vers des terres arides.
Première catégorie. Un temps, des familles des plaines purent conserver leurs terres, y perpétuer les pratiques ancestrales, alimenter les marchés ruraux, parfois commercer petitement avec les civils européens, voire avec les militaires. Mais elles souffrirent des inégalités abyssales avec les paysans européens. Dans le Constantinois en 1865[47], la valeur moyenne des instruments agricoles possédés par un colon était de 60,74 francs ; pour un indigène, la valeur était de 0,84 franc. L’estimation de la valeur des constructions constatait le même phénomène : 1 594,15 francs pour un colon, 27,26 francs pour un fellah*. Une famille de colons possédait en moyenne 91,31 arbres, celle d’un fellah* 1,32, etc.[48]
La seconde catégorie fut la minorité qui se résigna à venir travailler dans les zones contrôlées par l’armée française. Pour les colons, cela tombait bien, en quantité (les bras manquaient) et en qualité (le savoir-faire des fellahs* fut le bienvenu). En 1844, le périodique L’Algérie, maintes fois cité, estima qu’il y avait « 3 000 indigènes, Arabes ou Kabyles, employés dans les villages ou dans les fermes des colons »[49] . Il y avait à ce moment à peu près 8 000 colons[50], donc de l’ordre de 2 000 familles. On peut donc avancer l’hypothèse qu’au moins un « Arabe ou Kabyle » accompagnait à ce moment le travail de la terre dans la majorité des familles. Aux alentours de Bône en 1844, dans un rayon de 20 km, toutes les terres appartenaient à une dizaine de colons… qui n’y résidaient pas. Tout le travail de la terre était effectué par des indigènes[51]. Les éléments les plus fermés du monde colon trouvèrent tout naturel le retour de paysans indigènes. Le colon-aventurier déjà cité, le comte de Raousset-Boulbon, estima qu’il s’agissait là d’un processus logique : ces indigènes évincés de leurs terres pouvaient fort bien y revenir comme ouvriers. Ils y seraient bien accueillis[52]. Et pour cause : les salaires proposés étaient dérisoires. La population algérienne est « peu portée au travail », mais son apport est nécessaire, écrivait pour sa part André Cochut, chroniqueur régulier de la Revue des Deux Mondes. « On obtient facilement des pâtres ou des manœuvres à raison de 1 franc 50 centimes à 2 francs par jour, y compris le pain qu’on a coutume de leur donner, et qui fait le fond de leur subsistance ». Cochut se donnait bonne conscience en affirmant que, « malgré la modicité de leurs salaires, [ils] coût[ai]ent plus cher que les Européens » tant ils étaient lents[53].
Au milieu des récriminations innombrables sur la fainéantise des indigènes, il y eut des éclairs de lucidité. Comment, interrogea le Dr Vital, médecin de colonisation, « un malheureux, qui, après s’être allaité dans son enfance à une mamelle à moitié tarie, n’a ensuite qu’une mauvaise galette d’orge pour se nourrir », pourrait-il avoir le même rendement qu’un agriculteur européen ?[54]
Le général Daumas, officier des Bureaux arabes (et hostile aux spéculateurs), décrivait ainsi le processus :
« L’Arabe, ne sachant où aller planter sa tente, vient le lendemain trouver l’Européen qui, par droit de concession, est sur son champ, lui loue moyennant cent francs la même étendue pour laquelle il ne touche que dix francs d’indemnité du gouvernement (quand il en touche) et se met à la culture faute de mieux. Et l’on appelle l’Européen un “colon effectif“ et l’Arabe un “obstacle à la civilisation“ ! Ceci peut paraître étonnant ; mais je n’exagère pas […]. En présence de ces observations, il est difficile de croire que les indigènes aient jamais été, soient maintenant ou puissent être à l’avenir un obstacle à la colonisation, puisqu’ils ont toujours été les véritables travailleurs et que la plupart des nombreux acquéreurs des plus belles fermes de la Mitidja se contentaient de leur en louer quelques portions et de faucher du foin sur le reste ; eux seuls labouraient et faisaient de la culture : culture imparfaite, il est vrai, mais qui enfin vaut mieux que l’absence complète de tout travail[55]. »
La dernière catégorie fut celle des familles refoulées vers le sud, ayant parfois réussi à se réinstaller sur des terres infiniment moins riches en des contrées inconnues, inhospitalières. Même une commission officielle envoyée en Algérie en 1849 en convenait et le déplorait :
« Beaucoup de ces malheureux ont été harcelés par les refoulements réitérés, par les cantonnements qu’on leur disait être définitifs et qui étaient changés à chaque instant. Ils regardaient comme si insuffisantes et si précaires les compensations qu’on leur offrait (comme on offre aux faibles) qu’ils sont retournés à la montagne où se sont acheminés vers le désert pour y rejoindre les populations insoumises[56]. »
Ce ne fut pas là le fruit de la fatalité. On a déjà abondamment cité le discours-programme de Bugeaud, le 15 janvier 1840, un an avant son mandat de gouverneur général. Il faut y revenir car, outre les aspects proprement militaires, le général exposa à ses collègues sa conception de la guerre à mener « à la population ». En Europe, avait-il commencé, nous pouvons vaincre les armées ennemies, occuper les villes, saisir le commerce, les douanes, l’industrie, etc. Mais il déplorait qu’il n’y ait en Algérie « ni villages, ni fermes » à saisir. Pourtant, il y avait bien une activité agricole, « on sem[ait] des grains, on fai[sait] des récoltes, il y a[vait] des pâturages ». Pour poursuivre par une formule lourde de menaces : « Il faut bien s’en prendre à quelque chose ». Suivait un plan méticuleux : la « mission » de nos troupes n’était pas de « courir après les Arabes, ce qui est fort inutile, car on ne les atteint que quand ils le veulent bien », mais de les « empêcher de jouir de leurs champs ». Il fallait donc leur interdire « de semer, de récolter, de pâturer ». Par définition, une tribu qui n’a pu semer sera obligée de quitter sa zone ». Une fois une zone sécurisée par cette méthode, il fallait s’attaquer à une autre. Que feront alors les tribus ainsi privées de moyens de subsistances ? Elles se dirigeront vers le sud :
« Dans les déserts, on ne récolte pas de grains. […] Les Arabes pourront fuir dans le désert à l’aspect de nos colonnes, mais ils ne peuvent y rester. Ils seront obligés de capituler et, lorsqu’ils viendront à nous, ce sera le moment d’obtenir des garanties. Vous leur demanderez alors leurs chevaux et leurs armes pour leur permettre de s’établir derrière vous sur leur ancien territoire. Et d’ailleurs, s’ils restaient dans le désert, je ne regarderais pas cela comme un très grand malheur, le terrain serait plus libre pour établir la colonisation européenne ».
« S’ils restaient dans le désert » : Rarement phrase plus cynique fut prononcée, sans semble-t-il de protestations au sein de la Chambre. C’était dire sous une forme adoucie : « S’ils mouraient dans le désert ».
Et pourtant, le peuple algérien survécut. Cette constatation, d’une affligeante banalité, n’alla pas de soi pour bien des observateurs de l’époque.
Tous, pourtant, ne s’y trompèrent pas. La vitalité, la capacité de résistance de ce peuple, étonna – et peut-être même inspira des sentiments mêlés de respect et de crainte – ses pires ennemis. Puisqu’il faut, encore et toujours, en revenir à Bugeaud, redonnons-lui la parole.
Le 5 février 1848, fraichement revenu de son long mandat, décrivit pour ses collègues députés la situation de l’Algérie[57]. Bien des Français étaient encore sous le coup de l’émotion, et pour beaucoup de la joie à la nouvelle de la reddition de l’Émir. Attention, prévint celui qui venait de quitter le théâtre d’opérations :
« L’événement heureux qui a donné de nouvelles garanties à notre possession en Algérie a éveillé des espérances bien naturelles de voir enfin alléger les charges du pays. Nul plus que moi n’a désiré et ne désire encore ce résultat. Cette considération, quoique d’un ordre très élevé, ne m’empêchera pas de dire avec franchise que la chute du Jughurta moderne ne vous dispense pas de prudence. [formule déjà citée] Abd-el-Kader est tombé, mais les Arabes restent debout. Quoiqu’en disent certaines statistiques faites dans les bureaux de Paris, ils sont plus nombreux qu’on ne le croit ».
Le maréchal enchaîna sur la valeur guerrière des Arabes, maniant le fusil « depuis l’âge de quinze ans jusqu’à quatre-vingts, et même quatre-vingt-dix ans », un pays capable, donc, de lever « cinq à six-cent mille hommes capables de faire la guerre ». Il y avait bien sûr dans son discours une part de gloriole : moi, maréchal Bugeaud, j’ai commandé l’armée capable de refouler un tel peuple. Mais après moi ? Il renouvelait en conclusion sa mise en garde : « Nous devons rester devant eux toujours forts et vigilants. Une telle nation, Messieurs, n’a pas courbé la tête à toujours ». Il arriva parfois que les pires ennemis d’« une telle nation » lui rendent un hommage involontaire.
Pour la France : « Chère Algérie » (Daniel Lefeuvre) ou « Empire bon marché » (Denis Cogneau) ?
En 1984, le regretté Jacques Marseille (1945-2010) publia un essai novateur, démontant les thèses auparavant admises, dans le sillage d’un marxisme mécaniste et d’une application sans analyse du schéma léniniste de l’impérialisme[58] sur une réalité rétive, sur la place – dite importante par certains – de l’Empire colonial dans le développement du capitalisme français[59]. Non seulement cette place de l’Empire dans le commerce général de la France avait été minime et finalement peu fructueuse, mais elle s’était appuyée sur les secteurs vieillissants du capitalisme, les éléments modernistes des classes dirigeantes françaises ayant très tôt préconisé de se débarrasser de la façon ancienne de gérer ces territoires. La décolonisation à la française, faite de heurts et de conflits (de 1945 à 1962) avait même retardé de façon dramatique la modernisation en question. D’où le sous-titre, « Histoire d’un divorce ».
Vingt années plus tard, le tout autant regretté Daniel Lefeuvre (1951-2013), ami et collègue de Jacques Marseille, publia à son tour un essai brillant, présentant, avec un argumentaire charpenté, la terre algérienne comme ayant finalement entravé l’essor et surtout la modernisation de l’économie française. L’essai, habilement titré, Chère Algérie[60], jouait sur les deux sens du mot. Oui, cette Algérie fut chère au cœur de bien des Français durant 132 années – et l’est restée pour beaucoup –, mais elle avait finalement bien plus coûté à la collectivité qu’elle n’avait rapporté. Ce « joyau de notre Empire » avait non seulement été un « fardeau », mais s’était révélé « de plus en plus lourd »[61]. Curieusement, l’essai ne portait que sur les dernières décennies de cette Algérie française (1930-1962). Nul doute que, pour son premier siècle, le déséquilibre financier ait été plus impressionnant encore.
Vingt années passèrent de nouveau avant la parution d’une étude, dont le titre d’emblée fut une négation des thèses de Marseille et Lefeuvre : Un Empire bon marché. L’auteur, Denis Cogneau, historien de l’économie, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales (EGESS), insista dès l’introduction sur « le faible coût pour la métropole » de cet Empire : un domaine immense, plus de vingt fois plus étendu que la France, avait au total « peu coûté au contribuable[62]. »
Les compétences des uns et des autres ne peuvent évidemment être mises en cause. Leurs sources statistiques, matière première de l’histoire économique, furent et sont à peu près les mêmes. Reste donc à comprendre et à confronter les logiques qui ont présidé à leurs travaux respectifs, en regrettant évidemment, humainement mais aussi pour la clarté du débat, que les deux premiers ne puissent plus répondre.
La France ne s’est pas enrichie (thèse de Marseille-Lefeuvre) ? Cela demanderait déjà bien des nuances. Dans l’espace : le système a de toute évidence été plus rentable en Indochine (riziculture et hévéas de Cochinchine, charbonnages du Tonkin) qu’au Tchad, au Maroc (phosphates) qu’en Haute-Volta… Dans le temps : l’Empire a été d’un certain secours lors de la crise dite de 1929. Sa fonction de « réservoir » (expression de Jacques Marseille)[63], de « béquille » (Denis Cogneau)[64] a alors joué un rôle, qui a permis à la France de tomber plus tard que ses voisins dans une dépression économique. Mais, globalement, l’Empire a souvent coûté. Une certaine pléthore administrative, comparée par exemple à ce que firent les Britanniques dans leur domaine colonial, est une première explication. Surtout, il fallut en permanence assurer l’ordre par l’envoi aux quatre coins de l’Empire d’expéditions punitives, puis l’entretien d’un appareil répressif militaro-policier coûteux, en tout, selon Denis Cogneau, 80 % du total des dépenses ultramarines faites directement par la métropole[65].
La mise en valeur des colonies françaises chère à Albert Sarraut au lendemain de la Première Guerre mondiale[66] a certes permis, c’était son objectif premier, de drainer vers la métropole matières premières et, moins massivement, produits finis. Mais elle a eu un prix. Les immenses chantiers des chemins de fer du Congo-Océan, du Tonkin – avec le fleuron du pont Doumer –, du Yunnan, les milliers de kilomètres de routes, la mise en place d’infrastructures, se sont chiffrés en centaines de millions de francs[67]. Donc, la France ne s’est pas enrichie, affirmèrent Marseille et Lefeuvre. Mais elle ne s’est pas appauvrie non plus, a répondu Cogneau : la « mise sous tutelle » de millions de km² « a peu demandé aux contribuables métropolitains. […] Le fonctionnement des états coloniaux a été principalement financé par les impôts prélevés sur les autochtones colonisés et sur les colons ou expatriés européens présents sur place, même si ces derniers ont bénéficié d’un traitement fiscal généreux. » Du fait de l’effet de masse, ce sont en réalité les « impôts prélevés sur les autochtones colonisés » qui ont été l’aliment essentiel de la fiscalité coloniale[68]. On a vu que Bugeaud, au fur et à mesure qu’il contrôlait terrain et populations, faisait entrer des sommes importantes dans les finances de l’État. En 1843, les indigènes figuraient déjà pour plus de la moitié dans les recettes[69], taux qui augmenta avec le temps[70] : entre 70 et 75 %, selon les années, à la veille de la Première guerre mondiale[71]. Pour compléter cette analyse de la rentabilité du système, il faut toujours garder en tête que les salaires de ces indigènes étaient faibles, voire inexistants (travail forcé).
La question centrale est bien : qui a financé la fameuse mise en valeur ? Dès les premiers temps de la conquête de l’Algérie, une grande partie des frais reposa sur la population indigène : plus de la moitié des impôts en 1843[72], proportion qui s’alourdira par la suite. « Ce sont les impôts arabes qui ont fourni à la colonie sa ressource la plus assurée et la plus progressive », devait constater plus tard Paul Leroy-Beaulieu, par ailleurs solide défenseur du principe de la colonisation. Après avoir cité les propos du gouverneur général Tirman allant dans le même sens, l’auteur concluait : « On ne saurait mieux faire l’éloge des impôts arabes au point de vue des services qu’ils rendent aux colons. Il ne faut pas oublier cependant que ces taxes sont lourdes »[73]. La fiscalité ne fut pas inégalitaire par accident, mais par nature. C’est ce que les grands juristes de l’Université d’Alger Émile Larcher et Georges Rectenwald, appelèrent plus tard (sur le mode de la dénonciation), « le prix de la défaite »[74].Le résultat fut résumé par un homme célèbre qui, malgré qu’il fût naguère détesté par les colons, n’était pas précisément un révolutionnaire : « Les populations arabes, kabyles et sahariennes fournissent l’impôt, et la population européenne le consomme » (Napoléon III, Lettre, 20 juin 1865)[75].
Reste ce qui nous paraît comme la faille la plus importante dans le raisonnement de Jacques Marseille et de Daniel Lefeuvre – et en cela nous suivons Denis Cogneau : la France ne s’est pas enrichie ; mais qu’est-ce que la France ? Un pays est constitué de groupes aux intérêts économiques bien déterminés. Si la France, globalement, en a retiré aussi peu de profits, quid de certains Français ? Quid des grands groupes capitalistes qui ont trouvé leur base d’envol sous les tropiques, à l’abri du drapeau tricolore ? Quid, par exemple, de la sidérurgie, qui a vendu aux gouvernements généraux des colonies les milliers de tonnes de fer qui ont servi à la mise en place du réseau ferroviaire ? Quid des actionnaires des Charbonnages du Tonkin, de la Société Le Nickel de Nouvelle-Calédonie ? Quid des gros colons, du clan Borgeaud en Algérie (viticulture) aux familles Michelin et Giscard d’Estaing en Indochine (plantations d’hévéas) ? Mais quid aussi de la masse des petits blancs, colons, commerçants, hôteliers, ouvriers, employés, cadres intermédiaires, parfois installés aux colonies depuis des générations, vivant souvent modestement, mais toujours infiniment mieux que la masse des indigènes ? « Tout colonisateur, a écrit un jour Albert Memmi, est privilégié, car il l’est comparativement, et au détriment du colonisé[76]. » L’addition de ces gros et petits bénéficiaires de la situation coloniale (Georges Balandier, voir chapitre 21) n’a jamais représenté une masse quantitativement considérable, mais suffisante toutefois pour former un groupe de pression et peser sur les choix de Paris. Globalement, l’État y trouva finalement son compte. Croit-on vraiment que ce commandant en chef des intérêts de la classe dominante, aurait laissé se poursuivre, cinq générations durant, une expérience qui coûtait ? Comment expliquer que, à partir de la décennie 1830, tous les groupes politiques au pouvoir, des Orléanistes à la première Chambre de la Ve République, en passant par les Républicains gambettistes, ferrystes, sarrautistes, doumeriens, etc., aient mené cette politique de présence outre-mer, aient justifié même jusqu’à l’absurde les expéditions de la décolonisation tragique ?
L’Algérie, c’est la France ?
Le 20 mars 1851, un député interrompit un orateur adverse avec ce cri du cœur : « L’Algérie, c’est la France ! »[77]. On a déjà cité ici la fière proclamation du roi des Français devant les députés – qui l’acclamèrent presque unanimement :
« Nos braves soldats poursuivent sur cette terre, désormais et pour toujours française, le cours de ces nobles travaux, auxquels je suis heureux que mes fils aient eu l’honneur de s’associer. Notre persévérance achèvera l’œuvre du courage de notre armée, et la France portera dans l’Algérie sa civilisation à la suite de sa gloire[78]. »
Il faut croire que cette éternité était bornée dans le temps. Cent trente-deux ans, cela compte à l’échelle humaine, mais peut finalement se dissoudre dans l’histoire d’une nation. Au milieu des deuils, des ruines et des pleurs, il n’y eut jamais de capitulation totale des populations algériennes. Les grandes figures, Abd el-Kader, Ahmed Bey, mais aussi Bou Maza, Bû Zyâne, dit Bouziane, des centaines d’autres, prêchèrent la révolte. Et furent écoutés et suivis. Ces résistants de la première guerre d’Algérie eurent des héritiers, Cent treize ans après la fière proclamation de Louis-Philippe, une organisation brusquement apparue dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, le Front de libération nationale, FLN, reprit la lutte armée. Au lendemain de l’insurrection, un homme politique, alors président du Conseil, Pierre Mendès France, ne lui céda en rien en ton péremptoire :
« On ne transige pas lorsqu’il s’agit de défendre la paix intérieure de la nation, l’unité, l’intégrité de la République. Les départements d’Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps et d’une manière irrévocable. […] Ici, c’est la France. »[79].
Étonnant parallélisme entre le monarque traditionnaliste du XIXe siècle (« désormais et pour toujours française ») et l’homme politique de gauche du suivant : (terre « français(e) depuis longtemps et d’une manière irrévocable »). Étonnant ? À la réflexion, pas tant que cela. Cinq générations de Français ont été éduquées, façonnées, dans l’esprit de ce lien entre deux entités, de part et d’autre de la Méditerranée, finissant par n’en plus faire qu’une : « Je ne sais pas ce que l’on entend par question algérienne. L’Algérie, c’est la France ; le nier, c’est fermer les yeux à la lumière » (Jules Favre, 1868)[80]. « Cette Algérie qu’on a proposé d’appeler la nouvelle France et qui, en réalité, est bien la France elle-même » (Jules Verne, 1885)[81].
Et cette terre, conquise par nos soldats au prix de leur sang, avait été mise en valeur par les efforts de nos colons, au point donc de devenir France. Il n’est pas un discours ministériel, pas un éditorial de la presse conservatrice, qui n’ai fait le bilan de ce « chef d’œuvre colonial »[82], sans s’apercevoir d’ailleurs de la contradiction entre ces deux pans de la propagande : un territoire pouvait-il simultanément « être France » et « chef d’œuvre colonial » de notre pays ?
Qu’importait. Désormais, pour l’immense majorité des Français, le « spectacle de deux races unies dans un même effort, attirées vers un même idéal de bonheur par le travail » était la preuve éclatante de « la grandeur de [notre] œuvre africaine et la preuve palpable de [notre] génie colonisateur », selon le gouverneur général Pierre Bordes en mai 1928[83]. L’apogée de la bonne conscience fut l’organisation des cérémonies dites du Centenaire de l’Algérie, en 1930[84]. Vocabulaire spécieux : il n’existait donc pas d’Algérie avant la présence française, le colonisateur avait été le démiurge faisant surgir des amas informes des villes et des cabanes des villes une société nouvelle, tendant vers la modernité. Cette année-là, on célébra plus la prise d’Alger que la prise de la Bastille.
Et pourtant, les cris d’alerte ne manquèrent pas pour secouer cette bonne conscience. En 1848, un officier, non nommé, de l’armée d’Afrique eut cette formule étonnante, lue à la lumière de toute l’histoire de cette colonisation : « C’est très beau de crier sur le forum d’Alger que nous sommes sur le territoire français », suivie d’une démonstration implacable : « Citoyens d’Alger ! Vous êtes moins en France ici que dans n’importe quelle colonie. […] Vous êtes quelques milliers à vous efforcer de croire que vous êtes en France ; les musulmans sont six cent mille combattants qui espère que vous serez expulsés[85]. »
La suite, sur le terrain, lui donna amplement raison. Il y eut des insurrections, spontanées ou organisées, massives ou localisées, de l’insurrection kabyle de 1871 à la révolte du Constantinois du printemps 1945, en passant par le coup de colère de Margueritte (avril 1901) ou la révolte des Aurès (novembre 1916). Tous mouvements réprimés, noyés dans le sang. Pourquoi s’inquiéter ? Les protestations en métropole – d’ailleurs peu écoutées – ou de rares Français d’Algérie – encore moins audibles – étaient le fruit de ces éternels intellectuels insatisfaits, hypercritiques, naïfs dans le meilleur des cas, agents de l’étranger dans le pire. Quant aux révoltes indigènes, inspirées par des meneurs fanatiques auprès de masses crédules et ignares, il suffisait de dures, mais nécessaires, répressions périodiques pour éloigner les périls.
Comment un tel système aurait-il pu être éternellement viable ? Le plus étonnant, lorsqu’on observe cette histoire – certes, avec la lucidité que permettent plusieurs décennies de reculs – est la cécité de tous les gouvernants français de 1830 à 1954 : sept régimes (Restauration, monarchie de Juillet, seconde République, second Empire, puis les troisième, quatrième et cinquième (cette dernière durant ses premières années) ont obéi à la même logique, exalté « l’œuvre de la France », répondu par la même violence aux aspirations des colonisés. À chaque fois, les esprits lucides auraient pu dire, comme le général Duval au terme du drame du printemps 1945 « Je vous ai donné la paix pour dix ans »[86]. Mais après ? On connaît l’après. Il ne fallut pas dix ans, mais neuf et demi.
Les circonstances – un tragique tremblement de terre dans la région d’Orléansville – firent que le ministre de l’Intérieur du cabinet Mendès France, François Mitterrand, se rendit en Algérie à la veille même de l’insurrection. Il reprit la traditionnelle litanie de l’Algérie terre française (« La présence française sera maintenue dans ce pays »[87]), assortie d’une nouvelle et tout aussi habituelle promesse de réformes[88]. Le Parti du peuple algérien-MTLD, toujours dirigé par Messali Hadj de son exil, l’interpela :
« L’Algérie n’est pas trois départements français. Au demeurant, avez-vous jamais été accueilli dans vos visites officielles aux départements français de Bourgogne ou de Normandie par exemple par un Gouverneur général ? Avez-vous jamais présidé à une Assemblée à double collège en Bretagne ou en Picardie ? Avez-vous jamais été reçu par des caïds aghas et bachagas aux burnous écarlates dans le Jura ou l’Aquitaine ? Avez-vous jamais été acclamé par des hommes asservis ou humiliés, spoliés et expropriés, privés de toutes les libertés démocratiques et de tous les Droits de l’Homme, souffrant de la mainmise de l’administration sur leur culte et de l’étouffement de leur langue ? […] Non, monsieur le Ministre, ce spectacle accablant n’existe pas en France. Donc, monsieur le Ministre, vous n’êtes pas en France. Vous êtes en Algérie[89]. »
Mais il n’obtint – évidemment – aucune réponse. La deuxième guerre d’Algérie commença deux semaines plus tard.
[1] Taieb Morsly, Contribution à la question indigène en Algérie, Imprimerie Marle & Biron, Alger, 1894, cité par Christiane Achour, Anthologie de la littérature algérienne de langue française, Alger, ENAP, Paris, Bordas, 1990
[2] Journal des débats, 6 février 1848. Voir infra texte plus complet.
[3] Xavier Yacono, « Peut-on évaluer la population de l’Algérie vers 1830 ? », Questions d’histoire algérienne, Imprimerie nationale, Paris, 1955.
[4] Antoine De Juchereau de Saint-Denys, Considérations statistiques, historiques, politiques et militaires sur la Régence d’Alger, Delaunay, Libraire, Paris, 1831, p. 41.
[5] Alexis de La Pinsonnière, « Rapport sur la colonisation de l’ex-régence d’Alger », in Documents officiels déposés sur le bureau de la Chambre des députés, L.G. Michaud, Paris, 1834.
[6] Bugeaud, La Presse, 25 janvier 1845.
[7] L’Afrique, journal de la colonisation, 2 septembre 1845.
[8] Dr René Ricoux, Démographie figurée de l’Algérie, Paris, G. Masson, Libraire de l’Académie de Médecine, 1889.
[9] André Nouschi, Les armes retournées. Colonisation et décolonisation françaises, Paris, Belin, 2005.
[10] Xavier Yacono, loc. cit.
[11] Kateb Kamel, Européens, “indigènes“ et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, INED / PUF, 2002, p. 16.
[12] Dominique Maison, « La population de l’Algérie », Population, INED, n° 28-6, 1973, tableau p. 1080.
[13] André Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises, de la conquête jusqu’en 1919, première édition, Paris, PUF, 1961, réédition Bouchène, Saint-Denis, 2013, pp. 75-76.
[14] Charles-Robert Ageron, « Les migrations des musulmans algériens et l’exode de Tlemcen (1830-1911) », Annales, ESC, n° 22-5, 1967
[15] Dr Ricoux, Démographie figurée de l’Algérie, op. Cit., p. 260
[16] Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, Flammarion, Paris, 2006, p. 65.
[17] Jacques Fremeaux, Algérie, 1830-1914. Naissance et destin d’une colonie, Paris, Éditions du Rocher, 2021.
[18] Kamel Kateb, Européens, “indigènes“ et juifs en Algérie, op. cit. pp. 34, 41 et 47.
[19] Djilali Sari, Le désastre démographique, p. 130 (voir Bibliographie).
[20] Denis Cogneau, Un Empire bon marché. Histoire et économie politique de la colonisation française, XIXe-XXIe siècle, Seuil, Paris, 2023, p. 164.
[21] Philippe Fargues, « Un siècle de transition démographique en Afrique méditerranéenne, 1885-1985 », Revue Population, n° 41 (2), 1986, cité par Denis Cogneau, id.
[22] Yves Lacoste, André Nouschi & André Prenant, L’Algérie, passé et présent, Paris, Éditions Sociales, 1960, p. 328.
[23] Kamel Kateb, Européens, “indigènes“ et juifs en Algérie, op. cit, p. 47.
[24] Id., « Le bilan démographique de la conquête de l’Algérie (1830-1880) », in Abderrahmane Bouchène & al., Algérie à la période coloniale, Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Paris, La Découverte, Alger, Barzakh, 2012, p. 82.
[25] Par souci de ne pas dépasser les limites chronologiques de notre essai, nous ne citerons que pour mémoire les grandes famines postérieures, dont la plus terrible, en 1867-1869.
[26] Claire Fredj, « L’organisation du monde médical en Algérie de 1830 à 1914 », in Abderrahmane Bouchène & al., Algérie à la période coloniale, op. cit.
[27] Kamel Kateb, Européens, “indigènes“ et juifs en Algérie, op. cit.
[28] M. A. Vincent & V. Collardot, Le choléra, op. cit.
[29] Journal des débats, 20 novembre 1849.
[30] M. A. Vincent & V. Collardot, op. cit., p. 17.
[31] Dr Paul, rapport en date du 10 décembre 1849, cité par André Nouschi, op. cit., p. 218
[32] Rapport en date du 25 novembre 1849, id., même page.
[33] Dr Bonnafont, médecin militaire à l’hôpital d’Alger, lettre à l’Académie Royale de Médecine, 28 octobre 1836, Bulletin de l’ARM, tome I, À Paris, Chez J.-B. Baillère, 1836, p. 129.
[34] Cité par le Dr Pierre Rayer (1793-1867), « Phtisie en Algérie », Communication à l’Académie royale de Médecine, 16 mai 1843, Bulletin de l’ARM, tome VIII, À Paris, Chez J.-B. Baillère, 1842-1843, p. 941 (Gallica, <c.bnf.fr/SEC>).
[35] André Nouschi, Populations rurales constantinoises, p. 81 de l’édition Bouchène, op. cit.
[36] Dr Feuilet, « La phtisie en Algérie, d’après une enquête officielle sollicitée par la Société de climatologie d’Alger », Gazette médicale de l’Algérie, 1er janvier 1874 (Gallica, <c.bnf.fr/SGH>).
[37] Dr Pierre Chaulet, Histoire de l’Algérie médicale : Naissance de la médecine algérienne. Repères pour une histoire de la tuberculose en Algérie http://www.santemaghreb.com/sites_pays/hist_algerie_medicale.asp?id=153&rep=algerie
[38] Dr Jules Brault, « La tuberculose chez les indigènes musulmans d’Algérie », Annales d’Hygiène publique et de médecine légale, vol. III, 1905.
[39] André Nouschi, Populations rurales constantinoises, pp. 82-83 de l’édition Bouchène, op. cit.
[40] Lettre de M. Dussert au général Boniface De Castellane, Philippeville, 15 mai 1843, in Campagnes d’Afrique, Paris, Librairie Plon, 1898.
[41] Mounir Fantar, « Silos et entrepôts en Afrique préromaine. Des témoignages historiographiques et archéologiques », Revue Antiquités africaines, n° 43, 2007 (Persée).
[42] Duc d’Orleans, Carnet, camp du Sig, 30 novembre 1833, in Récits de campagne, publiés par ses fils, Calmann Lévy, Paris, 1890, p. 18 sq.
[43] Pellissier de Reynaud, Annales algériennes, Paris, Anselin & Gaultier-Laguione, Vol. II, 1836, p. 325 sq.
[44] Tocqueville, « Travail sur l’Algérie », octobre 1841.
[45] Id., lettre à Francisque De Corcelle, 1 er décembre 1846, citée par Jean Martin, L’Empire renaissant, 1789-1871, Denoël, Paris, 1987, p. 305.
[46] Comte de Martimprey, Rapport, 1 er mars 1851, cité par Marcel Emerit, « L’état d’esprit des musulmans d’Algérie de 1847 à 1870 », in Histoire de l’Algérie et du Maghreb. Études et documents, 1939-1977, Saint-Denis, Bouchène, 2015.
[47] Tableau des Établissements français, année 1865-1866, cité par André Nouschi, Populations rurales constantinoises, op. cit.
[48] Nous ne possédons pas de statistiques antérieures à 1865, mais les proportions devaient être les mêmes.
[49] L’Algérie, Courrier d’Afrique, 2 avril 1844.
[50] « Population européenne en Algérie à la fin de 1844 », L’Afrique, journal de la colonisation, 12 avril 1845.
[51] Rapport en date du 8 août 1844, cité par André Nouschi, Populations rurales constantinoises, op. cit., p. 186.
[52] Raousset-Boulbon, De la colonisation et des institutions civiles en Algérie, Dauvin & Fontaine, Paris, 1847.
[53] André Cochut, « De la colonisation de l’Algérie. Plan et budget d’exploitation », Revue des Deux Mones, avril 1847.
[54] Dr Vital, lettre à Isamaÿl Urbain, 17 décembre 1867, citée par André Nouschi, « Notes sur la médecine et la démographie en Algérie de 1840 à 1880 », Annales de démographie historique, 1973.
[55] Daumas, rapport, 6 mai 1846, cité par Philippe Lucas & Jean-Claude Vatin, L’Algérie des anthropologues, Maspero, Paris, 1975, p. 96.
[56] Dutrone, Rapport fait à la Commission des colonies agricoles de l’Algérie, Impr. d’E. Duverger, Paris, 1850, p. 21.
[57] Bugeaud, Journal des débats, 6 février 1848.
[58] Lenine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916.
[59] Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français. Histoire d’un divorce, Albin Michel, Paris, 1984.
[60] Daniel Lefeuvre, Chère Algérie. La France et sa colonie, 1930-1962, Flammarion, Paris, 2005.
[61] Daniel Lefeuvre, op. cit., p. 13.
[62] Denis Cogneau, op. cit., p. 33.
[63] Jacques Marseille, op. cit., p. 63.
[64] Denis Cogneau, op. cit., p. 39.
[65] Denis Cogneau, op. cit., p. 33.
[66] Albert Sarraut, La Mise en valeur des colonies françaises, op. cit.
[67] Le coût humain pour les colonisés fut abyssal, et nous ne le sous-estimons évidemment pas. Mais il s’agit dans ces paragraphes uniquement de descriptions économiques métropolitaines.
[68] Id., même page. Denis Cogneau, op. cit., p. 33.
[69] Jacques Fremeaux & Ahmed Henni, « Formes et processus de colonisation », in Frédéric Abecassis & Gilbert Meynier (dir.), Pour une histoire franco-algérienne. Pour en finir avec les pressions officielles et les lobbies de mémoire, La Découverte, Paris / ENS, Lyon, 2008
[70] François Bobrie, « Finances publiques et conquête coloniale : le coût budgétaire de l’expansion française entre 1850 et 1913 », Annales, ESC, n° 31-6, 1976 (Persée).
[71] Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), 2 volumes,Publications de la Faculté des Lettres & Sciences humaines de Paris-Sorbonne / PUF, Paris, 1968.
[72] Jacques Fremeaux & Ahmed Henni, loc. cit.
[73] Paul Leroy-Beaulieu, L’Algérie et la Tunisie, 2e édition, Guillaumin & Cie, Paris, 1897, p. 204.
[74] Émile Larcher & Georges Rectenwald, Traité élémentaire de législation algérienne, vol. II, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1923.
[75] Napoleon III, Lettre sur la politique de la France en Algérie adressée par l’Empereur au maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, gouverneur général de l’Algérie, cité par Mac Mahon, Mémoires, op. cit. (voir Bibliographie).
[76] Albert Memmi, Portrait du colonisé / Portrait du colonisateur, Paris, Buchet-Chastel, 1957.
[77] Assemblée législative, 20 mars 1851, Journal des débats, 23 mars 1851. Le nom du député n’est pas cité.
[78] Louis-Philippe, discours du trône, 27 décembre 1841, presse française, 28 décembre.
[79] Pierre Mendes France, réponses aux interpellations, assemblée nationale, 12 novembre 1954, presse française, 13 novembre.
[80] Jules Favre, discours, Alger, novembre 1868, Journal des débats, 5 novembre 1868.
[81] Jules Verne, Mathias Sandorf, Hetzel, Paris, 1885.
[82] Paul Despiques & Jean Garoby, Le chef d’œuvre colonial de la France. L’Algérie, Publication du Gouvernement général de l’Algérie, Commissariat général du Centenaire, Alger, Impr. Baconnier Frères, 1930.
[83] Pierre Bordes, discours devant les délégations financières, Alger, mai 1928 (résumé par Félix Fulchs, « Un siècle de colonisation en Algérie », Le Figaro, 21 mai).
[84] Octave Depont, L’Algérie du Centenaire, Bordeaux, Imprimerie Cadoret, 1928.
[85] « Nous recevons la note suivante, elle nous est adressée par un officier bien au courant des nouvelles arabes » (Akhbar, Alger, 27 avril 1848).
[86] Texte souvent cité sans précision de source. D’après le colonel Adolphe Gouta (Historia magazine, octobre 1971), il figura dans un rapport aux autorités françaises (archives de la famille Duval).
[87] François Mitterrand, discours, Oran, 17 octobre 1954,cité par André Mandouze, « Lettre ouverte à M. le ministre de l’Intérieur », Le Monde, 20 octobre.
[88] Id., discours, Alger, 16 octobre 1954,L’Écho d’Alger, 17-18 octobre.
[89] « Lettre ouverte à M. le Ministre français de l’Intérieur », L’Algérie libre, 15 octobre 1954.
Table des matières
Remerciements
Avertissement
Introduction
Une guerre longue et dévastatrice
1830-1851 : l’évidence alors reconnue (puis oubliée) d’une première guerre d’Algérie
Y eut-il une opinion publique à cette époque ?
Les sources d’une histoire globale de la conquête
Première partie : L’Algérie, une question coloniale
Chapitre 1
De Richelieu à Charles X : permanences de la politique française
Une motivation constante : la mise hors d’état de nuire des pirates barbaresques
« Tu cèderas ou tu tomberas sous ce vainqueur, Alger » (Bossuet)
Genèse d’un concept : la mission civilisatrice
Un (relatif) effacement des dangers barbaresques à partir du XVIIIe siècle
Un changement décisif : des actes de bombardement aux projets de débarquement
Les projets avortés de Napoléon Bonaparte
L’hypothèse d’un débarquement jamais abandonnée
La conquête de la Régence, tout sauf « un accident de l’histoire »
Revoir la chronologie de l’histoire de la colonisation française ?
Chapitre 2
Une tromperie : le coup d’éventail. Une cause : la volonté d’expansion (1827-1830)
Une dette ancienne à l’origine de la crise
Récits (contradictoires) de l’incident
Les réactions en France
La marche à la guerre, 1827-1828
L’ultime mise au point de la stratégie
Décembre 1829 : la décision
Une sombre affaire Seillière
Les réactions de l’Empire ottoman, acte I : mécontentement et impuissance
Les réactions britanniques, acte I : hostilité et inquiétudes (1827-1830)
Chapitre 3
Toulon, Sidi Ferruch, Alger, mai-juin 1830 : une guerre commence
Le plus grand engagement militaire français depuis la fin de l’ère napoléonienne
La traversée et le débarquement, mai-juin 1830
Le 14 juin 1830, cinq heures du matin, le drapeau blanc flotte sur Sidi Ferruch
Première proclamation, premier faux pas
Une interrogation : la faiblesse de la résistance
La marche sur Alger
Capitulation de Hussein-dey, promesses de Bourmont
La société française et la prise d’Alger : fierté militaire, morosité politique
Chapitre 4
Une ville et ses alentours livrés à la « curée » (général Loverdo), juillet-août 1830
L’avènement de la monarchie de Juillet : un drapeau chasse l’autre
Le pillage du trésor de la Casbah
L’enquête inaboutie et sabotée de Jean-Baptiste Flandin
Autres vols
Le vieil Alger, première victime
La destinée de Baba Merzoug ou La Consulaire
Chapitre 5
Une guerre s’installe, 1830-1833
Blida, juillet 1830, ou l’initiative aventureuse de Bourmont
Oran, Bône, Bougie, juillet-août 1830, piétinements et revers
Blida, novembre 1830 ou la revanche sanglante de Clauzel
Parmi les premiers soldats : les volontaires parisiens de 1830
Un bilan de la première année
Le duc de Rovigo et le massacre de la tribu des El Ouffia, avril 1832
Oran, Bône, Bougie, 1831-1833, ou la reprise de la conquête
Yusuf, l’officier qui savait « parfaitement la manière de faire la guerre aux Arabes » (général d’Uzer, 1832)
La conquête chaotique de la Kabylie, acte I : prudence et escarmouches
Naissance et balbutiements des Bureaux arabes
Mise en place d’un appareil judiciaire
Les réactions de l’Empire ottoman, acte II : protestations et impasse
Les réactions britanniques, acte II : pressions et accommodements
Chapitre 6
La société algérienne, de la sidération à la Résistance
L’Algérie en 1830 : possession ottomane ou terre autonome de fait ?
Personnalités algériennes : vie et opinions d’Hamdan Khodja
Personnalités algériennes : vie et opinions d’Ahmed Bouderba
Une société en ébullition
Le salut par le Maroc ?
L’avènement d’Abd el-Kader
Naissance d’un État
L’ère Abd el-Kader, naissance ou affirmation d’une nation ?
Une alliance en gestation avec Londres ?
Une figure oubliée du combat algérien : le hadj Ahmed Bey
Chapitre 7
« L’Algérie pour toujours française » (Louis-Philippe, 1841) : naissance et activités d’un parti coloniste
« Alger, cette conquête inespérée, le seul dédommagement qui nous reste » (François Mauguin, député, novembre 1830)
Des Possessions françaises dans le Nord de l’Afrique à l’Algérie française
Au fondement de l’idéologie coloniste : « La race européenne, supérieure à toutes les autres » (Saint-Simon & Augustin Thierry)
« Il faut imposer la civilisation » (Godefroy Cavaignac)
Un idéologue coloniste précoce : Alphonse de Lamartine
Un nouvel Eldorado
« L’extinction du paupérisme par la colonisation de l’Algérie »
« Tout parle en faveur de la colonisation de l’Algérie par les enfants » (Jean Zuber)
Le parti coloniste contre les « anti-Français »
Chapitre 8
« Renonçons à coloniser Alger » (Maurice Allart, 1830) : protestations et impuissance de la mouvance anticoloniste
L’Algérie, un tonneau des Danaïdes
« L’Algérie nous coûte déjà plus d’un milliard… » (La Presse, 21 février 1846)
Cris d’alerte et prémonitions
Apparition d’un mot : décolonisation (Henri Fonfrède, 1837)
L’incessant combat d’Amédée Desjobert
Chapitre 9
Entre paix possible et guerre certaine : l’ère des tâtonnements, 1834-1840
Négociations et trêves, acte I : le traité Desmichels, 26 février 1834
L’an 1835 : revers de Trézel (La Macta, juin), victoire de Clauzel (Habra, décembre)
L’affaire de Tlemcen
L’aventurisme désastreux de Clauzel, Constantine 1836
Négociations et trêves, acte II : le traité de la Tafna, 30 mai 1837
Grands espaces et petite politique : les chemins vicinaux de Dordogne
La revanche de Damrémont-Valée, Constantine 1837
La rupture du traité de la Tafna et l’offensive d’Abd el-Kader, automne 1839
Un symbole : 123 héros français face à des milliers de combattants arabes, Mazagran, février 1840
Le Credo du général Damrémont
Un dixième anniversaire de la conquête dans le bruit et la fureur
Deuxième partie : De Bugeaud à Saint-Arnaud : permanences de la guerre totale
Chapitre 10
Thomas-Robert Bugeaud : l’ère des déchaînements (1841-1847)
Une étonnante évolution : de l’Algérie « présent funeste » à la guerre totale Un officier qui ne faisait confiance qu’à « sa propre pensée » (Guizot)
Un programme annoncé : « Il faut que les Arabes soient soumis »
Systématisation de la guerre
La prise de la smalah ou le triomphe du duc d’Aumale, mai 1843
La guerre du Maroc et ses suites (1844)
Les réactions britanniques, acte III : entre Entente cordiale et refus d’un Maroc français
La conquête chaotique de la Kabylie, acte II : Bugeaud, avril et septembre 1844
Sidi Brahim ou l’erreur fatale de Montagnac, septembre 1845
Une petite revanche de Bugeaud : le voyage à Excideuil, septembre-octobre 1845
La conquête chaotique de la Kabylie, acte III : Bugeaud toujours, mai 1847
Chapitre 11
Un bilan de la pacification à la Bugeaud
L’homme « qui n’a [su faire] autre chose que la guerre » (Ismaÿl Urbain)
Un père pour ses soldats
Les mariages au tambour
La casquette
Les colonies militaires, principes
Les colonies militaires, illusions, réalités et échec final
Une fin de règne amère
Bugeaud après l’Algérie
Chapitre 12
« L’armée, faite féroce par l’Algérie » (Victor Hugo, 1852)
« Les Arabes anéantis devant la colonisation française » (Jules Verne) : une nécessité et / ou une fatalité
« Les Arabes anéantis… » : une abomination et / ou une impossibilité
Villages, moissons et terres brûlés
Les razzias*
Une pratique annexe des razzias* : le chapardage
Les décapitations durant les campagnes
Les décapitations en ville
Les essorillements
Les enfumades
Les emmurements
Les exécutions sommaires
L’histoire sordide du capitaine Doineau
Les viols
Zaatcha ou la destruction totale d’une ville fortifiée, juillet-novembre 1849
La conquête chaotique de la Kabylie, acte IV : Saint-Arnaud, mai-juin 1851
Chapitre 13
Combats et souffrances des hommes de troupe
« Héros trop oubliés de notre épopée coloniale »
Parmi les premiers soldats : les volontaires parisiens
Se nourrir en Algérie française
Boire (plus que de raison) en Algérie française, acte I : les militaires
Se loger en Algérie française
Se vêtir en Algérie française
Se déplacer en Algérie française
Être blessé ou malade en Algérie française
Mourir en Algérie française
Mourir de faim et d’oubli en Algérie française : Miliana, juin-octobre 1840
Être brutalisé en Algérie française
« Tortures en Algérie » (Journal de la morale chrétienne, septembre 1845)
« Mourir de nostalgie en Algérie française » (Thomas Dodman)
Recruter des indigènes en Algérie française
Les zouaves
Les « tirailleurs indigènes », plus tard appelés turcos
Les spahis
Des troupes peu fiables
La Légion étrangère
Chapitre 14
La Résistance : « Le combat du lion contre le moucheron » (Saint-Arnaud)
« Abd el-Kader et Jugurtha » (Ismaÿl Urbain, 1844)
Guerre classique contre guérilla
La fin de la coopération Maroc / Résistance algérienne
Vers un rapprochement avec la Sublime Porte ?
Troisième partie
Colonisateurs et colonisés en Algérie et en France
Chapitre 15
La colonisation : les processus d’accaparement des terres et des forêts
Logique française contre pratiques ancestrales algériennes
Alexis de Tocqueville, théoricien de l’expropriation
Le général Clauzel, praticien de l’expropriation
Colonisation accélérée contre réalisme : l’affrontement duc de Rovigo / intendant Pichon
Le principe : « L’expropriation des indigènes est la condition première » (comte de Raousset-Boulbon)
L’accaparement des forêts
Chapitre 16
Le monde colon : une Algérie cosmopolite
Quelques statistiques globales
« Notre établissement doit être européen, et pas seulement français » (Saint-Marc Girardin)
Les Espagnols
Les Irlandais
Les Allemands
Les Maltais
Les Suisses
Les Polonais
Les Italiens
Hors d’Europe : « Transporter des maronites du Liban en Algérie » (Louis de Baudicour)
Hors d’Europe : des Chinois, des Indiens et des Africains noirs en Algérie ?
Chapitre 17
Le monde colon : la première génération, pionniers, victimes ou spoliateurs ?
Au sein de cette population, des colons toujours minoritaires
Naissance d’une catégorie : les colons en gants jaunes
La première vague : illusions, souffrances, désillusions
Une société peu attirante pour les femmes
Répartition par provinces d’origine
Une expérience avortée : les villages départementaux
Les premiers travaux de défrichement et d’assainissement
« La Mitidja, chef d’œuvre colonial de la France en Algérie » ?
La vie des premiers colons
Le « pays de la mort jaune »
Le baron Augustin de Vialar, « premier colonisateur de l’Algérie »
Les Trappistes de Staoueli
Les villages coloniaux, des forteresses assiégées
Un désastre oublié : la destruction et les pillages des monuments de l’époque romaine
Naissance d’un autonomisme colon : « Nous autres, Algériens »
Chapitre 18
La colonisation : la grande année 1848 et ses suites
L’envoi en masse de colons : soulagement des possédants, espoirs des miséreux
Le premier convoi, de Bercy à Saint-Cloud
L’état d’esprit des apprentis-colons
« On leur a promis un Eldorado, ils trouvent la nature âpre et brute » (maréchal Pélissier)
Un constat d’échec généralisé
Les proscrits de 1848
Chapitre 19
Abd el-Kader, de la défaite algérienne au parjure français
Fin d’une épopée, décembre 1847
L’affaire Abd el-Kader, acte I : sous la monarchie de Juillet
L’affaire Abd el-Kader, acte II : sous la Seconde République
L’affaire Abd el-Kader, acte III : le geste de Louis-Napoléon Bonaparte
Une curiosité du tout-Paris
Chapitre 20
L’attitude envers l’islam
« C’est en France qu’il faut prêcher la dernière Croisade » (Chateaubriand).
La « lutte entre les généraux et les prêtres » (Marcel Emerit)
Le sort des mosquées
La grande misère du culte
Les profanations de sépultures
Une islamologie jeune et balbutiante
Des mosquées à Paris et à Marseille ?
Chapitre 21
Scènes de la vie quotidienne en situation coloniale
Colonisateurs et colonisés : « Deux corps juxtaposés » (Tocqueville)
« L’on acquiert vite en Algérie une très grande légèreté de main et de bâton » (Théophile Gautier)
Les Européens entre eux
Boire (plus que de raison) en Algérie française, acte II : les civils
De premiers touristes aisés
Chapitre 22
L’Algérie et les Algériens en France
Une fête aux couleurs algéro-marocaines
Exposer les produits
Exposer les indigènes
D’autres Algériens en France
Les arts : la peinture
Les arts : la fiction romanesque
Les arts : la poésie
Les arts : le théâtre
Les arts : la musique
L’Algérie dans nos foyers : naissance d’une invasion culturelle ?
La mode
L’Algérie dans les rues des villes de métropole
Conclusion
Pour l’Algérie : Vingt années de guerre, une société frappée de plein fouet « mais les Arabes restent debout » (Bugeaud)
Pour la France : « Chère Algérie » (Daniel Lefeuvre) ou « Empire bon marché » (Denis Cogneau) ?
L’Algérie, c’est la France ?
Annexe I
État quantitatif des troupes et des pertes françaises, 1830-1851
Annexe II
État quantitatif des populations civiles, 1830-1852
Bibliographie (principaux travaux cités)
Lexique des termes arabe et autres
Index

