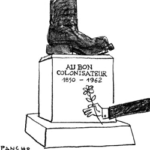Une disposition adoptée avec l’aval du gouvernement français
par Laetitia Van Eeckhout [Le Monde du 11 juin 2005]
La polémique déclenchée par la loi du 23 février 2005 puise sa source dans l’article 4 du texte. Celui-ci prévoit que « les programmes de recherches universitaires accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite« . « [Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, ajoute-t-il, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. »
Les députés de l’UMP et de l’UDF, en lien avec des associations de rapatriés, plaidaient pour l’adoption de cette notion de « rôle positif » , initialement absente du texte du gouvernement. Lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale, les 10 et 11 juin 2004, le ministre délégué, Hamlaoui Mekachera, donnait par avance son feu vert sur la question des manuels scolaires. Plusieurs amendements allant dans ce sens avaient été déposés, notamment par Robert Lecou (UMP, Hérault), Christian Vanneste (UMP, Nord) et Francis Vercamer (UDF, Nord). Le gouvernement donnait un avis favorable. Ces dispositions étaient adoptées sans que le Sénat ne les remette en cause. Jusqu’à la pétition lancée, au début du printemps, par six historiens (Le Monde du 25 mars).
Le député François Liberti (PCF, Hérault) s’indigne du « dévoiement » d’un texte dont il défendait la finalité initiale : « Cela aurait dû être une ultime loi d’indemnisation permettant de réparer les inégalités et les injustices existantes entre les rapatriés et à l’égard des harkis. La loi votée ne solde en rien ce problème et n’est qu’un texte de réhabilitation du fait colonial. » « En démocratie, il n’appartient pas au législateur d’imposer une version officielle de l’histoire » , tempête le sénateur Guy Fischer (PCF, Rhône), seul à s’être élevé en séance contre cette loi devenue, selon lui, « un cheval de Troie banalisant les guerres coloniales« .
Une accusation réfutée par M. Vanneste. « Notre intention, explique-t-il, n’était pas de refaire les livres d’histoire mais de délivrer un message aux rapatriés, de fixer la position de la France à l’égard de ces hommes et de ces femmes qui ont subi un drame, pour certains, une tragédie. »
M. Vanneste considère que la loi du 23 février 2005 « n’impose pas de censure« . « Il n’a jamais été question de peser sur la recherche de la vérité. Mais les livres d’histoire sont toujours une synthèse, une interprétation subjective de faits établis. Et là, le législateur peut tout à fait intervenir pour demander à ce que l’orientation des manuels soit conforme aux valeurs de la République » , argumente M. Vanneste, qui déplore que la recherche historique en France ait une « imprégnation marxiste« .
« Aujourd’hui, on ne parle que de la face négative de la colonisation. Mais on oublie l’oeuvre des Français d’Algérie, des autochtones qui ont dû être rapatriés et dont beaucoup étaient des gens modestes« , soutient le député Kléber Mesquida (PS, Hérault). « En conscience« , il affirme ne pas penser « que le législateur ait été guidé par un esprit colonialiste« .
__________________________________
Des enseignants dénoncent une attaque contre « la neutralité scolaire »
par Luc Bronner [Le Monde, 11 juin 2005]
Comme une réminiscence de l’époque où l’école vantait les mérites des colonies françaises. L’adoption par le Parlement, en février, d’une loi imposant aux programmes scolaires de reconnaître le « rôle positif » de la colonisation française, notamment en Afrique du Nord, a suscité la colère des historiens et des enseignants. A travers la signature d’un texte dans Le Monde (daté du 25 mars), universitaires et intellectuels ont dénoncé une disposition législative qu’ils jugent « contraire à la neutralité scolaire« .
Symboliquement, la loi du 23 février témoigne, à leurs yeux, d’un inquiétant retour en arrière. La république scolaire, construite par Jules Ferry, fut longtemps le promoteur de la république coloniale, défendue par ce même Jules Ferry. Jusqu’aux années 1960, les programmes scolaires sont restés des outils de cette mémoire, résumée par la citation des instituteurs parlant de « Nos ancêtres, les Gaulois » aux enfants des colonies.
Avec la décolonisation et les travaux des historiens, le contenu des enseignements s’est transformé. « Tant que la France est restée une puissance coloniale, les programmes présentaient une vision positive de la colonisation. A partir de la fin des années 1960, les programmes ont privilégié l’étude de ce qui a amené à la décolonisation« , résume Alain Bergounioux, inspecteur général d’histoire.
De l’avis général, les programmes reflètent assez fidèlement l’état de la recherche. Ces thématiques sont aujourd’hui abordées à plusieurs reprises au cours de la scolarité obligatoire. Au primaire, les programmes de l’école élémentaire, qui datent de 2002, font figurer la colonisation et la décolonisation parmi les mots-clés à retenir et à comprendre.
Au collège, les élèves abordent le sujet en classes de quatrième et de troisième. Les horaires prévus pour la discipline et l’importance du programme (trois siècles) n’autorisent toutefois qu’une étude « à grands traits » de cette période. Les manuels évoquent les causes de la colonisation et de la décolonisation en approfondissant les exemples de l’Inde et de l’Algérie. A travers des photos, des discours ou des témoignages, ils traitent aussi de la torture ou d’événements comme la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, à Paris.
Pour ceux qui poursuivent leurs études en lycée général, l’analyse historique est plus poussée. En première et en terminale, notamment, les élèves abordent le sujet à travers l’histoire des relations internationales et celle de la vie politique française. Ils peuvent éventuellement compléter cet enseignement par le choix d’un travail personnel encadré (TPE).
Au-delà des programmes officiels, l’enseignement du fait colonial continue de figurer parmi les sujets délicats pour les professeurs, qui témoignent à la fois des attentes des élèves et de la faiblesse de leur formation. Ce que montre une enquête conduite par l’IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) de Versailles : « Les enseignants interrogés disent tous à quelques rares exceptions leur sentiment de ne pas être assez armés du point de vue des connaissances sur la colonisation, la décolonisation, comme du reste sur l’histoire du conflit israélo-palestinien« , constatent les auteurs de l’étude après avoir interrogé 50 professeurs de collège et lycée.
Selon leur projet pédagogique ou en fonction de leurs centres d’intérêt, les professeurs peuvent consacrer plus ou moins de temps à ces sujets. « Les enseignants déterminent librement leur approche pédagogique et peuvent insister sur tel ou tel aspect des thèmes proposés« , indique le Bulletin officiel pour la classe de seconde. Cette liberté est tempérée, comme le rappelle Alain Bergounioux, par la déontologie propre à l’historien : « En classe, nous devons faire la distinction entre l’histoire et les différentes mémoires, qui peuvent être blessées, frustrées. Nous avons vocation à refléter le consensus des historiens à un moment donné. »
Au sein de l’inspection générale, comme à l’Association des professeurs d’histoire et géographie (APHG), on n’en est que plus sévère envers la nouvelle loi, assimilée à une « histoire officielle » inconciliable avec l’éthique d’un historien. Tous s’accordent pour considérer qu’elle n’aura aucun impact sur d’éventuels futurs programmes, dont la rédaction est confiée à des experts (universitaires et inspecteurs généraux).
François Durpaire, enseignant agrégé, auteur de Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois (Hachette Education), résume la situation en une formule : « C’est comme si l’on demandait aux mathématiciens, par une loi, d’enseigner que 2 et 2 font 5. »