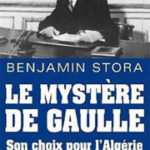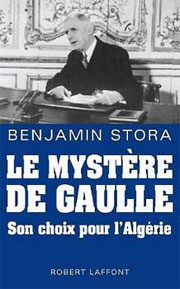
A qui De Gaulle a-t-il menti ?
Il y a cinquante ans, le 16 septembre 1959, De Gaulle prononçait un discours décisif accordant aux Algériens rien de moins que l’autodétermination. La guerre d’Algérie est alors loin d’être terminée. La France peut prétendre qu’elle est en train de gagner la guerre sur le terrain même si elle la perd sur le front diplomatique. Dans son dernier livre « le Mystère De Gaulle »2, Benjamin Stora souligne que les dirigeants algériens n’étaient pas préparés à ce discours. Les dix colonels, « divisés entre eux, savent qu’ils ne représentent qu’une part de l’opinion algérienne musulmane. Cent mille paysans en armes, les Harkis, se trouvent aux côtés de l’armée française dans les campagnes. Malraux le leur a rappelé en les foudroyants d’une formule : “Il ne suffit pas de prendre un fusil pour représenter le peuple” ». Mais dans ses Mémoires, Ferhat Abbas écrira : « Dans la guerre d’Algérie, le 16 septembre 1959 marque une date historique (…) Le problème est virtuellement réglé ».
Je me trouvais à Tunis ce jour-là et je me souviens de certains propos que Ferhat Abbas avait adressés devant moi à l’envoyé spécial New York Times, Tom Brady. Celui-ci avait été frappé par le fait que le leader algérien ne pouvait dissimuler son admiration pour l’audace du président français. D’ailleurs, à la même époque, Germaine Tillion notait « l’immense popularité de De Gaulle dans les masses musulmanes ». En août 1959, un mois avant, De Gaulle avait consulté chacun de ses ministres en conseil. Dans un livre devenu un classique, Jean Lacouture a souligné combien les débats avaient été vifs. Benjamin Stora cite le propos d’Edmond Michelet, Garde des Sceaux, chrétien progressiste, ancien déporté et qui n’a jamais toléré la torture : « Il n’est pas question d’amener notre drapeau à Alger mais je ne verrais pas d’inconvénient à ce qu’un autre flotte à côté de lui, comme à Lille l’étendard des Flandres auprès du drapeau tricolore. » C’est Jean-Marcel Jeanneney qui, de manière plus précise encore que celle de Couve de Murville, observera que « l’indépendance est inévitable ».
Alors, dans son livre, comme toujours rigoureux, sensible et intuitif, Benjamin Stora pose à nouveau le problème de l’origine et de la genèse de la décision gaullienne de se résigner à l’indépendance totale de l’Algérie. Pour ce faire, il reproduit le texte intégral du résumé que le cabinet militaire du général a fait d’une intervention aux officiers supérieurs de l’armée. C’est un document saisissant quand on le relit aujourd’hui. De Gaulle dit aux officiers que leurs succès militaires ne constituent en rien la solution et que, sans la participation directe des Algériens, rien ne sera possible. Bien sûr, certaines possibilités restent ouvertes et de Gaulle ne désespère pas encore de conduire les Algériens à des accords d’association avec la France.
Benjamin Stora a tout à fait raison de renvoyer dos-à-dos les idéalistes du gaullisme et ses procureurs grincheux. Reste que, pour ma part, je me suis fait dès cette époque plusieurs convictions. La première est que tout a changé en 1958 avec la proclamation de l’égalité des Algériens, qu’ils fussent ou non musulmans. L’avenir appartient aux neuf millions de musulmans et non au million de pied-noirs. Ensuite, j’ai compris, grâce au discours de Dakar, que de Gaulle s’engage à ne plus jamais rien faire contre les vœux des autochtones. Enfin, j’ai compris quelle était la vraie préoccupation du général, préoccupation que je trouvais fondée et que Couve de Murville m’avait confiée avant de faire sa dernière intervention à l’ONU. De Gaulle jugeait complètement outrecuidante la décision du FLN de se considérer comme le seul et unique représentant du peuple algérien. Il voulait que l’avenir de l’Algérie fut décidé par des élections libres. Un certain nombre de refus, de retards et d’atermoiements qui ont conduit à l’échec certaines négociations sont explicables par cette attitude. Il n’est pas indifférent de noter qu’il y a eu plusieurs analystes algériens et non des moindres pour noter, bien plus tard il est vrai, que le FLN n’aurait pas dû confisquer les fruits des combats et des victoires pour l’indépendance.
De Gaulle a abandonné les Harkis : c’est son crime – et le nôtre. Tantôt par ambiguïté tantôt par omission, il a menti aux Français d’Algérie et surtout à certains chefs militaires : c’est sa faute. Mais il a toujours souhaité une émancipation des Algériens qui se ferait en association avec la France pendant une dizaine d’années. Il a échoué. En fait, à la fin, il a tout simplement décidé de délivrer la France de l’Algérie. Il était le seul à pouvoir le faire.
Il y a 50 ans, un tournant de la guerre d’Algérie :
16 septembre 1959, le discours de de Gaulle sur l’autodétermination
Depuis bientôt quatre décennies, pas une année, pas un mois ne passent sans qu’un livre ne vienne ajouter une pierre, petit caillou ou imposant rocher, à l’auguste monument de papier consacré au général de Gaulle. Les derniers ajouts bibliographiques révèlent les mutations de la figure gaullienne dans la mémoire collective française et permettent de suivre à la trace les transformations apportées à la statue du Général par ses mille et un sculpteurs.
Dans ce foisonnement éditorial, très rares sont les auteurs qui n’abordent pas, de près ou de loin, la politique algérienne du Général, considérée à juste titre comme l’un des enjeux majeurs de sa présidence. Parmi les acteurs de l’époque, tous ou presque ont livré leur témoignage sur la question, du Premier ministre Michel Debré au président du Conseil constitutionnel Léon Noël, du gendre de De Gaulle Alain de Boissieu au directeur de L’Écho d’Alger Alain de Serigny, du général Jacques Massu au général Raoul Salan, du secrétaire général pour les Affaires algériennes Bernard Tricot à l’avocat des partisans de l’Algérie française Jacques Isorni, sans oublier, côté algérien, les leaders nationalistes Ferhat Abbas, Saad Dahlab ou Ali Kafi, acteurs et témoins privilégiés de la lutte des factions au sein du FLN. Tous se confrontent – et répondent de manière différente – à la question de la décision prise par le général de Gaulle de s’orienter vers l’indépendance de l’Algérie, alors qu’il a été porté au pouvoir au mois de mai 1958 par les partisans de l’Algérie française. Certains, fidèles ou opposants du premier président de la Ve République, font le récit d’une histoire jouée d’avance, d’un plan tenu secret et appliqué par de Gaulle une fois revenu aux affaires.
Quelle a donc été, dans la politique du général de Gaulle face à la guerre d’Algérie, la part des circonstances et celle des intentions ? A-t-il appliqué strictement un programme conçu de longue date par lui seul ou a-t-il évolué au gré des contingences et des conseils reçus, naviguant à vue, dans une mer agitée et truffée de mines ? Que voulait-il vraiment ? Maintenir l’Algérie sous domination ? S’en débarrasser ? Du côté des historiens et des meilleurs journalistes, c’est souvent, devant ces questions, une certaine perplexité qui l’emporte. L’historien Charles Robert Ageron explique combien il est impossible de se faire une idée claire des rapports du général de Gaulle avec l’Algérie. De son côté, Jean Daniel affirme que le général de Gaulle avait exclu clairement les hypothèses de l’intégration et de l’indépendance. Jean Lacouture, dans sa monumentale biographie de De Gaulle, décrit pourtant » un de Gaulle au pluriel « , personnage multiple qui ne pense pas de la même façon le problème algérien selon qu’il porte la casquette du » sociologue de l’histoire « , du général ou de l’homme politique. L’ouvrage paru dès 1974, La Guerre d’Algérie ou le Temps des méprises, qui rapporte les analyses de plusieurs témoins importants de l’époque, parmi lesquels André Jacomet ou Hubert Beuve-Méry, s’arrête quant à lui sur cette question : » Que sait-on des intentions du Général ? » Il semble que même ses proches les ignoraient. Et que ni ses discours ni ses actes ne permettent, le plus souvent, d’entrevoir une volonté de solution libérale, autonomiste. Contre cette incertitude fondamentale, l’historien américain Irwin Wall, dans son récent essai Les États-Unis et la guerre d’Algérie, a développé une thèse nettement plus tranchée. Selon lui, le général de Gaulle voulait garder l’Algérie française. Il ne faut pas, assure-t-il, se fier aux confidences faites aux uns et aux autres car elles se contredisent. De Gaulle a souvent agi sous la pression de l’ONU et surtout des États-Unis. Le choix de l’autodétermination, annoncé quelques jours seulement après la visite officielle du président Eisenhower à Paris en septembre 1959, exprime alors davantage la volonté d’une association forte de l’Algérie avec la France qu’une étape vers l’indépendance.
Peut-on tout de même parvenir à comprendre les ambiguïtés de la politique algérienne de De Gaulle ? Pour tenter, cinquante ans après, ce récit d’histoire, il faut repartir d’un moment oublié de la guerre d’Algérie, une date clé, tombée depuis lors dans une sorte de trou mémoriel : le 16 septembre 1959. Ce jour-là, à 20 heures, le général de Gaulle s’adresse aux Français dans un discours radiotélévisé. Alors que l’Algérie est à feu et à sang depuis cinq ans déjà, l’homme qui est revenu au pouvoir à la faveur de la crise secouant les départements français de l’autre rive de la Méditerranée lâche le mot : » autodétermination « . » La seule voie qui vaille « , explique alors le président de la République, est celle du » libre choix que les Algériens voudront bien faire de leur avenir « . » Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales et internationales, je considère comme nécessaire que le recours à l’autodétermination soit dès aujourd’hui proclamé « .
C’est un basculement décisif, qui ouvre grand, certes sans le dire tout de suite, la porte aux tenants de l' » Algérie algérienne « . Car si les Algériens votent pour décider de leur avenir, c’est la volonté de la population musulmane, très largement majoritaire, qui l’emportera. L’indépendance est encore loin, mais elle entre pour la première fois dans le domaine du possible.
Le général De Gaulle ne fixe pas d’échéances précises, de calendrier pour une éventuelle négociation. Il affirme aussi qu’en cas de sécession » toutes dispositions seraient prises pour que l’exploitation, l’acheminement, l’embarquement du pétrole saharien, qui sont l’œuvre de l’armée et intéressent tout l’Occident, soient assurés, quoi qu’il arrive « . Rejetant en fait » l’intégration « , baptisée par lui » francisation « , il offre aux Algériens le choix entre » l’association » et la » sécession « . Ce discours du 16 septembre 1959 suppose la négociation ouverte avec le FLN, et accorde à la population musulmane (majoritaire aux neuf dixièmes) de trancher le sort de l’Algérie. Les partisans de l’Algérie française crient aussitôt à la trahison. Trois ans après le discours de » l’autodétermination « , c’est donc la volonté de la population musulmane, très largement majoritaire, qui l’emportera…
Le général De Gaulle deviendra la figure principale de la guerre d’Algérie, celle autour de laquelle se cristalliseront les passions et les haines. Et longtemps, le mystère de sa décision autour du passage à l’autodétermination algérienne continuera de hanter les habitants d’Algériens, pieds-noirs ou Algériens musulmans.
Demeure cette date clé, le 16 septembre 1959, le jour où le général De Gaulle apparaît sur les écrans de la télévision et lève l’équivoque de son attitude face au conflit algérien, pour lâcher le mot tabou : » autodétermination « . La France se décide, enfin, à sortir du système colonial en Algérie. Une autre guerre va commencer, franco-française, cette fois….
- Article repris du blog de Jean Daniel : http://jean-daniel.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/09/15/a-qui-de-gaulle-a-t-il-menti.html.
- Ce texte est repris de Mediapart http://www.mediapart.fr/club/blog/benjamin-stora/150909/il-y-50-ans-un-tournant-de-la-guerre-d%E2%80%99algerie-16-septembre-1959-le-0, avec l’accord de Benjamin Stora.