Suzanne Citron.
Trajectoire et héritage(s) d’une intellectuelle engagée
mardi 6 mars, 18h30 > 20h30
La Colonie
128 rue de La Fayette – 75010 Paris
La Colonie et le collectif Aggiornamento organisent une soirée en honneur de l’historienne et militante Suzanne Citron, avec le soutien du CVUH (Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire). Auteur du Mythe national, elle est connue pour ses travaux critiques sur l’enseignement de l’histoire et pour ses engagements anticoloniaux.
Au programme : débats et témoignages sur ses écrits, son engagement et son héritage, projection et présentation d’archives.
Ouverture : Laurence De Cock (historienne),
● Première partie | Trajectoire et engagements de Suzanne Citron,
avec Marianne Debouzy (historienne et secrétaire du Comité Maurice Audin, de 1958 aux années 1960), Jérôme Bocquet (historien), Patricia Legris (historienne), Etienne Balibar (philosophe), Gilles Manceron (historien).
● Deuxième partie | Héritages : L’aggiornamento de l’enseignement de l’histoire, depuis l’article de 1968 de Suzanne Citron dans les Annales jusqu’à sa préface en 2017, « Pesanteurs et frustration autour de l’histoire scolaire », à la deuxième édition de La Fabrique scolaire de l’histoire (Agone, CVUH),
avec Véronique Servat, Servane Marzin, Vincent Casanova et Hayat El Kaaouachi qui ont contribué au livre La Fabrique scolaire de l’histoire.
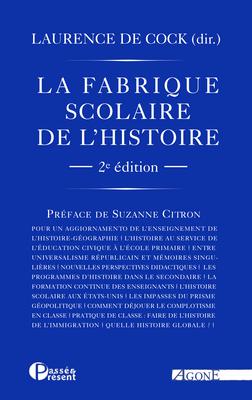
● Projection du film du CVUH : Suzanne Citron et Marianne Debouzy : itinéraires croisés d’historiennes
entretien avec Aurore Chéry et Nelcya Delanoé (février 2016).
Première partie. L’éveil de deux consciences politiques.
Deuxième partie. L’éveil de deux consciences politiques au temps de la guerre d’Algérie.
● Vente de livres.
Voir aussi sur les choix de Suzanne Citron lors de la guerre d’Algérie et sur son engagement pour les droits des Palestiniens
—————————
Extrait de l’avant-propos du livre de Mémoires de Suzanne Citron, Mes Lignes de démarcation. Croyances, utopies, engagements (Ed. Syllepse, 2003), pages 17-19.
[…]
Les colonies et la mission civilisatrice de la France
Quelques réminiscences surgissent de cette exposition coloniale1.
Elle répondait, a écrit Henri Dubief2 , à la volonté pédagogique des dirigeants d’alors d’« intéresser les masses à l’idée impériale ». Janine et moi, l’avons visitée dix fois et nous nous en prévalions avec fierté. Je me souviens surtout du temple d’Angkor reconstitué, l’un des clous de l’exposition. Je jetais un regard curieux, étonné sur ces « indigènes » que l’on avait pour l’occasion trimbalés de leur lointain pays d’Asie et d’Afrique afin de les montrer. Le site n’a-t-il pas donné naissance à ce qui est devenu un jardin zoologique ? En tout cas, ces populations frappaient par leur exotisme les petites parisiennes que nous étions. Elles confirmaient les idées que les manuels d’alors nous suggéraient. Ceux de géographie nous enseignaient la division de l’humanité en grandes races et nous les montraient en images : les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les « Peaux-Rouges ». Le Noir — en tout cas celui de Calédonie — était souvent figuré le nez traversé par un morceau de bois, ce qui ne manquait pas de nous confirmer dans le sentiment de la sauvagerie. Le Noir d’Afrique, cependant, avait aussi le visage on enfant du Nègre à chéchia Banania, qui nous invitait à nous pourlécher les babines d’u nouveau chocolat en poudre dissout dans du lait.
L’enseignement des manuels de géographie était complété par le message des livres d’histoire : grâce à la colonisation, nous améliorions le sort des indigènes, nous les faisions passer de l’état de primitifs à celui de civilisés. L’une des vignettes les plus significatives à cet égard montrait Brazza délivrant des esclaves. « La France ne veut pas qu’il y ait des esclaves dans les pays qu’elle possède , affirmait le Petit Lavisse de mon enfance. Je montrerai longtemps après, dans mon livre Le mythe national, comment cette image s’est transmise dans certains manuels de l’école élémentaire jusqu’aux années 1970 ! Mais sur ce thème de l’action civilisatrice des indigènes par la colonisation, l’osmose était parfaite entre ce que j’apprenais à l’école et ce que j’entendais dire à la maison.
Je crois que dans mon enfance je n’ai à peu près jamais entendu mettre en doute le bien-fondé de la colonisation. Peut-être m’a-t-on vaguement parlé du travail des noirs dans les champs de coton créés au Niger (un oncle ou un cousin maternel avait, me semble-t-il, participé comme ingénieur ou expert à cette mise en culture). Les seules réserves dont je me souvienne concernaient les Indes néerlandaises. Les Hollandais, me disait ma mère, s’étaient montrés féroces avec les indigènes, les réduisant en quelque sorte au travail forcé. Les Hollandais, oui, mais pas la France intouchable des droits de l’Homme.
Le mot indigène a longtemps été porteur d’une double connotation : celle de l’infériorité de celui que le mot désigne, celle de l’appartenance implicite à une humanité supérieure de celui qui parle. J’avais parfaitement intériorisé cette double connotation. J’ai cru dur comme fer aux bienfaits et à la justesse d’une colonisation qui avait apporté l’instruction, la médecine, le « progrès » à tous ces peuples. Tout en l’ignorant je faisais totalement mienne, cette célèbre phrase de Jules Ferry qui désormais nous dérange et qui est aujourd’hui présentée de façon critique dans quelques manuels du secondaire :
« Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont « le devoir de civiliser les races inférieures » » (Débats parlementaires, 28 juillet 1885).
Je découvrirai seulement à partir de la guerre d’Indochine, après 1945, la face cachée du colonialisme, complètement étrangère à mon éducation. Je reviendrai plus loin sur cet ébranlement décisif dans ma représentation de la France.
[…]
—————————
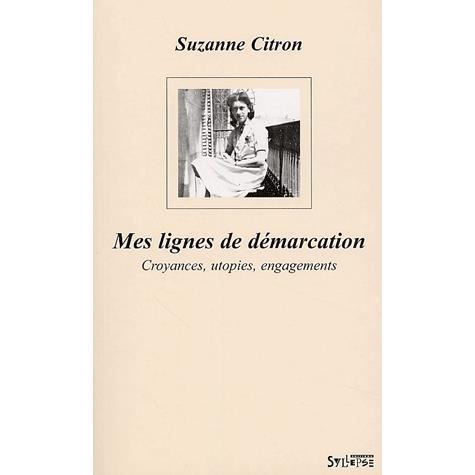
Un point de vue sur Mes Lignes de démarcation. Croyances, utopies, engagements.
par Rémi Fabre
Le livre de Suzanne Citron constitue une autobiographie intellectuelle qui relève en partie de ce que les historiens ont pris l’habitude de nommer « l’ego-histoire » ; mais c’est aussi un livre de témoignage sur une famille, des proches, des réseaux d’amitié. Bien qu’écrit à la première personne, c’est parfois un ouvrage à deux voix, car les lettres, le journal personnel de Suzanne Citron, les pages d’écriture de telle ou telle époque sont insérés dans le récit, et, quoique mis à distance par le commentaire critique, apportent leur part de vie et d’émotion.
Le parti pris rationaliste et « anti-sentimental » est aussi rompu par la suggestion des quelques très belles photos qui figurent à la fin de l’ouvrage. On est particulièrement frappé par l’image magnifique des deux grands-pères, ces deux grands juifs d’État dans leur gloire républicaine, le général Paul Grumbach et le président de la Cour d’Appel de Paris, Eugène Dreyfus. L’histoire intellectuelle de Suzanne Citron est marquée par la critique du mythe national qui avait baigné son enfance et sa famille. On ne jurerait pas que quelque chose n’en soit pas resté à travers l’image des deux grands-pères. En tout cas, cette histoire commence par la tragédie, et la première partie, « le gouffre de juin 1940 », frappe au point d’inciter à relativiser toute la suite, si riche, précise et suggestive qu’elle soit. Avoir 17 ans en 1940 : la jeunesse de Suzanne Grumbach, c’est l’Occupation, la déchirure de cette famille française israélite si patriote, qui se tourne immédiatement vers la voix de Londres, qui hait d’emblée, et pour le journal de Suzanne avec toute l’intransigeance de l’adolescence, le maréchal à la voix chevrotante.
Prisonnier, le père de Suzanne sera traité en officier français. Replié à Bordeaux puis Bayonne pendant la « drôle de guerre », le reste de la famille était revenu à Paris en septembre 1940. A la suite des premières mesures antisémites de Vichy, la mère de Suzanne s’était déclarée juive en octobre 1940, comme l’ensemble des juifs français de son milieu : « imprudence et fierté face à un pouvoir méprisable de tous ceux qui ne voulaient pas se « renier » sans en mesurer la folle imprudence ». Après deux années dans Paris occupé et l’expérience du port de l’étoile jaune, la ligne de démarcation est franchie in extremis en août 1942, les deux sœurs tombant dans les bras l’une de l’autre à… Saint-Gengoux-le-National. Les deux dernières années de l’Occupation se passent à Lyon. Étudiante en histoire, Suzanne Grumbach noue amitié et admiration avec Henri-Irénée Marrou, le grand professeur catholique et résistant. Elle s’était elle-même tournée au cours de l’année 1942 vers le christianisme réformé et était devenue membre de la « Fédé », l’organisation étudiante protestante. A Lyon, « protestants et catholiques œuvraient ensemble dans la clandestinité militante symbolisée au plus haut niveau par la participation commune à la rédaction et à la diffusion des Cahiers du Témoignage chrétien ».
Arrêtée à Lyon le 25 juin 1944, Suzanne Grumbach a vécu les dernières semaines du camp de Drancy. Distancié, précis, préférant l’analyse et la description au vain appel à l’émotion, son témoignage n’en est que plus frappant. Elle est sauvée comme « demi-juive » grâce à sa carte d’identité falsifiée, mais dans le dernier convoi du 31 juillet sont partis sans retour tous ses amis du camp et la cousine de sa mère, monitrice et accompagnatrice des orphelins juifs de l’UGIF. Suzanne mettra longtemps, dit-elle, à réapprendre à sourire. A la Libération, c’en est fini du temps fusionnel du Moi, de la famille et de l’Histoire. Sur le plan intellectuel et politique, Suzanne appartient à la génération de la Libération.
Elle retrace dans sa deuxième partie l’effervescence militante de l’après-guerre. Pour les étudiants de son époque la principale question intellectuelle a été le marxisme, la principale question politique le communisme. Suzanne a pu à certaines occasions se rapprocher du « compagnonnage de route », en particulier en 1950, année de l’Appel de Stockholm où elle a assuré le secrétariat de la Fédération française des associations chrétiennes d’étudiants. Il n’empêche que son engagement protestant, et « l’esprit fédératif », dont elle est une bonne représentante, ont été de solides garde-fous contre la dogmatique « scientiste » stalinienne, à laquelle n’ont jamais succombé non plus Paul Ricoeur ou André Dumas. Son engagement religieux datait d’avant la Libération et, après coup, les distances ayant été prises, elle en discerne les racines dans son mal-être existentiel d’adolescente à la jeunesse volée. Il n’empêche que si elle a été saisie en 1942, et pour quelques années, par une parole, celle du pasteur Pierre Maury, c’est sans doute aussi parce que le barthisme, dont Maury était la figure centrale, fournissait une armature intellectuelle et dialectique, en même temps qu’une forte proximité avec la culture biblique et ses racines juives. Si la « Fédé » de l’après-guerre est barthienne, elle est en même temps fort engagée à gauche et contestataire par rapport au protestantisme bourgeois, avec une sensibilité précoce aux questions d’outre mer, en particulier celle de Madagascar.
Devenue par son mariage Suzanne Citron, elle a gardé cette sensibilité et s’est fortement engagée au moment de la guerre d’Algérie. Deux aspects étroitement liés dominent tout le reste de ses mémoires, l’engagement politique et l’engagement enseignant. Des guerres coloniales à mai 1968, puis des années Lip au premier septennat de François Mitterrand, on a, avec son témoignage, un bon exemple de ce qu’on pourrait appeler la sensibilité de la deuxième gauche, anticolonialiste, autogestionnaire, très en phase avec l’esprit de mai, un temps sensible à la révolution culturelle chinoise, puis trouvant, le temps d’un mandat municipal, un épanouissement citoyen dans le socialisme rocardien, avant que ne vienne la prise de distance, et, peut-être une certaine désillusion.
Mais plus qu’une militante politique, Suzanne Citron apparaît surtout comme une militante enseignante. C’est le projet de changer l’école, l’université et l’enseignement de l’histoire, qui ont mobilisé tous ses espoirs et son énergie, et c’est la retombée de ces espérances qui l’amène à démissionner du PS en 1983. Si elle a terminé son parcours enseignant dans l’Université, elle n’a cherché ni voulu la « carrière » et « l’accession (écrit-elle) à ce haut incarné dans mon enfance par mes deux grands-pères ». Comme si, aurait-on envie d’ajouter, la trahison et la lâcheté de Vichy contre les siens lui avaient montré à jamais la vanité de telles « gloires ». De fait, la plus belle image qui ressort de ce parcours éducatif, ce n’est pas celle d’un professeur arrivé, mais la photo, en juillet 1949, de la dernière classe d’une jeune enseignante au bord de la Moselle.
Rémi Fabre
Un entretien a été réalisé en 2013, par Radio Zinzine (Forcalquier-Aix), avec Suzane Citron, chez elle, et Laurence de Cock, sur les tendances nationalistes françaises récurrentes dans l’historiographie et les travaux du site »Aggiornamento » qui propose une histoire plus universelle et plus vivante. Avec la participation de Nathalie Noubel, professeur des écoles (45 min). Ecoutez l’émission.
- L’exposition coloniale internationale de 1931 dans le Bois de Vincennes que Suzanne Citron a visitée à de nombreuses reprises avec sa sœur Janine, celles-ci étant âgées alors de 9 et 8 ans. NDLR.
- Henri Dubief (1910-1995) a été professeur de lycée puis de classes préparatoires, puis secrétaire et vice-président de la Société de l’histoire du protestantisme français, il a publié plusieurs ouvrages sur la Troisième République dans les années 1930. NDLR.



