Histoire et économie politique de la colonisation française, XIXe-XXIe siècle
par Denis Cogneau
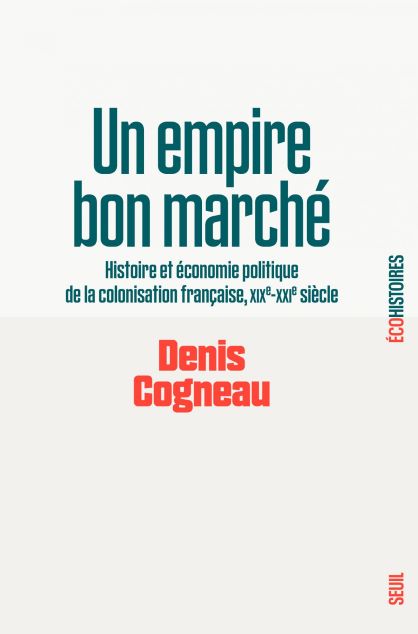
Denis Cogneau est professeur associé à Paris school of economics, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, directeur d’études à l’EHESS.
Au XIXe siècle, la France s’est lancée dans la colonisation de pays entiers en Afrique et en Asie. Quelles ont été les motivations et les méthodes de cette politique ? Comment les sociétés dominées ont-elles été bouleversées, et quel développement économique et social ont-elles connu ? La décolonisation est-elle achevée aujourd’hui ? Un Empire bon marché propose de nouvelles réponses à ces questions controversées.
Grâce à un long travail d’archives et d’analyse statistique, l’ouvrage décrit ainsi avec une grande précision les États coloniaux et leur fonctionnement – à travers notamment la fiscalité, le recrutement militaire, les flux de capitaux et les inégalités. Il montre que l’empire a peu coûté à la métropole jusqu’aux guerres d’indépendance, et que les capitaux français n’ont pas ruisselé vers les colonies. La « mission civilisatrice » que la République française s’était assignée n’a donc pas débouché sur le développement des pays occupés, et c’est plutôt un régime à la fois violent et ambigu qui s’y est établi. De fait, le régime colonial a surtout bénéficié à une petite minorité de colons et de capitalistes français. Quant aux élites nationalistes, elles ont le plus souvent reconduit un État autoritaire et inégalitaire après les indépendances. En s’attachant à l’évolution des sociétés colonisées et à leur devenir, Denis Cogneau fournit une contribution majeure et un nouvel éclairage sur l’impérialisme, d’hier à aujourd’hui.
Source
Sur l’empire colonial français, à propos duquel tant a déjà été écrit, voici un livre neuf. Publié dans la collection « Eco-histoires », qui fait une belle place aux tableaux et aux graphiques à l’appui de la narration, il propose une relecture globale très maîtrisée des enjeux économiques de la colonisation. Ici, pas de jugements ni d’emphase, mais un propos clair, dense et chiffré pour revisiter des idées reçues bien installées. L’historiographie est en effet restée tributaire d’un livre pionnier, Empire colonial et capitalisme français, de Jacques Marseille (Albin Michel, 1984), défendant l’idée d’un désintérêt des milieux d’affaires pour des colonies réputées coûter trop cher au contribuable. Les données établies par Denis Cogneau et l’équipe d’économistes ayant épluché avec lui les archives montrent précisément l’inverse : bien des entreprises firent de bonnes affaires dans l’empire, où la dépense publique fut toujours dérisoire. Les colonisés ont « payé pour leur propre domination », sans que les infrastructures, routes ou écoles, vantées par le discours colonial, se soient concrétisées.
André Loez
« Un empire bon marché. Histoire et économie politique de la colonisation française, XIXe-XXe siècle », de Denis Cogneau, Seuil, « Eco-histoires », 500 p., 24,50 €, numérique 18 €.
Denis Cogneau : « Les colonisés ont financé leur propre domination »
Propos recueillis par Pascal Riché, publié le 21 janvier 2023 par L’Obs.
[Source->https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20230121.OBS68585
/denis-cogneau-les-colonises-ont-finance-leur-propre-domination.html]
C’est l’un des premiers essais importants de 2023. « Un empire bon marché » (Seuil) s’attaque à l’histoire économique de la colonisation, un champ déserté depuis une quarantaine d’années. Un champ de mines aussi, tant les controverses sont vives sur le sujet. Pour s’y aventurer, l’auteur, Denis Cogneau, professeur à l’Ecole d’Economie de Paris et directeur de recherches à l’EHESS, s’appuie sur un travail de quinze ans, mené avec une équipe d’économistes. Ils ont épluché des centaines d’archives pour construire une base de données économiques et sociales offrant une bien meilleure vision de l’Empire français après 1830. Et ils ont eu de nombreuses surprises, la principale d’entre elles étant la modicité des dépenses de la France pour maintenir son empire.
Dans votre livre, vous détruisez plusieurs idées reçues. La colonisation n’a pas énormément alimenté la croissance des métropoles ; elle n’a pas été un « fardeau » pour leurs contribuables ; elle n’a pas non plus tiré les pays du Sud vers le haut en matière d’infrastructures ou d’éducation… Quel a été son impact sur l’économie française ?
Pas énorme. Les pays colonisés par la France étaient parmi les plus pauvres du monde, les plus éloignés des échanges. Pour le capitalisme français, l’empire colonial n’a donc pas été un champ d’investissement central. A la Belle Epoque, il ne constituait que 10 % des actifs investis à l’étranger et 2 % de la richesse mobilière. Et finalement, dans les années 1950, environ 10 % de cette richesse. Certes, cet empire a servi de matelas de sécurité, pour l’économie, pendant les périodes de crise, comme entre les deux guerres mondiales, ce qui n’est pas rien. Le bilan des investissements est contrasté : il y a eu des échecs retentissants, mais aussi quelques réussites – par exemple, les huiles Lesieur, nées du commerce de l’arachide avec le Sénégal, ou les mines d’Afrique du Nord. La colonisation a engendré quelques fortunes. Elle n’a profité qu’à une petite minorité de la société : quelques entreprises, une partie des colons, notamment des fonctionnaires et militaires dont elle a accéléré la carrière.
Y a-t-il eu, comme certains l’ont affirmé, un « divorce » entre le capitalisme français et la colonisation ?
Non. Le grand capital n’y était pas hostile. Il y voyait un champ d’opportunités comme un autre et il était dans l’attente d’investissements de l’Etat. Ce dernier a certes investi dans les routes, les chemins de fer et les ports, mais la thèse de mon livre est que cela n’a pas coûté si cher que ça.
C’est contre-intuitif, sachant que les possessions françaises étaient, par leur surface, vingt fois plus grandes que la métropole…
Cela s’explique par la disproportion économique entre la métropole et son empire, dont les populations étaient au départ de tailles équivalentes. A la fin du XIXe siècle, la France était déjà une économie très importante.
Votre livre décortique aussi le bilan pour les sociétés colonisées, pour le coup clairement négatif.
Pour justifier la colonisation, la France s’était donné une « mission civilisatrice ». Il s’agissait notamment de tirer vers le haut les économies colonisées, de les rapprocher des standards européens. Mais il n’y a jamais eu de rattrapage. La croissance, l’amélioration de l’espérance de vie, la progression de la scolarisation, ont été très en deçà des ambitions affichées. Les efforts d’investissements publics dans les colonies ont surtout eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire trop tard : c’était le début des processus d’indépendance. Avant cette période, les contribuables français ont été très peu sollicités. Les colonies étaient autofinancées par les impôts prélevés sur leurs populations, qui jusqu’au tout dernier moment sont restées privées des droits politiques.
Les investissements après 1945 ont-ils conduit à plus de croissance ?
Il y a eu des progrès, mais pas suffisants pour dissuader les mouvements d’indépendance. Et pendant ce temps, en France, c’était les Trente Glorieuses. L’écart ne se réduisait donc pas. Par ailleurs, durant cette période, les pays du Sud qui n’étaient déjà plus sous domination coloniale, comme l’Inde et l’Egypte, ou les nations d’Amérique latine n’ont pas eu de plus mauvais résultats que les colonies françaises concernant la santé ou l’éducation. Il est intéressant de comparer le cas de l’Indochine française avec celui de la Thaïlande voisine, qui était certes sous influence britannique, mais qui jouissait d’une pleine souveraineté. Au début du XXe siècle, l’Indochine fait un peu mieux en matière de revenus ou d’exportations. Mais elle entre en crise dans les années 1930, et connaît par la suite plusieurs guerres, d’abord contre la France, ensuite entre le Nord et le Sud, enfin contre les Etats-Unis. Finalement, la Thaïlande dépasse l’Indochine devenu le Vietnam. Et elle s’en est tirée aussi bien sinon mieux que nombre d’autres pays colonisés.
Y a-t-il eu des approches coloniales plus réussies ?
Certaines approches ont été moins difficiles à vivre que d’autres. Être sous protectorat, comme en Tunisie ou au Maroc, était moins douloureux (et moins destructeur des institutions préexistantes) qu’être annexé comme en Algérie. Si l’on compare les colonisations européennes (britannique, néerlandaise, portugaise…) entre elles, le bilan n’est ni particulièrement élogieux ni particulièrement catastrophique pour la France. On peut lui trouver des points négatifs mais aussi positifs, toujours de second ordre. Le sécularisme français a freiné l’extension de l’éducation, mais il a parfois favorisé des Codes du Mariage plus favorables aux femmes, par exemple.
Sur l’éducation, la République française n’avait-elle pas de plus grandes ambitions que les autres ?
Oui, mais il faut détruire un mythe, alimenté par pas mal d’auteurs, y compris les meilleurs, comme Fernand Braudel. A les lire, s’il y a eu une œuvre positive de la colonisation française, c’est l’éducation. Ce n’est pas ce qui ressort du bilan.
L’investissement éducatif a surtout visé les populations européennes installées dans les colonies. En 1955, le taux de scolarisation primaire en Algérie atteint péniblement 17 % et il ne dépassera pas un tiers, malgré une ultime accélération avant l’indépendance. Le modèle français n’est pas si brillant. L’éducation a par exemple davantage progressé dans la partie britannique du Cameroun que dans sa partie française, ou dans la partie britannique du Togo que dans sa partie française. Pourquoi ? Parce qu’à la différence de la France laïque, les Britanniques n’étaient pas réticents à l’investissement des missions chrétiennes, qu’ils subventionnaient même. En Afrique subsaharienne, ils ont créé plus d’écoles, de lycées et même d’universités. Au moment des indépendances, beaucoup plus de personnes sont passées par l’école au Ghana qu’en Côte d’Ivoire. Il en a résulté un plus petit nombre de cadres en Afrique francophone. De ce fait, après les indépendances, beaucoup de cadres français sont restés. Cela explique en partie la persistance d’un lien fusionnel entre la France et ses anciennes colonies, la « Françafrique ». Côté britannique, les élites locales, plus nombreuses, plus radicales, ont pris plus nettement leurs distances avec l’ancienne métropole.
On dit parfois que les anciennes colonies doivent à la France leurs routes, leurs infrastructures… Un autre fantasme ?
Des routes et des voies de chemin de fer ont été construites, pour relier les villes ou les mines. Mais il ne faut pas surestimer cet effort. Au début du XXe siècle, certaines régions en France étaient sous-équipées : la Bretagne ou la Corse, par exemple ; à la fin de la période coloniale, force est de constater qu’elles étaient bien mieux reliées et électrifiées que l’Algérie… Les colonies sont restées les parents pauvres.
Contrairement à ce qu’on disait alors, la Corrèze passait avant le Zambèze…
C’était une crainte exprimée à partir des années 1950 : que les colonies ne finissent par coûter cher. Elle était justifiée, car si on les avait conservées, les transferts nécessaires à leur développement auraient été très élevés. Mais cela n’a pas eu lieu. Ce qui coûtait cher vers la fin de la période coloniale, c’était les guerres, à commencer par l’Indochine puis l’Algérie.
Votre livre se risque à une quantification globale du coût de ces guerres, ce qui n’a jamais été vraiment fait jusque-là…
Oui, c’est un chiffrage un peu fruste encore, mais qui n’a pas d’équivalent à ma connaissance. De 1830 à 1939, en moyenne, le gouvernement dépense 0,5 % du PIB pour les colonies, dont 0,4 point pour le militaire, soit 80 % des financements ! Après 1945, on passe à 3 % du PIB, dont 2,5 points de dépenses militaires. Les transferts « généreux » ne constituent donc, à la fin de l’époque coloniale, que 0,5 % du revenu national.
L’objectif actuel d’aide publique au développement, fixé par l’OCDE, est de 0,7 % du PIB. On n’a donc même pas dépassé ce niveau…
Jamais. Dans l’après-guerre, en additionnant les transferts civils et les dépenses militaires « non coloniales » (les dépenses qui auraient été constatées dans ces territoires s’ils avaient été des pays indépendants), on s’approche péniblement cet étiage.
Jusque-là, le bilan économique de la colonisation qui faisait référence était celui de Jacques Marseille, publié en 1984 : Empire colonial et capitalisme français. Histoire d’un divorce (Albin Michel). Cet historien venu du marxisme était arrivé à une conclusion contraire à la doxa de la gauche : la colonisation n’avait pas dopé le développement des pays « impérialistes », elle avait même été pour eux un boulet.
Vous réduisez sa thèse en charpie.
Ce n’était pas mon objectif premier, mais j’ai été obligé de me confronter à ses thèses. Il a fait un travail héroïque sur les données, à la main, sans les moyens numériques dont nous disposons. Après avoir analysé les balances commerciales des pays colonisés par la France, il a constaté qu’elles étaient déficitaires ; il en a déduit que les colonies avaient bénéficié de transferts publics et d’apports privés de plus en plus importants. Un résultat contraire à l’interprétation marxiste, selon laquelle la colonisation est une exploitation du travail des peuples colonisés, payés au salaire de subsistance. Jacques Marseille est donc très surpris. Ce qu’il ne saisit pas alors, c’est que l’essentiel des financements français dans les colonies, comme on l’a vu, ce sont des dépenses militaires courantes.
Jacques Marseille aurait donc bâti sa thèse sur une erreur…
Une erreur comptable, oui. Et en 2005, l’historien Daniel Lefeuvre, dans Chère Algérie (Flammarion), a fait la même.
A vous lire, il est un domaine dans lequel la puissance coloniale française a été efficace, c’est la fiscalité. L’essentiel des dépenses a été financé par les contribuables locaux…
C’est une surprise, qui explique aussi pourquoi l’empire a été « bon marché ». Certains auteurs décrivent l’empire colonial comme un système chaotique et plein de trous, les colonisés parvenant à échapper à l’impôt ou au service militaire. Ce n’est pas le cas. Les États coloniaux français sont forts. Leur organisation est militarisée (les administrateurs ont d’ailleurs des titres évoquant la hiérarchie militaire, comme « lieutenant », « gouverneur »…), ainsi que leur police. Cet ordre militaro-policier se conjugue avec un ordre fiscal tout aussi sérieux. Il s’appuie sur des impôts frustes et injustes, comme la « capitation » [une taxe par tête, NDLR]. D’après nos simulations, il y a eu dans la collecte de ces impôts une déperdition normale. La thèse du système « plein de fuites » ne tient pas. La fiscalité, dans des pays indépendants comparables (Bolivie, Thaïlande…) était moins efficace qu’en France où la majeure partie des infrastructures, des salaires des enseignants, des services publics, a été payée par les autochtones. Les colonisés ont financé leur propre domination.
Quant aux coûts de fonctionnement de l’administration coloniale, ils étaient extraordinairement élevés…
Les fonctionnaires français étaient payés aux niveaux de la métropole, avec en plus des primes d’expatriation très importantes. Les fonctionnaires locaux de l’administration coloniale eux-mêmes bénéficiaient de salaires beaucoup plus élevés que le revenu moyen de la population. Dans le langage colonial et raciste de l’époque, on les appelait les « évolués ». Une toute petite classe moyenne a été créée autour d’eux. Mais globalement, les recettes fiscales ne profitaient pas beaucoup à l’intérêt général. Ce système n’a pas du tout permis le développement économique et social. Sans compter les nombreuses victimes de sa violence, au début, à la fin, et tout au long.


