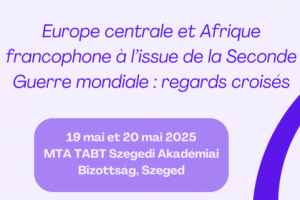par Aïssa Kadri, pour histoirecoloniale.net
Les 19 et 20 mai 2025, un colloque international, à l’initiative du Centre universitaire francophone, du département d’Histoire moderne et d’Études méditerranéennes de l’Université de Szeged et du Centre régional de l’Académie hongroise des sciences, s’est tenu en Hongrie, au Centre régional de l’Académie hongroise des sciences à Szeged. Son thème : « Europe centrale et Afrique francophone à l’issue de la Seconde Guerre mondiale : regards croisés ». Il a été le cadre de très riches apports et débats. Les organisateurs et les participants ont appelé en conclusion de ce colloque dense, riche et stimulant, à la publication des actes, afin d’approfondir ces recherches novatrices dans une perspective comparatiste et interactionniste afin d’éclairer davantage les effets de cette période sur le présent.
Lors des conférences inaugurales, Mr André Erdős (ambassadeur de Hongrie aux Nations Unies et en France) a parlé de la vie hongroise en Algérie jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le professeur Maurice Vaïsse (Science Po Paris) a développé une approche comparatiste : « Entre l’Afrique et l’Europe, le choix de la France en 1945 ». Ces deux conférences stimulantes ont mis d’emblée les participants au cœur du sujet.
La conférence de l’ambassadeur André Erdős, né en Algérie à Bab-el-Oued à la fin de la guerre, pleine d’émotion et de détails sur la vie quotidienne, a rappelé l’histoire des Hongrois qui ont émigré en Algérie à la fin de la Première Guerre mondiale. En s’appuyant sur des documents, sur l’iconographie et sur sa mémoire, il a fait vivre la communauté hongroise installée en Algérie dont il a restitué les grandes caractéristiques sociologiques. Il ne s’agissait pas de colons mais plutôt d’artisans, de travailleurs manuels exilés en Algérie après la Première Guerre mondiale. Sans être nombreux (il n’existe pas statistiques, mais cette communauté varierait selon les estimations de six cents à un millier de membres), ils ont constitué une communauté généralement installée dans l’Algérois. Organisés en association ils se retrouvaient à certaines occasions. Les photos que l’ambassadeur souhaite présenter dans une exposition en lien avec la représentation algérienne à Budapest montrent des réunions festives (place du Duc d’Orléans devenue place des Martyrs) à Alger et dans ses environs (à Blida notamment). Située plutôt à gauche sur l’échiquier politique du moment, cette communauté va se rapatrier dans les années 1960 en Hongrie. Dans les réponses aux questions qui ont suivi, on apprend ainsi que l’Emir Abdelkader aurait eu un expert artificier militaire hongrois comme conseiller, et que, parmi les Hongrois engagés dans la légion étrangère qui combattaient en Algérie, il y a eu des déserteurs et que l’un d’eux a fini comme colonel dans l’armée algérienne.
L’apport du professeur Maurice Vaïsse
Le professeur Maurice Vaïsse a souligné dans sa riche introduction que dans l’après Seconde Guerre mondiale, la France était parmi les États européens le seul à subir le choc des deux grands phénomènes simultanés : la guerre froide et la décolonisation. Le Royaume Uni est confronté à l’émancipation de ses colonies, mais il ne subit qu’indirectement la guerre froide à la différence de la France, où le PCF représente jusqu’au quart de l’électorat et reste membre du gouvernement jusqu’en mars 1947. Par ailleurs, le deuxième conflit mondial a souligné à bien des titres l’importance pour la France de son Empire. La France libre a deux capitales : Brazzaville puis surtout Alger. Ses colonies africaines lui ont fourni les moyens militaires et économiques de sa renaissance après l’effondrement de 1940 (recrutement de soldats et de main d’œuvre, sacrifice de combattants). D’où la formule de Gaston Monnerville (député de la Guyane) le 15 mai 1945 : « Sans son Empire, la France ne serait qu’un pays libéré. Grâce à son Empire, la France est un pays vainqueur ». La France, exclue des conférences de Yalta et de Potsdam en 1945, va tenter de conserver un rôle de pont entre l’Est et l’Ouest. C’est également le moment de la décolonisation. La résistance à celle-ci de la part de la classe politique française se heurte à la volonté d’indépendance quasi-unanime des élites outre-mer. L‘Union française n’est pas une conception fédérale susceptible de favoriser des évolutions, elle vise à maintenir l’autorité de la France et à gagner du temps.
Du côté africain, le député socialiste du Dahomey Apithy explique que « l’idéal des élus africains n’est pas de siéger sur les bords de la Seine, mais de traiter sur les bords du Congo-Niger les affaires de notre pays ». En Tunisie, le Destour puis le Néo-Destour, avec Tahar Ben Amar et Habib Bourguiba réclament l’indépendance et le terrorisme se développe. La France hésite au gré des gouvernements et des Résidents entre l’octroi de l’autonomie interne et la répression.
Quant à l’Union française, elle n’apparait pas comme une solution, Bourguiba n’en veut pas : son jugement est très sévère : « une sorte de baudruche en peau de lapin ». Le statut de 1947 considère l’Algérie comme un ensemble de départements français et les indigènes sont sous-représentés en raison du double collège et du tripatouillage électoral. Lors de la discussion, les députés « musulmans » affichent une attitude sans concessions[1]. D’où une série de crises, la guerre d’Indochine (1946-54), et les conflits d’AFN. Les élites politiques françaises résistent, veulent conserver l’Afrique et théorisent même le bloc franco-africain permettant à la France de se hisser au niveau des nations continents. François Mitterrand écrit en 1952 : « la France du XXI° siècle sera africaine ou ne sera pas »[2]. Au plan européen la France exclue de Yalta et de Potsdam en 1945 va tenter de conserver un rôle de pont entre l’Est et l’Ouest. Mais les lendemains de guerre sont cruels : le pays est dévasté, les infrastructures détruites, les moyens de transport manquent, les finances sont épuisées (dès 1946, la France doit solliciter une aide financière américaine), quant à l’armée, sa faiblesse est manifeste. La France n’a pas le poids pour peser sur la politique internationale. Elle ne peut pas imposer ses vues sur l’Allemagne. Dans un contexte où la France fait l’expérience de son impuissance en Europe, la menace russe impose le choix de la petite Europe avec la création du Pacte de Bruxelles (mars 1948) ; l’aggravation des tensions internationales (coup de Prague, 24 février 48, blocus de Berlin) conduit les Européens de l’Ouest et notamment les Français à solliciter l’appui des Américains et à faire le choix de l’intégration atlantique (1949 et 1950). Tout au long de la Quatrième République, au gré des gouvernements instables, la France a donc choisi l’Europe – en réalité la petite Europe –, mais elle n’a pas voulu pour autant abandonner l’Afrique, qui constituait la caution de sa place dans le monde. Si bien que la période a été caractérisée par une série de conflits et de crises, conséquence d’une politique de résistance à l’émancipation des territoires et à la décolonisation. Le refus de choisir entre l’Europe et l’Outre-mer est même une des causes de la mort de la Quatrième République. Il faudra attendre la perte de l’Indochine en 1954, l’indépendance accordée aux protectorats du Maroc et de la Tunisie en 1956, les indépendances africaines en 1960, et celle de l’Algérie en 1962 pour que la France tourne définitivement la page de l’outre-mer et choisisse l’Europe.
L’éclairage de Miklós Nagy, de l’Université de Szeged
La rencontre organisée par l’université de Szeged a permis de suivre l’évolution de la place des intellectuels dans les transformations observées en Europe centrale et orientale. La contribution de Miklós Nagy, de cette université, s’est attachée à analyser comment s’est affirmé et s’est installé le pouvoir soviétique, en s’attachant à le saisir de manière nuancée et contextualisée à travers les particularités de la politique de Staline et des purges staliniennes de l’après-guerre, et les conditions de la soviétisation des partis communistes de l’Europe centrale et orientale. Sa contribution a mis en exergue comment dans le contexte de la fin de la guerre, les nouveaux gouvernements de coalition d’Europe centrale et orientale dominés par les partis communistes peu influents au départ, profitant de l’occupation de l’armée soviétique, vont éliminer successivement les autres partis politiques. Après la proclamation de la doctrine Truman, l’URSS exige un contrôle absolu sur les gouvernements de la région, exercé par l’intermédiaire des partis communistes. Le moyen de l’emprise institutionnelle fut le Kominform. Après le schisme yougoslave, la méfiance vis-à-vis du communisme national se renforce. Staline entame l’épuration des appareils des partis communistes afin qu’ils s’alignent sur le PC soviétique en vue de créer un bloc monolithique. L’épuration touche 25% des effectifs des partis de la région, en reprenant les méthodes des grandes purges staliniennes des années 1930. Les épurations qui touchent tous les partis communistes d’Europe centrale et orientale jouent un rôle déterminant dans l’instauration du système politique totalitaire stalinien.
La Grèce au sortir de la Seconde Guerre mondiale
La contribution de Mme. Anastasia Tsagkaraki a abordé la place de la Grèce au sortir de la Seconde Guerre mondiale et les jeux des puissances à l’égard de ce pays, carrefour géostratégique entre l’Europe et l’Afrique. Elle a montré comment après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce s’est trouvée au centre d’un jeu géostratégique majeur, occupant une position charnière entre l’Europe et l’Afrique où se dessinent les lignes qui façonnent la guerre froide. Cette position stratégique dans le bassin méditerranéen est un élément crucial dans les relations entre les blocs occidental et soviétique. À la fin de la guerre mondiale, la Grèce, qui sort d’une guerre civile dévastatrice (1946-1949), est soumise à des pressions internes et externes. D’une part, les États-Unis, selon la doctrine Truman, œuvrent en Grèce pour faire face à l’expansion du communisme en Europe et en Asie. D’autre part, l’Union soviétique aspire à exercer une influence dans la région en étendant son influence dans toute la Méditerranée. Les questions du contrôle des routes maritimes, de l’accès aux ressources naturelles et des emplacements militaires stratégiques sont les principales origines de cette polarisation. L’aide des États-Unis, représentée par le plan Marshall et la théorie de l’endiguement, permet à la Grèce de se stabiliser sous un régime pro-occidental, mais les conflits internes entre les factions communistes et entre celles du gouvernement royal font de cette petite nation un champ de bataille idéologique. La Grèce devient donc un point clé du conflit Est-Ouest où les grandes puissances tentent d’asseoir leur domination en jouant sur les équilibres de la guerre froide. Dans cette dynamique, la Grèce représente un carrefour géostratégique entre l’Europe et l’Afrique, entre les blocs occidental et soviétique.
Volontaires hongrois des Forces françaises libres et relations entre la France et la Hongrie
Zoltán Garadnai, chercheur rattaché aux Archives de Hongrie, a mis l’accent sur la politique d’ouverture à l’Est du général de Gaulle et sur le nouveau départ des relations franco-hongroises en 1944-1946. Krisztián Bene, de l’université de Pécs, historien spécialiste de l’histoire militaire (auteur d’ouvrages publiés en France) a analysé l’engagement des volontaires hongrois des Forces françaises libres sur les théâtres d’opération africains entre 1940 et 1943. Les Forces françaises libres, créées en juillet 1940, ont trouvé beaucoup moins de soutien que prévu parmi les soldats français encore temporairement stationnés en Grande-Bretagne au début de la guerre puisque la plupart d’entre eux ont décidé de rentrer chez eux. Le mouvement de Charles de Gaulle devait donc produire des résultats ailleurs, et le Général choisit l’empire colonial français, le deuxième au monde après celui de la Grande-Bretagne. Seule une minorité des dirigeants des territoires coloniaux français a décidé de rejoindre volontairement la France Libre, le reste a dû être conquis par la force des armes. Les forces militaires dirigées par le général de Gaulle commencent donc leur guerre en Afrique centrale par des combats fratricides. Bien que les Français libres aient ensuite combattu les troupes de l’Axe sur d’autres théâtres d’opération, la conquête de l’empire colonial africain, qui leur donnait une légitimité territoriale et militaire, est restée une priorité tout au long de la guerre. Une série d’opérations de reconquête sanglantes ou bien sans effusion de sang a eu lieu entre 1940 et 1943, qui a finalement abouti au contrôle de l’ensemble de l’empire colonial français d’Afrique. Étonnamment, de nombreux Hongrois ont participé à ces opérations en tant que volontaires des Forces françaises libres. Leur contribution est significative pour l’historiographie hongroise et française, mais aucune tentative de grande envergure n’a été faite jusqu’à présent pour explorer leurs activités. Krisztián Bene a présenté, sur la base de sources d’archives, les volontaires hongrois qui ont combattu les armées des puissances de l’Axe sur le continent africain. Une communication qui a été éclairée par la contribution de Ákos Péter Ferwagner, de l’Université de Szeged, qui a porté sur les ressortissants hongrois au Levant, 1945-1946.
Gergely Fejérdy (Université catholique Péter Pázmány) est intervenu sur « les Fragments de l’histoire des relations franco-hongroises il y a 80 ans ». Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, les relations diplomatiques entre la France et la Hongrie ont été rompues de facto et n’ont été rétablies que très difficilement en 1946. Sa contribution a porté sur le personnel et les activités de la légation de France à Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l’année qui l’a suivie. Les relations officielles franco-hongroises ont été assombries par la Seconde Guerre mondiale, lors de l’expansion de l’Allemagne nazie en Europe centrale puis de l’avancée de l’Armée rouge à l’Ouest en 1944-1945. La légation française en Hongrie a réagi aux changements politiques et militaires en France et en Europe centrale. La communication s’est appuyée sur des sources peu ou pas connues, notamment le journal de l’attaché militaire français, André Hallier, ainsi que les dossiers du ministère français des Affaires étrangères, déclassifiés il y a seulement quelques années.
L’expérience des camps
L’universitaire Viktória Bába (Université de Pécs), dont la thèse est intitulée « Je viens du monde des camps », est intervenu sur l’expérience des camps d’internement français au XXe siècle dans les mémoires et journaux intimes français, hongrois et espagnols. Il a livré quelques témoignages de Hongrois internés dans les camps français au Maghreb à travers des récits recueillis dans la presse mais aussi de témoignages personnels et de récits autobiographiques. A la suite du Pacte germano-soviétique et de l’entrée de la France dans le conflit, les autorités françaises ont mis en œuvre des mesures radicales : en vertu du décret-loi du gouvernement Daladier de 1938, les individus considérés comme « indésirables » ou « dangereux » ont été pourchassés et incarcérés dans les camps d’internement français. Cette politique a ciblé principalement les communistes, mais également d’autres groupes, tels que les étrangers, les militaires, les Tsiganes et les personnes de confession juive, bien que celles-ci ne soient pas nécessairement identifiées comme telles. Le premier de ces camps a été établi dans le sud de la France, à Rieucros, dans le département de la Lozère, en raison de l’afflux de réfugiés espagnols fuyant la dictature de Francisco Franco. Cependant, ces actions ne se limitaient pas uniquement aux personnes présentes sur le territoire français mais concernaient également celles qui résidaient dans les colonies françaises. La communauté espagnole, perçue comme la « victime de la méfiance », a été affectée, tout comme les anciens des Brigades internationales, qui ont été internés en Afrique du Nord (plus précisément en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Afrique-Occidentale française). Les Brigades internationales étaient composées de citoyens de 53 pays qui se sont engagés dans la guerre civile en raison de la mobilisation de la gauche. Leur effectif total est évalué à environ 35 000 individus, dont la majorité était composée de Français et d’Allemands, ainsi que d’environ 1 000 Hongrois, dont les noms sont connus. Viktória Bába s’est proposé de différencier les types de camps créés par les collaborationnistes de Vichy en Afrique francophone (internement, travail forcé ou pénitentiaire) et d’évaluer le nombre de Hongrois présents dans les camps maghrébins. Elle a analysé les témoignages hongrois publiés dans la presse, afin de saisir leur expérience vécue dans ces conditions extrêmes.
Julien Papp a abordé la spécificité du système hongrois du travail militarisé dans sa contribution intitulée : « “Des troupes armées de pelles” – Le service du travail militarisé des Juifs hongrois pendant la 2e Guerre mondiale ». Pour ne pas donner des armes aux Juifs et aux politiquement non fiables, le gouvernement hongrois instaura à partir de 1939 le service auxiliaire du travail. L’idée ayant été conçue en 1919, suite à l’échec de la République des Conseils, quand l’équipe de Horthy installée au pouvoir rejeta les Juifs et les ouvriers organisés de « l’armée nationale ». Service humiliant mais fonctionnant dans des conditions convenables jusqu’en 1941, il devint très dur pour les compagnies de travailleurs juifs et d’autres requis envoyées avec la 2e Armée sur le front ukrainien. A côté des occupations meurtrières comme les déminages, ils subissaient les exactions et les cruautés d’un encadrement truffé d’éléments sadiques antisémites. La retraite de l’armée défaite en 1943 s’accompagna de massacres, ce qui donna le nom d’« échafaud mobile » à tout le système. Ce nom se justifia pleinement à travers le calvaire des travailleurs des mines de cuivre de Bor, en Serbie, que le gouvernement hongrois avait « prêtés » à l’Organisation Todt. Évacués devant l’avance des troupes soviétiques, leur marche de retour en septembre-octobre 1944 fut marquée par des milliers d’assassinats perpétrés par les SS et leurs complices hongrois. Après le putsch des Croix fléchées en octobre 1944, toute une partie, hommes et femmes, des Juifs survivants de Budapest subirent le même sort au cours de la « marche de la mort » vers les travaux forcés de la frontière occidentale. A l’Est, les forçats faits prisonniers par les troupes soviétiques et considérés par celle-ci comme des soldats, connaîtront pendant des années les camps de prisonniers de guerre. Certains acteurs du système furent jugés par des tribunaux populaires à partir de 1945, mais beaucoup d’entre eux ont trouvé refuge dans les pays occidentaux.
La Roumanie
L’image de l’Afrique dans la presse roumaine de 1945 est l’objet de l’intervention de madame Domnica Gorovei, Université de Bucarest, Faculté de sciences politiques & Institut d’études africaines qui est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Bucarest où elle enseigne depuis 2009. Elle a travaillé auparavant au Ministère des Affaires étrangères de Roumanie. Elle a relevé que dans une perspective (quasi) absente des manuels d’histoire, la place – et l’importance – de l’Afrique dans la Seconde Guerre mondiale, pourtant cruciale pour la survie des empires de l’époque, occupe aujourd’hui une place grandissante dans les discours politiques de part et d’autre de la Méditerranée. Comme l’illustrent nombreux pays francophones d’Afrique de l’Ouest qui soulignent désormais de plus en plus clairement que le destin de la France aurait été bien différent sans l’Afrique. Les relations les plus intenses que la Roumanie a eues avec l’Afrique ont été durant le régime communiste. S’intéressant graduellement au continent africain surtout après les indépendances du Ghana et de la Guinée, la Roumanie intensifie les échanges dans les années 1960 pour que dans les années 1970 un pic soit enregistré. L’examen des références à l’Afrique dans les journaux roumains de 1945 montre que les distinctions entre l’Afrique francophone, anglophone et lusophone restent peu marquées. Ce monde en pleine recomposition, est encore plutôt inscrit en 1945 dans la logique impérialiste européenne.
La Transylvanie a été l’objet de plusieurs communications ; celle introductive de madame Anna Tüskésva, Université de Pécs, Faculté des Arts, Département d’Histoire de l’Art, portant sur le sort de la Transylvanie du Nord et de l’Université hongroise de Cluj-Napoca après la Seconde Guerre mondiale à la lumière du journal d’un historien, Béla Zolnai. Béla Zolnai (1890–1969) est historien de la littérature et linguiste hongrois. Entre 1925 et 1940, il dirige l’Institut de philologie française de l’Université Ferenc József de Szeged, puis entre 1940 et 1945 l’Institut de philologie française de l’Université rapatriée à Cluj-Napoca en Transylvanie du Nord à la suite de la deuxième arbitrage de Vienne du 30 août 1940. Il reste à Cluj-Napoca jusqu’à l’automne 1948, espérant que l’enseignement universitaire hongrois serait préservé. Le journal de Béla Zolnai, tenu entre mars 1944 et février 1948, est une source extrêmement précieuse pour analyser le sort de la Transylvanie du Nord et de l’Université hongroise de Cluj-Napoca après la Seconde Guerre mondiale. L’effondrement du contexte institutionnel, la chute progressive de l’université hongroise aux mains des Roumains, l’incertitude politique et la marginalisation culturelle furent autant de facteurs qui influencèrent considérablement l’avenir de la communauté hongroise en Transylvanie. Selon le journal, après 1944, l’université hongroise n’a plus fonctionné comme un établissement d’enseignement supérieur de la communauté hongroise. L’incertitude politique et la marginalisation culturelle furent autant de facteurs qui influencèrent considérablement l’avenir de la communauté hongroise en Transylvanie. Deux autres communications sont revenues sur la question de la Transylvanie, celle de madame Smaranda Vultur (Université de Timișoara) sur le Banat 1945-1951 et les changements dans la vie des communautés, et celle de monsieur Jérémy Floutier (Université de Szeged) : « Tabula rasa ? La question transylvaine après 1945 dans les manuels scolaires hongrois et roumains ».
Le débarquement allié en Afrique du Nord et ses conséquences en Algérie et Tunisie
Pour ma part, j’ai abordé les effets du débarquement allié en AFN en novembre 42, qui a été un choc à la fois militaire, culturel et politique et a eu des effets importants dans la transformation des représentations des populations locales à l’égard de ce qui représentait de manière générale l’Occident. Le débarquement va mettre au cœur du débat, à travers la Charte de l’Atlantique, l’idée de liberté et de citoyenneté. Les mois et les années qui vont suivre voient se reconfigurer le mouvement national et plus largement le mouvement anticolonialiste. Le mouvement national algérien connait alors un progrès qualitatif de son action. La contribution aborde également le sort des juifs d’Algérie et leurs interrogations devant la perte de leur nationalité. Ces interrogations qui annoncent des recompositions du champ politique se heurtent à l’irrédentisme du lobby colonial et plus largement des autorités officielles toutes tendances confondues. La terrible répression de 1945 n’est une surprise que pour ceux qui pensaient que le colonialisme pouvait être amendé par des réformes servant de leurre.
Lazlo Nagy professeur, historien émérite de l’université de Szeged a traité du leader nationaliste algérien Ferhat Abbas, à travers une lettre que celui-ci a adressée au Gouverneur général le 7 janvier 1943 ; lettre portant le titre de « J’accuse l’Europe ». Le professeur Lazlo Nagy aborde alors d’une manière originale et stimulante la trajectoire de Ferhat Abbas qui interpelle l’Europe à travers un cri qui rappelle l’article de Zola publié dans l’Aurore le 13 janvier 1898 à propos de l’Affaire Dreyfus. Selon Lazlo Nagy, ce sont les mêmes idées qui poussent à la réflexion Ferhat Abbas, celles concernant la République et la démocratie. Et plus largement c’est bien sûr l’avenir de son pays et de l’Europe, et au-delà celui de l’humanité. Abbas tient responsable l’Europe de ce que ces deux précieuses idées très chères à lui, la République et la démocratie, ne se réalisaient pas dans le monde colonial. Mais maintenant, à l’approche de la fin de la guerre d’où certainement un nouveau monde viendra au jour, il est temps que l’Europe corrige ses erreurs et même ses crimes commis envers le monde entier. La prise de position de Ferhat Abbas ne veut pas dire le refus de l’Europe, la condamnation de notre continent, surtout pas son anéantissement. La construction du nouveau monde est une tâche commune des mondes européen et colonial. Collant à l’évolution de la trajectoire de Abbas, Lazlo Nagy met en exergue sa prise de conscience que le statut colonial de l’Algérie rend impossible de construire un État où les gens sont égaux ayant les mêmes droits et les mêmes chances, autrement dit « établir un régime politique juste, libéral, humain »[3]. Ses idées prennent la forme en 1943 dans le Manifeste du peuple algérien dans lequel la condamnation de la colonisation est catégorique et sans appel : « La colonisation ne relève ni d’un souci humanitaire, ni d’un souci de justice et encore moins de la civilisation et du progrès. Elle est dans son essence même un phénomène impérialiste. Et comme telle, elle exige – pour se développer et durer – l’existence simultanée de deux sociétés, l’une opprimant l’autre ». S’interrogeant sur les responsabilités de la guerre il observe que « l’Europe empoisonne l’Humanité de son humeur guerrière de bellicisme et de sa toute-puissance financière, nous l’accusons de tous les deuils et de tous les crimes qui pèsent sur l’homme depuis au moins deux siècles ».
Les rapports du renseignement rédigés après le débarquement du novembre 1942 rendent compte de ce que beaucoup d’Européens « surtout les propriétaires fonciers restaient fidèles au régime de Vichy et écoutaient les émissions de l’Axe ». Dans son analyse, Ferhat Abbas utilise une terminologie inhabituelle de sa part : capitalisme, impérialisme, exploitation de l’homme par l’homme, etc., particularité attribuée plutôt aux communistes. Il cite plusieurs fois Staline, Lénine (« un peuple qui en opprime un autre ne peut être libre ») et fait référence à l’URSS comme modèle d’Etat fédéral dans lequel « tout vestige colonial a disparu ». Et pour appuyer ces affirmations il cite longuement Sumner Welles[5] : « Notre victoire doit apporter avec elle la libération de tous les peuples. Le droit d’un peuple à la liberté doit être reconnu. Les principes de la Charte atlantique doivent être garantis au monde entier et dans leur ensemble, sur tous les océans et sur tous les continents ». Ferhat Abbas est-il devenu marxisant ? s’interroge l’auteur ; non, conclut-il. Il n’est pas devenu marxisant, mais antimarxiste ou anticommuniste non plus. Cherchant la voie la meilleure possible de la construction d’une Algérie libre et prospère, il est ouvert envers toute idée d’égalité et de justice sociale.
Sergiu Mișcoiu, professeur des universités Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie, a abordé la trajectoire d’une autre figure du nationalisme africain, Félix Houphouët-Boigny (1905-1993). Cette figure centrale du panafricanisme a joué un rôle déterminant dans la fondation et l’essor du Rassemblement Démocratique Africain (RDA), movement-clé dans la lutte pour l’émancipation des colonies africaines francophones, créé en 1946 à Bamako.
Le professeur émérite Habib Kazdaghli aborde alors sur le versant tunisien, la question de « la situation des juifs en Tunisie sous Vichy et sous l’occupation allemande (1940-1943 ». La période allant de la défaite de la défaite de la France (juin 1940) jusqu’à l’entrée des alliés à Tunis le 13 mai 1943 venant d’Algérie et du Maroc se compose de deux temps. La première la Tunisie qui était sous protectorat français depuis le 12 mai 1881, va le rester sous le régime de Vichy. Un nouveau résident l’Amiral Esteva va diriger le pays prenant ses directives du Régime de Vichy qui a coopéré avec le régime nazi. Les même lois racistes visant les juifs en métropole vont être appliquées en Tunisie. Cependant, l’Amiral Esteva va être souple dans l’application de ces lois, de peur que le pays manque de médecins, d’avocats, d’enseignants. A partir du 8 novembre 1942, date du débarquement des alliés au Maroc et en Algérie, de les forces allemandes vont occuper la Tunisie pendant 6 mois jusqu’au 13 mai 1943. Au cours de cette période, ce sont les Allemands qui vont prendre directement la gestion des affaires dans l’espoir de repousser l’avancée des forces alliés venant de l’Est, les Allemands ne vont pas ménager leurs efforts à l’encontre des Juifs : mobilisation et travaux obligatoires dans les camps les obligeant à remettre les pistes d’atterrissage et les quais des ports en activité, etc. De même les Allemands vont pourchasser les résistants communistes et les réseaux qui essayaient de guider les attaques des forces alliés vers les fortifications allemandes. Les Juifs seront les premiers à fêter l’entrée des alliés à Tunis en mai 1943. La Tunisie va devenir une base de départ pour la libération de toute l’Europe et assurer la victoire totale de forces libres contre l’Allemagne nazie.
Faten Bouchrara Chebil (Université de La Manouba) a abordé le cas de « femmes résistantes à l’occupation nazie de la Tunisie 1942-1943 ». Durant l’occupation nazie en Tunisie (novembre 1942 – mai 1943), des réseaux de résistance se sont développés en dehors des structures politiques traditionnelles, en réaction à l’armistice et à la collaboration d’une partie de l’élite avec l’Allemagne. Ces réseaux clandestins, tels que « Mounier, Béranger, Dick Jones, Bazangour et Air Tunisie », se sont formés dès 1940 et avaient pour objectif principal de recueillir et transmettre des informations stratégiques sur les mouvements de troupes et les défenses allemandes. Ces renseignements étaient ensuite communiqués soit aux agents britanniques opérant en Tunisie, soit au mouvement de la « France Libre » de Charles de Gaulle, basé à Londres. Les membres de ces réseaux, souvent des civils engagés dans des professions libérales ou des cercles influents, menaient une double vie en poursuivant des activités visibles tout en servant la cause de la résistance. Deux figures féminines se distinguent dans ce combat : « Louise Hanon », avocate juive originaire de Souk El Arba, actuellement Jendouba, une région du nord-ouest de la Tunisie et « Martha Perrussel, épouse de l’avocat Perrussel, futur maire de Tunis après la guerre. Leur position sociale leur permettait d’accéder à des informations cruciales et de faciliter les actions clandestines. Ces réseaux seront en grande partie démantelés en avril 1943, révélant l’ampleur de la résistance menée dans l’ombre, notamment par des femmes.
L’universitaire Vojtěch Šarše (Université Charles de Prague) quant à lui développa une analyse sur les représentations des tirailleurs sénégalais à travers une communication intitulée : « Représentations (dé)coloniales des tirailleurs sénégalais dans les œuvres franco-francophones ». Il a insisté, à partir de tracts, de photos, d’affiches, sur les stéréotypes développés par les populations à l’égard des soldats africains qui se battaient pour leur libération. Le débat qui s’en est suivi a relevé que les dominés stigmatisés vont également être à leur tour instrumentalisés dans les répressions des mouvements nationalistes qui démarrent avec la fin de la guerre.
En guise de conclusion
Les organisateurs et les participants ont appelé en conclusion de ce colloque dense, riche et stimulant, à la publication des actes et à approfondir et élargir des recherches aussi novatrices, toujours dans une perspective comparatiste et interactionniste afin d’éclairer davantage les effets du contexte de la fin de la seconde guerre mondiale sur le présent.
Bibliographie indicative :
Fejtő, François-Kulesza-Mietkowski, Ewa, La fin des démocraties populaires, Paris, Seuil, 1992.
Molnár, Miklós, Histoire de la Hongrie, Paris, Hatier, coll.Nations d’Europe, 1996.
Prigent, Michel-Naigeon, Marc, L’Europe de l’Est depuis 1945, Paris, PUF, 1997.
Serge Berstein-Pierre Milza, Histoire du monde de 1900 à nos jours, Hatier, La compil initial, 2018.
[1] Cadi Abd El Kader : « nous voulons êtes citoyens algériens ; nous demandons la constitution de la République algérienne ».
[2] Thomas Deltombe, l’Afrique d’abord !, La Découverte, 2024.
[3] Lettre de Ferahat Abbas adressée au Gouverneur général le 7 janvier 1943. Centre d’informations et d’études, (CIE) Rapport janvier 1943, Direction des affaires indigènes de l’Algérie, Gouvernement général de l’Algérie, Archives nationales d’outre-mer (ANOM), 11H50.
[4] Égalité, 1er décembre 1944.
[5] Diplomate, homme politique américain (1892-1961). Rédacteur du texte de la Charte atlantique et de la Charte originale de l’ONU.