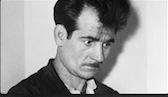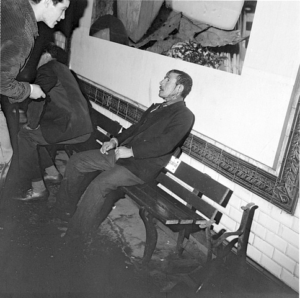
« Ratonnade » : le retour d’un mot du racisme colonial
« Ratonnade » : ce mot terrible revient depuis peu dans le débat public pour qualifier l’expédition de groupuscules néo-nazis dans un quartier populaire de Romans-sur-Isère le 25 novembre 2023. L’historien Alain Ruscio rappelle ici qu’il s’agit d’un mot du racisme colonial, forgé au XXème siècle en Algérie à partir de « raton », une injure animalisant les colonisés.