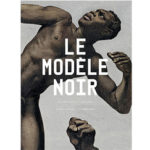Quand le modèle noir masque l’histoire
de la fabrication du blanc
par Françoise Vergès, présidente de l’association Décoloniser les arts.
Ayant lu de nombreux articles dans la presse nord américaine tous très élogieux à propos de l’exposition Posing Modernity : The Black Model from Manet to Matisse to Today à la Wallach Art Gallery, université de Columbia dont la commissaire était l’africaine américaine, Denise Murrell, puis ayant constaté le même ton élogieux dans la presse française, mais ayant été déçue par l’exposition, j’ai voulu comprendre ce qui ne m’avait pas convaincue, pourquoi je ne partageais pas ces avis louangeurs. Le texte est basé sur deux visites et sur la lecture du catalogue Le modèle noir, de Géricault à Matisse (Paris, 2019).
Premières remarques
Le titre « Le modèle noir, de Géricault à Matisse » est trompeur car si les commissaires annoncent qu’il s’agit d’une part de la personne qui pose comme modèle et est payée (ou pas) pour son travail et d’autre part, de la personne porteuse de valeurs, de nombreuses toiles n’entrent dans aucune de ces catégories.
De belles toiles sont accrochées à côté de chromos
Les genres sont mélangées — peinture, cinéma, affiches, objets, documents d’archives — mais si a priori ça ne pose pas de problème, comme le « fil rouge » de l’exposition est le modèle noir, on ne comprend pas bien la juxtaposition de films sur les tirailleurs sénégalais, d’affiches de cirque, ou de peintures orientalistes.
Les cartels sont imprécis
Les commentaires de l’audio-guide n’apportent rien ni comme informations historiques, ni comme commentaires esthétiques, ni comme analyse du modèle noir.
On nous dit que le fil rouge de l’exposition est d’une part, l’Olympia de Manet et d’autre part, le fait que la domestique noire ait été identifiée, mais ce fil est rapidement perdu : en effet, comment faire entrer le portrait de Jean Baptiste Bellay, député noir de Saint Domingue à la Convention dans ce cadre ? Ou les portraits d’Alexandre Dumas ? Ou la toile de François-Auguste Biard sur l’abolition de l’esclavage en 1848 ?

Puis on nous dit que l’une des choses essentielles accomplies par l’exposition est d’avoir identifié les Noir.e.s ayant posé pour des portraits — aspect salué par la presse nord-américaine et française comme historique et ouvrant un nouveau champ dans l’histoire de l’art — mais ceci ne concerne que deux ou trois toiles.

L’entrée par l’abolition de 1794, l’esclavage et l’abolition de 1848 fait entrer la présence de Noir.e.s dans la peinture comme domestiques et esclaves, alors que l’on sait qu’au 17ème siècle, des tableaux représentent des Noirs comme ambassadeurs, musiciens, voyageurs. Répondre que le cadre temporaire ne le permettait pas n’est pas possible puisque les tableaux montrés ne respectent pas non plus le cadre temporaire induit par le titre « de Géricault à Matisse ». L’exposition propose une version étroite et dépassée de la représentation de Noir.e.s à partir d’une sélection qui rapidement ne fait plus grand sens.
La guide que nous avions le 18 avril n’a pas cessé de faire des erreurs historiques ou des commentaires totalement inappropriés (par exemple, devant la toile orientaliste de Jean-Léon Gérôme, À vendre, esclaves au Caire, 1873, elle nous dit qu’elle illustre la « traite des blanches »…). Nous avons voulu savoir si c’était un cas particulier et donc nous avons prêté l’oreille à d’autres guides et c’était en gros du même acabit, mais il est tout à fait possible que des guides (majoritairement des femmes à ce que j’ai vu) soient mieux formées. Penser que des écoliers, collégien.ne.s, lycéen.ne.s et grand public entendent de tels commentaires fait frémir. Une meilleure formation n’était pas difficile.
Plusieurs personnes ont déjà fait remarquer que les personnes qui gardent les salles sont toutes des Noir.e.s ou des racisé.e.s. On sait que c’est une banalité dans les institutions culturelles et artistiques et je ne voudrais pas par moralisme faire perdre à des racisé.e.s un des rares postes rémunérés qui leur est pratiquement réservé, mais la question ici est pourquoi cette ségrégation de couleur dans les institutions ?
Finalement les commissaires de l’exposition n’expliquent pas leur choix de ne retenir qu’une petite partie des œuvres d’artistes noir.e.s contemporain.e.s qui ont été exposées dans la dernière partie de l’exposition Murrell à New York, ni pourquoi ils ont d’emblée exclu des artistes noir.e.s des « outre-mer » et de France. L’espace de la République, de la France composite qu’ils dessinent est celui d’une France sans peintre ou plasticien.ne noir.e. Dans « Corps noir, capital discursif. Le modèle noir, de Denise Murrell au musée d’Orsay », le praticien chercheur résidant au Québec, Eddy Firmin cite ces artistes : « Il est urgent d’écouter ces voix captives depuis un siècle. Il convient aussi de garder ce fol espoir que dès maintenant ces voix parleront pour elles-mêmes et en dialogue avec les autres voix françaises. Ces artistes qui aujourd’hui vivants inventent demain, ont eux aussi une histoire. Ils se nomment José Legrand, Mirtho Linguet, Thierry Fontaine, Jack Beng Thi, Shirley Rufin, Jacqueline Fabien, Mickaël Caruge, Gwladys Gambie, Michel Rovelas, Philipe Thomarel, Anaïs Verspan, Bruno Iwa Pédurand, Edwin fanny, Thiery ALET, Annabel Gueredrat, Esther Hoareau, Jean-François Boclé, Joelle Ferlylex Burke, Kenny Duncan, Anaïs Verspan, Steeve Bauras, Thierry Major, Marielle Plaisir, Hervé Beuze, Henri Tauliau, Robert Charlotte, Mina Biabiani, Richard-Vicktor Sainsily, Ernest Breleur, Nathalie Leroy-Fievée, Samuel Gélas, Rene Boutin, Mounir Allaoui, Myriam Omar Awadi, Thierry Tian-Sio-Po et tant d’autres encore ayant travaillé sur leur corps collectivement ou individuellement1. »
Plusieurs textes du catalogue du musée d’Orsay et quelques commentaires de l’audio-guide nous invitent à « changer nos imaginaires ». Ces imaginaires seraient à l’origine du racisme et de la stigmatisation des Noir.e.s. En faisant entrer des représentations « corrigées » de Noir.e.s au musée et en faisant des « modèles », on changerait ainsi les imaginaires du public. Le racisme étant structurel, changer les imaginaires ne suffira pas.
Des racisé.e.s ont contribué à la conception de l’exposition — Anne Lafont, Pap Ndiaye, Lilian Thuram et Abd El Malik.
Les catalogues des expositions à New-York et Paris sont très différents mais cela n’est pas exceptionnel. Les expositions n’ont pas le même titre ni les mêmes commissaires bien que Denise Murrell soit une des commissaires de l’exposition à Paris.
Le catalogue Posing Modernity : The Black Model from Manet to Matisse to Today (2018, 206 pages), qui a une seule auteure, Denise Murrell, est plus classique dans son contenu. Les textes qui commentent les tableaux et les comparent sont tirés de la thèse doctorale de Murrell, avec un long développement sur les différentes formes de figuration des Noir.e.s. Le chapitre « A Reimagined Legacy » développe bien plus longuement que dans le catalogue français comment des artistes noirs américains ont peint des Noir.e.s. Parmi les œuvres choisies pour ce chapitre, celles qui ont été reprises à Orsay sont celles d’Aimé Mpane, Romane Bearden, et Ellen Gallagher.
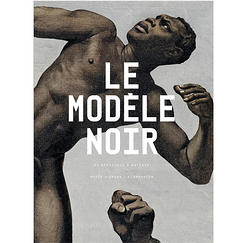
Le catalogue français Le Modèle noir est bien plus épais (381 pages), et se présente comme bien plus ambitieux. Les auteurs de la préface, Laurence des Cars et Jacques Martial, écrivent qu’ils voient les Noir.e.s comme un « corps social » et que dès lors, c’est bien le double sens de « modèle » qui est en jeu, le sujet regardé et représenté et le sujet « porteur de valeurs ». L’exposition met en lumière « un des grands non dits de l’histoire ». C’est la « première fois » que le sujet est « abordé en tant que tel en France ». Ils insistent à plusieurs reprises sur cet aspect — une « initiative sans précédent », un « projet de cohésion ».
Le catalogue se révèle être un plaidoyer pour la « République » : on reconnait des fautes et des erreurs mais pour mieux défendre « la France composite d’aujourd’hui ». Ses auteur.e.s semblent avoir constamment eu en tête ce qui pourrait leur être opposé dans une société où toute critique d’une œuvre d’art est qualifiée d’atteinte à la liberté artistique. Le débat est de fait forclos.
Le ton du plaidoyer domine dans le catalogue français, et passe de l’euphémisme au défensif. On apprend peu de choses au vu de tout ce qui a été analysé ces vingt dernières années. En France, les études visuelles sur la représentation des non blanches/non-blancs restent en grande partie fondées sur une approche où dominent binarisme et euphémisme. Il semble que le sentiment qu’il faille finalement faire « quelque chose » (« inédit », « pour la première fois ») conduit à l’accumulation, à la juxtaposition d’objets, d’œuvres en tout genre qui finissent non seulement par diluer le propos mais par produire une impression de malaise.
Mais, me dira t’on, au fond, c’est une exposition d’art, pas un livre d’histoire, et une expo n’est jamais complète. Je pourrais donc me contenter de ce qui est présenté, me dire que c’est mieux que rien, mais à la réflexion, je n’ai trouvé cette exposition ni passionnante, ni inédite. On me dira qu’au vu de l’inexistence d’expositions de ce genre, c’est déjà énorme mais faut-il continuer de se contenter de tentatives de combler le vide en ignorant les travaux sur la représentation des Noir.e.s (modèle ou pas) ou sur la question du nom dans l’histoire de l’esclavage. Je n’ai pas compris pourquoi ces travaux dont certains sont facilement accessibles et ont été traduits en français — L’Atlantique noir de Paul Gilroy, les ouvrages de Stuart Hall, bell hooks, Angela Davis, James Baldwin, les textes réunis par Elsa Dorlin sur le Black Feminism, ou des interviews d’artistes noir.e.s — n’ont pas constitué une référence. En d’autres termes, en 2019, une exposition plus tranchante était possible, dérangeant de manière plus ouverte les présupposés raciaux de la société française.
Tout vous engage à participer à la célébration de cette exposition « inédite et historique » sous peine d’être taxée de mauvaise joueuse, jamais contente, jalouse même. L’injonction est forte d’adhérer à l’objectif de l’exposition : se réjouir d’avoir enfin une telle exposition dans un musée prestigieux, se réjouir que des Noir.e.s retrouvent un prénom, se réjouir du fait que l’institution musée ait enfin franchi un cap. Pourtant je n’ai éprouvé aucun sentiment de réjouissance, j’ai même éprouvé de la tristesse devant, encore une fois, une opportunité gâchée, j’aurais voulu qu’un pas soit franchi, car même si je n’ai pas une confiance aveugle dans les institutions, je sais qu’elles peuvent changer car étant des structures culturelles et sociales, elles ne sont pas fixées à jamais, même si le poids de leurs structures entravent leur décolonisation. En d’autres termes, des institutions savent proposer un changement de perspective qui perturbe, secoue, questionne, étonne, je pense ici, pour lui rendre hommage, à celles du regretté Okwui Enwezor et au travail de la regrettée Bisi Silva.
Je vais donc essayer d’expliquer mon absence d’enthousiasme.
Le musée et le récit national
Dans La communauté imaginée, Benedict Anderson écrit que l’imprimerie et le musée sont essentiels pour forger et raconter le récit national et construire l’identité de la nation. Quelle est alors la fonction du musée dans le contexte actuel, ou, comment sert-il le récit national et l’identité nationale dans le contexte répété d’exigence d’adhésion à une identité nationale, de reconstitution d’une communauté nationale fantasmée, blanche, mâle, chrétienne et laïque (ces deux dernières notions ne s’excluant pas obligatoirement) et du refus de considérer le racisme structurel dans la République ? Dans un pays, où des lois anti-migrants qui violent le principe de solidarité et le droit d’asile sont votées, où les frais d’inscription pour les étudiant.e.s étrangers.ères vont plus que doubler et toucher plus particulièrement les Africain.e.s, où des camps de migrant.e.s sont détruits pratiquement chaque jour augmentant leur vulnérabilité et leur précarité, où des communautés Rroms sont attaquées à la suite de rumeurs faisant écho au vieux fantasme rromophobe de voleur d’enfant, où des crimes policiers, qui ont mené à la mort de femmes et d’hommes racisés, restent impunis, où negrophobie et islamophobie constituent des points de convergence pour des femmes et des hommes de la gauche à l’extrême-droite, comment analyser cette intégration des Noir.e.s au musée ?
Ne faudrait-il pas d’abord reconnaître l’impossibilité de se tenir totalement hors des systèmes de domination quand on se lance dans un tel projet ? Et donc ne pas se contenter de dénoncer l’effacement de noms ou de représentations racistes, mais expliquer comment cela s’inscrit dans un système plus large de domination passée et présente. Les Noir.e.s ont été pris dans des systèmes de domination produits par l’esclavage, le colonialisme et l’impérialisme dont les héritages vivants continuent à affecter leurs vies. Le racisme structurel, dans ses manifestations et dans son organisation, qui n’a pas besoin de s’appuyer sur la croyance en une différence biologique des races, a été amplement analysé. De surcroît, si la différence biologique entre les « races » a été frappée d’invalidité, la croyance en l’infériorité de certains groupes humains n’a pas disparu : il suffit pour s’en convaincre d’analyser les discours qui affirment encore l’irréductibilité de différences culturelles excluant des « hautes civilisations » les Noir.e.s et autres racisé.e.s. Peut-on négliger ce contexte en organisant une exposition sur le modèle noir ? Autrement dit, est-il possible de ne pas se confronter au racisme et à la race dans une exposition sur les modèles noir.e.s et donc aux controverses autour de cette représentation ?
Le « retard » français
L’argument du retard de la France par rapport aux États-Unis ou la Grande Bretagne ne suffit pas à expliquer la faiblesse du dispositif car il y a, en France, suffisamment de travaux sur ces questions. En effet, plusieurs auteur.e.s ont exploré la représentation des Noir.e.s au-delà du binarisme blanc/noir qu’induit une compréhension paresseuse du racisme. Au-delà de cette problématique précise, les travaux sur la représentation de racismes, de catastrophes, ou de crimes contre l’humanité abondent (voir tous les travaux sur la Shoah et sur le refus critique de représenter les Juifs essentiellement comme victimes — par exemple les travaux de Georges Didi-Huberman ou de Tal Bruttmann — ou les travaux sur les génocides au Rwanda ou au Cambodge). Pourquoi ont-ils été ignorés ?
La rivalité France/Etats-Unis, dénoncée comme retard de l’un ou de l’autre, est une rivalité sans grand intérêt car elle masque les raisons d’une plus grande présence des Noir.e.s dans les arts aux Etats-Unis (luttes, plus grande autonomie due au système économique, existence d’un capitalisme noir encouragé dans les années 1970 dans le but de freiner des luttes plus radicales), présence cependant toujours fragilisée par le racisme. Les artistes ne sont pas dupes qui ne cessent d’affirmer leur solidarité avec les Noir.e.s victimes de violence, comme l’initiative initiée par l’artiste Simone Leigh de « Black Women Artists for Black Lives Matter2 ». Cet argument masque aussi le fait qu’il y a eu des luttes antiracistes en France et qu’elles se poursuivent. La question serait alors la suivante : pourquoi les institutions françaises ont-elles autant de mal à travailler avec ces mouvements ? Nous n’idéalisons pas les institutions culturelles américaines (les cas de racisme ou de censure ne manquent pas) mais elles mettent en lumière la spécificité du cas français, pas de rivalité donc mais une comparaison car nous n’avons pas à choisir entre le républicanisme nord-américain et le républicanisme français, chacun s’est construit sur des exclusions, des processus de racisation, du sexisme et du patriarcat.
Parler de retard reste problématique aussi parce que cela pose un idéal à atteindre, cependant que cet idéal, nulle part, n’existe, à ce jour. En outre, l’argument du retard a été utilisé pour justifier la mission civilisatrice hier et les politiques de développement du Sud aujourd’hui. Ne devrait-on pas plutôt analyser les formes que prend l’opposition à l’égalité et la dignité ? La manière dont cette rivalité Etats-Unis/France renforce, dans chacun des pays, une identité nationale autour de qui sera le « meilleur blanc », le plus universel, le plus intégrationniste ?
Un acte de réparation ?
Il flotte dans l’exposition comme un air de contrition mais qui ne sonne pas juste, du style « il y a eu une époque très dure (négatif) mais n’oublions pas le métissage (positif) et avançons ! » (la formule est : « l’influence du métissage sur la genèse de la modernité3 »). Il faudrait avancer mais pour aller où ? Il flotte aussi comme une proposition de réparation — enfin une représentation culturelle des Noir.e.s au musée ! — dans un climat où cette intégration culturelle ne s’accompagne ni de représentation politique (or représentation culturelle et représentation politique sont dialectiquement liées), ni d’égalité de traitement. Et cette intégration culturelle coexiste avec la multiplication de représentations de « faces de noiraud » (proposition de Décoloniser les arts pour traduire blackface), un refus total d’essayer de comprendre pourquoi des représentations font scandale, et celui d’une contre-offensive médiatique, gouvernementale et universitaire contre le décolonial, le genre, ou contre tout débat qui parle de race. Toute cette réflexion est, dans la rhétorique réactionnaire actuelle, accusée d’être une importation nord-américaine, « anglo-saxonne » (ce terme étant bizarre vu que les théories sur ces questions viennent beaucoup de racisé.e.s dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’elles/ils ne sont ni « anglais » ni « saxons ») entravant la liberté de création, l’ironie, la caricature, l’humour. Ce serait le règne du « politiquement correct ». Quand on pense que l’enseignement sur le passé colonial et le présent postcolonial reste à l’école, à l’université ou dans les institutions muséales et artistiques, imprécis, hoquetant, ou laissé à l’initiative d’enseignant.e.s, on se demande où est l’hégémonie. Le renversement du schéma dominant/dominé est devenu depuis les années 1980 un procédé favori pour toute une caste qui a vu le sol bouger sous ses pieds. Accuser le dominé d’hégémonie est la meilleure manière de refuser de l’entendre.
Malgré leur pouvoir médiatique, institutionnel et universitaire, en face ça panique. Et les réactions sont à la hauteur de la panique qui les anime. C’est ici que la réponse du musée à cette panique (je parle ici toujours en relation avec ce qu’a écrit Benedict Anderson) m’intéresse. Le musée prête son autorité morale et scientifique au sauvetage d’un récit national malmené par la remise en cause de l’universalisme abstrait qui le fonde. L’argument irait ainsi : 1- le musée reconnaît que des Noir.e.s ont été victimes d’une injustice, elles/ils ont été privé.e.s de nom, 2- le musée répare cette injustice grâce à cette exposition, 3- une nouvelle ère est inaugurée. L’ambition est grande et les auteurs de la préface du catalogue d’Orsay soulignent que « seul un grand établissement national pouvait la porter » et qu’« elle se devait de rayonner sur tout le territoire français, en particulier, l’outre-mer, dont l’histoire est si intimement liée aux questions que l’exposition soulève » (p.13). Nous sommes averti.e.s, l’exposition a un but, un « projet de cohésion », mais une exposition doit-elle, peut-elle, avoir cette ambition ? Le musée doit-il rester, comme l’a écrit Benedict Anderson, un des piliers du récit national, ce récit dont le but n’est pas de confronter conflits et contradictions, mais de construire une communauté imaginée dont la cohésion fondée sur une mise en scène lissée des conflits, en disant mais sans dire en quelque sorte. Il n’y a donc pas effacement total mais une logique du recensement où le patrimoine est utilisé comme un moyen d’assurer leur position, a écrit Anderson. Les « Noir.e.s » sont patrimonialisés (ce que remarque Damien Trawale dans un texte cité plus bas). Retrouvant leur nom, les Noir.e.s entreraient de plein pied au musée. Mais qui sont ces Noir.e.s ?
Noir.e.s
Il aurait été utile d’expliquer quand, comment et pourquoi, intervient l’invention du blanc et donc du noir dans une exposition sur « le modèle noir » afin d’éviter que le public ne pense que les Noir.e.s ont toujours été « noir.e », qu’elles/ils sont tous semblables et immédiatement reconnaissables comme Noir.e.s. Déjà, Madeleine n’est pas Laure qui n’est pas Joseph qui n’est pas Joséphine Baker qui n’est pas un tirailleur sénégalais qui n’est pas le clown Chocolat et ainsi de suite, autrement dit il y a des Noir.e.s et si le titre devait demeurer, un pluriel, « Les modèles noirs » aurait au moins indiqué que les commissaires avaient conscience de l’effort pour restituer individualités et singularités à des peuples massifiés et uniformisés. Mais ces éléments ne sont pas indiqués, le contexte dans lequel ces personnes vécurent reste mystérieux, contexte qui contribuerait à les individualiser. Il y a aussi un effacement des genres et des positions sociales, une femme n’est socialement pas un homme, une domestique n’est pas une danseuse, un soldat n’est pas une nourrice, une travailleuse du sexe n’est pas une acrobate.

C’est racialiser des êtres humains que de les réduire à leur couleur et c’est effacer classe et genre que des les réduire à être un modèle. Noir.e n’était pas leur métier pour paraphraser un titre d’ouvrage, ni la seule identité que ces personnes avaient. Et en commençant par l’esclavage, l’exposition enferme les Noir.e.s dans une histoire que des Européens ont mis en place et ainsi reproduit leur objectification. On nous l’a dit il s’agit du modèle noir de Géricault à Matisse mais en commençant avec l’esclavage, cette histoire reste « toujours assignée aux Noirs. Au lieu de faire partie de l’héritage éthique et intellectuel de l’Occident dans son ensemble, l’esclavage devient ainsi la propriété exclusive des Noirs », écrit Paul Gilroy4.
Nommer
La citation d’Aimé Césaire mise en exergue — le nom est la première chose que les esclaves se font voler — induit qu’une réparation, qu’une restitution va avoir lieu, la promesse qu’un crime va être réparé. Comme « Nommer ou ne pas nommer est un acte de pouvoir » (p. 27) et qu’il faut cesser « de marquer la race de certaines personnes et pas celles des autres » (p. 27), et qu’il ne faut plus dire « Portrait d’une noire » (dirait-on Homme un quart noir ou Femme sept seizième blanche, cinq seizièmes africaine, quatre seizième navajo, écrit Anne Hugonnier, p.28), retrouver le prénom ou les nom et prénom des Noir.e.s dans les tableaux et photographies constituerait cet acte. Mais les tableaux portent le prénom du modèle soit parce que le nom n’a pas été trouvé (« Portrait d’une Noire » devient « Portrait de Madeleine ») soit que les commissaires ont choisi de ne mettre que le prénom (« Portrait de Joseph » alors que son nom est connu).
La question du nom — enlevé, efface, imposé — est centrale dans l’histoire de l’esclavage. Priver les Africain.e.s déporté.e.s de leurs noms et leur attribuer des prénoms ou des surnoms souvent réducteurs, à leur arrivée dans les colonies esclavagistes (nom qui pouvait changer quand elles/ils changeaient de propriétaire) a contribué au processus de déshumanisation et au traumatisme de la déportation et de la réduction en esclavage. On sait aussi qu’au moment de la deuxième abolition dans les colonies françaises en 1848, ce sont des officiers d’état-civil qui ont donné des noms aux affranchi.e.s et que ces noms furent fantaisistes, injurieux, moqueurs. Au Brésil et aux Etats-Unis, certain.e.s descendant.e.s ont choisi de se renommer pour se défaire de noms que leurs ancêtres n’avaient pas choisis et pour indiquer une origine réappropriée. Si dans Le trauma colonial (Paris, 2018), la psychanalyste Karima Lazili peut parler de trauma perpétué à travers des générations par l’imposition d’un nom par le pouvoir colonial en Algérie, dans un geste qui efface filiation, appartenance au clan, et à l’histoire, que dire alors des traumas répétés qu’ont subi les esclavagisé.e.s et leurs descendant.e.s ! Autrement dit, l’histoire du nom attribué aux Noir.e.s mériterait un peu plus d’explication et de contexte dans une exposition qui dit reposer sur l’acte de nommer.
Ainsi, que penser du prénom — Madeleine — attribué à la femme noire dont le portrait au Louvre était connu sous le titre « Portrait d’une négresse » puis « Portrait d’une noire » ? Elle aurait été amenée à Paris depuis la Martinique après l’abolition de 1794 mais avant l’abolition de la traite (1815), le rétablissement de l’esclavage par Napoléon (1802) et l’abolition de l’esclavage de 1848. Que savait-elle de l’abolition de l’esclavage de 1794 et de l’insurrection à Saint-Domingue, si, comme l’a démontré Julius S. Scott dans The Common Wind. Afro-Americans in the Age of the Haitian Revolution (2019), les nouvelles circulaient à une rapidité étonnante parmi les communautés d’esclaves dispersées dans les îles des Caraïbes et dans les Amériques, parfois avant même que les colons blancs ne les apprennent ? Si on ne peut restituer sa vie car elle est à jamais effacée par le système esclavagiste pour qui un.e esclave était un meuble, il aurait été possible d’évoquer le contexte dan lequel elle vécut, la Martinique de la fin du 18ème siècle et du début du 19ème (le tableau est exposé en 1800) et le Paris de la même époque. Mais aussi, Madeleine était-il le prénom qui lui fut donnée par ses propriétaires ou celui que lui avait donné sa mère ? Le catalogue reconnaît que « les modèles noirs du 19ème siècle sont le plus souvent connus par leur prénom, voire par un surnom, et rarement par un nom de famille » (p. 200), et ce même des années après l’abolition de 1848. Dès lors, on aurait pu indiquer ces éléments pour complexifier la restitution d’un prénom dont les circonstances d’acquisition sont inconnues et sur lesquelles pèse l’histoire des prénoms, surnoms et noms donnés aux personnes réduites en esclavage.
Laure, la domestique noire du tableau de Manet, n’a aussi qu’un prénom. Elle a vécu à Paris après 1848 et dans le 9ème arrondissement. Pourquoi n’a t’elle pas de nom ? Est-ce parce qu’elle est domestique et femme et noire qu’elle n’a pas de nom, autrement dit cette absence ne met-elle pas en lumière le fait qu’elle cumule plusieurs conditions qui la rendent inexistante aux yeux d’une société bourgeoise, blanche, et patriarcale, ayant pris sa revanche sur les révoltes populaires de 1830 et 1848 dans un contexte de pleine expansion coloniale ? Car 1863 (date de l’exposition du tableau de Manet au public) correspond à l’Algérie colonisée et départementalisée après des massacres, à Madagascar sous l’assaut de plusieurs impérialismes, à l’expédition française vers Ségou, à l’écrasement par l’armée française d’insurrections au Vietnam…, et au moment historique où la France est dirigée par un empereur, Napoléon III (1852-1870). Il aurait été intéressant de mieux connaître qu’elle était la vie sociale et culturelle des Noir.e.s dans ce quartier où nous dit-on, ils étaient nombreux. Un des articles du catalogue tente une sociologie de cette communauté de quelques milliers Noir.e.s vivant à Paris exerçant des métiers d’artisans, de domestiques, de blanchisseuses, de modistes. Ces Noir.e.s ont des vies singulières que ni leur statut de domestique ou de modèle ne peut résumer.
Damien Trawale voit dans l’initiative de renommer, qu’il juge a priori louable, une « naturalisation des catégories raciales et (une) sauvegarde du patrimoine racialiste5 ». Le rapport des commissaires, dit-il « à la catégorie « Noir·e » est encore plus ambivalent. Si nombre de titres d’œuvres qui en faisaient originellement mention sont modifiés, la catégorie est utilisée pour nommer l’exposition elle-même. « Noir·e » catégorie infamante ou désignation neutre et objective pour nommer certains groupes sur la base de caractéristiques phénotypiques ? Sur ce point, les conservateur·rice·s du musée d’Orsay ne nous éclairent guère. ».
Nommer n’épuise pas la question de la représentation des Noir.e.s dans l’art occidental. Les féministes noires ont expliqué pourquoi le fait d’être nommée reproduisait une objectivation, devenir sujet et affirmer sa subjectivité passe nécessairement par un processus d’autoreprésentation. Passer du fait d’avoir été représentée au fait de se représenter constitue un geste qui appartient au processus de décolonisation de soi. Or, il ne semble pas que ce processus soit engagé par l’exposition à Orsay. Est-ce à dire que le geste opéré par Denise Murrell et les commissaires en France serait inutile ? La question est plutôt que le geste s’appuie sur une compréhension de la subjectivité qui s’opère avec la nomination qui reste tellement sourde et aveugle à tous les travaux critique sur ce processus qu’il ne peut accomplir ce qu’il promet, une réparation. Le contexte historique de la nomination des Noir.e.s manque comme des références aux théories du féminisme noir, d’historien.ne.s ou de psychologues sur la fonction du patronyme dans la société occidentale et l’importance accordée à cette nomination de soi par les Noir.e.s.
Si l’effort pour retrouver le prénom/nom de cette femme noire, de cet homme noir, est louable, comme l’écrit Trawale, il ne peut aboutir et résulte dans un nouvel effacement tellement cet effort est empêtré dans tout un tas de non dits et d’évitements. Qu’est ce que les commissaires n’ont pas vu ? Et pourquoi n’ont-ils pas vu qu’il y avait une autre histoire derrière celle de retrouver un nom ? Qu’avec cette histoire de nom, plusieurs fils devaient être tirés?
Finalement, on est en droit de poser la question : Quelle réparation accomplit cette nomination quand toute forme de réparation de l’esclavage ou des crimes coloniaux est rejetée sauf à être strictement « symbolique », mais de quel symbolique s’agit-il ? Qui trace les contours de ce symbolique ?
Montrer
J’ai choisi de me concentrer sur deux éléments de l’exposition qui en comptent plusieurs parce que le premier, l’esclavage colonial, pose énormément de questions de représentation et que le second, la domestique noire dans l’Olympia de Manet, est au cœur de la conception de l’exposition.
L’esclavage
En choisissant d’ouvrir l’exposition par des documents et des tableaux sur l’esclavage colonial — le décret d’abolition de 1794, un tout petit tableau de l’insurrection de 1791 à Saint-Domingue, future Haïti, une esquisse du portrait de Jean-Baptiste Bellay, un portrait de Thomas Alexandre Dumas et le tableau de François-Auguste Biard sur l’abolition de 1848 — dans une exposition consacrée au modèle noir, les commissaires entraient sur un terrain glissant vu la manière dont l’esclavage colonial continue à être analysé en France (à condamner mais sans reconnaître pleinement comment il a durablement influencé lois, littérature, goûts, racisme, idées sur « la sexualité noire » et donc « blanche », le corps noir féminin ou masculin…). Du coup, les euphémismes abondent. Ecrire, page 58 du catalogue, « Olympe de Gouges dans ses réflexions pionnières sur l’analogie du sort fait aux femmes et aux esclaves » (souligné par moi), c’est ignorer les nombreuses critiques du féminisme noir et européen à propos de cette analogie. Ce n’est pas faire un jugement rétrospectif de son œuvre que de signaler ces apories, d’autant plus que plus tôt dans le catalogue, on apprend qu’Olympe de Gouges « condamne vivement le soulèvement de Saint-Domingue dans une préface ajoutée à son œuvre en 1792 »). C’est reconnaître, comme le fait un auteur page 63, qu’être anti-esclavagiste n’a pas signifié être pour l’égalité raciale, c’est introduire l’idée que la préservation du privilège de race fut souvent plus importante que l’idée de l’égalité. Écrire, page 61, que l’abolitionnisme en France est une « révolution méconnue », « l’une des nouveautés radicales de la fin du XVIIIe siècle en France notamment » une historiographie minorée par les anglo-saxons et corrigée par Olivier Pétré-Grenouilleau, nous dit-on, ou, page 76, que « des actes, des ordonnances et des lois (en faveur de l’émancipation des personnes réduites en esclavage), il y en a des dizaines jusqu’à la chute de Louis Philippe », « la réglementation de l ‘esclavage fait de réels progrès », « on ouvre des écoles de Guizot aux enfants d’esclaves à partir de quatre ans », c’est choisir d’ignorer sur ces « progrès », souvent restés au stade du souhait, les travaux de Nelly Schmidt, Sudel Fuma, Prosper Eve, Myriam Cottias, ou Jean-Pierre Sainton (pour n’en citer que quelques uns).
Sur le tableau de François-Auguste Biard sur l’abolition, écrire après avoir reconnu son caractère paternaliste que « on aurait tort d’ignorer le sentiment de fraternité interethnique et démocratique où le trop oublié Biard mit sa foi géricaldienne » (page 80), c’est ignorer les travaux sur la représentation de l’esclavage et de l’abolition comme don qui va rapidement servir de justification aux conquêtes coloniales post-esclavagistes (sauver les peuples soumis en esclavage, mission civilisatrice). Certes cette recherche est surtout en langue anglaise (Grande-Bretagne et Etats-Unis) donc « anglo-saxonne » et dès lors suspecte aux yeux de nombreux universitaires français mais leur lecture nous évite une analyse défensive de l’abolitionnisme en général et de l’abolitionnisme français en particulier et sur ses politiques de la pitié qui marginalisent ce que l’esclavage colonial a structuré dans le droit, le politique, les idées de liberté et d’égalité, comment il a affecté les normes sociales et culturelles. Finalement, aborder l’esclavage par son abolition, c’est encore privilégier une histoire où l’Europe a le beau rôle alors que nous savons que les abolitions furent imposées pour des raisons multiples (économiques, idéologiques, géopolitiques, culturelles) et par les luttes incessantes des esclaves (suicides, empoisonnements, marronnage, révoltes, insurrections, autobiographies, révolutions).
Dans le chapitre « Renommer » du catalogue, on lit en conclusion cette phrase, « Ce fut un siècle de racisme, mais la Troisième République a défini les principes qui permettent de le combattre et même d’atteindre un certain universalisme ». Tout l’échafaudage rhétorique qui précède où une certaine reconnaissance du fait esclavagiste comme fondement de la création de la suprématie blanche et de l’enrichissement des colons, des villes portuaires, du système bancaire et de l’assurance, s’effondre. On pourrait déjà répondre que la République d’Haïti fut la première république à vouloir réellement appliquer ces principes en étant anti-esclavagiste, anticoloniale et antiraciste (voir sa constitution de 1804), que ce fut la Révolution française qui en posant les principes d’égalité et de liberté questionna le pouvoir absolu et l’esclavagisme en France, mais surtout se souvenir que la Troisième République fut la république sous laquelle la plus grande partie de l’empire colonial post-esclavagiste se construisit, qu’elle fit adopter le « Code de l’indigénat » en 1881, qu’elle lança des guerres de conquête à travers le monde, massacrant, pillant (une grande partie des collections « ethnographiques » des musées français se constitue alors comme le démontre le rapport Sarr-Savoy), que les oppositions ne furent jamais assez fortes pour empêcher la mission civilisatrice que Jules Ferry résumait ainsi : « Partout doivent reculer les antiques puissances de l’ignorance, de la superstition, de la peur, de l’oppression de l’homme par l’homme. Ainsi l’action colonisatrice est-elle fondamentalement définie comme une œuvre d’émancipation : par elle, et à travers elle, se poursuit la lutte, entreprise depuis plus d’un siècle au nom de l’esprit de Lumière, contre l’injustice, l’esclavage, la soumission aux Ténèbres. » Et Ferry d’invoquer explicitement les droits de l’homme, pour justifier ce qu’il appelle« cette nouvelle croisade civilisatrice ». Vu la présence d’historiens dans le comité scientifique, on aurait espéré qu’une telle phrase ne soit pas incluse.
L’entrée par l’esclavage pose la question de la représentation antiesclavagiste en Europe. Historien.ne.s de l’art et des Black Studies ont étudié le choix par des artistes antiesclavagistes de mettre en scène la torture pour soulever l’indignation du public européen. Ils ont créé un genre « humanitaire » afin de provoquer la pitié, un genre qui a connu un grand succès mais qui mérite d’être analysé. Il met en scène des Noir.e.s dans une attitude passive à la merci du sadisme des maîtres. Marcus Wood fait un lien entre l’iconographie abolitionniste et la pornographie sadomasochiste6. Ces représentations procurent, dit-il, un plaisir devant le corps noir torturé, tout le contraire des tableaux allégoriques de Turner sur la catastrophe et le crime. Pour Saidiya Hartmann, le caractère spectral et spectaculaire de la souffrance dans ces représentations non seulement efface et restreint ce que la victime ressent mais fait du corps captif une chose abstraite et vide, offerte à la projection de sentiments, désirs, valeurs, et idées par d’autres7. Ce sont ces remarques qui me sont venues à l’esprit à la vue du tableau de Marcel-Antoine Verdier Le châtiment des quatre piquets (1843) qui occupe une place centrale dans le dispositif à Orsay (le tableau est imposant — 1m50 sur 2m14). Qu’y voyons-nous ? À l’avant scène un homme noir dont le corps nu est étalé face à terre et dont les quatre membres sont tenus écartés par des piquets. Derrière lui, un noir, habillé celui-ci, brandit un fouet de la main droite et s’apprête à l’abattre sur les fesses du condamné. A gauche, un homme blanc est nonchalamment appuyé au mur d’une case, à sa droite une femme blanche assise tient dans ses bras un bébé qu’une servante noire agenouillée regarde. En avant-plan à gauche, des enfants noirs nus regardent la scène. En arrière-plan, un Noir arrive le torse nu et les mains nouées dans le dos probablement pour recevoir la même punition, suivi par une femme noire elle aussi les mains attachées au dos. La guide à Orsay nous ayant dit que la représentation de femmes nues dans la peinture orientaliste ou de femmes travailleuses du sexe avait été un « alibi » pour montrer des corps nus à une époque de pudibonderie (alliée à une violence contre les femmes domestiques en France, les colonisées, les travailleuses du sexe), n’aurait-il pas été légitime de parler du voyeurisme qui consiste à montrer des corps noirs nus dans une position de passivité ? Et à nous expliquer pourquoi les commissaires ont choisi ce tableau d’une extrême violence ? Dans cette mise en scène où des blancs regardent passivement un noir s’apprêtant à fouetter un autre noir, n’aurait-il pas fallu que la guide puisse expliquer quand et pourquoi ce poste de commandeur fut attribué à des Noirs ? (On trouve dans le catalogue une explication au fait que le commandeur est un Noir : au 17ème siècle, le commandeur était un blanc, au 18ème quand le nombre d’esclaves dépassèrent le nombre de blancs, ce poste fut souvent attribué à un esclave). Mais aussi, pourquoi cette objectification du corps masculin et cette sexualisation de la punition, occupe une telle place ? Car que voyons-nous sinon un corps noir masculin jambes écartées et fesses nues rendu passif pour recevoir un fouet brandi par un homme ? Cette scène sexuellement chargée qui met en scène deux hommes noirs sous le regard de l’homme blanc méritait une plus ample explication. Le voyeurisme autour du corps noir passif et martyrisé dans une exposition sur le modèle noir révèle en creux tout un impensé sur l’iconographie de l’esclavage.
Il existe pourtant d’autres œuvres sur les punitions et les conditions de l’esclavage, comme celles de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) et Felix-Emile Taunay (1795-1881). De Debret, on peut retenir Le dîner brésilien (1827) qui montre un couple de blancs et deux domestiques noirs, une femme qui évente le couple et un homme qui les sert, et deux petits enfants noirs entièrement nus à qui la femme blanche donne des restes comme à des animaux, ou Un contremaître punissant des esclaves (1835) où l’esclave n’est pas dénudé et le personnage du prêtre qui regarde la scène les bras croisés renvoie à l’adhésion de l’Eglise à l’esclavage, ou son Hommes noirs punis (1834-1835) qui dépeint la punition qui consistait à maintenir les chevilles d’hommes noirs prisonnières, encore une fois ils ne sont pas entièrement nus ; les toiles de Félix-Émile Taunay sur les marchés d’esclaves (1823) s’éloignent aussi du genre paternaliste. Certes on pourrait me répondre que l’exposition n’étant pas sur ce thème, pourquoi les commissaires auraient-ils du s’intéresser à ces recherches ? Tout simplement pour éviter que les tableaux choisis ne donnent une image de l’esclavage qui masque sa complexité et n’en retienne que l’aspect moraliste, qui commence par l’abolition par la France et met en scène un tableau exemplaire du genre humanitaire.
Sur l’abolition dans la peinture française, le recours systématique au tableau de François-Auguste Biard fait problème, non seulement pour son paternalisme mais pour la place qu’il occupe dans la construction de l’histoire de l’abolitionnisme en France où il prend une place plus grande que la Révolution haïtienne et les luttes incessantes des esclavagisé.e.s. L’abolition de 1848 reste enfermée dans la rhétorique de 1998 et son slogan gouvernemental « Tous nés en 1848 ».
La domestique
Laure, la domestique noire de l’Olympia de Manet a intrigué plus d’un.e artiste. On se dit d’ailleurs que de rassembler dans une même salle autour du tableau de Manet, les « relectures » qui en ont été faites (et qui à Orsay apparaissent en fin de parcours, le lien avec le tableau est devenu lointain) aurait été bien plus intéressant : pourquoi ce tableau a-t-il inspiré tant de réinterprétations ? Quelles formes ont pris ces réinterprétations ?
La femme au corps nu offerte au regard, la Jézabel et la domestique noire ne sont-elles pas les deux faces d’une féminité construite par une domination masculine et patriarcale et par un système économique où toute une partie de la reproduction sociale est dévolue aux femmes ? Ici la femme noire apparaît comme un double du corps blanc. Dans un article sur la subjectivité des femmes noires qui part d’une analyse de la figure de Laure, l’artiste et critique africaine-américaine Lorraine O’Grady voit dans Laure, une de ces « peripheral Negroes » comme il en existe tant d’autres dans l’art occidental8. Dans le tableau de Manet la femme noire n’est là ni pour mettre en contraste la blancheur de la femme blanche comme dans des tableaux du 18ème siècle, ni même pour représenter une personne réelle, elle est en fait un « robot » car « seul le corps de la femme blanche est objet du regard masculin voyeuriste et fétichiste ». Laure n’est rien. « Blanche est ce qu’une femme est ; non-blanche est ce qu’elle devrait surtout ne pas être », écrit-elle. Pour O’Grady, ce qui efface Laure c’est la construction même de la femme noire comme appendice, comme décor.
Le rôle de la femme domestique noire dans la reproduction sociale du monde blanc, comme a été maintes fois analysé. « Le modèle noir » présente plusieurs tableaux sur cette fonction — femmes noires servantes, domestiques, nourrices, travailleuses du sexe — mais sans signaler cette fonction. Laure est celle qui organise la vie d’Olympia, qui joue le rôle d’intermédiaire, de médiatrice entre le client et Olympia. Elle est un corps double9 dont la fonction est de veiller à la reproduction de la vie sociale et intime d’Olympia, elle est bien plus qu’une domestique, elle est la femme noire qui prend soin d’une femme blanche, écho de la servitude millénaire des femmes noires dans un monde blanc.
Une visibilisation peut donc produire une nouvelle forme d’invisibilisation. D’une part, comme le remarque Trawale, le processus d’effacement de leur identité n’est pas expliqué (sauf en disant qu’il y avait du racisme à l’époque) refoulant dans le même temps les processus de racialisation, et d’autre part, rien de l’existence sociale des Noir.e.s n’est restitué. La représentation des Noir.e.s révèle un processus de présence/absence : là mais pas vraiment, là mais pas pleinement. Car une présence requerrait de tenir compte de l’expérience sociale des Noir.e.s en France et dès lors d’aborder les processus d’indignité et de dignité si brillamment explorés par Norman Ajari qui remarque que « l’injonction à l’assimilation ou à l’intégration caractéristique de la France » fait « écho au désir esclavagiste de destruction de l’altérité ». Ajari s’interroge sur le « type de désir » qui anime le rapport du regard blanc « aux formes culturelles noires, mais aussi au corps noir lui-même ». Or, ce rapport n’est ici qu’effleuré.
D’autant plus que la « tâche ne consiste pas seulement à rendre aux femmes noires leur visibilité », écrit Hazel Carby, « Au contraire, nous devons soutenir que le processus de prise en compte de leur position historique et actuelle est en soi, une mise en question des catégories et des présupposés de la pensée féministe dominante10 ». Exposer des œuvres d’artistes noir.e.s aurait mis en perspective ce mouvement de réappropriation. Quel est l’intérêt d’ignorer les travaux des premières concernées par cette représentation ? Il ne s’agit ni de censure ni d’incompréhension devant la « fonction de l’art », mais de réfléchir plus sérieusement à ce qu’a représenté une figuration des Noir.e.s comme objets décoratifs, comme illustration, comme citation. Ce que des artistes ont mis en question, c’est exactement le corps-citation, le corps-illustration, le corps-décoratif.
Ayant lu le catalogue Historias Afro-Atlanticas (2018) sur l’exposition du même nom qui s’est tenue à Sao Paulo en 2018 au même moment où je voyais l’exposition de Paris et que je lisais le catalogue de l’exposition de New York et de Paris, j’ai vu ce qui aurait été possible. Textes et œuvres présentées n’entrent pas dans une logique de compensation, au contraire les commissaires poussent à la réflexion critique en faisant référence à la notion de L’Atlantique noir développée par Paul Gilroy qui fait apparaître un monde complexe où « l’homme blanc » n’est plus au centre. Dans le catalogue du musée d’Orsay, le concept d’Atlantique noir est abordé mais de manière historique en nous donnant des faits et des noms. L’article se conclue avec cette phrase « D’objet d’étude, le modèle noir est devenu sujet politique » (p. 279). Certes, mais cette condition — modèle et sujet politique — ne se justifient que si nous adhérons à une temporalité occidentale. C’est l’Europe qui les découvrent comme sujets après en avoir fait des modèles inertes, car les Noir.e.s ont affirmé leur position de sujet politique soit en Afrique avec les créations de communautés politiques, de royaumes et d’empires, soit dès en résistant à chaque étape à la mise en servitude. Cette phrase marginalise la pensée de Gilroy pour qui la mémoire de l’esclavage reste centrale dans la constitution de l’Atlantique noir. « La façon dont ces populations continuent de faire un usage créatif et communicatif de la mémoire de l’esclavage nous détourne de deux positions qui vont de pair et ont surdéterminé jusqu’à présent le débat sur la modernité : un rationalisme complaisant, acritique, et un antihumanisme embrassé et rhétorique, qui ne fait que banaliser la puissance du négatif11 ».
En résumé, si des imperfections, des manques, ou des faiblesses sont tout à fait acceptables dans une exposition, on est en droit de s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’ambition annoncée ne tient pas sa promesse. Il y a un écart entre la promesse — exposition inédite, historique — et finalement, ce qui est mis en place et cet écart est dû, je pense, à la non résolution des questions que posent l’esclavage et le racisme en France, car, je le répète, je ne pense pas qu’une telle exposition puisse se tenir sans se confronter aux systèmes de domination. Le passage par une analyse historique — dans le catalogue, sur les cartels, fourni par les guides — ne résout pas cette tension.
Il faut cependant reconnaître le succès de l’exposition : elle ne désemplit pas. L’opération est donc réussie. Il faut désormais tenir compte de son existence et en cela, d’une certaine façon, elle est historique. En d’autres termes, au travail!

Pour illustrer mon propos, j’ai choisi deux images, deux portraits photographiés de femmes noires. Sélika Lazeski, la cavalière, comme Marie Lassus regardent droit dans l’objectif, conscientes de l’importance d’un regard à hauteur du public, elles ne baissent ni la tête ni les yeux. Elles évoquent pour moi les portraits de Sojourner Truth comme de Frederick Douglass, tous deux extrêmement conscients que le rôle de la photographie pouvait jouer dans la lutte contre le racisme à la fois pour dénoncer les réalités de l’esclavage et pour créer des portraits où le personnage noir se met en scène plutôt que d’être objectifié.

Atelier de Félix Nadar, Sélika Lazeski, écuyère de haute école, 1891, et Jacques-Philippe Potteau, Marie Lassus, 19 ans, née à la Nouvelle-Orléans d’une mère noire et d’un père parisien, 1860, (nul besoin de spécifier la couleur de peau du père, « parisien », il est nécessairement blanc).
En marge de cette exposition, s’est déroulé les 6 et 7 mai 2019, dans le grand auditorium du Musée d’Orsay, un colloque intitulé « Patrimoines déchaînés. Vers un réseau du paysage culturel de l’esclavage, héritages, transmission, création », organisé par la Mission de la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions et auquel Françoise Vergès a participé.
Il a comporté en particulier une table ronde autour de « Peut-on « décoloniser » son regard, sa pensée, son imaginaire, ses collections ? » rassemblant les responsables de plusieurs musées : Matthieu Dussauge (Musée Schœlcher, Guadeloupe), Krystel Gualdé (Musée d’histoire de Nantes), Jean-François Manicom (International Slavery Museum Liverpool, Royaume Uni), Gilles Pignon (Service général de l’inventaire, La Réunion) et Hilke Rhode-Arora (Deutsche Museumbund, Allemagne).

Cette dernière a notamment présenté le Guide pour le traitement des biens issus de contextes coloniaux , publié en novembre 2018 par l’Association allemande des musées et accessible en français sur le site de ICOM France.
- Eddy Firmin, « Corps noir, capital discursif. Le modèle noir, de Denise Murrell au musée d’Orsay », minorit’Art, Revue de recherches décoloniales, avril 2019, 3.Plusieurs des artistes cité.e ;s ont été exposés dans la série d’expostions Latitudes, commissaire Régine Cuzin.
- Voir, https://www.youtube.com/watch?v=2jJaidt4Y2w
- Page 13 du catalogue. Il y aurait beaucoup à dire sur cette formule. La modernité qui s’inaugure au 16ème siècle se construit sur une division entre humanité et non-humanité, « l’homme » – européen, civilisé, blanc – s’oppose rapidement au « non-homme » – autochtone et noir. Nombreux sont les philosophes au 18ème siècle qui ne considèrent pas les Africains comme des êtres humains à part entière.
- Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris, Amsterdam, 2010, p. 80.
- Damien Trawale, « Naturalisation des catégories raciales et sauvegarde du patrimoine racialiste au musée d’Orsay », 11 avril 2019, https://documentations.art/Naturalisation-des-categories-raciales-et-sauvegarde-du-patrimoine.
- Marcus Wood, Slavery, Empathy and Pornography, Oxford University Press, 2002, et Blind Memory. Visual Representations of Slavery in England and America, 1780-1865, Manchester University Press, 2000.
- Saidiya Hartmann, Scenes of Subjection. Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth Century America, Oxford University Press, 1997, p. 19-20.
- Lorraine O’Grady, « Olympia’Maid: Reclaiming Black Female Subjectivity », Afterimage, 1992, 1.
- Je dois cette formule à Hourya Bentouhami, université de Toulouse, dont le travail original et novateur sur le corps-double va ouvrir un nouveau champ. Je suis loin de pouvoir développer aussi bien qu’elle cette théorie mais je la remercie pour m’avoir alertée sur cette dimension.
- Hazel Carby « Femme blanche écoute ! Le féminisme noir et les frontières de la sororité», in Black Feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, textes choisis et présentés par Elsa Dorlin, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 87-111.
- Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris, Amsterdam, 2010, p. 88.