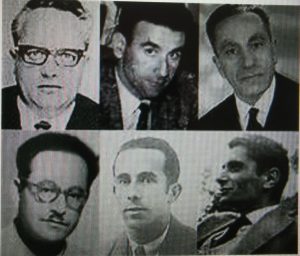Le 19 mars 1962, l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en Algérie, est une date importante : la veille, le 18 mars, les accords d’Evian étaient signés entre la France et le FLN. Ce jour n’a pas marqué la fin des combats et des massacres de populations civiles, dont beaucoup étaient dûs à la folie meurtrière de l’OAS, mais dans la mémoire collective française, le 19 mars est l’anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. D’où la décision du président de la République François Hollande de rendre hommage le 19 mars aux victimes de cette guerre.
Le 18 mars 2016, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a publié une tribune dans Le Figaro pour contester cette décision : l’ancien chef de l’Etat critique la date choisie par François Hollande pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie, au prétexte que cette date ne marquerait pas la fin des combats – voyez la prise de position électoraliste de Christian Estrosi. En réalité on peut voir dans cette prise de position du leader des Républicains une manifestation de la “guerre des mémoires” dont l’objectif premier est de s’approprier le soi-disant vote pieds-noir.
Ci-dessous deux liens pour prendre connaissance du discours de François Hollande, suivis d’un communiqué de la FNACA réagissant, le 18 mars, à l’article de Nicolas Sarkozy.
Mis en ligne le 18 mars 2016, mis à jour le 21