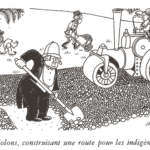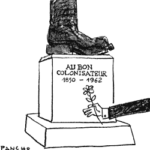L’anti-repentance, une contre-offensive réactionnaire
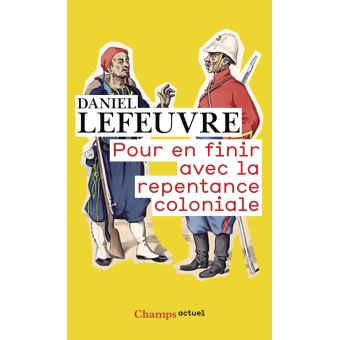 Comme le dit l’historien Nicolas Offenstadt, « l’anti-repentance est une grille de lecture pour repenser l’histoire de France »4. De fait, ses partisans remettent explicitement en cause l’honnêteté de la recherche historique ainsi que la « neutralité » de l’enseignement scolaire de l’histoire coloniale de la France, et en appellent au pouvoir politique pour obtenir leur contrôle. On frôle le négationnisme pur et simple.
En 2000, en réaction à la polémique sur l’usage de la torture relancée avec fracas par le témoignage de Louisette Ighilahriz , c’est d’abord l’armée, mise brutalement sur la sellette pour son action en Algérie, qui sort du silence. Pas moins de 521 officiers généraux ayant servi en Algérie s’associent à un Livre blanc de l’armée française en Algérie prétendant mettre fin à une insupportable « propagande »5. Comme aux beaux jours de l’opération de « maintien de l’ordre » en Algérie française, le rôle de l’armée y est présenté comme un « travail de pacification » visant à « garantir les droits de l’homme » et l’« exercice des droits civiques et des libertés fondamentales » : « Ce qui a caractérisé l’action de l’armée en Algérie ce fut d’abord sa lutte contre toutes les formes de torture, d’assassinat », osent-ils soutenir, évoquant également « l’abandon » de l’Algérie française par de Gaulle.
Comme le dit l’historien Nicolas Offenstadt, « l’anti-repentance est une grille de lecture pour repenser l’histoire de France »4. De fait, ses partisans remettent explicitement en cause l’honnêteté de la recherche historique ainsi que la « neutralité » de l’enseignement scolaire de l’histoire coloniale de la France, et en appellent au pouvoir politique pour obtenir leur contrôle. On frôle le négationnisme pur et simple.
En 2000, en réaction à la polémique sur l’usage de la torture relancée avec fracas par le témoignage de Louisette Ighilahriz , c’est d’abord l’armée, mise brutalement sur la sellette pour son action en Algérie, qui sort du silence. Pas moins de 521 officiers généraux ayant servi en Algérie s’associent à un Livre blanc de l’armée française en Algérie prétendant mettre fin à une insupportable « propagande »5. Comme aux beaux jours de l’opération de « maintien de l’ordre » en Algérie française, le rôle de l’armée y est présenté comme un « travail de pacification » visant à « garantir les droits de l’homme » et l’« exercice des droits civiques et des libertés fondamentales » : « Ce qui a caractérisé l’action de l’armée en Algérie ce fut d’abord sa lutte contre toutes les formes de torture, d’assassinat », osent-ils soutenir, évoquant également « l’abandon » de l’Algérie française par de Gaulle.
Du Livre blanc de l’armée française à la loi du 23 février 2005
Commence alors la gestation d’une loi à venir en 2005, qui tentera de réhabiliter la colonisation dans son ensemble et de faire taire son histoire critique ainsi que son enseignement. Dans ce « livre blanc », comme le souligne une analyse détaillée de la genèse de cette loi, « des travaux d’historiens sont attaqués, comme la thèse de Raphaëlle Branche [sur la torture] : “Qu’une telle thèse ait pu non seulement être préparée, mais être admise à la soutenance et de surcroît recevoir les félicitations unanimes du jury laisse planer un doute sérieux sur la neutralité axiologique dont se targuent les instances universitaires”. Et les manuels scolaires sont vigoureusement mis en cause : “Partielle, partiale, réductionniste, voire mensongère, la présentation de la guerre d’Algérie dans les manuels scolaires relève moins de la science historique que de la propagande” »6. Quelques temps après, cet appel à reconquérir le terrain de l’histoire et de son enseignement est repris, dans des termes voisins, par un lobby pied-noir nostalgérique particulièrement actif et influent dans les départements français méridionaux, et dont le FN et l’UMP se disputent âprement les voix à coup de surenchères incluant l’érection de monuments à la gloire de l’OAS et de militaires tortionnaires et putschistes. En 2005, des députés souvent élus dans ces départements inscrivent cette exigence d’une révision de l’histoire enseignée dans une loi ad hoc.Elle est promulguée le 23 février. Accordant la « reconnaissance de la nation » aux « Français rapatriés », c’est-à-dire des réparations, elle stipule dans son article 4 : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. »
Ces dispositions incluent les programmes de recherche universitaire, dont on aimerait qu’ils cessent de s’adonner à la « repentance », et s’intéressent à l’œuvre « civilisatrice » de la France dans son empire colonial. Fait lourdement significatif, les députés de gauche ne se sont pas opposés à ce texte. Devant la levée de boucliers provoquée ultérieurement par cet article, notamment parmi les enseignants et les chercheurs, celui-ci est finalement abrogé par décret un an plus tard. Mais on a pu mesurer avec cette affaire l’ampleur de la diffusion de l’idéologie portée initialement par le Front national dans la vie politique française : ce dernier n’est plus, loin s’en faut, le seul champion de la nostalgie coloniale et de tout ce qu’elle charrie de miasmes racistes. À la fin de cette même année 2005, de violentes révoltes surviennent à travers la France dans les quartiers populaires après la mort dans un transformateur EDF, à Clichy-sous-Bois, de deux jeunes, Zyed et Bouna, qui fuient la police. Les incessants et humiliants contrôles d’identité au faciès et les brutalités policières qui s’en suivent souvent sont dénoncées par les « émeutiers ». Quelques mois auparavant, avait été lancé un appel à des « assises de l’anticolonialisme postcolonial ». Ce texte marquant s’intitulait : « Nous sommes les indigènes de la République ! » et faisait entendre la voix de « personnes issues des colonies anciennes et nouvelles », discriminées « à l’embauche, au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs », victimes de « contrôles au faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes [ainsi que de] brutalités policières, parfois extrêmes, […] rarement sanctionnées par une justice qui fonctionne à deux vitesses ». L’appel proclamait notamment : « La décolonisation de la République reste à l’ordre du jour » et estimait :
« L’État et la société doivent opérer un retour critique radical sur leur passé-présent colonial. »7 Pour la première fois depuis les années 1980, le racisme systémique était clairement et collectivement dénoncé comme un héritage de l’oppression coloniale.
Les réactions publiques aux émeutes de cette fin d’année 2005 et le traitement politique de ces dernières par le gouvernement donnèrent raison à ce texte. Les habitants et les habitantes des quartiers de relégation sociale furent en effet clairement l’objet, dans les réactions politiques, d’un imaginaire raciste hérité du colonialisme. Le FN et au moins un député UMP dénoncèrent « la racaille » noire et arabe qui détruit « par plaisir ». Un ministre et le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, de même qu’une secrétaire perpétuelle de l’Académie française, affirmèrent très sérieusement que « la polygamie » était une cause de ces violences. Dans ce concert, l’intellectuel médiatique Alain Finkielkraut s’illustra particulièrement : « Il est clair que cette révolte a un caractère ethnique et religieux », et non social, déclara-t-il8. […] Le gouvernement Villepin jugea alors politiquement payant de ressusciter une loi de répression coloniale, promulguée en 1955 sur le territoire algérien pour mater l’insurrection nationaliste et réutilisée en 1985 en Nouvelle-Calédonie contre une révolte kanak. Il décréta l’« état d’urgence » pour pacifier les quartiers populaires de France. « Le recours à l’état d’urgence serait-il l’indice d’un héritage colonial non assumé mais resurgissant à la faveur de l’actualité ? », s’interrogea l’historienne Sylvie Thénault9.
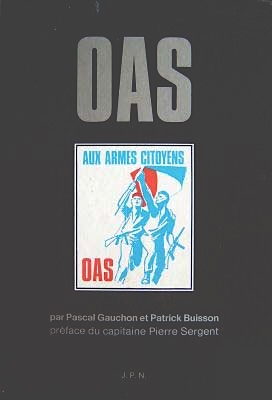 […] Conseillé par le militant d’extrême-droite Patrick Buisson, auteur d’un livre traitant de ce qu’il nomme la « résistance française » de l’OAS à l’« abandon » de l’Algérie10, et par ailleurs directeur de la chaîne privée Histoire, Nicolas Sarkozy devient en 2007 président de la République. Avec lui, l’anti-repentance siège à l’Élysée. Le refus de la « repentance », concept épouvantail désormais banalisé, avait été un thème tout à fait central de sa campagne présidentielle. « La question de la repentance est […] clairement identifiée dans le discours, relève alors le Comité de vigilance sur les usages de l’histoire, comme une justification de la loi du 23 février, dont l’article 4 a sans doute été annulé dans les faits, mais non dans les esprits »11. Maintes fois réaffirmée durant son quinquennat, elle apparaît comme le pendant mémoriel d’une hostilité désormais « décomplexée » à l’égard de l’immigration, perçue comme une menace pour « l’identité nationale », ainsi que d’une défiance explicite à l’égard des Français issus de l’immigration postcoloniale, tout particulièrement des musulmans. Par une résurgence d’une islamophobie elle aussi d’origine coloniale, ces derniers sont suspectés de déloyauté à l’égard de la France mais aussi, de plus en plus, d’une incapacité d’ordre culturel à « s’intégrer » comme on exige qu’ils le fassent, c’est-à-dire en gommant, si possible entièrement, leurs particularités, notamment religieuses. Dans ces conditions, revenir sur l’esclavage ou les exactions coloniales, les commémorer et les enseigner reviendrait à alimenter « la haine » de la France, ainsi que le « communautarisme » ou le « racisme anti-blanc », autres concepts assez peu définis et passablement creux, mais qui deviennent également d’usage courant dans ces années.
Aussi, jusqu’à la défaite de Sarkozy en 2012, la contre-offensive réactionnaire triomphe. L’idée d’une nécessaire transparence sur le passé colonial, alors qu’elle était largement partagée dans la décennie précédente, avait perdu un terrain politique considérable.
[…] Conseillé par le militant d’extrême-droite Patrick Buisson, auteur d’un livre traitant de ce qu’il nomme la « résistance française » de l’OAS à l’« abandon » de l’Algérie10, et par ailleurs directeur de la chaîne privée Histoire, Nicolas Sarkozy devient en 2007 président de la République. Avec lui, l’anti-repentance siège à l’Élysée. Le refus de la « repentance », concept épouvantail désormais banalisé, avait été un thème tout à fait central de sa campagne présidentielle. « La question de la repentance est […] clairement identifiée dans le discours, relève alors le Comité de vigilance sur les usages de l’histoire, comme une justification de la loi du 23 février, dont l’article 4 a sans doute été annulé dans les faits, mais non dans les esprits »11. Maintes fois réaffirmée durant son quinquennat, elle apparaît comme le pendant mémoriel d’une hostilité désormais « décomplexée » à l’égard de l’immigration, perçue comme une menace pour « l’identité nationale », ainsi que d’une défiance explicite à l’égard des Français issus de l’immigration postcoloniale, tout particulièrement des musulmans. Par une résurgence d’une islamophobie elle aussi d’origine coloniale, ces derniers sont suspectés de déloyauté à l’égard de la France mais aussi, de plus en plus, d’une incapacité d’ordre culturel à « s’intégrer » comme on exige qu’ils le fassent, c’est-à-dire en gommant, si possible entièrement, leurs particularités, notamment religieuses. Dans ces conditions, revenir sur l’esclavage ou les exactions coloniales, les commémorer et les enseigner reviendrait à alimenter « la haine » de la France, ainsi que le « communautarisme » ou le « racisme anti-blanc », autres concepts assez peu définis et passablement creux, mais qui deviennent également d’usage courant dans ces années.
Aussi, jusqu’à la défaite de Sarkozy en 2012, la contre-offensive réactionnaire triomphe. L’idée d’une nécessaire transparence sur le passé colonial, alors qu’elle était largement partagée dans la décennie précédente, avait perdu un terrain politique considérable.Pour en finir avec le chantage à la repentance
 Pour que les choses soient claires d’emblée, précisons que nous n’incluons nullement dans nos dénonciations les historiens avec lesquels nous avons eu, avons et aurons des débats, souvent vifs, des désaccords, parfois des polémiques. Ces collègues sont des chercheurs affirmés, qui arrivent à des conclusions que nous contestons, mais qui appliquent les règles habituellement reconnues dans notre profession. Ils méritent des réponses argumentées, non des invectives, non des appels à la censure… et encore moins des recours aux tribunaux.
Ceci étant souligné une fois pour toutes, revenons à nos réhabilitateurs.
Ils ont (re)commencé un travail, avons-nous écrit. Et nous avons pris soin de placer le « re » entre parenthèses. Car, en fait, ce travail de sape n’a jamais cessé. Le fait nouveau est qu’il a porté ses fruits, qu’il a, pourquoi le nier, profité de notre torpeur, de notre désarroi parfois devant les errances d’un tiers-monde que nous avions magnifié – ce pluriel s’appliquant à notre courant d’idées, toutes générations confondues –. Persuadés d’aller dans le sens de l’Histoire, nous nous étions endormis sur nos lauriers. Le réveil a été brutal.
Nos adversaires ont réussi le tour de force de faire passer un appareil idéologique des années 1930-1950 comme une nouveauté, de s’imposer comme des interlocuteurs, porteurs d’une certaine vérité, une parmi d’autres, peut-être, mais une vérité. La loi du 23 février 2005 a été la manifestation la plus éclatante de cette offensive. Mais cette loi n’a pas été un épiphénomène, un épisode clos après la décision présidentielle de renoncer au trop fameux article 4. Qui pourrait sérieusement contester que le faisceau de faits que l’actualité charrie depuis quelques années – du discours sarkozyste (racaille et moutons égorgés dans les baignoires) aux risettes aux anciens OAS (dont bien des électeurs lepénistes), en passant par le retour frêchien à la classification hommes / sous-hommes – est une coïncidence ? Nous sommes d’autant plus amenés à nous interroger que ce courant est désormais international (Italie, Belgique, Royaume-Uni14 …).
Nous nous considérons en état de légitime défense. Qui pourrait dénier à ceux qui tiennent pour acquis une certaine critique radicale du colonialisme le droit de riposter ?
Ce droit… est un devoir. Nous le devons, d’abord, aux peuples injustement agressés dans leur mémoire, comme ils le furent naguère dans leur chair. Nous le devons à nos aînés, les intellectuels anticolonialistes, les Paul Mus, les Pierre-Henri Simon, Charles-André Julien, Jean Dresch, Madeleine Rebérioux, André Mandouze, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant15. Et nous le devons à l’établissement des faits. Rien que cela.
Ce que nous avons nommé Faisceau de faits ne provient certes pas du travail d’un chef d’orchestre clandestin (vision policière de l’Histoire), mais est significatif d’une réelle convergence idéologique : esprit de revanche d’anciens militaires coloniaux refusant le sort des armes et invoquant la trahison de l’arrière, de nostalgiques de l’Algérie française encouragés et cautionnés par le clientélisme électoral ; position de défense de certains cercles du pouvoir cherchant à éviter ou à atténuer les effets d’un grand déballage mettant en évidence la continuité des politiques françaises à l’endroit des ex-colonies (Françafrique et scandale d’une éventuelle complicité de génocide au Rwanda des plus hautes autorités militaires et politiques) ; plus généralement, en Occident, tendance à l’auto-justification pour permettre la poursuite de politiques d’ingérence à façade humanitaire (la mission civilisatrice sous d’autres formes), nouvelle forme de développement du capitalisme mondialisé, du pillage de la périphérie pauvrissime par le centre développé…
Pour que les choses soient claires d’emblée, précisons que nous n’incluons nullement dans nos dénonciations les historiens avec lesquels nous avons eu, avons et aurons des débats, souvent vifs, des désaccords, parfois des polémiques. Ces collègues sont des chercheurs affirmés, qui arrivent à des conclusions que nous contestons, mais qui appliquent les règles habituellement reconnues dans notre profession. Ils méritent des réponses argumentées, non des invectives, non des appels à la censure… et encore moins des recours aux tribunaux.
Ceci étant souligné une fois pour toutes, revenons à nos réhabilitateurs.
Ils ont (re)commencé un travail, avons-nous écrit. Et nous avons pris soin de placer le « re » entre parenthèses. Car, en fait, ce travail de sape n’a jamais cessé. Le fait nouveau est qu’il a porté ses fruits, qu’il a, pourquoi le nier, profité de notre torpeur, de notre désarroi parfois devant les errances d’un tiers-monde que nous avions magnifié – ce pluriel s’appliquant à notre courant d’idées, toutes générations confondues –. Persuadés d’aller dans le sens de l’Histoire, nous nous étions endormis sur nos lauriers. Le réveil a été brutal.
Nos adversaires ont réussi le tour de force de faire passer un appareil idéologique des années 1930-1950 comme une nouveauté, de s’imposer comme des interlocuteurs, porteurs d’une certaine vérité, une parmi d’autres, peut-être, mais une vérité. La loi du 23 février 2005 a été la manifestation la plus éclatante de cette offensive. Mais cette loi n’a pas été un épiphénomène, un épisode clos après la décision présidentielle de renoncer au trop fameux article 4. Qui pourrait sérieusement contester que le faisceau de faits que l’actualité charrie depuis quelques années – du discours sarkozyste (racaille et moutons égorgés dans les baignoires) aux risettes aux anciens OAS (dont bien des électeurs lepénistes), en passant par le retour frêchien à la classification hommes / sous-hommes – est une coïncidence ? Nous sommes d’autant plus amenés à nous interroger que ce courant est désormais international (Italie, Belgique, Royaume-Uni14 …).
Nous nous considérons en état de légitime défense. Qui pourrait dénier à ceux qui tiennent pour acquis une certaine critique radicale du colonialisme le droit de riposter ?
Ce droit… est un devoir. Nous le devons, d’abord, aux peuples injustement agressés dans leur mémoire, comme ils le furent naguère dans leur chair. Nous le devons à nos aînés, les intellectuels anticolonialistes, les Paul Mus, les Pierre-Henri Simon, Charles-André Julien, Jean Dresch, Madeleine Rebérioux, André Mandouze, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant15. Et nous le devons à l’établissement des faits. Rien que cela.
Ce que nous avons nommé Faisceau de faits ne provient certes pas du travail d’un chef d’orchestre clandestin (vision policière de l’Histoire), mais est significatif d’une réelle convergence idéologique : esprit de revanche d’anciens militaires coloniaux refusant le sort des armes et invoquant la trahison de l’arrière, de nostalgiques de l’Algérie française encouragés et cautionnés par le clientélisme électoral ; position de défense de certains cercles du pouvoir cherchant à éviter ou à atténuer les effets d’un grand déballage mettant en évidence la continuité des politiques françaises à l’endroit des ex-colonies (Françafrique et scandale d’une éventuelle complicité de génocide au Rwanda des plus hautes autorités militaires et politiques) ; plus généralement, en Occident, tendance à l’auto-justification pour permettre la poursuite de politiques d’ingérence à façade humanitaire (la mission civilisatrice sous d’autres formes), nouvelle forme de développement du capitalisme mondialisé, du pillage de la périphérie pauvrissime par le centre développé…
Un terme utilisé par nos adversaires
Face à cette offensive, il nous paraît nécessaire de rappeler quelques acquis de la recherche historique en matière coloniale. Simplement, calmement. Et sans repentance. Car cette notion nous est radicalement et définitivement étrangère. Remarquons pour commencer que le mot a été mis à la mode… par ses adversaires. Le procédé est rôdé : amalgamer des noms de bateleurs et de pamphlétaires et ceux de citoyens critiques, historiens ou pas, viser de préférence des cibles faciles puis se présenter comme raisonnables, nuancés. Ce mode de fonctionnement est assez fidèlement résumé par le Dossier de Marianne consacré au phénomène : « C’est une opération commando, une vaste entreprise de démoralisation, qui voit se répandre comme une traînée de poudre la mauvaise conscience et la mauvaise foi ». Une « vague de repentance », un « malaise dans l’identité historique », une « victimisation à outrance » s’abattent sur la France, écrit Philippe Petit dans l’article introductif16. Suit un article vantant, avec force citations, la « rationalité » de l’ouvrage médiatisé de Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec le repentance coloniale17, une interview de Pascal Bruckner, « Arrêtons de confondre l’ethnique et le politique », le tout contrebalancé, il est vrai, par un entretien avec Benjamin Stora. Anti-repentance ! Que d’encre tu as fait couler ! Que de pages tu as noircies ! Les intellectuels les plus divers, du nostalgérique au souverainiste, de l’ex-communiste devenu républicaniste à l’ex-maoïste devenu bushiste, y sont allés de leur attaque (qu’ils nomment comme il se doit : défense). Le très réactionnaire Alain Griotteray avait ouvert le feu en 2001 avec Je ne demande pas pardon. La France n’est pas coupable18 ; en 2006, ce fut un tir groupé : Paul-François Paoli : Nous ne sommes pas coupables. Assez de repentances !19 ; Max Gallo, Fier d’être Français20 ; Daniel Lefeuvre, déjà cité ; Pascal Bruckner, La tyrannie de la pénitence. Essai sur le masochisme occidental21 … presque tous, soit dit en passant, publiés chez de « grands » éditeurs, et donc destinés à un large public, presque tous invités réguliers des médias, presque tous exposés honorablement sur les étals des libraires. Pour des auteurs qui mettent en avant leur courage intellectuel contre les modes, voire les « commandos » (dixit Marianne), sortes de Don Quichotte pourfendant le politiquement correct, il y a pire épreuve… Mais, franchement, pour aboutir à quoi ? A force de ramener l’argumentaire de leurs adversaires à une caricature, nos auteurs enfoncent des portes ouvertes. Certains frisent le ridicule : « Il faut bien que quelqu’un monte sur le ring et dise : “je suis fier d’être Français” écrit Max Gallo. Qu’il réponde coup pour coup, du poing et du pied, à ceux qui, du haut de toutes les estrades, condamnent la France pour ce qu’elle fut, ce qu’elle est, ce qu’elle sera ». Ils veulent « que la France s’agenouille, baisse la tête, avoue, fasse repentance, reconnaisse ses crimes et, tondue en robe de bure, se laisse couvrir d’insultes, de crachats, heureuse qu’on ne la viole qu’en chanson et qu’on ne la brûle que symboliquement chaque nuit. » Et de demander que l’on réponde à ces accusations par… « la boxe à la française »22. Non, la lutte des idées n’est pas un ring de boxe. Vous avez perdu votre temps, messieurs… et vous avez fait perdre celui de vos lecteurs. Soyons francs : nous avons un problème de communication avec ce mot. L’immense majorité des femmes et hommes qui ont combattu la loi de février 2005 le récusent 23. Nous avons entendu cent fois Christiane Taubira lui régler son compte. Nous-mêmes le dénonçons catégoriquement depuis des années – et ici encore. Mais comment se faire entendre ? Comment ne pas se faire taxer de schématisme, à chaque fois, avec cet argument éculé : « Vous demandez la repentance ». Puisque les récusations polies n’ont, semble-t-il, pas été convaincantes, nous faisons ici appel à Cavanna. Qui n’a pas la réputation d’être particulièrement bien élevé : « La repentance, forme suprême de I’hypocrisie. Mot immonde, mot hideux, mot de cureton honteux. Mot d’assassin impuni (et impunissable !) qui veut, en plus de l’impunité, le pardon de ses victimes pour la tranquillité de son âme. Repentance mon cul ! Démerdez-vous avec vos remords et vos autres petits inconforts, confessez-vous à votre curé habituel si c’est votre tasse de thé, mais ne venez pas nous faire chier, nous qui ne pouvons être que des victimes. Repentance… pouah! » 24 Nous ne demandons donc pas « que la France s’agenouille » (Max Gallo). D’abord, parce que nous pensons qu’il y a eu, face au phénomène colonial, des France. Dont une n’a pas adhéré aux valeurs dominantes. Des contemporains des événements ont appelé un chat un chat, et un crime un crime, des intellectuels, des politiques ont résisté à l’air du temps…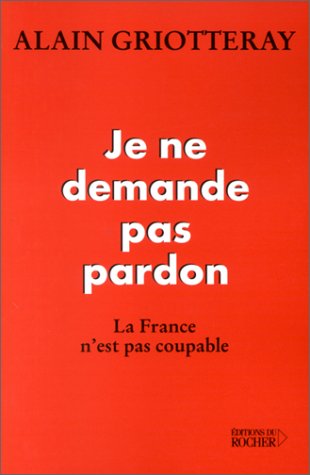 Mais oui, nous demandons, oui, nous exigeons que l’Etat français reconnaisse les préjudices que le système a mis en place entre les premières déportations négrières et la décolonisation – plus de trois siècles – . Nous prenons au mot le Président de la République [Jacques Chirac. NDLR] lorsqu’il affirme, à l’intention des autorités d’Ankara, que « tout pays qui reconnaît ses erreurs se grandit ». Nous avons la conviction qu’une telle mise au point par un discours officiel (et non une loi ou une quelconque réparation financière, bien sûr…) serait propice à pacifier le débat sur la question, à désarmer un argumentaire démagogique et communautariste que, certes, nous ne sous-estimons pas, à ôter un prétexte au chantage de certains gouvernements d’ex-colonies.
Point de naïveté pourtant : il ne suffira pas de dénoncer les injustices d’hier pour en finir avec celles d’aujourd’hui. Mais une telle clarification aurait au moins le mérite de limiter les risques d’un violent retour du refoulé et d’amorcer un débat – enfin sérieux – sur ce que devrait, sur ce que devra être une France républicaine respectueuse de ses principes fondateurs.
Il faut le dire et le répéter, et pour notre part nous n’y renoncerons pas : oui, la France coloniale fut coupable d’appropriation illégale de territoires étrangers… de pillages… de spoliations… de massacres… de discriminations racistes à base de discours pseudo scientifique… Toutes choses qui suffiraient à faire de la colonisation un crime contre l’humanité… Certes, tout n’a pas été abus, un équipement ferroviaire et routier a été mis en place, des infrastructures éducatives et sanitaires ont été construites. Mais ce fut dans un souci, d’ailleurs légitime pour tout système, de meilleure rentabilité économique, la fameuse « mise en valeur de l’Empire » exaltée en 1923 par Albert Sarraut dans son ouvrage le plus célèbre 25.
Mais oui, nous demandons, oui, nous exigeons que l’Etat français reconnaisse les préjudices que le système a mis en place entre les premières déportations négrières et la décolonisation – plus de trois siècles – . Nous prenons au mot le Président de la République [Jacques Chirac. NDLR] lorsqu’il affirme, à l’intention des autorités d’Ankara, que « tout pays qui reconnaît ses erreurs se grandit ». Nous avons la conviction qu’une telle mise au point par un discours officiel (et non une loi ou une quelconque réparation financière, bien sûr…) serait propice à pacifier le débat sur la question, à désarmer un argumentaire démagogique et communautariste que, certes, nous ne sous-estimons pas, à ôter un prétexte au chantage de certains gouvernements d’ex-colonies.
Point de naïveté pourtant : il ne suffira pas de dénoncer les injustices d’hier pour en finir avec celles d’aujourd’hui. Mais une telle clarification aurait au moins le mérite de limiter les risques d’un violent retour du refoulé et d’amorcer un débat – enfin sérieux – sur ce que devrait, sur ce que devra être une France républicaine respectueuse de ses principes fondateurs.
Il faut le dire et le répéter, et pour notre part nous n’y renoncerons pas : oui, la France coloniale fut coupable d’appropriation illégale de territoires étrangers… de pillages… de spoliations… de massacres… de discriminations racistes à base de discours pseudo scientifique… Toutes choses qui suffiraient à faire de la colonisation un crime contre l’humanité… Certes, tout n’a pas été abus, un équipement ferroviaire et routier a été mis en place, des infrastructures éducatives et sanitaires ont été construites. Mais ce fut dans un souci, d’ailleurs légitime pour tout système, de meilleure rentabilité économique, la fameuse « mise en valeur de l’Empire » exaltée en 1923 par Albert Sarraut dans son ouvrage le plus célèbre 25.
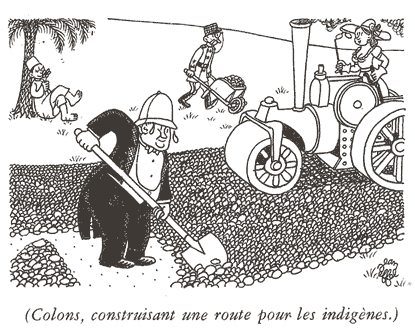 Il n’y a pas de débat possible sur les aspects positifs de la colonisation. Il n’y a jamais eu de colonisation respectueuse des individus dominés. La conquête coloniale, bien qu’ayant toujours voulu se parer des atours de la légalité internationale, n’en avait pas moins pour seule règle la loi du plus fort. Elle s’est toujours faite dans la violence. Elle s’est parfois faite au prix de crimes. Et, dans les cas extrêmes, on, peut parler de génocides : qu’on songe aux Caraïbes, aux Hereros et aux Aborigènes (même si nous récusons dans cet ouvrage l’usage de ce concept, génocide, pour qualifier l’ensemble du phénomène colonial).
Enfin, si nous nous prononçons pour une reconnaissance de la responsabilité de la France dans cette phase de son histoire, c’est aussi parce que nous y voyons un moyen bien plus efficace que le silence pour libérer la Nation d’une souffrance qui naît précisément de la pérennisation de l’implication collective dans le déni. Cet acte de responsabilité collective est ainsi un préalable à la construction de nouvelles formes de relations à l’altérité.
En ce sens, ce débat, qui parle beaucoup du passé, est une (petite) fenêtre ouverte sur l’avenir.
Il n’y a pas de débat possible sur les aspects positifs de la colonisation. Il n’y a jamais eu de colonisation respectueuse des individus dominés. La conquête coloniale, bien qu’ayant toujours voulu se parer des atours de la légalité internationale, n’en avait pas moins pour seule règle la loi du plus fort. Elle s’est toujours faite dans la violence. Elle s’est parfois faite au prix de crimes. Et, dans les cas extrêmes, on, peut parler de génocides : qu’on songe aux Caraïbes, aux Hereros et aux Aborigènes (même si nous récusons dans cet ouvrage l’usage de ce concept, génocide, pour qualifier l’ensemble du phénomène colonial).
Enfin, si nous nous prononçons pour une reconnaissance de la responsabilité de la France dans cette phase de son histoire, c’est aussi parce que nous y voyons un moyen bien plus efficace que le silence pour libérer la Nation d’une souffrance qui naît précisément de la pérennisation de l’implication collective dans le déni. Cet acte de responsabilité collective est ainsi un préalable à la construction de nouvelles formes de relations à l’altérité.
En ce sens, ce débat, qui parle beaucoup du passé, est une (petite) fenêtre ouverte sur l’avenir.La repentance est un mot écran

Lire aussi
• Assumer les violences du passé colonial, par Karima Dirèche, historienne, directrice de recherche au CNRS.
• La question des responsabilités est centrale, par Paul-Max Morin, chercheur à Sciences-Po et au Cevipof, membre du bureau de SOS Racisme.
dans le le dossier « Débats & Controverses » par Latifa Madani, publié dans l’Humanité le 17 février 2021 : « Histoire et mémoire de la colonisation. France-Algérie : quel travail de reconnaissance et de vérité ? (1) »

Lire les articles Histoire et mémoire de la colonisation France-Algérie : quel travail de reconnaissance et de vérité ?
Documents joints
- Voir ici même : https://histoirecoloniale.net/Il-y-a-vingt-ans-la-redecouverte-par-la-societe-francaise-de-la-torture-dans-la.html
- Suzan Faludi, Backlash : The Undeclared War Against American Women, 1991.
- Sébastien Jahan et Alain Ruscio (dir.), Histoire de la colonisation. Réhabilitations, Falsifications et Instrumentalisations, Paris, Les Indes savantes, coll. « Le Temps colonial », 2007.
- Cité par Laetitia Van Eeckhout, « Opposé à la repentance, M. Sarkozy participe à la commémoration de l’abolition de l’esclavage », Le Monde, 9 mai 2007. Nicolas Offenstadt est notamment membre du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH), collectif d’historiens créé au moment de la polémique sur la loi du 23 février 2005.
- Collectif, Le livre blanc de l’armée française en Algérie, Contretemps, Paris, 208 p., in 4°, cartonné, 2001.
- Valérie Morin, François Nadiras et Sylvie Thénault, « Les origines et la genèse d’une loi scélérate », in La colonisation, la loi et l’histoire, Claude Liauzu et Gilles Manceron (dir.), Paris, Syllepse, 2006, p. 23-58.
- Collectif, « Nous sommes les indigènes de la République », Les mots sont importants, 28 février 2005 (lmsi.net/Nous-sommes-les-indigenes-de-la).
- Dans une interview donnée au quotidien Haaretz, « Quelle sorte de Français sont-ils ? », 17 novembre 2005. Le MRAP renonça à porter plainte pour incitation à la haine raciale après les « excuses » d’Alain Finkielkraut.
- Sylvie Thénault, « L’état d’urgence (1955-2005). De l’Algérie coloniale à la France contemporaine : destin d’une loi », Le Mouvement social, Les Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, 2007, 218 (1), p.63.
- OAS : Histoire de la résistance française en Algérie, avec Pascal Gauchon, Bièvres, Jeune Pied-Noir
- Sylvie Aprile (dir.), « L’histoire par Nicolas Sarkozy. Le rêve passéiste d’un futur national-libéral », Dossier du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, site internet du CVUH, 30 avril 2007 (cvuh.blogspot.fr/2007/04/lhistoire-par-nicolas-sarkozy-le-reve.html ?m=1).
- Avec les contributions de Sidi Mohammed Barkat, Anissa Bouayed, Michele Brondino, Catherine Coquery-Vidrovitch, Philippe Dumont, Vincent Geisser, Sébastien Jahan, Gilles Manceron, Rosa Moussaoui, François Nadiras, Jean-Philippe Ould-Aoudia, Mickaëlla Perina, Delphine Robic-Diaz, Alain Ruscio, Odile Tobner, Trinh Van Thao et Jan Vandersmissen.
- L’Express, 9 avril 1955.
- Voir pour ce pays Saumas Milne, Le Monde Diplomatique, mai 2005.
- Mais nous n’avons pas l’outrecuidance de vouloir re-créer on ne sait quel Parti intellectuel anticolonialiste : en ce début de XXIè siècle, quarante-cinq ans après la fin de la guerre d’Algérie. Une telle étiquette prêterait inévitablement – et justement – à sourire : nos aînés prenaient des risques, eux, et pas seulement intellectuels…
- « Vices et vertus de la repentance », 30 septembre 2006.
- Paris, Gallimard, 2006.
- Paris, Ed. du Rocher.
- Paris, La Table Ronde.
- Paris, Fayard.
- Paris, Grasset.
- Max Gallo, o.c.
- La seule référence, à notre connaissance, à la notion de repentance, dans un travail sérieux, est celle du livre dirigé et coordonné par Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme. XVI è – XXI è siècle : de l’extermination à la repentance, Paris, Ed. Robert Laffont, 2003. Encore savons-nous de source sûre que ce titre et ce sous-titre ont été appréciés de façon distanciée par nombre de co-auteurs…
- Charlie-Hebdo, 29 novembre 2000.
- Paris, Ed. Payot.