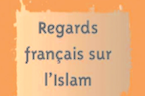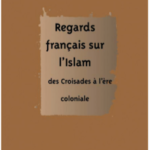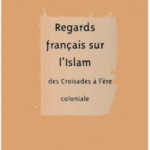des Croisades à l’ère coloniale
dirigé par Alain Ruscio

Contributions de Faruk Bilici, Gérard Chalaye, Luc Chantre, Catherine Coquery-Vidrovitch, Sébastien Jahan, Aïssa Kadri, Roland Laffitte, Naïma Lefkir-Laffitte, Ophélie Léonard, Simone Mazauric, Laurence Montel, Jacques Poirier, Hocine Zeghbib.
Présentation de l’éditeur
La nature de l’islam, la place des musulmans, deux thèmes qui taraudent – et souvent enflamment – les débats de la société française depuis plusieurs décennies.
Les auteurs et autrices de cet essai, spécialistes de périodes et d’aires géographiques différentes, mettent en lumière l’ancienneté des regards français sur cette religion et sur cette communauté.
Quatorze auteur-e-s, spécialistes de périodes et d’aires géographiques différentes, ont cherché à historiciser cette question. Et l’on découvrira, ou l’on aura confirmation, dans ces pages, que bien des jugements et attitudes d’aujourd’hui ont des racines multiséculaires, parfois venues du grand choc que furent les Croisades.
Au fil des siècles, intérêt, adhésion et hostilité se croiseront. L’étude couvre la totalité de la période coloniale et s’achève donc à la guerre d’Algérie. Au lecteur du début du XXIème siècle de tirer des enseignements sur l’état actuel du débat sur ces questions.
Sommaire
• Comment les nommer ? Les hésitations du vocabulaire français face à l’Iislam et aux Musulmans
Roland Laffitte & Alain Ruscio
• Images de Mohammed /Mahomet au fil des siècles
Roland Laffitte & Alain Ruscio
• Mise au point historico-sémantique : le mot et les maux de l’islamophobie
Roland Laffitte & Alain Ruscio
• L’hostilité à l’islam et aux musulmans, phénomène multiséculaire
Roland Laffitte & Alain Ruscio
• Intérêt paradoxal pour l’islam, l’autre tradition française
Roland Laffitte & Alain Ruscio
• Poitiers 732, Roncevaux 778 : vraies batailles, fausses histoires
Alain Ruscio
• Les sciences arabo-islamiques vues de France (XIXe-XXe siècles)
Simone Mazauric
• L’Islam en France sous l’Ancien Régime et la Révolution :
attraction et répulsion
Faruk Bilici
• Le prophète de l’Islam au prisme de la raison « calme et réfléchie » :
la vie de Mahomet par Henri-François Turpin (1773-1779)
Sébastien Jahan
• Le sort des mosquées en Algérie française, de la conquête au début du XXe siècle
Alain Ruscio
• État et islam dans l’Algérie coloniale. Séparation contrariée, laïcité empêchée.
Hocine Zeghbib
• Regards français sur le hajj, de l’expédition d’Égypte à la Grande Guerre
Luc Chantre
• Les autorités coloniales, les écoles coraniques et la langue arabe en Algérie
Aïssa Kadri
• Les conversions d’Européens à l’islam durant la période coloniale,
– Juliette, la (fausse) Chrétienne de la Smalah d’Abd el Kader
– Ismayl Urbain
– Isabelle Eberhardt
– Aurélie Picard-Tidjani
– Le Dr Grenier
– Henri Gustave Abdou’l Karim Jossot
– Étienne Nasreddine Dinet
– Valentine de Saint-Point
Roland Laffitte, Naïma Iffkir-Laffitte, Ophélie Léonard, Laurence Montel, Jacques Poirier & Alain Ruscio
• Les « Reniés » du Protectorat français au Maroc
Gérard Chalaye
• Regards français sur le voile islamique, XIXe -XXe siècles
Alain Ruscio
• Comment l’incompréhension coloniale facilita l’expansion de l’islam en Afrique de l’ouest francophone
Catherine Coquery-Vidrovitch
Une critique de Denise Brahimi
Denise Brahimi a vécu de 1962 à 1972 à Alger et ensuite à Paris. Elle s’intéresse au Maghreb depuis les années 1960, et elle est spécialiste des récits de voyage dans cette région. Elle leur a consacré plusieurs ouvrages, dont sa thèse, portant sur les voyageurs du XVIIIe siècle, plus ou moins inspirés par l’esprit philosophique de leur temps, ainsi qu’un recueil de textes intitulé Opinions et regards des Européens sur le Maghreb aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle s’intéresse particulièrement aux femmes qui écrivent et à leurs personnages féminins.
Ce livre est un recueil d’une quinzaine d’articles, chacun d’entre eux étant une étude substantielle d’une bonne vingtaine de pages. Les contributeurs sont nombreux, cependant un bon tiers du livre a été co-écrit par Alain Ruscio et Roland Laffitte, ce qui indique que le domaine de recherche est principalement historique et c’est de là que viennent de nombreux réemplois, car on ne saurait écrire une telle somme sans s’appuyer sur les travaux antérieurs des spécialistes ; en sorte que le livre constitue aussi une sorte de copieuse bibliographie, dans laquelle les lecteurs et lectrices pourront puiser selon leurs besoins ou leurs centres d’intérêt.
Ces « regards sur l’islam » commencent même plus tôt qu’il n’est indiqué dans le titre, puisque, avant les Croisades, il y est question de Charles Martel (et donc de la date mythique de 732) et aussi de Charlemagne à travers Roncevaux et la Chanson de Roland. Le travail sur ces périodes lointaines consiste forcément à distinguer l’histoire de la légende, cependant c’est un travail qui continue bien au-delà du Moyen-Âge, tant il est vrai qu’à partir du moment où il s’agit de « regards sur », la place et l’importance de l’idéologie y sont considérables et l’emportent souvent de très loin sur le souci de la vérité. Le livre suivant à peu près l’ordre chronologique est amené à considérer avec soin l’apport des penseurs du 18e siècle, dont on sait à quel point ils se sont attaqués à la pensée auparavant dominante, qui était globalement hostile à l’islam ou plutôt à tous ceux en lesquels il s’incarnait, c’est-à-dire en fait au très petit nombre de ceux qu’on connaissait ou plutôt qu’on croyait connaître : pendant des siècles on les a appelés les Sarrazins, après quoi sont apparus les noms de Barbares, en tant qu’habitants de la Barbarie (plus ou moins notre Maghreb actuel, vu surtout à partir de ses côtes méditerranéennes) et de Barbaresques, en usage pendant deux ou trois siècles (notamment le 17e siècle) pour désigner les pirates qui sévissaient en Méditerranée, s’emparant d’un butin en marchandises et en hommes prélevé sur les flottes des Européens. À la fin du 18e siècle, la piraterie barbaresque semble en régression sans doute parce que moins rentable économiquement que d’autres types d’activité, mais elle n’en est que davantage invoquée pour justifier ce qui va devenir bientôt la colonisation.
Avant qu’on n’en arrive là, les philosophes à la manière de Voltaire se sont beaucoup intéressés à l’islam et le résultat de leurs investigations n’est certes pas négligeable, mais il faut bien dire que leur but était souvent tout autre que la pure connaissance, il s’agissait de s’en prendre au catholicisme des dévots que le mot « fanatisme » désignait et dénonçait, alors même qu’en apparence, il s’agissait des Mahométans. Le personnage du Prophète n’a pas manqué d’intéresser en dehors même de la religion qui s’est propagée en son nom, il a même suscité des admirations, cependant il semble que majoritairement on ait employé pour le désigner le mot « imposteur » dont l’usage lui était pratiquement réservé.
Le livre fait aussi une place importante à un événement historique par lequel on passe de la réflexion à l’action : il s’agit de l’Expédition d’Égypte menée par Bonaparte qui deviendra Napoléon et dont les propos à l’égard de l’islam sont d’une remarquable ambiguïté : il y est beaucoup question de rapprochement des cultures et des civilisations et de tolérance à l’égard de l’autre, alors que dans les faits ce rapprochement a été beaucoup plus brutal et beaucoup moins glorieux,—sans qu’on puisse mettre la conquête coloniale en continuité directe avec cet épisode singulier.
La colonisation trouve alors sa place dans le livre d’Alain Ruscio, sous la forme de quelques études monographiques consacrées principalement à l’Algérie, à l’exception d’un dernier article qui analyse la propagation (parfois fulgurante) de l’islam dans l’Afrique subsaharienne, où la conquête semble avoir été non seulement odieuse comme on sait mais aussi particulièrement maladroite. Les études de détail sont forcément factuelles, elles montrent cependant à chaque fois la complexité de la situation coloniale qui confronte le modèle français voire ses ambitions universalistes avec les particularités (c’est un euphémisme) que le parti colonial juge nécessaires et indispensables à son maintien dans les lieux.
D’un côté donc, les manifestations d’un pragmatisme brutal et de l’autre une attirance beaucoup plus rare quoique non exceptionnelle pour un islam de type mystique (à dominante soufie) dont le livre donne des exemples, à partir du chapitre collectif (six auteurs) à multiples entrées, consacré aux conversions d’Européens alors même qu’on est encore en pleine période coloniale.
Le livre en tout cas, vu dans sa totalité, fait comprendre qu’on ne peut parler de ces « regards français sur l’islam » sans convoquer des concepts ambigus et complexes comme celui d’amour-haine, nécessitant le concours de diverses sciences humaines venant à la rescousse des historiens.