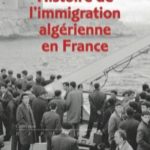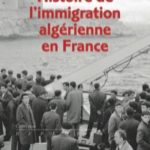« Marseille 73 ». Interview de Dominique Manotti sur Arte.
Marseille 73. Une histoire française, de Dominique Manotti.
 La France connaît une série d’assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d’entre eux sont abattus, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C’est l’histoire vraie.
Onze ans après la fin de la guerre d’Algérie, les nervis de l’OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans l’appareil d’État et dans la police, le Front national vient à peine d’éclore. Des revanchards appellent à plastiquer les mosquées, les bistrots, les commerces arabes.
C’est le décor.
Le jeune commissaire Daquin, vingt-sept ans, a été fraîchement nommé à l’Évêché, l’hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions, où tout se sait et rien ne sort. C’est notre héros.
Tout est prêt pour la tragédie, menée de main de maître par Dominique Manotti, avec cette écriture sèche, documentée et implacable qui a fait sa renommée. Un roman noir d’anthologie à mettre entre toutes les mains, pour ne pas oublier.
La France connaît une série d’assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d’entre eux sont abattus, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C’est l’histoire vraie.
Onze ans après la fin de la guerre d’Algérie, les nervis de l’OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans l’appareil d’État et dans la police, le Front national vient à peine d’éclore. Des revanchards appellent à plastiquer les mosquées, les bistrots, les commerces arabes.
C’est le décor.
Le jeune commissaire Daquin, vingt-sept ans, a été fraîchement nommé à l’Évêché, l’hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions, où tout se sait et rien ne sort. C’est notre héros.
Tout est prêt pour la tragédie, menée de main de maître par Dominique Manotti, avec cette écriture sèche, documentée et implacable qui a fait sa renommée. Un roman noir d’anthologie à mettre entre toutes les mains, pour ne pas oublier.
Arabicides. Une chronique française 1970-1991, de Fausto Giudice.
Force est de le constater : on a pu, dans la France de l’après-68, tuer impunément des Arabes. Souvent traité par la justice comme un « accident du travail » ou de la circulation, l’arabicide a bénéficié d’une jurisprudence de fait le transformant en simple délit. Cause première des révoltes des « Beurs », puis de l’embrasement des banlieues, la banalisation des arabicides est l’aspect le plus dur de la « question de l’immigration ».
 Il fallait enquêter sur ces « gestes obscurs » qui jettent une lumière crue sur la société française, les extraire de la chronique lassante et répétitive des faits divers pour leur donner un statut. En reconstituant cette longue série de meurtres d’Arabes, plus de deux cents en vingt ans, Fausto Giudice a cherché à en élucider les ressorts, les suites et les implications. La chronique commence en 1971 avec le meurtre du jeune Algérien Djilali Ben Ali à la Goutte-d’Or. Elle s’achève près d’Angoulème, par la mort commune de Mustapha Assouana jeune français musulman et Mohamed Daoudi, jeune marocain, en 1991. Entre ces deux dates, se déroule une dramaturgie aux nombreux acteurs, reconstituée par l’auteur.
Comment et pourquoi l’arabicide s’est-il à ce point banalisé ? Fausto Giudice propose une réponse : la Ve République repose sur un crime fondateur, l’arabicide de masse, commis tout au long de la guerre d’Algérie, jusque dans les rues de Paris. Ses auteurs et ses responsables ont bénéficié d’une impunité totale, par le jeu des amnisties. Ce fut là le plus formidable encouragement à répéter en temps de paix, sur une échelle réduite, ce que militaires, policiers et « simples particuliers » avaient fait en temps de guerre.
Il fallait enquêter sur ces « gestes obscurs » qui jettent une lumière crue sur la société française, les extraire de la chronique lassante et répétitive des faits divers pour leur donner un statut. En reconstituant cette longue série de meurtres d’Arabes, plus de deux cents en vingt ans, Fausto Giudice a cherché à en élucider les ressorts, les suites et les implications. La chronique commence en 1971 avec le meurtre du jeune Algérien Djilali Ben Ali à la Goutte-d’Or. Elle s’achève près d’Angoulème, par la mort commune de Mustapha Assouana jeune français musulman et Mohamed Daoudi, jeune marocain, en 1991. Entre ces deux dates, se déroule une dramaturgie aux nombreux acteurs, reconstituée par l’auteur.
Comment et pourquoi l’arabicide s’est-il à ce point banalisé ? Fausto Giudice propose une réponse : la Ve République repose sur un crime fondateur, l’arabicide de masse, commis tout au long de la guerre d’Algérie, jusque dans les rues de Paris. Ses auteurs et ses responsables ont bénéficié d’une impunité totale, par le jeu des amnisties. Ce fut là le plus formidable encouragement à répéter en temps de paix, sur une échelle réduite, ce que militaires, policiers et « simples particuliers » avaient fait en temps de guerre.
L’historien Emmanuel Blanchard :
 Spécialiste de la police, de sa sociologie comme de son histoire, notamment du maintien de l’ordre en situation coloniale, Emmanuel Blanchard est chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip, sous tutelle du Cnrs mais aussi du ministère de la justice).
Maître de conférences à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, il vient de publier, avec trois autres historiens, une Histoire des polices en France : des guerres de religion à nos jours (éditions Belin). Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Crime, histoire & sociétés. Emmanuel Blanchard explique combien la focalisation des forces de l’ordre sur des profils ethno-raciaux plonge dans le passé colonial français. Mais pas seulement. Entretien.
Pascale Pascariello : La mobilisation mondiale suscitée par la mort de George Floyd a relancé en France le débat sur les pratiques discriminatoires et les violences policières. Peut-on qualifier la police française de raciste ?
Emmanuel Blanchard : Cette question entraîne des crispations, voire des mobilisations de policiers qui refusent de se voir taxer de racisme, que leur travail soit qualifié par un délit pénal. C’est une étiquette politique infamante aujourd’hui : même l’extrême droite parlementaire refuse d’être labellisée « raciste ». De l’autre côté, on comprend que les victimes de violences policières ou les proches de personnes tuées par la police considèrent que le racisme peut être un facteur important du contexte qui a conduit à ces illégalismes et ces violences.
Spécialiste de la police, de sa sociologie comme de son histoire, notamment du maintien de l’ordre en situation coloniale, Emmanuel Blanchard est chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip, sous tutelle du Cnrs mais aussi du ministère de la justice).
Maître de conférences à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, il vient de publier, avec trois autres historiens, une Histoire des polices en France : des guerres de religion à nos jours (éditions Belin). Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Crime, histoire & sociétés. Emmanuel Blanchard explique combien la focalisation des forces de l’ordre sur des profils ethno-raciaux plonge dans le passé colonial français. Mais pas seulement. Entretien.
Pascale Pascariello : La mobilisation mondiale suscitée par la mort de George Floyd a relancé en France le débat sur les pratiques discriminatoires et les violences policières. Peut-on qualifier la police française de raciste ?
Emmanuel Blanchard : Cette question entraîne des crispations, voire des mobilisations de policiers qui refusent de se voir taxer de racisme, que leur travail soit qualifié par un délit pénal. C’est une étiquette politique infamante aujourd’hui : même l’extrême droite parlementaire refuse d’être labellisée « raciste ». De l’autre côté, on comprend que les victimes de violences policières ou les proches de personnes tuées par la police considèrent que le racisme peut être un facteur important du contexte qui a conduit à ces illégalismes et ces violences.
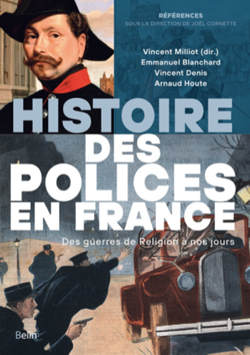 Mais votre question est complexe : pour répondre par l’affirmative, suffit-il que le racisme soit une opinion individuelle ? À l’inverse, y a-t-il besoin que les policiers soient explicitement racistes pour qu’un certain nombre de pratiques soient possiblement racistes ? Selon un récent avis du Défenseur des droits, on peut dire qu’il existe des discriminations systémiques qui conduisent à ce que des fractions de la population soient plus ciblées par des pratiques policières considérées comme routinières, qui ciblent de fait des personnes en fonction de leur genre (des hommes), de leur âge (jeune), mais aussi de leur apparence ethno-raciale, des personnes noires de peau ou « de type nord-africain », dans le vocabulaire couramment utilisé au sein de l’institution policière.
Au-delà des opinions, des préférences et des expressions individuelles d’un certain nombre de policiers, l’institution a une histoire qui la conduit à avoir une emprise différenciée sur les habitants de ce pays, en fonction de leur historie nationale ou de leur appartenance ethno-raciale.
Aux États-Unis, dans de larges parties de la population, il y a une relative acceptation du fait qu’il y aurait un racisme institutionnel dans la police. L’expression de « racisme institutionnel » peut y être relativement consensuelle, en raison du rôle que les polices modernes émergentes ont joué à partir du début du XIXe siècle dans le maintien de l’esclavage et surtout dans la politique ségrégationniste qui a duré jusqu’aux années 1960.
En France, si on a recours à l’histoire (une histoire des pratiques de police qui n’est pas celle des États-Unis, qui ne plonge pas dans le même passé et n’aboutit pas au même degré de violence), il y a néanmoins des moments importants dans la constitution des polices modernes (et j’englobe les forces de gendarmerie) depuis le milieu du XIXe siècle, en métropole et aux colonies, où les pratiques de police ont été racialisées. C’est-à-dire que des personnes définies en fonction de leur apparence ethno-raciale étaient considérées comme a priori suspectes ou devant être contrôlées de manière plus systématique.
Au XVIIIe siècle, il existait, en France, une « police des Noirs » pour contrôler les esclaves qui arrivaient en métropole, où ils n’avaient plus la condition d’esclaves mais faisaient l’objet de contrôles spécifiques. L’histoire de France, en particulier celle de l’empire colonial, est aussi une histoire des mises en esclavage, une histoire des abolitions, mais des abolitions qui ont entraîné des retours à des formes de travail forcé ou de contrôle de la mobilité.
Par exemple, durant le second XIXe siècle, dans les Antilles françaises, après l’abolition de l’esclavage, les forces de police sont amenées à contrôler la mobilité des Noirs qui sont considérés en état de vagabondage dès qu’ils s’éloignent de leur ancienne habitation ou plantation (pour reprendre les termes de l’époque). Et c’est très important puisque cela explique pourquoi les conflits du travail aux Antilles sont réprimés avec beaucoup plus de force qu’ils ne le sont en métropole. On peut penser au mouvement de mai 1967 en Guadeloupe, par exemple.
Mais cette focalisation des forces de police sur des personnes définies par leur profil ethno-racial ne plonge pas simplement dans le passé colonial. La grande loi qui a donné des modalités de contrôle offrant aux policiers la possibilité de traiter toute une partie de la population comme a priori suspecte, c’est la loi de 1912, qui impose un carnet anthropométrique aux populations dites nomades : les gitans et tsiganes, notamment. Pour les policiers et les gendarmes, c’est bien l’apparence et le mode de vie de ces personnes qui les érigent en suspectes. On criminalise une population en donnant aux force de police une possibilité de les traiter comme toujours « déjà suspectes ».
Ce sont des processus qui vont se répéter dans les années 1930, par exemple, avec la police des étrangers, lorsque va se mettre en place une politique d’immigration visant à l’expulsion des « indésirables ». Depuis le milieu des années 1920, les populations dites nord-africaines font l’objet de surveillance et d’un fichage policier spécifique avec la création d’une brigade nord-africaine. Il est évident que ce type de police se fait sur des formes de profilage ethno-racial qui empruntent largement aux stéréotypes négatifs qui circulent à l’époque. Les étrangers dits indésirables étaient alors surtout des réfugiés juifs, ciblés en raison aussi de l’importance de l’antisémitisme.
La police n’est cependant pas simplement touchée par la montée de la xénophobie et de l’antisémitisme qui aurait marqué l’opinion des personnels de police ; elle est aussi prise dans des dispositions et des institutions qui la conduisent à activer ces stéréotypes, sinon racistes, du moins racialisants.
Vous évoquez le récent rapport du Défenseur des droits qui constate que certains jeunes sont ciblés systématiquement par des contrôles de police…
On peut dire que dans le mandat d’un policier, il y a la possibilité de faire valoir qui est français et qui ne l’est pas. Autrement dit : le contrôle d’identité permet à la fois administrativement et symboliquement de faire vivre la catégorie de Français, qui, au quotidien, n’est donc pas seulement définie juridiquement.
Mais votre question est complexe : pour répondre par l’affirmative, suffit-il que le racisme soit une opinion individuelle ? À l’inverse, y a-t-il besoin que les policiers soient explicitement racistes pour qu’un certain nombre de pratiques soient possiblement racistes ? Selon un récent avis du Défenseur des droits, on peut dire qu’il existe des discriminations systémiques qui conduisent à ce que des fractions de la population soient plus ciblées par des pratiques policières considérées comme routinières, qui ciblent de fait des personnes en fonction de leur genre (des hommes), de leur âge (jeune), mais aussi de leur apparence ethno-raciale, des personnes noires de peau ou « de type nord-africain », dans le vocabulaire couramment utilisé au sein de l’institution policière.
Au-delà des opinions, des préférences et des expressions individuelles d’un certain nombre de policiers, l’institution a une histoire qui la conduit à avoir une emprise différenciée sur les habitants de ce pays, en fonction de leur historie nationale ou de leur appartenance ethno-raciale.
Aux États-Unis, dans de larges parties de la population, il y a une relative acceptation du fait qu’il y aurait un racisme institutionnel dans la police. L’expression de « racisme institutionnel » peut y être relativement consensuelle, en raison du rôle que les polices modernes émergentes ont joué à partir du début du XIXe siècle dans le maintien de l’esclavage et surtout dans la politique ségrégationniste qui a duré jusqu’aux années 1960.
En France, si on a recours à l’histoire (une histoire des pratiques de police qui n’est pas celle des États-Unis, qui ne plonge pas dans le même passé et n’aboutit pas au même degré de violence), il y a néanmoins des moments importants dans la constitution des polices modernes (et j’englobe les forces de gendarmerie) depuis le milieu du XIXe siècle, en métropole et aux colonies, où les pratiques de police ont été racialisées. C’est-à-dire que des personnes définies en fonction de leur apparence ethno-raciale étaient considérées comme a priori suspectes ou devant être contrôlées de manière plus systématique.
Au XVIIIe siècle, il existait, en France, une « police des Noirs » pour contrôler les esclaves qui arrivaient en métropole, où ils n’avaient plus la condition d’esclaves mais faisaient l’objet de contrôles spécifiques. L’histoire de France, en particulier celle de l’empire colonial, est aussi une histoire des mises en esclavage, une histoire des abolitions, mais des abolitions qui ont entraîné des retours à des formes de travail forcé ou de contrôle de la mobilité.
Par exemple, durant le second XIXe siècle, dans les Antilles françaises, après l’abolition de l’esclavage, les forces de police sont amenées à contrôler la mobilité des Noirs qui sont considérés en état de vagabondage dès qu’ils s’éloignent de leur ancienne habitation ou plantation (pour reprendre les termes de l’époque). Et c’est très important puisque cela explique pourquoi les conflits du travail aux Antilles sont réprimés avec beaucoup plus de force qu’ils ne le sont en métropole. On peut penser au mouvement de mai 1967 en Guadeloupe, par exemple.
Mais cette focalisation des forces de police sur des personnes définies par leur profil ethno-racial ne plonge pas simplement dans le passé colonial. La grande loi qui a donné des modalités de contrôle offrant aux policiers la possibilité de traiter toute une partie de la population comme a priori suspecte, c’est la loi de 1912, qui impose un carnet anthropométrique aux populations dites nomades : les gitans et tsiganes, notamment. Pour les policiers et les gendarmes, c’est bien l’apparence et le mode de vie de ces personnes qui les érigent en suspectes. On criminalise une population en donnant aux force de police une possibilité de les traiter comme toujours « déjà suspectes ».
Ce sont des processus qui vont se répéter dans les années 1930, par exemple, avec la police des étrangers, lorsque va se mettre en place une politique d’immigration visant à l’expulsion des « indésirables ». Depuis le milieu des années 1920, les populations dites nord-africaines font l’objet de surveillance et d’un fichage policier spécifique avec la création d’une brigade nord-africaine. Il est évident que ce type de police se fait sur des formes de profilage ethno-racial qui empruntent largement aux stéréotypes négatifs qui circulent à l’époque. Les étrangers dits indésirables étaient alors surtout des réfugiés juifs, ciblés en raison aussi de l’importance de l’antisémitisme.
La police n’est cependant pas simplement touchée par la montée de la xénophobie et de l’antisémitisme qui aurait marqué l’opinion des personnels de police ; elle est aussi prise dans des dispositions et des institutions qui la conduisent à activer ces stéréotypes, sinon racistes, du moins racialisants.
Vous évoquez le récent rapport du Défenseur des droits qui constate que certains jeunes sont ciblés systématiquement par des contrôles de police…
On peut dire que dans le mandat d’un policier, il y a la possibilité de faire valoir qui est français et qui ne l’est pas. Autrement dit : le contrôle d’identité permet à la fois administrativement et symboliquement de faire vivre la catégorie de Français, qui, au quotidien, n’est donc pas seulement définie juridiquement.
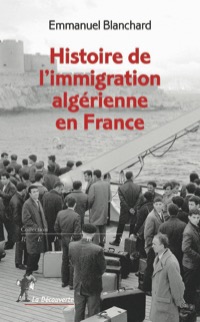 Il faut se souvenir que la carte nationale d’identité a été créée en 1955 dans le contexte de la guerre d’indépendance algérienne. Il devenait important de pouvoir contrôler les Français, notamment parce que la question de la mobilité des Français musulmans d’Algérie posait problème. Et que cette question va devenir encore plus sensible après l’indépendance algérienne, où cette même police qui a été ciblée par les attentats du FLN et a perpétré le massacre du 17 octobre 1961 est amenée à contrôler les anciens Français musulmans, afin de déterminer qui sont ceux restés français et qui sont ceux devenus algériens…, avec l’idée que ces derniers sont devenus indésirables et doivent donc être expulsés. Sauf si leur utilité économique est attestée par un employeur.
À cette époque, il y a un véritable flou sur la nationalité des personnes et notamment celle des enfants d’immigrés algériens nés en métropole. Ce qui va conduire la police à continuer après 1962 la politique de contrôle au faciès qu’elle avait pratiquée pendant la guerre d’Algérie. Et c’est dans cette histoire-là que s’est construit ce rapport si spécifique de la police française au contrôle d’identité.
Le contrôle d’identité, ça va être la justification pour faire peser un soupçon proprement politique sur certaines personnes. Cela peut être un soupçon symbolique : faire ressentir aux personnes que même si on connaît leur nom, même si on sait qu’elles sont françaises, il est possible de leur demander d’exhiber leurs papiers.
De plus, le contrôle d’identité va très souvent s’accompagner de violences, qui commencent avec les palpations et autres emprises sur les corps, quand ces personnes font justement partie de ce que les policiers appellent leur « clientèle », c’est-à-dire les jeunes hommes des quartiers populaires, dont une grande partie est aussi désignée par son apparence ethno-raciale.
Quelles sont les spécificités françaises ?
Les policiers britanniques ou allemands, deux pays proches, sont littéralement estomaqués quand ils voient comment le contrôle d’identité est pratiqué en France d’une façon routinière, comme la manière d’entrer en relation avec les habitants d’un certain nombre de quartiers.
Les polices française et britannique n’ont pas la même histoire, mais elles ont partagé une histoire coloniale, d’immigration. Si elles ne sont pas semblables, il y a donc des points de comparaison, des situations contemporaines qui sont comparables d’une certaine façon. Le passé colonial anglais ne passe pas très bien non plus. Mais cela n’a pas empêché les forces de police d’avoir une réflexion et que des réformes prennent en charge cette question : comment avoir une police qui soit moins systématiquement discriminatoire ?
Il faut se souvenir que la carte nationale d’identité a été créée en 1955 dans le contexte de la guerre d’indépendance algérienne. Il devenait important de pouvoir contrôler les Français, notamment parce que la question de la mobilité des Français musulmans d’Algérie posait problème. Et que cette question va devenir encore plus sensible après l’indépendance algérienne, où cette même police qui a été ciblée par les attentats du FLN et a perpétré le massacre du 17 octobre 1961 est amenée à contrôler les anciens Français musulmans, afin de déterminer qui sont ceux restés français et qui sont ceux devenus algériens…, avec l’idée que ces derniers sont devenus indésirables et doivent donc être expulsés. Sauf si leur utilité économique est attestée par un employeur.
À cette époque, il y a un véritable flou sur la nationalité des personnes et notamment celle des enfants d’immigrés algériens nés en métropole. Ce qui va conduire la police à continuer après 1962 la politique de contrôle au faciès qu’elle avait pratiquée pendant la guerre d’Algérie. Et c’est dans cette histoire-là que s’est construit ce rapport si spécifique de la police française au contrôle d’identité.
Le contrôle d’identité, ça va être la justification pour faire peser un soupçon proprement politique sur certaines personnes. Cela peut être un soupçon symbolique : faire ressentir aux personnes que même si on connaît leur nom, même si on sait qu’elles sont françaises, il est possible de leur demander d’exhiber leurs papiers.
De plus, le contrôle d’identité va très souvent s’accompagner de violences, qui commencent avec les palpations et autres emprises sur les corps, quand ces personnes font justement partie de ce que les policiers appellent leur « clientèle », c’est-à-dire les jeunes hommes des quartiers populaires, dont une grande partie est aussi désignée par son apparence ethno-raciale.
Quelles sont les spécificités françaises ?
Les policiers britanniques ou allemands, deux pays proches, sont littéralement estomaqués quand ils voient comment le contrôle d’identité est pratiqué en France d’une façon routinière, comme la manière d’entrer en relation avec les habitants d’un certain nombre de quartiers.
Les polices française et britannique n’ont pas la même histoire, mais elles ont partagé une histoire coloniale, d’immigration. Si elles ne sont pas semblables, il y a donc des points de comparaison, des situations contemporaines qui sont comparables d’une certaine façon. Le passé colonial anglais ne passe pas très bien non plus. Mais cela n’a pas empêché les forces de police d’avoir une réflexion et que des réformes prennent en charge cette question : comment avoir une police qui soit moins systématiquement discriminatoire ?

Marche contre les violences policières à Beaumont-sur-Oise le 20 juillet 2019 © Sophie Garcia (Hans Lucas via AFP).
Marche contre les violences policières à Beaumont-sur-Oise le 20 juillet 2019 © Sophie Garcia (Hans Lucas via AFP).
Marseille 73. Une histoire française, de Dominique Manotti.
(Les Arènes, 2020)
 La France connaît une série d’assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d’entre eux sont abattus, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C’est l’histoire vraie.
Onze ans après la fin de la guerre d’Algérie, les nervis de l’OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans l’appareil d’État et dans la police, le Front national vient à peine d’éclore. Des revanchards appellent à plastiquer les mosquées, les bistrots, les commerces arabes.
C’est le décor.
Le jeune commissaire Daquin, vingt-sept ans, a été fraîchement nommé à l’Évêché, l’hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions, où tout se sait et rien ne sort. C’est notre héros.
Tout est prêt pour la tragédie, menée de main de maître par Dominique Manotti, avec cette écriture sèche, documentée et implacable qui a fait sa renommée. Un roman noir d’anthologie à mettre entre toutes les mains, pour ne pas oublier.
La France connaît une série d’assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d’entre eux sont abattus, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C’est l’histoire vraie.
Onze ans après la fin de la guerre d’Algérie, les nervis de l’OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans l’appareil d’État et dans la police, le Front national vient à peine d’éclore. Des revanchards appellent à plastiquer les mosquées, les bistrots, les commerces arabes.
C’est le décor.
Le jeune commissaire Daquin, vingt-sept ans, a été fraîchement nommé à l’Évêché, l’hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions, où tout se sait et rien ne sort. C’est notre héros.
Tout est prêt pour la tragédie, menée de main de maître par Dominique Manotti, avec cette écriture sèche, documentée et implacable qui a fait sa renommée. Un roman noir d’anthologie à mettre entre toutes les mains, pour ne pas oublier.
Arabicides. Une chronique française 1970-1991, de Fausto Giudice.
(La Découverte, 1992)
Force est de le constater : on a pu, dans la France de l’après-68, tuer impunément des Arabes. Souvent traité par la justice comme un « accident du travail » ou de la circulation, l’arabicide a bénéficié d’une jurisprudence de fait le transformant en simple délit. Cause première des révoltes des « Beurs », puis de l’embrasement des banlieues, la banalisation des arabicides est l’aspect le plus dur de la « question de l’immigration ».
 Il fallait enquêter sur ces « gestes obscurs » qui jettent une lumière crue sur la société française, les extraire de la chronique lassante et répétitive des faits divers pour leur donner un statut. En reconstituant cette longue série de meurtres d’Arabes, plus de deux cents en vingt ans, Fausto Giudice a cherché à en élucider les ressorts, les suites et les implications. La chronique commence en 1971 avec le meurtre du jeune Algérien Djilali Ben Ali à la Goutte-d’Or. Elle s’achève près d’Angoulème, par la mort commune de Mustapha Assouana jeune français musulman et Mohamed Daoudi, jeune marocain, en 1991. Entre ces deux dates, se déroule une dramaturgie aux nombreux acteurs, reconstituée par l’auteur.
Comment et pourquoi l’arabicide s’est-il à ce point banalisé ? Fausto Giudice propose une réponse : la Ve République repose sur un crime fondateur, l’arabicide de masse, commis tout au long de la guerre d’Algérie, jusque dans les rues de Paris. Ses auteurs et ses responsables ont bénéficié d’une impunité totale, par le jeu des amnisties. Ce fut là le plus formidable encouragement à répéter en temps de paix, sur une échelle réduite, ce que militaires, policiers et « simples particuliers » avaient fait en temps de guerre.
Il fallait enquêter sur ces « gestes obscurs » qui jettent une lumière crue sur la société française, les extraire de la chronique lassante et répétitive des faits divers pour leur donner un statut. En reconstituant cette longue série de meurtres d’Arabes, plus de deux cents en vingt ans, Fausto Giudice a cherché à en élucider les ressorts, les suites et les implications. La chronique commence en 1971 avec le meurtre du jeune Algérien Djilali Ben Ali à la Goutte-d’Or. Elle s’achève près d’Angoulème, par la mort commune de Mustapha Assouana jeune français musulman et Mohamed Daoudi, jeune marocain, en 1991. Entre ces deux dates, se déroule une dramaturgie aux nombreux acteurs, reconstituée par l’auteur.
Comment et pourquoi l’arabicide s’est-il à ce point banalisé ? Fausto Giudice propose une réponse : la Ve République repose sur un crime fondateur, l’arabicide de masse, commis tout au long de la guerre d’Algérie, jusque dans les rues de Paris. Ses auteurs et ses responsables ont bénéficié d’une impunité totale, par le jeu des amnisties. Ce fut là le plus formidable encouragement à répéter en temps de paix, sur une échelle réduite, ce que militaires, policiers et « simples particuliers » avaient fait en temps de guerre.
L’historien Emmanuel Blanchard :
« Les pratiques de police ont été racialisées »
 Spécialiste de la police, de sa sociologie comme de son histoire, notamment du maintien de l’ordre en situation coloniale, Emmanuel Blanchard est chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip, sous tutelle du Cnrs mais aussi du ministère de la justice).
Maître de conférences à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, il vient de publier, avec trois autres historiens, une Histoire des polices en France : des guerres de religion à nos jours (éditions Belin). Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Crime, histoire & sociétés. Emmanuel Blanchard explique combien la focalisation des forces de l’ordre sur des profils ethno-raciaux plonge dans le passé colonial français. Mais pas seulement. Entretien.
Pascale Pascariello : La mobilisation mondiale suscitée par la mort de George Floyd a relancé en France le débat sur les pratiques discriminatoires et les violences policières. Peut-on qualifier la police française de raciste ?
Emmanuel Blanchard : Cette question entraîne des crispations, voire des mobilisations de policiers qui refusent de se voir taxer de racisme, que leur travail soit qualifié par un délit pénal. C’est une étiquette politique infamante aujourd’hui : même l’extrême droite parlementaire refuse d’être labellisée « raciste ». De l’autre côté, on comprend que les victimes de violences policières ou les proches de personnes tuées par la police considèrent que le racisme peut être un facteur important du contexte qui a conduit à ces illégalismes et ces violences.
Spécialiste de la police, de sa sociologie comme de son histoire, notamment du maintien de l’ordre en situation coloniale, Emmanuel Blanchard est chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip, sous tutelle du Cnrs mais aussi du ministère de la justice).
Maître de conférences à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, il vient de publier, avec trois autres historiens, une Histoire des polices en France : des guerres de religion à nos jours (éditions Belin). Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Crime, histoire & sociétés. Emmanuel Blanchard explique combien la focalisation des forces de l’ordre sur des profils ethno-raciaux plonge dans le passé colonial français. Mais pas seulement. Entretien.
Pascale Pascariello : La mobilisation mondiale suscitée par la mort de George Floyd a relancé en France le débat sur les pratiques discriminatoires et les violences policières. Peut-on qualifier la police française de raciste ?
Emmanuel Blanchard : Cette question entraîne des crispations, voire des mobilisations de policiers qui refusent de se voir taxer de racisme, que leur travail soit qualifié par un délit pénal. C’est une étiquette politique infamante aujourd’hui : même l’extrême droite parlementaire refuse d’être labellisée « raciste ». De l’autre côté, on comprend que les victimes de violences policières ou les proches de personnes tuées par la police considèrent que le racisme peut être un facteur important du contexte qui a conduit à ces illégalismes et ces violences.
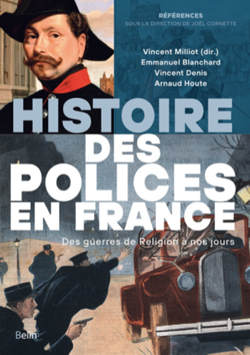 Mais votre question est complexe : pour répondre par l’affirmative, suffit-il que le racisme soit une opinion individuelle ? À l’inverse, y a-t-il besoin que les policiers soient explicitement racistes pour qu’un certain nombre de pratiques soient possiblement racistes ? Selon un récent avis du Défenseur des droits, on peut dire qu’il existe des discriminations systémiques qui conduisent à ce que des fractions de la population soient plus ciblées par des pratiques policières considérées comme routinières, qui ciblent de fait des personnes en fonction de leur genre (des hommes), de leur âge (jeune), mais aussi de leur apparence ethno-raciale, des personnes noires de peau ou « de type nord-africain », dans le vocabulaire couramment utilisé au sein de l’institution policière.
Au-delà des opinions, des préférences et des expressions individuelles d’un certain nombre de policiers, l’institution a une histoire qui la conduit à avoir une emprise différenciée sur les habitants de ce pays, en fonction de leur historie nationale ou de leur appartenance ethno-raciale.
Aux États-Unis, dans de larges parties de la population, il y a une relative acceptation du fait qu’il y aurait un racisme institutionnel dans la police. L’expression de « racisme institutionnel » peut y être relativement consensuelle, en raison du rôle que les polices modernes émergentes ont joué à partir du début du XIXe siècle dans le maintien de l’esclavage et surtout dans la politique ségrégationniste qui a duré jusqu’aux années 1960.
En France, si on a recours à l’histoire (une histoire des pratiques de police qui n’est pas celle des États-Unis, qui ne plonge pas dans le même passé et n’aboutit pas au même degré de violence), il y a néanmoins des moments importants dans la constitution des polices modernes (et j’englobe les forces de gendarmerie) depuis le milieu du XIXe siècle, en métropole et aux colonies, où les pratiques de police ont été racialisées. C’est-à-dire que des personnes définies en fonction de leur apparence ethno-raciale étaient considérées comme a priori suspectes ou devant être contrôlées de manière plus systématique.
Au XVIIIe siècle, il existait, en France, une « police des Noirs » pour contrôler les esclaves qui arrivaient en métropole, où ils n’avaient plus la condition d’esclaves mais faisaient l’objet de contrôles spécifiques. L’histoire de France, en particulier celle de l’empire colonial, est aussi une histoire des mises en esclavage, une histoire des abolitions, mais des abolitions qui ont entraîné des retours à des formes de travail forcé ou de contrôle de la mobilité.
Par exemple, durant le second XIXe siècle, dans les Antilles françaises, après l’abolition de l’esclavage, les forces de police sont amenées à contrôler la mobilité des Noirs qui sont considérés en état de vagabondage dès qu’ils s’éloignent de leur ancienne habitation ou plantation (pour reprendre les termes de l’époque). Et c’est très important puisque cela explique pourquoi les conflits du travail aux Antilles sont réprimés avec beaucoup plus de force qu’ils ne le sont en métropole. On peut penser au mouvement de mai 1967 en Guadeloupe, par exemple.
Mais cette focalisation des forces de police sur des personnes définies par leur profil ethno-racial ne plonge pas simplement dans le passé colonial. La grande loi qui a donné des modalités de contrôle offrant aux policiers la possibilité de traiter toute une partie de la population comme a priori suspecte, c’est la loi de 1912, qui impose un carnet anthropométrique aux populations dites nomades : les gitans et tsiganes, notamment. Pour les policiers et les gendarmes, c’est bien l’apparence et le mode de vie de ces personnes qui les érigent en suspectes. On criminalise une population en donnant aux force de police une possibilité de les traiter comme toujours « déjà suspectes ».
Ce sont des processus qui vont se répéter dans les années 1930, par exemple, avec la police des étrangers, lorsque va se mettre en place une politique d’immigration visant à l’expulsion des « indésirables ». Depuis le milieu des années 1920, les populations dites nord-africaines font l’objet de surveillance et d’un fichage policier spécifique avec la création d’une brigade nord-africaine. Il est évident que ce type de police se fait sur des formes de profilage ethno-racial qui empruntent largement aux stéréotypes négatifs qui circulent à l’époque. Les étrangers dits indésirables étaient alors surtout des réfugiés juifs, ciblés en raison aussi de l’importance de l’antisémitisme.
La police n’est cependant pas simplement touchée par la montée de la xénophobie et de l’antisémitisme qui aurait marqué l’opinion des personnels de police ; elle est aussi prise dans des dispositions et des institutions qui la conduisent à activer ces stéréotypes, sinon racistes, du moins racialisants.
Vous évoquez le récent rapport du Défenseur des droits qui constate que certains jeunes sont ciblés systématiquement par des contrôles de police…
On peut dire que dans le mandat d’un policier, il y a la possibilité de faire valoir qui est français et qui ne l’est pas. Autrement dit : le contrôle d’identité permet à la fois administrativement et symboliquement de faire vivre la catégorie de Français, qui, au quotidien, n’est donc pas seulement définie juridiquement.
Mais votre question est complexe : pour répondre par l’affirmative, suffit-il que le racisme soit une opinion individuelle ? À l’inverse, y a-t-il besoin que les policiers soient explicitement racistes pour qu’un certain nombre de pratiques soient possiblement racistes ? Selon un récent avis du Défenseur des droits, on peut dire qu’il existe des discriminations systémiques qui conduisent à ce que des fractions de la population soient plus ciblées par des pratiques policières considérées comme routinières, qui ciblent de fait des personnes en fonction de leur genre (des hommes), de leur âge (jeune), mais aussi de leur apparence ethno-raciale, des personnes noires de peau ou « de type nord-africain », dans le vocabulaire couramment utilisé au sein de l’institution policière.
Au-delà des opinions, des préférences et des expressions individuelles d’un certain nombre de policiers, l’institution a une histoire qui la conduit à avoir une emprise différenciée sur les habitants de ce pays, en fonction de leur historie nationale ou de leur appartenance ethno-raciale.
Aux États-Unis, dans de larges parties de la population, il y a une relative acceptation du fait qu’il y aurait un racisme institutionnel dans la police. L’expression de « racisme institutionnel » peut y être relativement consensuelle, en raison du rôle que les polices modernes émergentes ont joué à partir du début du XIXe siècle dans le maintien de l’esclavage et surtout dans la politique ségrégationniste qui a duré jusqu’aux années 1960.
En France, si on a recours à l’histoire (une histoire des pratiques de police qui n’est pas celle des États-Unis, qui ne plonge pas dans le même passé et n’aboutit pas au même degré de violence), il y a néanmoins des moments importants dans la constitution des polices modernes (et j’englobe les forces de gendarmerie) depuis le milieu du XIXe siècle, en métropole et aux colonies, où les pratiques de police ont été racialisées. C’est-à-dire que des personnes définies en fonction de leur apparence ethno-raciale étaient considérées comme a priori suspectes ou devant être contrôlées de manière plus systématique.
Au XVIIIe siècle, il existait, en France, une « police des Noirs » pour contrôler les esclaves qui arrivaient en métropole, où ils n’avaient plus la condition d’esclaves mais faisaient l’objet de contrôles spécifiques. L’histoire de France, en particulier celle de l’empire colonial, est aussi une histoire des mises en esclavage, une histoire des abolitions, mais des abolitions qui ont entraîné des retours à des formes de travail forcé ou de contrôle de la mobilité.
Par exemple, durant le second XIXe siècle, dans les Antilles françaises, après l’abolition de l’esclavage, les forces de police sont amenées à contrôler la mobilité des Noirs qui sont considérés en état de vagabondage dès qu’ils s’éloignent de leur ancienne habitation ou plantation (pour reprendre les termes de l’époque). Et c’est très important puisque cela explique pourquoi les conflits du travail aux Antilles sont réprimés avec beaucoup plus de force qu’ils ne le sont en métropole. On peut penser au mouvement de mai 1967 en Guadeloupe, par exemple.
Mais cette focalisation des forces de police sur des personnes définies par leur profil ethno-racial ne plonge pas simplement dans le passé colonial. La grande loi qui a donné des modalités de contrôle offrant aux policiers la possibilité de traiter toute une partie de la population comme a priori suspecte, c’est la loi de 1912, qui impose un carnet anthropométrique aux populations dites nomades : les gitans et tsiganes, notamment. Pour les policiers et les gendarmes, c’est bien l’apparence et le mode de vie de ces personnes qui les érigent en suspectes. On criminalise une population en donnant aux force de police une possibilité de les traiter comme toujours « déjà suspectes ».
Ce sont des processus qui vont se répéter dans les années 1930, par exemple, avec la police des étrangers, lorsque va se mettre en place une politique d’immigration visant à l’expulsion des « indésirables ». Depuis le milieu des années 1920, les populations dites nord-africaines font l’objet de surveillance et d’un fichage policier spécifique avec la création d’une brigade nord-africaine. Il est évident que ce type de police se fait sur des formes de profilage ethno-racial qui empruntent largement aux stéréotypes négatifs qui circulent à l’époque. Les étrangers dits indésirables étaient alors surtout des réfugiés juifs, ciblés en raison aussi de l’importance de l’antisémitisme.
La police n’est cependant pas simplement touchée par la montée de la xénophobie et de l’antisémitisme qui aurait marqué l’opinion des personnels de police ; elle est aussi prise dans des dispositions et des institutions qui la conduisent à activer ces stéréotypes, sinon racistes, du moins racialisants.
Vous évoquez le récent rapport du Défenseur des droits qui constate que certains jeunes sont ciblés systématiquement par des contrôles de police…
On peut dire que dans le mandat d’un policier, il y a la possibilité de faire valoir qui est français et qui ne l’est pas. Autrement dit : le contrôle d’identité permet à la fois administrativement et symboliquement de faire vivre la catégorie de Français, qui, au quotidien, n’est donc pas seulement définie juridiquement.
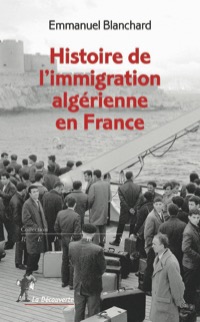 Il faut se souvenir que la carte nationale d’identité a été créée en 1955 dans le contexte de la guerre d’indépendance algérienne. Il devenait important de pouvoir contrôler les Français, notamment parce que la question de la mobilité des Français musulmans d’Algérie posait problème. Et que cette question va devenir encore plus sensible après l’indépendance algérienne, où cette même police qui a été ciblée par les attentats du FLN et a perpétré le massacre du 17 octobre 1961 est amenée à contrôler les anciens Français musulmans, afin de déterminer qui sont ceux restés français et qui sont ceux devenus algériens…, avec l’idée que ces derniers sont devenus indésirables et doivent donc être expulsés. Sauf si leur utilité économique est attestée par un employeur.
À cette époque, il y a un véritable flou sur la nationalité des personnes et notamment celle des enfants d’immigrés algériens nés en métropole. Ce qui va conduire la police à continuer après 1962 la politique de contrôle au faciès qu’elle avait pratiquée pendant la guerre d’Algérie. Et c’est dans cette histoire-là que s’est construit ce rapport si spécifique de la police française au contrôle d’identité.
Le contrôle d’identité, ça va être la justification pour faire peser un soupçon proprement politique sur certaines personnes. Cela peut être un soupçon symbolique : faire ressentir aux personnes que même si on connaît leur nom, même si on sait qu’elles sont françaises, il est possible de leur demander d’exhiber leurs papiers.
De plus, le contrôle d’identité va très souvent s’accompagner de violences, qui commencent avec les palpations et autres emprises sur les corps, quand ces personnes font justement partie de ce que les policiers appellent leur « clientèle », c’est-à-dire les jeunes hommes des quartiers populaires, dont une grande partie est aussi désignée par son apparence ethno-raciale.
Quelles sont les spécificités françaises ?
Les policiers britanniques ou allemands, deux pays proches, sont littéralement estomaqués quand ils voient comment le contrôle d’identité est pratiqué en France d’une façon routinière, comme la manière d’entrer en relation avec les habitants d’un certain nombre de quartiers.
Les polices française et britannique n’ont pas la même histoire, mais elles ont partagé une histoire coloniale, d’immigration. Si elles ne sont pas semblables, il y a donc des points de comparaison, des situations contemporaines qui sont comparables d’une certaine façon. Le passé colonial anglais ne passe pas très bien non plus. Mais cela n’a pas empêché les forces de police d’avoir une réflexion et que des réformes prennent en charge cette question : comment avoir une police qui soit moins systématiquement discriminatoire ?
Il faut se souvenir que la carte nationale d’identité a été créée en 1955 dans le contexte de la guerre d’indépendance algérienne. Il devenait important de pouvoir contrôler les Français, notamment parce que la question de la mobilité des Français musulmans d’Algérie posait problème. Et que cette question va devenir encore plus sensible après l’indépendance algérienne, où cette même police qui a été ciblée par les attentats du FLN et a perpétré le massacre du 17 octobre 1961 est amenée à contrôler les anciens Français musulmans, afin de déterminer qui sont ceux restés français et qui sont ceux devenus algériens…, avec l’idée que ces derniers sont devenus indésirables et doivent donc être expulsés. Sauf si leur utilité économique est attestée par un employeur.
À cette époque, il y a un véritable flou sur la nationalité des personnes et notamment celle des enfants d’immigrés algériens nés en métropole. Ce qui va conduire la police à continuer après 1962 la politique de contrôle au faciès qu’elle avait pratiquée pendant la guerre d’Algérie. Et c’est dans cette histoire-là que s’est construit ce rapport si spécifique de la police française au contrôle d’identité.
Le contrôle d’identité, ça va être la justification pour faire peser un soupçon proprement politique sur certaines personnes. Cela peut être un soupçon symbolique : faire ressentir aux personnes que même si on connaît leur nom, même si on sait qu’elles sont françaises, il est possible de leur demander d’exhiber leurs papiers.
De plus, le contrôle d’identité va très souvent s’accompagner de violences, qui commencent avec les palpations et autres emprises sur les corps, quand ces personnes font justement partie de ce que les policiers appellent leur « clientèle », c’est-à-dire les jeunes hommes des quartiers populaires, dont une grande partie est aussi désignée par son apparence ethno-raciale.
Quelles sont les spécificités françaises ?
Les policiers britanniques ou allemands, deux pays proches, sont littéralement estomaqués quand ils voient comment le contrôle d’identité est pratiqué en France d’une façon routinière, comme la manière d’entrer en relation avec les habitants d’un certain nombre de quartiers.
Les polices française et britannique n’ont pas la même histoire, mais elles ont partagé une histoire coloniale, d’immigration. Si elles ne sont pas semblables, il y a donc des points de comparaison, des situations contemporaines qui sont comparables d’une certaine façon. Le passé colonial anglais ne passe pas très bien non plus. Mais cela n’a pas empêché les forces de police d’avoir une réflexion et que des réformes prennent en charge cette question : comment avoir une police qui soit moins systématiquement discriminatoire ?