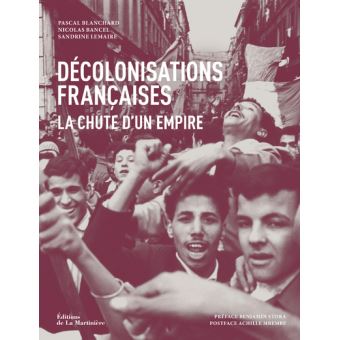Pourquoi a-t-on si peur des études postcoloniales en France ?
par Alain Mabanckou et Dominic Thomas, publié sur le site de l’Express le 16 janvier 2020 Source
La tribune à l’initiative de Laurent Bouvet et Pierre-André Taguieff.
Alain Mabanckou est écrivain, professeur de littératures française et francophone à l’Université de Californie-Los Angeles (UCLA).
Dernier ouvrage paru : Huit leçons sur l’Afrique, Grasset, 2020.
Dominic Thomas est professeur, directeur du Départment des études françaises et francophone à l’Université de Californie-Los Angeles (UCLA).
Dernier ouvrage paru : Noirs d’encre. Colonialisme, immigration et identité au cœur de la littérature afro-française, La Découverte, 2013.
Les Etudes postcoloniales — en anglais Postcolonial Studies —, apparues dans les années 1980 en Amérique du Nord et en Inde, et bien plus tard en Europe, nous exhortent à repenser notre vision du monde en prenant en compte l’influence de la colonisation. Ce n’est sans doute que ce mot colonisation que beaucoup retiennent pour décrier à tort ces études et, en passant, certains historiens français de la nouvelle génération œuvrant depuis des décennies pour ce champ de recherche.
Si dans le milieu universitaire français ces études alimentent encore des réticences c’est que beaucoup de chercheurs sont angoissés à l’idée que leur fonds de commerce — l’histoire racontée ou enseignée unilatéralement sous le prisme de la gloriole occidentale avec ses canons traditionnels — ne tombe définitivement en faillite et qu’une autre page s’ouvre, contredisant ou nuançant le récit national et égocentrique français, pour une conception plus éclatée et la remise en cause des vérités toutes faites.

L’attitude de repliement de ces chercheurs français s’est encore manifestée le 24 décembre 2019 dans une enquête de L’Express intitulée « Les obsédés de la race noyautent le CNRS ». En vérité, cet article préparait une tribune, publiée deux jours plus tard sur le site de L’Express, signée par six chercheurs et universitaires, avec en figure de proue Laurent Bouvet (un des fondateurs du Printemps républicain) et Pierre-André Taguieff, « l’instigateur de cette tribune », précise l’hebdomadaire.
Quand la colonisation est inconsciemment considérée comme une « entreprise positive »
Les auteurs de ladite tribune s’indignent ainsi contre « l’institutionnalisation » en France des études postcoloniales qui seraient caractérisées par « une obsession sur le colonialisme » et auraient pour « objet principal de préoccupation, l’héritage du colonialisme, et leur posture hypercritique à l’égard de l’Occident, supposé intrinsèquement colonialiste, raciste et impérialiste. »
Ce mélange idéologique et politique s’écarte de l’esprit d’ouverture scientifique puisque les auteurs empruntent les sentiers embourbés du militantisme grégaire et nous livrent un message à peine voilé : ils préservent avec toute l’énergie du désespoir le discours traditionnel de l’Occident, minimalisent ou normalisent la colonisation qui, dans leur inconscience, et peut-être même dans leur conscience, sera toujours considérée comme une « entreprise positive » que devraient applaudir les descendants des anciens territoires colonisés par la France. La vérité vient donc toujours du Nord, et ce qui provient hors de ce « centre » ne pourrait être pris au sérieux. La pensée serait en conséquence verticale, et ceux qui sont en bas devraient congratuler ceux qui, apparemment, sont au-dessus, bien installés à la droite de Dieu.
C’est quasiment le même état d’esprit que nous retrouvons sur le plan politique à travers la fameuse « affaire Marie NDiaye ». En 2009, celle-ci reçut le prix Goncourt pour son roman Trois Femmes puissantes. Métisse née en France d’un père sénégalais et d’une mère française, dans l’esprit de certains elle demeure une « écrivaine noire », donc « venue d’ailleurs ». À l’époque, horripilé par les commentaires de l’auteure, qui avait décidé d’aller vivre en Allemagne afin de s’éloigner du pays qu’elle qualifiait de « France monstrueuse de Nicolas Sarkozy », un député de la droite, Eric Raoult, s’en prit ouvertement à la lauréate : « Nous lui avons donné le prix Goncourt […] C’est la France qui lui a donné ce prix ». Il estimait de ce fait que Marie NDiaye avait « un devoir de réserve » qui l’obligeait à « respecter la cohésion nationale » et à « [défendre] les couleurs littéraires de la France ». Quelles sont ces couleurs littéraires ? Nous ne sommes donc pas loin du paternalisme colonial puisque la récompense d’un écrivain pour son travail personnel est perçue comme un cadeau de la République, voire une médaille pour ses bons et loyaux services…
L’ampleur du retard du milieu scientifique français vu des Etats-Unis
Ces querelles franco-françaises, vues des États-Unis ou nous enseignons depuis des décennies illustrent hélas l’ampleur du retard amoncelé par le milieu scientifique français en la matière. Il existe en effet depuis les années 1960, dans les universités américaines un élan vers des départements d’études qui incluent le discours de l’Autre que l’Histoire n’a pas forcément enregistré ou a continuellement ignoré ou muselé : African American Studies, Latino/Hispanic/Chicano Studies, Asian American Studies, Native American Studies, etc. Pendant ce temps les adversaires de ces champs de recherche en sont encore à s’insurger contre les « importations anglophones » et à amalgamer études postcoloniales et militance décoloniale, deux choses distinctes.

Notre collègue Didier Gondola, originaire de la République Démocratique du Congo et professeur à Indiana University ne mâche pas ses mots lorsqu’il souligne que « l’Amérique accueille des dizaines de chercheurs français, brimés dans une France viciée par les lourdeurs de son propre système universitaire ». C’est désormais presque un cliché de rappeler que les universités américaines ont depuis longtemps porté aux nues et recruté des penseurs français tels Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Félix Guattari, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Emmanuel Levinas, tandis que les études postcoloniales ont connu une ascension extraordinaire grâce à l’influence des théoriciens francophones tels Frantz Fanon, Édouard Glissant, Aimé Césaire, V. Y. Mudimbe, Léopold Sédar Senghor, Achille Mbembe et Souleymane Bachir Diagne entre autres. À New York, en Louisiane, Édouard Glissant, Maryse Condé, Assia Djebar, ou encore Emmanuel Dongala, ont laissé une empreinte comme écrivains professeurs, et aujourd’hui leurs successeurs, les écrivains Abdourahman Waberi (Djibouti), Alain Mabanckou (Congo) entre autres, enseignent aux côtés de leurs homologues africains anglophones, tels que Ngùgì wa Thiong’o (Kenya), Chris Abani (Nigeria), Helon Habila (Nigeria), Wole Soyinka (Nigeria, prix Nobel), et Teju Cole (Nigeria).
Une peur panique gagne le camp des gardiens de l’Empire français
Ce n’est plus un secret de souligner que les pourfendeurs des études postcoloniales ne viennent plus seulement de la droite, mais aussi d’une gauche — ils s’en proclament encore, mais en sont déjà très loin — qui freine le diagnostic des maux de la République française et qui taxe de valets de l’impérialisme américain ou anglo-saxon tous ceux qui se consacrent à une telle recherche. C’est donc la peur panique qui gagne le camp des gardiens de l’Empire français ravitaillé depuis le berceau par la nostalgie de la grandeur coloniale. L’université française passe ainsi à côté de cet élan de progrès, et Achille Mbembe, un des illustres théoriciens des études postcoloniales nous rappelle qu’« à cause de son insularité culturelle et du narcissisme de ses élites », elle « s’est coupée de ces nouveaux voyages de la pensée mondiale ».
Qu’est-ce qui justifie alors les réticences quant aux études postcoloniales en France ? L’épineuse question de la race ? Celle des « minorités » ou bien l’éternelle appréhension des « communautarismes » devant une société française qui affiche au grand jour un décalage entre son quotidien de métissage et ses idéaux de nation judéo-chrétienne ? Est-ce cette attitude qui touche progressivement l’université française au moment où quelques-unes d’entre elles essayent, même de façon marginale, d’aborder ces sujets pendant que leurs publications scientifiques sont traînées dans la boue par les auteurs de la tribune de L’Express ?
Le train est en marche. Il est plus que jamais temps de prendre en compte la nécessité d’inclure l’imaginaire de « dispersion » et de « circulation », de libérer l’expression de ceux que Césaire qualifie de « sans voix ». Dans ce sens, le Sénégalais Felwine Sarr, qui rejoint cette année Duke University, devient presque un visionnaire lorsqu’il dit dans son ouvrage Afrotopia (2016) : « L’avenir est ce lieu qui n’existe pas encore, mais que l’on configure dans un espace mental. » Et cet espace mental, proclamons-le, est notre chantier le plus imminent, contre vents et marées, ou plutôt contre cette France qui n’est pas la France et qui remonte le pont-levis sur le monde avant de cadenasser toutes les issues du manoir et de se recroqueviller dans sa belle et glorieuse histoire occidentale…
Alain Mabanckou et Dominic Thomas.
Lire aussi :
Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ?
par Achille Mbembe, historien, sur le site AOC, le 21 janvier 2020.
À peu près tous les deux ou trois mois, le public lettré d’expression française est convié à un curieux sabbat au cours duquel des sacrificateurs patentés procèdent à l’immolation rituelle non point d’un bélier, d’un agneau ou de tout autre bouc émissaire, mais du postcolonialisme. Cela fera bientôt vingt ans que dure le manège et rien, en l’état actuel des choses, ne semble — hélas — devoir l’arrêter. Lire la suite
Publié par CNRS Éditions, 2019, Sexualités, identités & corps colonisés. Des imaginaires coloniaux aux héritages postcoloniaux.
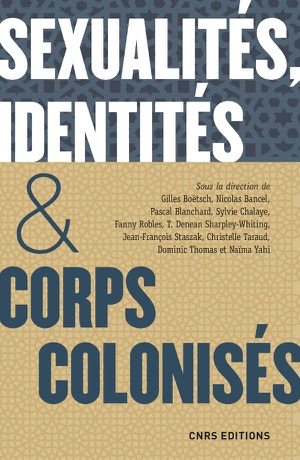
• Son introduction, intitulée « Des imaginaires coloniaux aux héritages postcoloniaux », par Gilles Boëtsch, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Christelle Taraud, Dominic Thomas, Jean-François Staszak, T. Denean Sharpley-Whiting, Sylvie Chalaye, Fanny Robles, Naima Yahi.
L’article « Il faut brûler la recherche postcoloniale : l’Empire contre-attaque » publié le 27 décembre 2019 sur le blog de Pascal Blanchard-Achac de Mediapart
Le dernier ouvrage de l’Achac, Décolonisations françaises. La chute d’un empire, paru en janvier 2020 aux éditions de la Martinière.