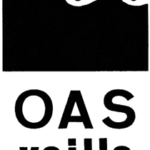La ville dont il va être question a un passé si lourd que chacune de ses résurrections tient du merveilleux. À intervalles réguliers, tous les vingt–trente ans, elle se referme sur elle-même au point de risquer de disparaître, et quand tout semble perdu, elle rejaillit avec une vitalité nouvelle comme si le fléau la détruisant avait nourri ses racines les plus profondes.
Il y a cinquante ans, un rat gros et gras, malhabile dans ses mouvements, suivi par des dizaines puis des centaines de rats barbus, flasques et mouillés, transmirent par leurs puces une maladie qui semblait être reléguée dans une mémoire populaire lointaine. Les bubons ne laissèrent plus aucun doute, la peste s’installa et régna, façonnant à sa manière les hommes, leur vie, leur cœur, leurs sentiments.
C’était à Oran.
Camus y avait situé la Peste. Par quel hasard ? Avait-il pressenti les hoquets de l’Histoire, justement, là, répétitifs dans les ravages perpétrés ?
Qui a connu vingt ans plus tard, en 1961 et 1962, la tourmente qui balaya la ville ne peut lire la chronique de Tarrou ni suivre Rieux sans voir se superposer les images tant visuelles que sonores, sans être transposé d’un temps à l’autre, enfermé dans un malaise d’une acuité avivée quand les passés se mêlent à leur tour au présent déchiré des années 1990.
Il y eut un premier mort, là, dans la rue, au milieu des passants qui s’écartèrent. Ce fut brutal, soudain, à l’occasion d’un mouvement insignifiant. C’était un individu, un homme dans la foule.
C’était un mauvais rêve, le fléau était encore irréel. Les hommes ne reconnaissent jamais qu’il peut se passer chez eux ce qui se passe ailleurs, ils se révèlent alors sans imagination.
Plus ils se regardaient, s’observaient, moins ils se voyaient. Alors, ils simplifièrent et ce fut très évident pour eux. Il y avait les Européens et les Arabes. Certains nuancèrent quelque peu. Dans chaque groupe, les bons se distinguaient des mauvais.
Chez les Arabes, les bons ne pouvaient être que ceux qui se disaient français, ceux qui travaillaient dans les fermes, ou à la ville, les femmes de ménage et les marchands ambulants.
Chez les Européens, les mauvais étaient ceux qui étaient compréhensifs, on les appelait les libéraux. Certains étaient encore pires que les autres, les communistes, les rouges, ceux qui pouvaient même reprendre les aspirations des Arabes.
Tout était alors simple, limpide. La force ne pouvait être que victorieuse du côté des Européens. Les gens faisaient confiance à l’armée, aux forces de répression. Ils pouvaient scontinuer à partir pour la plage où nul intrus ne se risquait à venir. Les mêmes plaisirs les attendaient. La ville fleurait bon les épices, les salaisons, l’alcool anisé. Le soleil dardait sa chaleur, le sirocco enfermait les corps dans leur moiteur, la cité était immuable.
La ville n’était pas seule. Dans tout le pays, et parfois plus, ailleurs, la guerre s’installa, mais nulle part on ne dit que c’était une guerre. Plus les soldats débarquaient, plus les armes claquaient, plus les bilans s’alourdissaient, plus on mettait au pilon tous ceux, ils n’étaient pas nombreux, qui osaient nommer “ les événements ” par leur nom.
Non, la guerre, c’est lorsqu’il y a un ennemi, formé et encadré par un Ėtat, un gouvernement, des gens semblables des deux côtés d’une frontière même lorsqu’il y a débarquement ou occupation. Là, le schéma classique ne se trouvait que du côté de l’armée de la métropole. Elle correspondait bien à ce que l’on en attendait. En face, des gueux, des pauvres, mal armés, dont les ancêtres avaient réclamé un peu plus de reconnaissance, de justice sociale, mais toujours en vain, osaient à présent lever la tête. Puisqu’on n’avait jamais accepté qu’ils soient, eux les indigènes, eux les Arabes, comme les autres avec les mêmes droits, eh bien, ils se les donneraient. Ils ne pouvaient être que des marginaux ! Des bandits, des terroristes. À éliminer.
La guerre sans nom ne pouvait qu’être terrible, barbare de la violence organisée étatique, de celle des opprimés dans leur sursaut de vie.
La ville se coulait dans la bonne conscience, elle bénéficiait d’avantages qu’elle était la seule à posséder. Elle était à l’ouest, face à l’Espagne, à l’Andalousie d’où venaient tant de ses habitants. En son sein les Européens étaient plus nombreux que les Arabes. Elle aimait la vie. En vingt ans, elle s’était affirmée tout en gardant sa coloration hispanique. Elle s’était globalement enrichie et les différences sociales accusaient le fossé entre Ceux des quartiers indigènes du Village Nègre, du Ravin Raz El Aïn ou des Planteurs, et les Autres.
Pourtant les Autres avaient une origine si variée qu’ils se donnaient le nom d’Européens pour gommer leur spécificité, pour affirmer qu’eux, ils n’étaient pas Nord-Africains comme tous ces Arabes. Pour être forts à présent, ils devaient oublier que le voisin était Maltais, Italien, Juif, Espagnol, Français de métropole. Les Espagnols étaient les plus nombreux, ils se disaient castillans ou catalans, mais surtout du pays valencien ou d’Andalousie. Ils parlaient l’espagnol ou le catalan et les écoles de flamenco étaient nombreuses.
Depuis que cette chose sans nom avait éclaté, car l’administration était encore plus prudente qu’à l’époque où vingt ans auparavant la peste avait sévi, ils se sentaient d’un seul bloc, même d’un seul peuple sans les Arabes, bien sûr. Alors comme pour s’en convaincre, ils se disaient Français, Français d’ici mais tout de même quelque part comme ceux de métropole. C’était une étiquette commode qui les rassemblait autour de l’Ėtat colonisateur face aux colonisés en révolte. Pourtant, là-bas, les vrais Français étaient plus grands, plus blancs, plus riches, plus intellectuels aussi. Si l’on désirait les mêmes droits qu’eux, et les grandes guerres avaient aider à les obtenir, si on affirmait que cette terre n’était qu’un bout de France, on tenait à montrer la différence.
Ici la vie était saisie à pleines mains, l’individu pouvait se protéger dans la foule rieuse, animée, envahissant les rues, les places, au soleil complice de l’hiver, dans la chaleur amoindrie des fins d’après-midi du printemps et de l’été. La ville sentait ce bonheur palpable au milieu des vapeurs de viande rôtie, de poisson grillé, de coquillages écaillés, dans le mouvement des foules et le jeu des silhouettes. Cela, là-bas, ils ne savaient pas.
La mer offrait ses trésors. Du quartier de la Marine, de la jetée du port aux douces plages de sable, passée la corniche rocailleuse et sauvage, la mer galbait les corps des adolescents. Dans les criques lointaines, la famille en tribu se déplaçait chargée comme des bourricots et déballait l’attirail d’une journée ou d’un week-end. Tout un monde de saveurs et d’odeurs, des plus délicates aux plus entêtantes annonçait de véritables festins comme savent les vivre les familles populaires. D’un coin de paradis perdu, isolé du monde, ils faisaient un moment de luxe qu’aucun riche avec toute sa fortune et ses yachts ne connaîtra jamais. Ils ne réfléchissaient pas beaucoup, ils étaient sûrs de ce qu’ils possédaient. Jamais ils ne le perdraient.
La ville vivait au rythme de ses habitants, de leurs activités, car ils étaient laborieux, dans le fracas des bruits du travail des ateliers, dans le vrombissement des camionnettes, l’éclat des klaxons, le jaillissement électrique des perches du tramway, l’intense chambardement des docks. Elle s’arrêtait dés qu’il faisait trop chaud, dans la torpeur de la sieste. La ville de pierre surgissait. Les arbres le long de quelques avenues, les ficus aux larges feuilles, les tamaris au feuillage si fragile, les palmiers décoratifs tempéraient sa sécheresse poussiéreuse. La végétation plus abondante de la promenade de létang apaisait les sens. De grands immeubles modernes de qualité l’ouvraient sur la Méditerranée à l’extrémité du plateau dominant le port.
Elle compatit aux tourments des autres avant d’être, à son tour, vraiment touchée.
D’abord, elle ferma les yeux aux signes avant-coureurs, il ne fallait affoler personne. Quelques opérations, une présence accrue de forces de police, de jeunes soldats ne l’inquiétaient guère. Elle était habituée aux défilés militaires, de la légion si proche à Sidi Bel Abbés, de troupes d’élite avec leur apparat, leur mise en scène, leur musique, leur pas au rythme recherché derrière leur mascotte.
Les morts firent plus d’effet. Tant qu’il s’agissait d’indigènes, on ne s’inquiéta pas trop. Mais quand ils furent bien français, les choses commencèrent à changer.
Une inquiétude sournoise s’empara de la ville. Elle se tapit dans le tréfonds des individus. Ils la combattirent en s’affirmant toujours identiques à eux-mêmes. Mais qui connaissait bien la ville lui trouva alors un surplus d’agitation artificielle. On voulait tellement que tout soit comme avant que l’on en rajoutait, On s’amusait plus, on criait plus, les fêtes brillaient d’un nouvel éclat. On réfléchissait moins, on refusait d’échanger la moindre idée avec les autres d’ici ou d’ailleurs dès qu’ils ne pensaient pas comme tout le monde.
Plus l’inquiétude grandit, moins on décida d’en tenir compte. Ceux qui osaient émettre des doutes, qui proposaient de discuter, y compris avec les rebelles, furent vite isolés. Non seulement par les gens mais par l’administration. Cette dernière paraissait, comme toujours, être au-dessus des événements, mais elle était la gardienne de la ville. Elle semblait parfois faire la part des choses, refuser le manichéisme, mais elle était aussi le produit de la cité et son cœur vibrait avec elle.
Elle grondait un peu tout en faisant savoir qu’elle n’abandonnerait jamais la ville. Tous les puissants, tous ceux qui possédaient une parcelle de savoir ou de pouvoir, les médecins, les avocats, les journalistes, les patrons, les banquiers, les corps constitués faisaient chorus avec leur administration. Si bien que loin de l’esprit critique nécessaire, loin du courage à voir la réalité, les hommes perdirent complètement la mémoire et l’imagination. Cet aspect de la maladie était inquiétant car à l’évidence inguérissable.
On parlait beaucoup, on affirmait beaucoup, on détenait la vérité, le courage, la force. Pour la plupart, ce n’était là que façade et fanfaronnade, mais tous finirent par y croire, même si c’était de manière différente. Certains passèrent à l’acte. Puisque tout le mal venait de cette vermine, il fallait l’extirper de la ville. Puisqu’elle avait la vie dure, on allait s’organiser, on ne ferait plus confiance qu’à soi-même. Là encore, c’était quelque peu inexact parce que s’ils étaient peu nombreux, les plus actifs, ils avaient partout des complices, dans toutes les sphères de l’État, dans les corps d’élite de l’armée, les paras et les légionnaires.
L’épidémie éclata eu plein jour et éclaboussa toute la ville. Elle prit le nom d’OAS. Les plus avisés des citoyens l’avaient vu germer mais ils n’y avaient pas pris garde. Il y avait eu les territoriaux, hommes de bonne volonté prêts à donner deux à trois nuits pour défendre l’ordre établi, les membres du FNF, le Front National Français, les Jeunes Nations, les activistes, individus et noyaux paramilitaires. Ils se retrouvèrent tous dans l’OAS, Organisation de l’Armée Secrète, le summum de l’organisation politique et militaire, dictée par la situation, mûrie au sein des habitants.

La maladie s’empara de la ville. Mais comme dans les périodes d’incubation, la ville se sentit mieux et elle écarta inconsidérément le danger. Elle se savait protégée, elle accompagnait les hommes les plus déterminés qui prirent possession de la cité, la firent pavoiser, sonoriser. De plus en plus souvent, le vacarme l’envahit. De toutes les fenêtres, de tous les balcons, les gens frappaient sur tout ce qui pouvait faire retentir les trois brèves, deux longues, Al-gé-rie Fran-çaise. Les sons étaient martelés sur les balustrades en métal, les persiennes, des tôles, des bidons, des casseroles. Plus tard, la nuit, les lumières prenaient le relais, elles clignotaient au même rythme.
La ville était pavoisée de couleurs, du bleu-blanc-rouge du drapeau métropolitain, du noir et blanc de l’OAS, de fanions, de banderoles, d’affiches guerrières, de celles qui dénonçaient les traîtres et les imposteurs. Se mêlaient une apparence de fête enfantine et un sentiment de malaise dissimulé.
L’oreille s’habitua â toutes les déflagrations, armes automatiques, grenades, bombes. Les attentats se multiplièrent. Des jeunes gens enthousiastes, décidés, ajoutèrent la fougue de l’âge et devinrent des petits tueurs sans aucune retenue.
La peur grandit, la mort rôdait. Tous pouvaient être touchés, directement ou par ricochets. Il n’y avait plus d’îlot préservé, plus d’enclos de calme. Les Européens craignaient les Algériens qui redoutaient les Européens. Chaque camp avait ses hommes armés. Chaque camp avait ses dissidents. Quelques Algériens, notables quelque peu intégrés, ou individus isolés, se rangeant derrière le pouvoir en place, quelques Européens, Français de là-bas ou gens du pays, égarés dans leur soif de justice, de reconnaissance des droits de l’homme se coupaient de leur communauté qui les éliminait sauvagement. Cette peinture stylisée pourrait sembler renvoyer dos-à-dos ces protagonistes, mais l’objectivité pointilliste du moment choisi n’est pas une neutralité de bonne conscience. Ce qui était en jeu c’étaient des choix, des engrenages, des responsabilités individuelles et collectives, c’était le déchiffrage du passé, son sens, son poids et Oran reste un témoin irremplaçable.
Plus la ville était en danger, plus elle s’emballait. Plus elle était prise dans un destin général, plus elle se refermait sur elle-même. Les grèves succédaient aux grèves, on commença à manquer de tout, les queues devant les magasins rappelaient aux plus vieux les années de guerre, des recettes de temps de pénurie circulaient.
Plus on affirmait qu’on resterait, plus on détruisait pour ne rien laisser aux Autres. Tout sautait, locaux administratifs, postes et télécommunications, locaux du gaz et de l’électricité, hôpitaux, écoles, maisons et magasins, cars, autos, motos, parfois au cours de festivals grandioses, les nuits bleues.
Quoi qu’il en soit de l’avenir, l’argent pourrait toujours être utile. Tout était pillé les banques, les postes, les commerces, les recettes les plus grosses comme les plus petites. Les hold-up pouvaient rapporter quelques millions de francs comme quelques milliers. Les perceptions avaient déjà, toutes, brûlé.
La ville n’avait plus de colonne vertébrale, plus de règle, plus de loi, si ce n’est celle de la violence barbare, celle des hommes de cette nouvelle milice. Les rues avaient perdu leur nom, les immeubles leur numérotation pour retarder et gêner les forces de police ou de l’armée qui existaient toujours et qui se permettaient parfois d’intervenir.
Plus la ville se refermait sur elle-même autour de son noyau de l’OAS, plus elle se coupait de l’armée française. Celle-ci suivait, parfois de mauvaise grâce, la politique de l’État gaulliste qui voulait, par réalisme, en finir avec l’Algérie coloniale. Seuls des soldats égarés de cette armée, nostalgiques de guerre perdue comme en Indochine, avaient rejoint l’OAS. Les rapports restaient ambigus entre le squelette d’administration de la ville représentant l’État français et l’embryon de celle de l’OAS. Les transfuges étaient nombreux et le passé commun rejaillissait dans le présent.
Personne ne sortait plus de la ville. Il n’y avait plus d’avions, plus de bateaux. Les laissez-passer n’étaient plus délivrés. Rarissimes étaient les combines qui ouvraient les portes. Plus rien ne fonctionnait, les morts eux-mêmes attendaient d’être enterrés des jours, et parfois des semaines, dans la chaleur de cette fin de printemps.
L’odeur de la ville avait changé. Aux fumées se mêlaient la poussière, le roussi des incendies, le goût âcre de la destruction, du sang, de la mort.
Parfois, une trêve permettait de monter sur une terrasse, ces points de vue ventés, dominant les quartiers s’ouvrant sur la mer. Un moment d’accalmie balayé par la brise marine rendait au ciel ses couleurs de nuit au scintillement magique. Il rejetait dans le passé proche. La tendresse du moment emplissait les cœurs d’oubli avant qu’une déflagration ne fasse replonger dans un réel auquel nul ne pouvait échapper.

Que la ville se referme sur elle-même n’était guère suffisant. Â l’intérieur de ces hautes fortifications de haine et de désespoir s’élevaient d’autres murailles isolant les quartiers ethniquement ennemis. Plus personne ne devait sortir des maisons algériennes pour rejoindre le centre et les quartiers européens. Ceux qui refusaient d’obéir pour rejoindre leur travail, les femmes de ménage, les dockers, les ouvriers, les marchands ambulants, les petits commerçants des marchés, y laissaient presque tous la vie. La chasse à l’homme devint plus sauvage, les lynchages plus odieux.
Plus la haine s’aiguisait, plus la folie s’emparait des esprits. Achever les blessés dans les cliniques et les hôpitaux n’était qu’un jeu d’enfant, mais il fallait encore frapper plus fort. Alors l’histoire des vampires fit le tour de la ville. Chaque communauté, emmurée dans sa bulle, dénonça par ses récits colportés de bouche à oreilles, par tracts déments, les horreurs les plus incisives. C’était le prix du sang. À cette mort qui frappait fallait du sang frais. Chacun accusait l’Autre de faire disparaître des individus pour les vider de leur sang. Ce liquide rouge et chaud, que personne n’hésitait à faire couler à flots, devint, quelle qu’en soit son origine, le viatique de l’étincelle de vie. La société de vivants voulait encore forcer le destin.
Quelques rares individus tentèrent d’échapper à l’emprise de la collectivité, ils refusaient le meurtre.
Ils se cachaient, se taisaient, ne pouvaient faire confiance qu’à des amis qu’ils n’avaient jamais cessé de côtoyer. Eux pouvaient, être différents parce qu’ils avaient fait des choix antérieurs à l’emprise de l’OAS. Ils apprirent à lire entre les lignes, à voir entre les faits. Ils continuèrent à affirmer contre vents et marées leur humanisme, leur radicalisme anticolonial. Leur lucidité face à l’évolution de la situation ne les protégeait ni du danger, ni de l’amertume née de leur impuissance. Qui n’a jamais vu commettre un lynchage, qui a assisté au scénario des prémisses, du développement, de la puissance d’une organisation d’extrême droite fascisante, qui n’a pu réagir à la barbarie, qui a été emporté dans un tourbillon de violence et de haine et s’en est sorti seul, vivant mais déchiré à jamais, ne pourra ni oublier ni se taire de peur que tout ne recommence.
La ville s’asphyxia. On ne pouvait plus travailler, plus entrer ni sortir, lorsque des réserves de gaz puis les cuves de pétrole du port sautèrent. Les flammes s’élevèrent jusqu’aux plus hauts immeubles du front de mer, les bateaux rompirent leurs amarres, le soleil disparut au-dessus des nuages noirs. La ville s’effondrait, disparaissait. L’inévitable était arrivé.
Quelques-uns eurent alors un sursaut insensé, ils voulurent effacer le passé. Ils allèrent trouver les Algériens pour renouer le lien qu’ils n’avaient jamais su tisser. Mais personne ne put arrêter le rouleau compresseur de l’Histoire mis en branle depuis les cent trente ans de colonisation, personne ne pouvait faire ressusciter les centaines de milliers de morts, faire oublier l’humiliation, la misère, l’exploitation, la ségrégation.
Cette ville, ils auraient pu la construire ensemble, l’habiter ensemble, la vivre ensemble. Les écoles, les collèges, les lycées auraient pu entendre leurs rires mêlés. Les ouvriers, les employés, les médecins auraient pu travailler de concert. Non, ils avaient été cantonnés dans leur sphère du labeur, de l’habitat, les uns au-dessus de la société, les autres au-dessous. Ceux qui y échappaient par le haut ou par le bas n’en étaient que plus déclassés.
L’Histoire avait surgi. Comme à son habitude, elle paraissait autonome alors qu’elle n’était qu’un produit des hommes. Elle avait balayé le passé proche de ce siècle où les Uns s’étaient approprié un pays en niant les Autres à l’enracinement plus lointain. Les nouveaux arrivants, la plupart du temps des exclus de leur monde, avaient cru enfin trouver le lieu où vivre bien, mais ils se rangeaient derrière des oppresseurs.
Les vaincus avaient rêvé à une assimilation qui en ferait des citoyens égaux avec leur propre culture. Déçus, enfermés dans la relégation, ils avaient un jour refusé le dos courbé, les mains calleuses, la misère des douars, le chômage des villes. Redressés, ils avaient fait face.
L’armée, la haine, le racisme, la violence, l’État, le meurtre les avaient tous entraînés, dans un camp ou l’autre. Les choix étaient déterminés, seuls quelques individus y échappèrent. Peu nombreux, ils se devaient, pour exister et survivre, rejoindre les autres par une décision volontaire, celle de l’engagement derrière des valeurs de progrès et d’avenir. Ils devinrent des hommes fiers d’être des traîtres, traîtres à la barbarie imposée.
L’Histoire s’emballa, on lui laissa prendre son galop du 19 mars au 3 juillet 1962. Le ciel brûlait, la mer devenait étrangère, la ville s’effondrait. Les Uns désespéraient et pleuraient, les Autres encore isolés dans leurs quartiers se réjouissaient. L’issue terrible ou heureuse était encore, pour tous, incroyable, inimaginable.
La ville s’ouvrit pour se vider. Comme un bubon. Les Européens se ruèrent vers le port, l’aérodrome de La Sénia, sur les routes vers le Maroc, les bateaux, vers des pays que la plupart ne connaissaient pas, l’Espagne ou la France.
Le désespoir infini, l’accablement dans l’attente et le dénuement faisaient suite à l’acharnement à tout détruire, à ne rien laisser derrière soi.
Partir avec si peu en laissant sa vie sur le sol chéri, c’était le lot des petites gens, de loin les plus nombreux. Les riches eux avaient tiré les ficelles mais ils avaient depuis longtemps mis leurs biens et leur argent à l’abri, là-bas. La chaleur des docks dans l’abattement sinistre, car le soleil ne parvenait plus à réchauffer les cœurs, l’entassement sur les bateaux, et déjà il fallait se tourner vers l’autre rive que l’on craignait si inhospitalière.
Alors les Algériens s’emparèrent des rues de la ville. Ils défilèrent dans la liesse, ils choisissaient l’avenir avec tous ceux qui voulaient bien le construire, y compris les Européens. La ville changea de mains, mais elle était encore dans l’expectative.
Un dernier sursaut de la peste s’en empara une ultime journée avant de sombrer à nouveau dans des profondeurs inconnues. Le 5 juillet 1962, l’éclair froid du glaive frappa à nouveau sans que personne ne vit d’où il venait. Encore des dizaines de morts Algériens et Européens, puis l’histoire à coup de boomerang décima. Des centaines d’Européens disparurent, en un dernier hoquet de violence, le cycle s’acheva.
La ville, c’est toujours Oran, chatte sauvage avec ses sautes d’humeur, ses langueurs inattendues. Les terrasses où le linge claque au vent dispersant son odeur de soleil enfoui. La mer et ses embruns aigrelets de l’hiver, son hospitalité bienfaisante de l’été, son opéra de tourmente où se cabrent les couleurs des tempêtes et ses accalmies huileuses. Oran, et sa torpeur de la sieste dans la chaleur moite, sa foule grouillante qui interminablement s’agite dans les fins d’après-midi. Ses bruits du labeur qui résonnent du port, des quartiers populeux et industrieux, ses moments de répit avec les vieilles dames au chignon blanc assises sur le pas de la porte et qui agitent leur éventail en murmurant, qué calor !
Oran et ses enfants, ses femmes, ses hommes. Ils sont la ville, ils font la ville. Chacun est seul, unique, mais tous sont ensemble.
L’oeil est sur la ville. Il voit les fissures, les clans, les forces déployées, les forces cachées, l’unanimité de la masse et ceux qui s’en détachent. La foule hésite, elle suit ceux qui la flattent. Elle croit échapper au malheur en refusant la réalité, en se coulant dans le cocon de l’égoïsme. Elle se réfugie derrière le pouvoir imposé et arme elle-même le bras des soldats, des religieux. Elle écarte ceux dont la voix ose s’élever au-dessus du brouhaha pour prévenir et refuser la fatalité.
La fatalité ne conduit qu’à la négation des hommes. Elle est leur aberration. C’est elle qui fait rejaillir la vermine et le bacille de la peste.
Ce sont les rats et leurs puces qui transmettent la peste. Les hommes ne sont pas des rats.