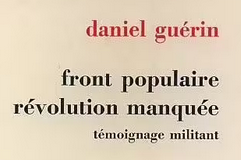Militant communiste libertaire, anticolonialiste et membre du mouvement pour la libération homosexuelle, historien, Daniel Guérin (1904 -1988) fut membre de la tendance « Gauche Révolutionnaire » de Marceau Pivert au sein de la SFIO au pouvoir durant le Front Populaire. Dans cet extrait de son Front Populaire, révolution manquée (1963), il fait le récit de son expérience pour le moins décevante au sein de la Commission coloniale de la SFIO et souligne le poids considérable des préjugés colonialistes au sein du parti dirigé par Léon Blum.
Extrait de Front Populaire, révolution manquée (1963)

On ne tient pas parole aux colonisés
Pour la plupart des militants SFIO, le problème de ce que nous appelons aujourd’hui la décolonisation était une question secondaire. Elle ne les touchait pas directement. Ils étaient imbus de préjugés plus ou moins colonialistes et, ne comprenant rien à la question nationale, ils taxaient de nationalisme (au sens rétrograde du mot) les luttes libératrices des colonisés. À la Gauche révolutionnaire, grâce à l’insistance de quelques spécialistes, dont j’étais, le problème dit colonial avait cessé d’être sous-estimé.
Sur ce grave sujet, dont l’actualité n’était pas moins brûlante alors que de nos jours, le Rassemblement populaire n’avait accouché que d’une souris : sur un plan théorique, la reconnaissance d’un vague principe de « justice pour les indigènes des colonies » ; sur le plan pratique, la nomination d’une commission d’enquête. Tel était le maigre lest jeté par les radicaux-socialistes, qui trempaient jusqu’au cou dans la fange colonialiste. Encore fallut-il attendre décembre 1936 pour que le Sénat se décidât à voter la création de cette commission d’enquête, et celle-ci ne fut envoyée qu’en Afrique occidentale, sans résultats tangibles.
La SFIO, dans une large mesure sous notre impulsion, s’était montrée un peu moins chiche. Au congrès de Huyghens, à la veille de prendre le pouvoir, elle avait adressé un message solennel aux peuples colonisés :
« Le congrès du parti vous adresse l’expression de son active solidarité. Il connaît votre misère, il a la volonté d’y mettre un terme. Avec le Front populaire au pouvoir, une ère nouvelle commence pour la France laborieuse aussi bien que pour les peuples qu’elle associe à sa destinée. […] Le parti socialiste vous en donne l’assurance formelle. »
La SFIO s’engageait à mettre en vigueur dans les pays colonisés l’ABC de nos républicaines conquêtes : libertés démocratiques, législation sociale. On n’avait jamais entendu au-delà des mers pareil langage, pareilles promesses. Leur retentissement, les espoirs suscités furent immenses.
Mais ce programme minimum, programme pourtant démocratique et non socialiste, qui s’inscrivait dans le cadre de l’ordre existant, n’en fut pas moins saboté par une administration demeurée impérialiste et ne reçut pas le plus petit commencement d’exécution. Tout au contraire, le Front populaire une fois au pouvoir, une nouvelle vague de répressions, emprisonnements, dissolution de mouvements, fusillades s’abattit sur les colonisés. Un pauvre bougre d’Annamite fut même condamné à plusieurs années de prison pour avoir donné lecture à ses amis d’une brochure ancienne du président du Conseil Léon Blum.1
En une série d’articles, je m’obstinais à dénoncer ce scandale qui, à vrai dire, ne nous surprenait guère. Nous nous étions associés au message de Huyghens, dû à la plume généreusement démagogique de Maurice Paz, mais nous savions que les féodalités capitalistes ne lâcheraient pas leur proie coloniale sans y être contraintes. Nous tendions une main fraternelle à ceux qu’elles opprimaient et qui lui résistaient : « Tous les ennemis de nos ennemis sont nos amis. »
Seul à la commission coloniale
J’étais entré, après Huyghens, à la commission coloniale, organisme purement technique et consultatif, qui devait, en principe, transmettre des avis à la commission administrative du parti. J’y étais l’unique représentant de la Gauche révolutionnaire, position inconfortable dans un aréopage réformiste, assimilationniste, néocolonialiste. Ainsi, Germaine Picard-Moch nous déclara, un jour, avec une moue butée, qu’au grand jamais elle ne voudrait mettre un bulletin de vote entre les mains d’illettrés algériens. Un autre membre, le gouverneur colonial Hubert Deschamps, chef de cabinet de Léon Blum, me retourna un cahier des revendications qui émanait authentiquement du peuple malgache avec ce commentaire méprisant : « [Elles] n’émanent en réalité que d’un petit groupe sans mandat. Vous savez le mot de Guesde : quand nous sommes trois, signons : le comité. Quand nous sommes deux, nous signons : le parti. Mais que je sois seul, je signe : le peuple. Ce travail ne servira donc pas de base à mon rapport. » Quant au docte professeur Charles-André Julien, il nous confia, en invoquant des incidents survenus en Tunisie entre les deux partis destouriens, qu’il « ne fallait pas donner trop vite la liberté aux indigènes ». L’illustre historien politique de l’Afrique du Nord, ancien communiste, futur président du Comité pour la vérité sur l’affaire Ben Barka, assurait alors le secrétariat d’un organisme gouvernemental de coordination : le Comité méditerranéen. Il n’avait pas les mains libres.
La plupart des membres de cette inopérante commission étaient liés aux ministres dits socialistes par des liens personnels et même, parfois, professionnels, car plusieurs d’entre eux faisaient partie de cabinets ministériels. Bien que peu satisfaits, inquiets même, du tour que prenait la répression dans les pays colonisés, ils craignaient de parler trop haut ; ils ne voulaient faire à leurs ministres aucune peine, même légère ; ne protestaient que lorsque l’abus était trop flagrant. Ils croyaient se mettre en règle avec leur conscience en se contentant de délibérations académiques, en vase clos, ou en émettant, leurs soirs d’audace, des ordres du jour platoniques, qui allaient mourir dans les paperasses du secrétariat du parti.
Les ministres dits socialistes, par ailleurs, traitaient notre commission par-dessus la jambe, n’accusaient même pas réception de nos résolutions et prenaient la plupart de leurs initiatives sans juger bon de nous consulter.
À l’automne 1937, je déposai devant la commission un texte leur rappelant les termes des motions de nos congrès de Huyghens et de Marseille et exigeant l’exécution des promesses faites. Je fus, bien entendu, le seul de mon avis. Le cri d’alarme que je publiai ensuite en tribune libre du Populaire suscita l’ire de Maurice Paz, étroitement lié au secrétariat du parti. Il se refusait « à déplacer les responsabilités pour en accabler nos camarades délégués au gouvernement » et il soutenait que la commission n’avait « aucun pouvoir de citer à sa barre les ministres socialistes pour leur adresser des remontrances ». Je voulais à toute force « faire œuvre de tendance », ce qui n’était pas la meilleure façon d’aider les colonisés.
Je ripostai, le 21 octobre, au cours d’une réunion du parti dont il sera question plus loin, que ce n’était pas faire injure à nos délégués au gouvernement que d’exprimer un doute sur leurs possibilités d’action. Ils se heurtaient, à chaque minute, nous ne le savions que trop, à la formidable pression exercée sur eux tant par l’appareil de l’État bourgeois que par la coalition des grands intérêts colonialistes. Et c’était une des raisons, précisément, pour lesquelles nous adjurions le parti de les retirer d’un gouvernement à direction radicale.5
Je réussis, pourtant, à force d’insistance, à décider le ministre des Colonies, Marius Moutet, à se rendre, un soir, devant notre commission. Le 25 octobre 1937, il se fit conduire rue Victor-Massé par un chauffeur qui, une fois l’Excellence débarquée, ploya littéralement sous le poids des piles de dossiers mobilisés par la rue Oudinot pour se défendre, et me confondre. Pendant plusieurs heures, je dus rompre des lances seul, ou à peu près, avec un personnage entêté, venimeux, de mauvaise foi, souvent désarçonné, car il ne connaissait pas trop bien ses dossiers. D’accusateur, on essaya de me transformer en accusé. Le procès de Marius Moutet faillit devenir le mien. Seul, le brave et courageux Jean Longuet vint, de temps à autre, bien que timidement, à ma rescousse.
La situation était pour moi d’autant plus intolérable que j’avais jadis connu, et apprécié, un autre Moutet : celui qui, en 1931, au Comité de défense et d’amnistie des Indochinois, avait accepté, avec un dévouement inépuisable, la défense d’innombrables emprisonnés. Maintenant, c’était lui qui jetait, ou laissait jeter en prison, les leaders anticolonialistes (tels les conseillers municipaux autochtones marxistes de Saigon), s’obstinant, contre toute raison, à défendre soit ses services, soit les lointains proconsuls, ses subordonnés, jusque dans leurs actes les plus odieux.
Lorsqu’il était en veine de confidences, Moutet nous avouait volontiers, à Jean Longuet et à moi-même, dans le creux de l’oreille, qu’il était « prisonnier » de ses bureaux. Mais il se résignait trop aisément à cette captivité dorée.
Un jour il m’adressa une lettre fort vive, où il s’emportait contre ces « agitateurs » qui, disait-il, « dirigent leurs buts contre le Front populaire, le gouvernement qui en est issu et l’administration coloniale dont je suis le chef ». Ce fut lui qui, le 19 septembre 1936, avait invité le gouverneur général de l’Indochine à maintenir l’ordre « par tous les moyens » et à engager des poursuites contre les « fauteurs de trouble ». À Loubet, de la commission coloniale, Moutet confia qu’il ne serait pas le fossoyeur des colonies, qu’il ne les ferait pas perdre à la France.
Les dirigeants staliniens n’étaient pas d’un avis sensiblement différent. Moutet me révéla que des députés communistes étaient venus tout exprès le voir pour me dénoncer auprès de lui comme un « dangereux personnage ». En prévision de la guerre des « démocraties » contre les dictatures, le Komintern veillait à ne pas priver l’allié impérialiste du soutien de ses précieuses colonies. De ses conseillers occultes, de Goloubieva, dite Suzanne, en particulier, le parti communiste reçut l’ordre de renverser la vapeur dans ce domaine comme dans les autres, et les organisations d’émancipation nationale, non inféodées à Moscou, donc jugées indociles, furent désormais en butte à l’hostilité systématique du stalinisme. Il combattit à boulets rouges l’Étoile nord-africaine et, dans la coulisse, exigea sa dissolution ainsi que l’arrestation de son leader, le fondateur du Mouvement de libération nationale algérien, Messali Hadj. Au Maroc, il ne fut pas étranger à la dissolution du Comité d’action marocaine et à l’emprisonnement de ses chefs. À Madagascar, il désavoua publiquement les activités du mouvement national malgache, attirant sur lui les foudres colonialistes.
En Indochine, les staliniens ordonnèrent une scission au sein du groupe du journal La Lutte*, dressant deux conseillers municipaux de Saigon, de tendance stalinienne (dont l’un avait nom Tao), contre deux autres, de tendance trotskistes (Ta thu thau et Tran van Tach), pour ensuite appeler la répression des pouvoirs publics sur ces derniers. Averti par le ministre intérimaire des Colonies, Maurice Violette, des menaces de dissolution qui pesaient sur le groupe de Saigon, je m’étais rendu en hâte, le 1er avril 1937, devant le Rassemblement des Indochinois de France pour alerter ses militants. Mais le même jour les staliniens ordonnaient à leurs affiliés de cesser de participer à ce Rassemblement : on les faisait se défiler au moment précis où était sollicitée, en faveur d’un groupe menacé par la répression, leur solidarité active.
Quant aux affaires algériennes, elles étaient du ressort du ministre de l’Intérieur, Marx Dormoy. Elles allaient fort mal, puisque le gouvernement de Front populaire n’avait même pas osé tenir tête au Sénat pour lui imposer le vote du projet Blum-Violette. Ce texte, éminemment assimilationniste, était, pour les Français d’Algérie, les prépondérants, comme on les appelait, bien peu nocif, et pour nous bien insuffisant, puisqu’il visait simplement à écrémer les populations musulmanes de leurs « élites » les plus dociles, pour les verser dans le collège électoral français. Mais c’en était encore trop pour les partisans du double collège et de la suprématie de la représentation européenne. Tandis que le projet était enterré, la répression la plus brutale frappait le mouvement national de Messali Hadj. J’insistai pour l’audition de Dormoy par la commission. Le ministre me répondit qu’il « causerait volontiers » de la question algérienne avec la commission coloniale. Mais il ne daigna pas se déranger.
Le gouvernement de Front populaire n’avait manifesté une certaine hardiesse décolonisatrice que sur un point : le mandat exercé par la France en Syrie. Pierre Viénot, sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères du gouvernement Blum, y était chargé des territoires sous protectorat et mandat (Tunisie, Maroc, Syrie). Il n’appartenait pas au parti socialiste, mais au minuscule Parti socialiste français gravitant autour du social-patriote Paul-Boncour. Pourtant, il fit preuve de moins d’inconséquence que le SFIO Marius Moutet. N’hésitant pas à négocier directement avec les leaders du nationalisme syrien, il signa avec eux, le 22 décembre 1936, un traité qui mettait fin au mandat et proclamait l’indépendance de l’État syrien.
Cet acte de sagesse faisait, d’ailleurs, la part assez belle aux intérêts impérialistes : l’indépendance ne devait devenir effective qu’après une période probatoire de trois ans ; pendant vingt-cinq ans, la Syrie resterait liée à la France par une alliance politique et militaire. Mais le colonialisme se cabra. Pierre Viénot fut vitupéré ; les gouvernements qui se succédèrent de 1936 à 1939 renièrent la parole donnée : le traité franco-syrien ne fut jamais soumis à la ratification du Parlement.
Exécution d’une brebis galeuse
Au conseil national des 6-7 novembre 1937, la fédération socialiste du Maroc m’avait donné mandat de la représenter. Elle constituait une exception remarquable. Contrairement aux autres fédérations social-démocrates des pays colonisés qui, composées presque exclusivement de petits métropolitains, voyaient d’un fort mauvais œil les mouvements d’émancipation nationale, celle du Maroc avait épousé résolument la cause des autochtones et elle militait en liaison étroite avec le Comité d’action marocaine, le futur parti de l’Istiqlal. Ses leaders : P. Chaignaud, Gaston Delmas, étaient pourtant des fonctionnaires, enseignants pour la plupart, mais leurs sympathies pour le marxisme, voire le trotskisme, avaient fait d’eux des internationalistes. Le mandat en question m’avait été expressément confié pour me permettre de faire à la tribune du conseil national le procès de la politique coloniale du gouvernement de Front populaire.
La fédération du Maroc était, juste à ce moment-là, à couteaux tirés avec la direction du parti comme avec Léon Blum, devenu vice-président du Conseil dans le gouvernement radical présidé par Camille Chautemps. Le 22 octobre, son journal, Le Maroc socialiste, avait été saisi par la Résidence de Rabat pour avoir combattu la répression déchaînée par le général Noguès contre les nationalistes marocains. Le 25, André Blumel, chef de cabinet de Léon Blum, et Paul Faure, au nom du secrétariat du parti, avaient téléphoné et télégraphié à Chaignaud et à Delmas pour leur signifier à la fois leur « approbation » de la politique autoritaire du résident, un militaire cher au cœur de Léon Blum, et leur « désapprobation » de l’attitude socialiste de la fédération. Ainsi assuré de la confiance des ministres dits socialistes et du parti, le général Noguès, le soir même, se décida à sévir, selon sa propre expression, de façon impitoyable ; les dirigeants du Comité d’action marocaine furent jetés en prison.
Telles étaient les ignominies que je m’apprêtais, au nom de la fédération du Maroc, à produire à la tribune du conseil national. La bureaucratie SFIO décida de me fermer la bouche. Un prétexte purement formel fut aisément trouvé. Pour être délégué, il fallait, aux termes des statuts, cinq années au moins de présence dans le parti et, par suite de ma malencontreuse démission temporaire (de mars 1931 à mai 1935), je n’en comptais que trois et demie, et encore non consécutives. En vain ma section, bonne fille, avait-elle consenti à me laisser payer les cotisations dues pour la période où j’avais été démissionnaire. Mon étouffement parut à la direction du parti affaire non négligeable puisqu’il fit l’objet d’un vote par mandats. Par près de 4?000 mandats contre 798, ma délégation fut annulée.
Cette guillotine sèche était d’autant moins justifiable que j’appartenais, par décision de congrès, à deux organismes dirigeants du parti : conseil d’administration du journal Le Populaire, commission coloniale. Lorsque les trotskistes, en 1934, étaient entrés dans la SFIO, leur ancienneté dans le parti communiste leur avait été comptée et ils purent ainsi être délégués à la commission administrative permanente comme aux assises nationales. N’ayant jamais vendu mon âme à Moscou, je ne pus revendiquer pareille faveur.
La brebis galeuse une fois exécutée, le conseil national s’empressa de blanchir le camarade Marius Moutet. Il le félicita de « l’effort immense » qu’il avait « accompli pour apporter aux populations indigènes plus de justice et plus d’humanité » et lui fit « confiance pour poursuivre l’application de ce programme en surmontant toutes les résistances ».
Si j’ai cru devoir insister sur cet incident de procédure, c’est à cause de sa signification politique et des amers lendemains qu’il nous réservait : la démocratie, tant vantée, de la SFIO,, s’en allait en fumée dès que sa bureaucratie désirait étouffer des voix gênantes.
La lutte décolonisatrice de la Gauche révolutionnaire était orientée dans trois directions :
– harceler et, si possible, tenter convaincre les ministres dits socialistes ;
– faire l’éducation anticolonialiste des militants de base SFIO ;
– soutenir, voire même coordonner, les luttes menées respectivement par les autochtones dans les pays colonisés par la France.
J’ai déjà traité de la première tâche, et de ses piètres résultats.
Pour mener à bien la seconde, nous eûmes recours à des moyens théoriques aussi bien que pratiques.
Il importait, avant tout, car personne dans la social-démocratie française ne s’en était soucié avant nous, de définir un anticolonialisme qui fût internationaliste et révolutionnaire et de l’insérer dans nos perspectives socialistes d’ensemble. Il fallait, notamment, préciser, pour répondre aux objections sans cesse renaissantes qui nous étaient faites, la nature de nos rapports avec ceux des mouvements de libération nationale dont le contenu n’avait pas encore dépassé le stade bourgeois.
Les socialistes révolutionnaires, dans les pays colonisés, devaient, selon nous, s’efforcer de conserver vis-à-vis de ces mouvements l’autonomie politique la plus absolue, empêcher la bourgeoisie de prendre la direction exclusive de la lutte émancipatrice. En même temps, ils avaient à mener une lutte sans compromis contre le féodalisme, le cléricalisme, contre la réaction sociale et le Moyen Âge. Il leur fallait mettre, entre autres, à leur programme, la réforme agraire, les libertés démocratiques, le droit syndical, une législation ouvrière. Le jour où la lutte libératrice prendrait la forme d’un mouvement révolutionnaire de masses, susceptible d’effrayer la bourgeoisie, ils auraient sans doute à prévenir une collusion du nationalisme bourgeois, menacé dans ses privilèges de classe, soit avec les éléments féodaux, soit même avec l’impérialisme. À chaque étape, en bref, ils auraient pour tâche de mettre la bourgeoisie autochtone au pied du mur, jusqu’au jour où ils parviendraient à lui enlever la direction du mouvement pour mettre fin à toute forme d’exploitation, nationale ou sociale, sous le drapeau du socialisme.
J’avais été le rédacteur de ce morceau doctrinal, et je n’y avais aucun mérite, car il s’inspirait, dans ses grandes lignes, des écrits de Lénine et des plates-formes des quatre premiers congrès de l’Internationale communiste. Son seul défaut était son irréalité. Les socialistes, dans les pays colonisés, étaient, on l’a déjà dit, des Européens, des « petits blancs » à mentalité colonialiste. Quant au socialisme révolutionnaire et internationaliste, c’était une monnaie qui n’avait plus cours nulle part, sauf dans notre petit groupe et dans les quelques groupuscules étrangers avec lesquels nous avions noué, à défaut d’une adhésion à la fantomatique IVe Internationale, des liens fraternels. Qu’espérer, par ailleurs, du Komintern, qui domestiquait les mouvements anticolonialistes pour les asservir aux impératifs changeants de la diplomatie russe?? Il était chimérique, dans ces conditions, de prétendre enlever à la bourgeoisie autochtone la direction d’une lutte que, d’ailleurs, à cette étape de l’évolution, elle menait avec ténacité et un sens politique assez remarquable.
Notre tâche pratique consistait à alerter nos militants par des articles de presse, des causeries faites dans les sections, des réunions d’information, des interventions dans les assises du parti sur la gravité du problème colonial. Il fallait, à tout prix, percer le mur de l’indifférence. Nous n’y parvenions pas toujours.
Une fois le gouvernement Blum au pouvoir, le soutien des mouvements autochtones devint la partie la plus positive de notre effort. Nous obéissions d’ailleurs à des mobiles moins altruistes que politiques. Nous savions que, comme sur le champ de bataille intérieur, seule l’action directe des masses était capable de désembourber le Front populaire. C’étaient donc les peuples colonisés eux-mêmes qui, par leur constante pression, devaient contrebalancer celle exercée par le colonialisme sur nos ministres. Mais la bureaucratie SFIO tenait aux colonisés exactement le même langage qu’aux travailleurs français : patience, sagesse, confiance. Elle les invitait à renoncer aux exigences « utopiques », c’est-à-dire aux promesses qui leur avaient été faites solennellement au congrès de Huyghens, et à ne pas « gifler en plein visage », comme l’avaient fait ces malotrus de grévistes sur le tas, « leur » gouvernement de Front populaire.
Extrait publié par Contretemps
Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée, Marseille, Agone, 2013, 504 pages (Avant-propos de Charles Jacquier, préface de Barthélémy Schwartz).
A lire dans notre dossier
• Le Front Populaire survint dans un pays à la tête du second Empire colonial du monde, à une époque où les doutes en ce domaine étaient strictement minoritaires : Le Front populaire et les colonies, par Alain Ruscio
• Dans cet extrait de son Front Populaire, révolution manquée (1963), Daniel Guérin relate son expérience de la Commission coloniale de la SFIO : « On ne tient pas parole aux colonisés » : le témoignage de Daniel Guérin
• Dès la première moitié du XIXème siècle, les socialistes se sont divisés sur la légitimité de l’expansion coloniale : Ligue des droits de l’Homme, socialistes et communistes et la question coloniale lors du premier Front populaire