![Séghira, Fatima et Salah, mari de Séghira. [ Photo prise au domicile de Séghira, le 6 mai 2006, alors que Fatima recueillait son témoignage. ] Séghira, Fatima et Salah, mari de Séghira. [ Photo prise au domicile de Séghira, le 6 mai 2006, alors que Fatima recueillait son témoignage. ]](https://histoirecoloniale.net/wp-content/uploads/2006/09/seghira_fatima_salah.jpg)
Des deux côtés de l’amer
Au mois de mai dernier, Fatima Besnaci-Lancou était à Rosans.
Après Roubaix, Marseille, Clermont-Ferrand, Paris ou Rouen, elle mettait dans les Hautes-Alpes un point final à un travail de longue haleine.
Après un premier ouvrage autobiographique, “Fille de harki”, l’écrivaine a décidé de recueillir les témoignages des femmes de
harkis de la première génération, celles qui sont arrivées en France en 1962 avec leurs maris, et de les regrouper au sein d’un ouvrage
intitulé “Nos mères”. “ À la publication de mon premier livre,
beaucoup de femmes m’ont dit : «on a des choses à dire, on a besoin de se confier, de laisser une mémoire». 40 ans après, elles ont envie d’être lues, de parler de la déchirure du départ”.
Avant la douleur du déracinement, il y a donc eu la violence d’un départ sous les jets de pierres. Un épisode d’autant plus douloureux
que la plupart de ces familles n’ont pas fait “le choix de la France”; la fuite s’est faite dans l’urgence.
“Les Harkis, ce n’est pas un drame militaire. Ce sont des milliers
de femmes et d’enfants précipités dans l’inconnu”.
L’inconnu sera d’abord dessiné par la géométrie rectiligne et cloisonnée d’un camp. Comme beaucoup de leurs contemporaines,
la plupart de ces Rosanaises sont passées par Rivesaltes dès la fin de
l’année 62. Ce camp militaire des Pyrénées-Orientales est resté à jamais gravé dans leur mémoire.
Pourtant, la plupart de ces femmes évoquent ce souvenir pour la première fois. “C’est universel, la victime ne parle pas rapidement”, analyse Fatima. “Mais le fait d’avoir une parole portée par une femme, ça a légitimé la génération au-dessus à s’exprimer”. La légitimité, elles l’ont toujours eu. Il leur restait à en prendre conscience et à
briser le silence dans lequel elles ont trop longtemps été enfermées.
“C’est universel, la victime ne parle pas rapidement”
Par petites touches, l’écrivaine accompagne ces femmes que la parole délivre de leurs trop lourds secrets. Petit à petit, les souvenirs sont exhumés. Le premier hiver dans le camp : “on faisait fondre la neige pour faire les biberons”. La promiscuité dans les tentes sous lesquelles s’entassaient les familles quatre à quatre : “on n’entendait
pas que les ronflements”. La barrière de la langue entre les ethnies.
Les vêtements parfois douteux récupérés à la Croix-Rouge. Etc.
Fatima s’attache avant tout à l’émotion de ces femmes ; des sentiments
qui, trop longtemps tus, jaillissent au bout de 40 ans. Et leur constat sur leurs deux pays est amer. “L’Algérie nous traite de traîtres, mais la France nous a trahis”, assène Malika.
“ Heureusement qu’on avait nos femmes pour nous aider à porter le drame ”
Loin de toute idée reçue, ces paroles féminines appellent à la réflexion. Elles apportent un éclairage nouveau et enrichissant sur l’histoire des Harkis. “Beaucoup d’hommes m’ont dit : « Heureusement
qu’on avait nos femmes pour nous aider à porter le drame ». Elles ont
été des béquilles pour les maris. Il est temps de les entendre. Faire ce travail avec elles, c’est leur rendre hommage”.
Et ce travail de mémoire est essentiel. Pour celles qui s’expriment et qui trouveront dans ces mots, couchés sur le papier d’un livre, une reconnaissance de leurs souffrances, certes tardive mais qui a le mérite d’exister.
Pour celles de la même génération qui s’y reconnaîtront et pourront peut-être ainsi s’en inspirer pour briser à leur tour le silence.
Pour tous les Français et les Algériens aussi, que cette histoire ne peut laisser indifférents et qui, loin d’attiser les rancoeurs, doit être la pierre angulaire de la réconciliation.
Mais il est surtout indispensable pour tous les enfants de cette génération qui, pour beaucoup encore, vivent dans le malaise du non-dit.
Comme Sonia. Cette jeune fille de la troisième génération, aujourd’hui
âgée d’une quinzaine d’années, aura dû attendre la venue de Fatima Besnaci-Lancou à Rosans pour apprendre que ses aïeux sont passés par des camps.
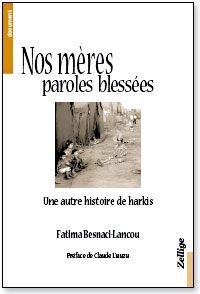
Le témoignage de Zohra, 63 ans
À l’indépendance de l’Algérie je n’avais que 19 ans. Je venais de me marier et je n’avais pas encore d’enfants. Mon mari était harki. Il avait pu choisir de rester dans l’armée française et de partir vers la France. Il m’a demandé de partir avec lui mais j’ai refusé. J’avais peur de l’inconnu et je ne voulais pas quitter mes parents et mes frères. Avant qu’il ne traverse la Méditerranée, je lui ai rendu visite à la caserne de Miliana, en compagnie de ma belle-mère et de mon beau-frère Mohamed. C’est là qu’il a su que je ne l’accompagnerais pas. Je suis donc restée avec mes parents, mon frère aîné, ma belle sœur et ses quatre enfants. Mon plus jeune frère, lui, avait quitté Novi et il était parti vivre à Alger avec son épouse et son fils.
L’été 1962, lorsque des harkis et des anciens fonctionnaires de l’administration française furent tués, mon père et mon frère partirent pour Paris afin de protéger mon père. Il était ancien fonctionnaire. Mes frères n’étaient pas harkis.
Nous n’étions plus que trois femmes à la maison, avec les enfants. Nous ne nous sentions pas en sécurité. Les exécutions des « pro-français » continuaient. Ma belle-sœur avait envie de partir pour la France. Sa mère et ses frères, presque tous des harkis, étaient partis en France. Un jour, je finis, par écrire à mon mari pour lui demander de nous faire les papiers pour partir avec ma mère et ma belle-sœur. Il me les a fait parvenir assez rapidement.
Je suis allée à Cherchell, où il y avait encore des bureaux de l’administration française. Je crois qu’ils étaient rattachés à l’ambassade de France. J’ai remis nos documents et on m’a demandé de revenir les chercher dans une semaine. Ça a été rapide. En nous remettant les autorisations, les fonctionnaires nous conseillèrent de partir le plus rapidement possible.
Nous étions entassés dans un taxi de Novi. Le chauffeur nous connaissait bien. C’est un proche de la famille. Il nous avait dit : « Si c’est notre jour, nous mourrons tous ensemble ». Il avait beaucoup de courage. Il nous a emmenés jusqu’à l’entrée de la caserne de Zéralda. Là, nous sommes montés dans un camion qui nous a ensuite déposés devant des bâtiments de l’armée. Il y avait beaucoup de monde. Des kabyles, des Chaouis. Beaucoup de personnes de toutes les régions d’Algérie. Nous avons retrouvé là des gens de Novi comme la famille Ferroudj. Ils étaient partis pour la France avant nous.
Nous sommes restés plusieurs mois à Zéralda. Nous dormions sur des matelas de paille. Nous avons dû les laver avant de coucher dessus. Ils sentaient l’urine et étaient noirs de saleté. Nous mangions les mêmes plats que les militaires. Nous allions chercher nos rations au réfectoire de la caserne.
Un jour, un officier était venu nous annoncer que nous faisions partie du lot qui allait partir vers la France. Le militaire m’informa que ma belle-sœur et ses enfants ne pouvaient pas partir parce que mon frère n’était pas harki. Il me donna l’autorisation, seulement pour ma mère. Je me souviens l’avoir imploré pour qu’il accepte ma belle-sœur. J’ai longuement argumenté en lui disant qu’elle était seule. Que son mari était en France. Que ses frères étaient harkis et déjà partis en France. Il a fini par accepter. Je n’aurais jamais eu le courage de la laisser seule avec mes neveux et nièces.
Deux ou trois jours avant le grand départ, un officier de l’armée est venu me voir pour me remettre une caisse en bois. Il me dit qu’il en avait seulement deux. L’autre, il l’avait remise à un harki de Gouraya. J’étais un peu surprise car je n’avais rien demandé. Je ne me suis pas méfiée non plus lorsqu’il était revenu pour clouer la malle en bois dans laquelle nous avions entassé des couvertures et quelques affaires dont on n’avait pas besoin tous les jours. Le soldat a mis une étiquette avec mon nom. Il n’a pas mis mon nom de mariée mais mon nom de jeune fille. Je trouvais ça bizarre aussi mais je ne disais rien. La malle était avec les bagages ordinaires.
Nous sommes partis vers le port d’Alger dans des camions bâchés. Tout était bien fermé. Il faisait tellement sombre dans les véhicules que l’on pouvait à peine se reconnaître. Nous avions l’ordre de ni parler, ni bouger. Il fallait surveiller les enfants et les empêcher de pleurer. Il ne fallait pas attirer l’attention des gens à l’extérieur. Dans les convois précédents, les gens avaient reçu des projectiles de toutes sortes : des cailloux, des boites…
Comme pour presque toutes les familles de harkis, nous avons voyagé dans les cales du bateau. Le paquebot « Le Kérouan » a mis 4 jours pour arriver en France. Nous avions une halte à Oran pour récupérer des familles de harkis de Tlemcen. Sur le port, nous étions remontés sur le pont pour prendre l’air. Des insultes et des jets de pierres nous attendaient. Les gens criaient : « Partez traîtres. Que la mer vous engloutisse. ». C’est dans la précipitation et des cris, que les militaires nous poussèrent vers la trappe qui nous ramena vers les chaises pliantes en bois de la cale.
Arrivés à Marseille, vers le 5 décembre 1963, nous avons passé plusieurs heures dans une caserne avant de partir pour le camp militaire de Rivesaltes. Là, on nous a donné à manger et à boire. C’est là aussi que j’ai vécu la deuxième étape de mon histoire de malle en bois. Un officier blond, avec une petite moustache fine est venu vers moi pour me demander de payer le transport de la caisse. J’ai eu peur parce que je n’avais pas d’argent. Je lui dis que je pensais que le transport des bagages était pris en charge par l’État français. Avant qu’il ne me réponde, ma mère sortit un petit porte-monnaie et me dit de prendre le contenu pour payer. Elle ne voulait surtout pas que l’on se fasse remarquer. Il me remit un justificatif que je me suis empressée de ranger soigneusement dans mes affaires. Je me posais de plus en plus de questions. J’avais un mauvais pressentiment.
En fin de journée on nous a demandé de remonter dans les camions pour aller à Rivesaltes. La noria de véhicules se mit en route. Il faisait déjà nuit. J’ai su bien des années plus tard que l’État français nous cachait. Nous devions être invisible aux yeux des français. Voilà pourquoi on nous déplaçait seulement à la tombée du jour.
À Rivesaltes, nous avons été logés dans des baraques en dur. Nous n’avons pas connu les tentes militaires. Comme à Zéralda, nous étions dans des pièces immenses à plusieurs familles. Les fenêtres étaient hautes pour ne pas être vu de l’extérieur. On aurait dit des prisons. Comme à Zéralda, la literie en paille était très sale. Nous l’avons soigneusement lavée avant de dormir dessus.
Huit jours après notre arrivée dans ce lieu entouré de fils barbelés, un gendarme et deux militaires sont entrés dans ma baraque et m’ont demandé de les suivre dans un bureau militaire. J’ai eu tellement peur que je n’arrivais même pas à me poser des questions. J’avais la tête vide et je tremblais. En fait, j’allais vivre la troisième étape de mon histoire de malle en bois. La porte du bureau se referma. Je restai debout. Un des hommes me demanda combien j’avais de caisses en bois. Je lui répondis que j’en avais qu’une seule. Il me répondit qu’il y en avait deux à mon nom. Là, j’ai cru bon de lui préciser qu’à Zéralda un harki de Gouraya avait eu aussi une caisse en bois. Qu’il devait y avoir simplement une erreur d’étiquetage. Il me précisa qu’avec la sienne, ça faisait trois caisses en tout. Je ne comprenais plus rien. J’avais peur. Ca ressemblait à un cauchemar. Que me voulaient-ils ? Je pressentais que quelque chose de tragique se tramait dans mon dos. Je me suis mise à jurer que je n’avais qu’une seule caisse qui contenait des couvertures et quelques affaires personnelles. Ils se regardèrent. Ils firent des signes de la tête, puis ils me demandèrent de retourner dans ma baraque. Je pleurais en chemin. Que m’arrivait-il ? Quand le malheur allait-il s’arrêter ? Du haut de mes 19 ans, je faisais le bilan de ces dernières années : une guerre atroce, des gens que j’aimais se sont fait tuer pendant la guerre et à l’indépendance, la séparation d’avec mon mari, le départ de mon père et de mon frère, la fuite vers la France… c’était trop pour mes épaules de jeune femme. Je pensais qu’en arrivant en France, j’allais enfin être protégée mais voilà qu’on me harcelait pour une caisse en bois. J’avais l’impression que l’on me soupçonnait de vol. Ce que j’allais découvrir quelques jours plus tard était bien plus dramatique qu’un éventuel vol de caisse.
Après le premier interrogatoire, je ne m’attendais pas à en subir deux autres. C’est lors de mon troisième passage devant ce qui ressemblait à une assemblée de juges, face à un accusé, que j’allais comprendre enfin le mystère de l’affaire de la « Caisse » en bois. Un officier de l’armée française m’apprit sans ménagement que la malle en bois contenait des armes comme des mitraillettes et des grenades. Je venais d’être victime de l’OAS. Quarante ans après j’en souffre encore et en vieillissant des cauchemars hantent mes nuits de plus en plus. Sans généraliser, j’estime que certains militaires n’ont pas été corrects avec les familles de harkis. Ils ont profité de notre fragilité et de notre désarroi. J’y penserai jusqu’à la fin de ma vie. Quand je songe qu’à cette époque là on guillotinait encore, j’en tremble ! Ce qui m’a sauvé dans cette histoire c’est d’avoir bien décrit la blondeur des cheveux et de la moustache du lieutenant qui m’avait fait payer le transport de la malle. J’avais eu aussi la chance de pouvoir leur montrer le genre de képi que portait le type. Pour clôturer l’affaire, un des officiers m’a simplement demandé de retourner dans ma baraque et dit de ne plus avoir peur. C’était fini pour moi. Quelques jours après, un militaire m’a informée de l’arrestation du gars de l’OAS. Personne ne m’a jamais exprimé de regrets.
L’aventure que je venais de vivre est le fait le plus traumatisant que j’ai vécu mais personne ne s’est soucié de savoir ce que j’étais devenue après ça. Mon histoire de « Caisse » en bois ne s’arrêtera pas comme ça dans ma tête. Je ne suis jamais retournée au camp de Rivesaltes. Je ne veux pas raviver encore plus ce moment de détresse totale.
Le premier janvier 1964, nous étions encore à Rivesaltes. On nous a distribué des dattes. Nous sommes restés seulement une vingtaine de jours à Rivesaltes. Mon père et mon frère sont venus nous rejoindre. Mon mari qui était encore militaire était venu en permission pour nous voir. Les autorités voulaient nous envoyer dans le camp d’enfermement de Bias. Ils trouvaient que mes parents âgés ne pouvaient aller qu’à Bias où étaient accueillis les invalides, les vieillards et les handicapés. Nous avons refusé fermement. Une famille de Novi, les « Fedlaoui », nous avait dit que même la misère dans les montagnes en Algérie était plus douce que la vie à Bias.
Fin janvier 1964, nous sommes partis à Vic-le-Comte dans le Puy-de-Dôme. Nous avons voyagé par le train avec la famille Simiane.
À Vic-Le-Comte, la solidarité entre gens de Novi fonctionnait très bien. C’est un homme que l’on surnomme « Babour » et sa famille qui nous ont hébergés. Nous couchions par terre et partout dans la maison, même dans la cuisine et le grenier. Nous étions entassés mais plus heureux qu’au camp militaire de Rivesaltes avec ses fils barbelés.
Il fallait trouver rapidement où nous loger et nous étions nombreux. Le vieux M. Marès, de Novi aussi, qui habitait à Vic-Le-Comte depuis trois ans avec sa femme qu’on appelait « Tata Aïcha », nous indiqua une maison à vendre à Parent. Parent est un petit bourg à 3 ou 4 kilomètres de Vic-le-Comte. Nous n’avions bien sûr pas d’argent pour louer et encore moins pour acheter une maison.
Les propriétaires, Monsieur et Madame Montagnon, nous proposèrent d’habiter la maison sans payer. Ils étaient très gentils. C’était une très vieille bâtisse. Il n’y avait pas de carreaux aux fenêtres et des puces s’accrochaient à nos jambes dès que l’on pénétrait dans la maison. Il faisait très froid et nous n’avions pas de quoi nous chauffer. Je n’oublierai jamais la gentillesse aussi de M. Brun, le propriétaire des autobus et du bar à Vic-Le-Comte. Il s’est occupé de nous comme de sa famille. Il nous a donné du bois. Il a cloué des cartons aux fenêtres pour nous préserver du froid et rendu un tas de services. Nous n’avions rien. Ni table, ni chaises, ni lit. Rien. M. Brun est toujours en vie. Lorsque je le rencontre, je vais toujours le saluer. Je n’oublierai jamais ce qu’il a fait pour nous.
Nous avons organisé notre nouvelle vie en Auvergne petit à petit. Les hommes se sont mis à la recherche de travail. Madame Pétersen, une assistante sociale de Clermont-Ferrand, par l’intermédiaire du vieux Monsieur Marès, nous a donné quelques affaires pour démarrer. Un jour mon père a reçu un peu d’argent pour les rapatriés et a payé la maison.
Quarante ans après, je pense que j’ai tout ce qu’il faut matériellement : une maison que nous avons achetée, une retraite qui nous fait vivre correctement mais je souffre énormément de l’ennui. Les vieux sont morts. Beaucoup sont partis vers des villes plus grandes. Il n’y a rien à faire ici. Quelques fois, avec ma belle sœur Yamna, nous allons nous recueillir sur les tombes de nos proches. Ils sont nombreux maintenant. Nous souffrons en pensant à notre vie et à notre destin loin de chez nous.
L’Algérie ? Je ne pense pas que le président de la République algérienne d’aujourd’hui arrange les choses vis à vis des harkis. J’espère qu’il laissera les gens circuler librement pour voir leur pays. Mon mari, quant à lui, ne veut plus en entendre parler. Pourtant, il y a laissé toute sa famille : sa mère, décédée maintenant, et ses frères qui vivent toujours à Novi. Moi j’y suis retournée, il y a 4 ans. J’adore retourner là-bas même si je ne reconnais plus mon village. À notre époque, il me semble qu’il y avait moins de monde. Maintenant la rue principale est noire de monde. Ca se construit partout. Bien que tout soit changé, je m’y sens bien. C’est chez moi.

![Séghira, Fatima et Salah, mari de Séghira. [ Photo prise au domicile de Séghira, le 6 mai 2006, alors que Fatima recueillait son témoignage. ]](https://histoirecoloniale.net/wp-content/uploads/2006/09/seghira_fatima_salah-300x150.jpg)
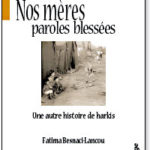
![Séghira, Fatima et Salah, mari de Séghira. [ Photo prise au domicile de Séghira, le 6 mai 2006, alors que Fatima recueillait son témoignage. ]](https://histoirecoloniale.net/wp-content/uploads/2006/09/seghira_fatima_salah-150x150.jpg)