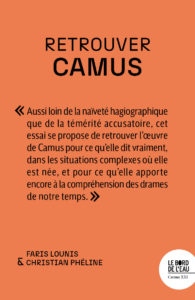Nous avons déjà signalé la publication aux éditions Au bord de l’eau, en 2024, du livre Retrouver Camus de Faris Lounis et de Christian Phéline, ce dernier étant membre de la rédaction de notre site. Il se situe dans un contexte où l’ouvrage d’Olivier Gloag, Oublier Camus, paru en 2023, qui a présenté Camus comme un défenseur de la colonisation de l’Algérie, a suscité des critiques diverses. Notre site a fait écho à ce débat. Il a publié un article de Sarra Grira favorable au livre d’Olivier Groag, la critique de ce livre par Nedjib Sidi Moussa, et aussi un article plus nuancé de Christiane Chaulet Achour, qu’évoque pourtant avec sévérité le livre Retrouver Camus. Afin de continuer à alimenter ce débat, voici, en guise de « bonnes feuilles », l’introduction et la conclusion du livre de Faris Lounis et Christian Phéline.
Tout indique que la controverse n’est pas close. Elle se poursuivra notamment lors du colloque « Camus et l’Algérie coloniale » qui se tient les 18 et 19 mars 2025 à Paris, à l’Institut du Monde Arabe.
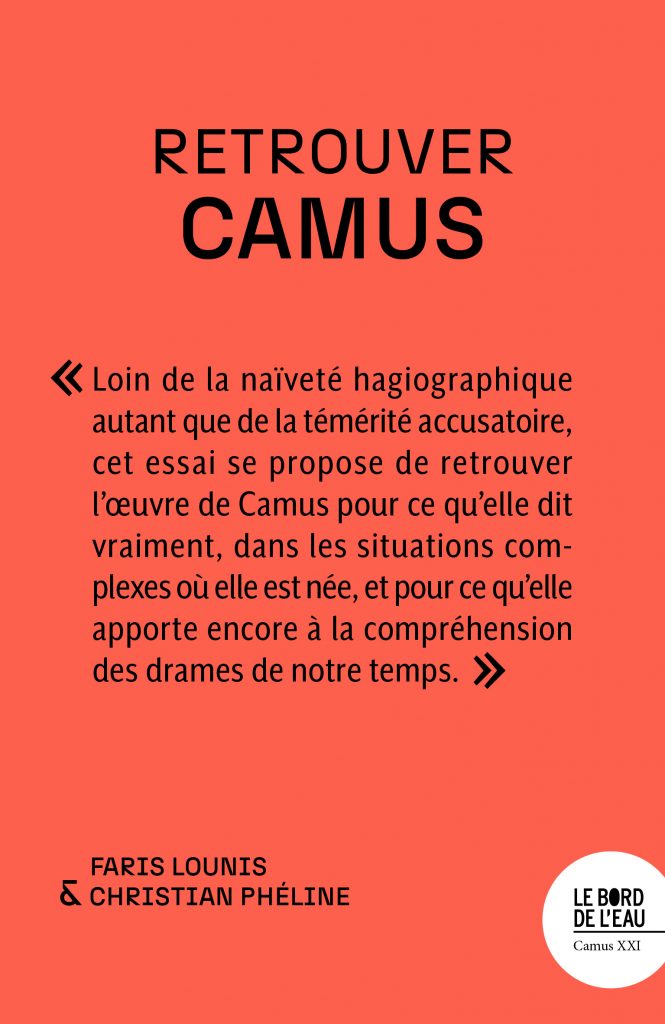
Introduction
L’opération Oublier Camus : tristes tropismes…
– Alors, je me demande s’il faut encore lire Camus et surtout, s’il faut continuer à le proposer dans les écoles et dans les programmes d’enseignement…
Sous sa forme interrogative, cet appel fut la dernière intervention du public lors de la soirée du 11 octobre 2023 au Cirque électrique à Paris.
Il s’agissait de l’une des multiples tribunes qu’aura offertes à Olivier Gloag, professeur associé en Caroline du Nord, le titre, bien propre à faire le buzz, d’un pamphlet publié à la rentrée 2023, Oublier Camus, selon lequel chacun des actes et propos de l’écrivain n’aurait été que ruse d’un « colonialiste » de la dernière heure. La glaçante proposition de déprogrammation scolaire de l’écrivain a cependant bien montré quel écho un exercice aussi outrancier pouvait trouver auprès de tout un public qui se sent, non sans raisons, discriminé et stigmatisé dans un pays se refusant encore à reconnaître les faits les moins glorieux de son passé colonial et à extirper vraiment les comportements racistes qui en sont issus.
« Non, il est important de lire Camus ! », était-il certes répondu – sans qu’il soit expliqué comment donc et pourquoi lire un écrivain si détestable que l’on devrait l’oublier... Mais c’était pour pousser un peu plus loin l’accusation : s’il fallait encore étudier Camus, ce ne serait en effet que « comme pièce à conviction de ce qu’était le colonialisme français » et pour l’ériger, à lui seul, en totem expiatoire de trois siècles d’exactions impériales.
Cet échange est bien révélateur des objectifs de la vive offensive idéologique dont un tel libelle a donné l’occasion. Il aurait certes été salubre d’aller à contre-courant de l’actuel unanimisme médiatique qui, affadissant l’écrivain pour en faire un simple penseur du juste milieu, l’expose aux récupérations les plus suspectes, de celle, aussi claironnante qu’abusive, de Michel Onfray, à celles de la droite ouvertement xénophobe et raciste. Cela aurait conduit à en revenir, avec la distance et la pondération de l’histoire, à la réalité de ses prises de position, évaluées sans anachronismes contextuels ni méconnaissance du statut différencié de ses modes d’écriture. Nous sommes plusieurs au niveau international à tenter de le faire en nous gardant tant de la naïveté hagiographique que de la témérité accusatoire.
Telle n’est en rien l’approche de ce brûlot, contrairement à ce que voudrait laisser croire son préfacier Fredric Jameson selon qui « ses critiques visent moins Camus lui-même que sa canonisation mainstream ». Le fait que l’écrivain ait eu le tort de ne pas se prononcer pour l’indépendance algérienne avant sa mort en 1960, loin d’inviter à en évaluer sereinement les motivations, autorise à dénoncer toute sa trajectoire comme une apologie de la domination coloniale, aggravée en outre d’« anticommunisme ». Procès tout à charge qui, on le verra sur pièces, fait autant violence à l’histoire (en ne rapportant pas les textes ou prises de position à leur conjoncture politique exacte) qu’à la littérature (en confondant le plus souvent le point de vue du romancier et celui de ses narrateurs ou personnages) ; les articles de l’écrivain ne sont pas mieux traités tant leur lecture partielle et partiale conduit souvent à en fausser, voire à en inverser, le propos. Pour sa croisade en France, le polémiste aura cependant été encouragé à étendre avec autant de parti pris sa mise en cause de Camus tout à la fois à son rôle de résistant à l’occupant, à sa lutte contre la peine capitale, ou comme hérault de la pire idéologie « sexiste ».
Malgré les approximations, anachronismes ou bourdes de lecture dont se nourrit sa malveillance, ce pamphlet a trouvé de multiples promoteurs et relais propres à en propager le mode de pensée sommairement binaire. À commencer par La Fabrique, maison d’édition qui, sous la conduite de son fondateur, le pugnace et très inquisitif Éric Hazan, récemment disparu, a notamment publié de courageuses prises de position sur le conflit israélo-arabe émanant d’auteurs tant palestiniens qu’israéliens. Depuis quelque temps l’accent est mis, sans reculer devant les effets de marketing, sur des ouvrages se réclamant d’une résistance aux formes d’oppression et d’injustice subies par les citoyens issus des anciennes migrations coloniales et au regain des violences qu’ils subissent. Le risque est cependant qu’à absolutiser l’indispensable combat contre de telles discriminations, cet « antiracisme politique » ne perpétue, en en inversant les signes de valeur, les barrières auxquelles ces citoyens se heurtent dans l’espace public et leur assignation à une essence supposée d’« immigrés », de « musulmans», de « jeunes des cités » ou de potentiels « radicalisés ». Alors que le débat public banalise par ailleurs les thèses de la « préférence nationale », ce serait, par une fétichisation du seul antagonisme entre « les Blancs » et « les Autres », détourner ces derniers des solidarités de classe et du combat plus large contre la dérive antidémocratique de l’État et la déstructuration néo-libérale des acquis sociaux.
Comme il lui en exprime la gratitude, l’auteur d’Oublier Camus a par ailleurs été d’emblée « aidé dans son projet » par la chercheuse Christiane Chaulet Achour. Membre d’une fratrie de Français d’Algérie connue pour son soutien actif au FLN dès avant 1962, celle-ci s’est affirmée de longue date à l’université d’Alger comme l’une des meilleures spécialistes de la littérature de langue française.
Le recueil Quand les Algériens lisent Camus (2015), qu’elle a codirigé, a par ailleurs contribué, en se gardant de la « camusmania » comme de la « camusphobie », à faire découvrir la diversité du rapport à l’écrivain des intellectuels et romanciers algériens sur plus de trois générations Tout en publiant un recueil de ses propres lectures camusiennes récentes, Albert Camus, le poids de la colonie. Une œuvre, des contemporains, des lecteurs (2023), Christiane Chaulet Achour s’est cependant empressée d’apporter au pamphlet de La Fabrique un éloge bien imprudent dans son inconditionnalité. Ni sa science des textes, ni son expérience des vicissitudes réelles de l’histoire algérienne ne l’ont détournée de s’émerveiller devant les « 348 notes » de « cette somme de lectures impressionnante », sans s’inquiéter des multiples contre-vérités, contresens, voire falsifications qu’elle recouvre. La bruyante conjonction de soutiens dont a bénéficié le libelle suffit en outre à démentir la surenchère doloriste dans laquelle son auteur et Christiane Chaulet Achour soutiennent que toute pensée non conformiste sur l’écrivain serait privée « dans la France actuelle » du droit à « se faire entendre ».
Indépendamment de ces crispations polémiques, l’annonce choc faite par La Fabrique de son ouvrage de rentrée a suffi à attirer de nombreux participants algériens ou franco-algériens. Loin de les inciter à un retour circonstancié sur les différenciations complexes et évolutives du champ politique algérien sous la période coloniale, le propos manichéen d’Oublier Camus n’a fait que les ré-enfermer dans les poncifs d’une légende patriotique officielle qui, hormis des héros indiscutés et ceux qui les ont soutenus sans réserve, ne connaît toujours que traîtres ou suppôts du colonialisme.
C’était redoubler une mémoire sanctuarisée de la lutte de libération nationale et dissuader toute réflexion sur les sources intrinsèques de l’induration autoritaire dès 1962-1965 du régime qui en est issu. À côté de quelques timides doutes émis sur certaines des outrances de l’orateur ou de l’expression d’un « trauma colonial » toujours présent pour beaucoup, le public ne s’est dès lors saisi de la question Camus que pour ressasser la vieille accusation : « Entre la résistance et ma mère, je choisis ma mère, Fermez le ban ! », sans autre examen de l’objet exact de ce propos, ni de l’ultime position, désormais connue, de l’écrivain en faveur de l’autodétermination. De tels épisodes traduisent bien l’effet d’intimidation intellectuelle et d’appel à la surenchère que portent les excès mêmes de proclamations se voulant tant décoloniales que postcoloniales. Ils manifestent aussi comment leur appel à une fière réaffirmation de soi au sortir d’un assujettissement séculaire, tend à enfermer leurs auditoires dans la posture désespérante d’opprimés cultivant un ressentiment inextinguible contre l’inhumanité de l’entreprise coloniale qui a façonné leur destin et qui, à plus d’un égard, le gouverne encore.
On pourrait enfin s’étonner qu’Oublier Camus ait été d’emblée célébré au cœur même des institutions les plus exigeantes de la recherche en histoire de la littérature. On ne saurait en effet avoir que sympathie intellectuelle pour ces deux séminaires de jeunes chercheurs dont l’un, rue d’Ulm, entend « réinscrire les phénomènes littéraires dans le contexte historique, économique ou sociologique de leur production », et l’autre, aux Grands-Moulins de Tolbiac, veut interroger les « interactions entre styles, individuels ou collectifs, et positions politiques ». Quant à Vincent Berthelier, animateur de l’un et l’autre de ces groupes, son essai Le Style réactionnaire : de Maurras à Houellebecq (2022) a prouvé toute l’actualité de son questionnement. Vulnérabilité à l’air du temps ?
Ces deux cercles auront en tout cas bien hâtivement érigé un essai aussi peu rigoureux, en modèle d’un renouveau critique se voulant fondé sur une approche historiquement et politiquement informée de la littérature. Au total ce sont donc d’assez tristes tropismes qui se seront rejoints autour de cet ouvrage. Tristes, moins parce que de sincères fidélités aux luttes de libération nationale d’antan se refusent trop souvent à interroger les menaces pour l’avenir que recelaient nombre de leurs directions, et l’inconditionnalité de certains des soutiens qu’elles ont reçus. Tristes, moins parce que les indispensables résistances à toutes les formes de la violence postcoloniale dans notre société peinent à se donner des objectifs qui fassent vraiment réparation et ouvrent la voie à un dialogue civique égalitaire. Mais tristes, surtout quand des intellectuels en position d’auteur, d’éditeur, de chercheurs, de médiateurs culturels, loin de tenter d’ouvrir à ces fidélités et à ces résistances une visée démocratique universalisante, les instrumentalisent pour perpétuer des lectures simplistes de l’histoire et les fractures ethnico-sociales héritées de cette dernière, plutôt que d’œuvrer à leur dépassement critique.
Sur le fond, on le verra, la vive charge idéologique menée ici contre Camus se limite pour l’essentiel à reprendre, étendre et parfois pousser jusqu’aux surinterprétations les plus arbitraires les griefs de certains écrits postcoloniaux. L’hégélianisme ici invoqué à tout-va se réduit à passer chaque prise de position ou expression symbolique au crible de couples d’antonymes idéels qui ne sont pas plus rapportés aux circonstances précises du débat qu’ils ne font la moindre place à la gradation, la contradiction interne ou le mouvement évolutif. Dans une vision de l’histoire n’admettant que des alternatives binaires telles que Colonialisme versus Indépendantisme, Anticommunisme versus Communisme, Non-Violence versus Violence révolutionnaire, l’exercice de cette pensée se voulant critique se résume à un moralisme aussi abstrait que péremptoire ne sachant délivrer que le blâme le plus grave ou la glorification sans réserve. De même, dans une indigence tout essentialiste, cette approche ramène toutes les différenciations intellectuelles et politiques dans les dernières décennies de l’Algérie sous domination française au seul antagonisme ethnique « Algériens »/« Pieds noirs » et au choix ou au refus d’une indépendance appelée à consacrer cet antagonisme sur un mode nécessairement exclusiviste.
Camus n’est comptable d’aucune récupération
Le sens de la nuance permis par la distance historique est tout autant absent de la manière dont, à sept décennies de distance, le débat Sartre-Camus se trouve ici rejoué dans une longue narration manichéenne (53-109) où, de 1938 à 1960, la célébration toujours superlative de la lucidité et de l’entièreté des engagements de l’un est opposée, dans « un antagonisme irréductible (54) », à ce que serait l’inconsistance intellectuelle et morale de l’autre. Pour notre part, nous nous garderons bien de nous livrer en faveur de Camus à l’exercice inconditionnel ainsi développé à l’égard de Sartre, nous limitant ci-après à rétablir, sur les points où ce sera nécessaire, les termes exacts du débat qui a opposé ces deux penseurs.
Nous n’entrerons pas davantage dans la paradoxale mais complaisante complémentarité de rôles qui s’est établie entre l’auteur d’Oublier Camus et les plumitifs de la presse la plus nettement marquée à droite pour qui ce n’était que nouvelle occasion de se livrer à sa traque obsessionnelle du« wokisme », de la « cancel culture » ou du « communautarisme ». Mais, pour finir, ce déferlement aura permis au pamphlétaire d’éluder toutes critiques de sa désinvolture à l’égard de la réalité des textes et des contextes, pour se persuader qu’avoir ainsi contre lui tout l’establishment, et même « une union allant du Monde libertaire au Figaro », prouvait bien comment son combat était juste et ses conclusions inattaquables. Rien n’y gagne au total qu’un face-à-face entre deux modes de pensée aussi caricaturaux l’un que l’autre.
Heureusement, Camus n’est comptable d’aucune des récupérations qui, à des fins qui lui sont bien étrangères, réduisent sa pensée à quelques maximes passe-partout, ou ne reprennent les termes anti- autoritaires de sa dénonciation des crimes staliniens que pour disqualifier per se tout combat d’émancipation sociale et citoyenne.
Heureusement, il est à son sujet un autre « discours de gauche » que celui qui s’acharne contre lui pour réintroduire une compréhension de l’histoire du siècle dernier héritée des temps de la Guerre froide. Sans nous enfermer dans le débat pipé entre plumitifs réactionnaires défendant Camus pour mieux le dévoyer, et un contempteur pseudo « progressiste », nous réfuterons donc tour à tour les lectures abusives que ce pamphlet s’autorise des positions civiques de l’écrivain comme de ses fictions, et pointerons les enjeux de débat toujours actuels qu’une telle malveillance tente d’éluder.
Ce nécessaire exercice critique aura été au moins l’occasion, tout en mesurant la vraie part d’impensé politique décelable chez Camus, de retrouver son œuvre pour ce qu’elle dit vraiment, dans la réalité complexe des situations où elle est née, et pour ce qu’elle peut encore apporter à l’intelligence de notre temps.
Conclusion
Orwell, au secours ! Jdanov revient…
« Oublier Camus » ?
Il y a quelque chose d’à la fois pathétique et terrifiant dans l’insoutenable excès du titre retenu pour le brûlot paru à la Fabrique. Pathétique, par le côté donquichottesque de l’injonction faite à la conscience universelle qu’elle renonce à ce que chacun, depuis plus de trois générations, a pu trouver dans la pensée et l’imaginaire de l’écrivain pour mieux concevoir son existence individuelle et collective.
Terrifiant, en révélant que l’auteur d’une campagne aussi pitoyable et ceux qui se mobilisent autour d’elle admettent que le rôle d’intellectuels, fussent-ils critiques, puisse être de vouloir faire « oublier » qui ou quoi que ce soit qui appartienne à la culture ou à l’histoire humaines. C’est-à-dire rien moins que de disputer aux appareils totalitaires un peu du monopole arbitraire qu’ils s’arrogent de condamner à disparaître toute œuvre ou pensée d’aujourd’hui et d’hier qui ne satisferait pas aux exigences de l’orthodoxie édictée par eux seuls. C’est-à-dire d’aller exactement à l’inverse de ce devoir, que l’intelligence s’est jusqu’ici assigné, de sauvegarder, étudier, essayer de comprendre, et transmettre, toutes traces de notre vie en société, y compris celles qui apparaîtraient les plus condamnables, en les laissant ouvertes à la connaissance, à l’examen et au jugement des générations à venir.
L’auteur lui-même dans les multiples débats de promotion de son ouvrage a manifesté, il est vrai, une certaine gêne à assumer la visée éradicatrice d’un tel titre, avançant que son idée de titre aurait plutôt été un « Libérer Camus », sa vraie cible n’étant, selon lui, ni l’écrivain, ni son œuvre dont il se disait le plus grand admirateur, mais « Camus, tel qu’on nous l’a présenté » et « ces critiques qui en font un gagne-pain perpétuel ». Conscient peut-être des abus polémiques de son disciple, Fredric Jameson dans sa préface volait par avance à son secours en soutenant, lui aussi, que rendre « intelligibles les stratégies littéraires et idéologiques de Camus – si atroces qu’elles puissent être » ne viserait qu’à « le libérer des manipulations de l’establishment politique ». Piètres esquives que dément l’acharnement souvent poussé jusqu’à la falsification dont témoigne Oublier Camus.
Ce relatif embarras pourrait bien trahir que le choix d’un tel titre a été le fait, moins de l’auteur lui- même, que de promoteurs décidés à jouer délibérément le sensationnalisme. Il reste que le polémiste n’a pas désavoué ce choix.
Sur le fond, ses atténuations rétrospectives ne détournent en rien un tel ouvrage de la vraie visée de prétendus historiens de la littérature qui, avec lui, s’érigent en vigiles de la pensée pour sommer la mémoire universelle d’écarter les œuvres et les auteurs victimes de leur vindicte. Pour sa présentation à l’ENS, l’appel à « Oublier Camus » s’est ainsi doublé, avec le renfort d’Edward Lee-Six, d’un aussisommaire « Oublier Orwell ». Début d’épuration intellectuelle à rebours se préparant sans doute à frapper, de proche en proche, toutes autres figures qui, en leur temps et à leur manière, auraient affronté le stalinisme ou interrogé la manière exclusiviste dont était conduite telle ou telle lutte de libération nationale.
Sans y répondre sur le fond ici, on relèvera que le choix de George Orwell comme la seconde cible après Camus de cette campagne de censure rétroactive est aveu involontaire de la méthode intellectuelle profondément obscurantiste qui, sous des allures de pensée critique et « progressiste », s’y montre à l’œuvre.
Car quelle qu’ait été la réalité des prises de position personnelles d’Orwell ou l’éventuel caractère discutable de la figuration allégorique proposée par lui du totalitarisme nazi et fasciste ou de la dictature stalinienne, ses œuvres ont permis et permettent encore à des générations de lecteurs de mieux penser les formes les plus diverses de despotisme ; celles qui ont prospéré depuis sur les ruines du « socialisme réel », dans le sillage de certaines indépendances nationales, ou à travers la dérive autoritaire de régimes démocratiques. La puissance heuristique de l’allégorie orwellienne peut ainsi être invoquée dans une Algérie plus que jamais soumise à la judiciarisation de tout propos s’écartant du discours officiel. Elle tient notamment à ce qu’elle a su figurer comment un contrôle total des individus et de la vie sociale passerait, au moins autant que par la force policière brute, par une perversion complète du langage visant à rendre littéralement impensable toute vision du présent comme du passé autre que celle du pouvoir.
À cet égard, la notice explicative des « Principes de la novlangue » sur laquelle se conclut 1984 peut aussi bien éclairer le mode opératoire de contention et d’appauvrissement de la pensée dont procède le projet de faire « oublier Camus ». Car, comme le souligne Orwell : « La novlangue était conçue non pour étendre mais pour restreindre le champ de la pensée, ce à quoi contribuait indirectement le fait de réduire le choix des mots au minimum. ». Anticipant la célébration des « faits alternatifs » affichée par les despotismes et populismes contemporains, Orwell lançait cette alerte : « Ce qu’il y a de véritablement effrayant dans le totalitarisme, ce n’est pas qu’il commette des atrocités mais qu’il s’attaque au concept de vérité objective : il prétend contrôler le passé aussi bien que l’avenir ».
Dans ce but de radicale épuration des signifiants comme des signifiés, « tout mot pouvait être mis à la négative par l’adjonction du préfixe “non-” ou renforcé par le préfixe “plus-”, ou, pour une formeencore plus emphatique, par “plusplus” ». Il faut au pamphlétaire une pensée aussi simplificatrice pour réduire l’analyse des situations historiques et sociales ou des prises de position politiques au face-à-face de catégories monolithiques, entre d’un côté le « communisme », l’« anticolonialisme » ou les « Algériens », tous uniment célébrés comme plusplusbon, et, de l’autre, l’« anticommunisme »,le « colonialisme » et les « pieds-noirs », en bloc rejetés dans le vaste enfer du plusplusnonbon et du penséecrime.
Devant la spécificité des situations, la novlangue impose à tout membre du Parti « une sorte de caquetage, à la fois saccadé et répétitif » proféré « avec l’automatisme d’une mitrailleuse crachant ses balles ». On le voit dans la manière psittaciste dont le procès en « colonialisme » de Camus s’applique à toutes circonstances en excluant purement et simplement de ses critères des notions comme celles de « droits des minorités », de « protection des populations civiles », de « pluralisme ethnique, religieux ou politique » : il ne retient que le critère sommaire de ce qui serait pour ou contre le régime colonial, de même qu’une prise en compte du phénomène « stalinisme » se trouve bannie d’un débat qui ne connaît que le couple « communisme » / « anticommunisme ». Sous l’empire de l’a priori idéologique, cette pratique du jugement sommaire expurge du langage et de la pensée tout ce qui échapperait aux catégories simplistes du bonpenser. En débat public, le pamphlétaire pouvait ainsi repousser, avec autant de désinvolture à l’égard du vrai ou du simple vraisemblable, des objections de fait aisément vérifiables, des appels à la simple prudence intellectuelle dans l’interprétation, voire l’accusation d’avoir falsifié un texte.
Dans une étrange subjectivation ethniciste du jugement, un tel auteur s’autorise même cette facilité de la novlangue pour laquelle certains mots « étaient ambivalents, ayant une connotation positive quand ils s’appliquaient au Parti, et négative une fois appliqués à ses ennemis » : on l’a vu, la qualification de Camus comme « auteur algérien » est célébrée ou flétrie selon que celui qui l’exprime est ou n’est pas, lui-même, de nationalité algérienne ; semblablement, un soutien au même plan Blum- Viollette sera preuve de « colonialisme » chez le « pied-noir » Camus, et un juste pas vers l’indépendance pour les Oulémas ou pour le PCA, même si ceux-ci le placent expressément dans la perspective du « rattachement à la France ».
Selon l’auteur de 1984, le Sociang s’était donné pour objectif, face aux œuvres de maîtres du passé, que leur traduction en novlangue les détruise en les remettant de fait dans le droit fil de la philosophie officielle, en espérant que ce chantier de longue haleine puisse être mené à bien « avant la fin de la première ou de la deuxième décennie du XXIe siècle ». Nous y sommes. Mais les modernes apprentis- sorciers d’un nouveau bonpenser unique, après avoir accablé leurs cibles sous des dénonciations aussi peu respectueuses de l’histoire que de la littérature, jugent plus expéditif d’enjoindre les lecteurs d’aujourd’hui à les « oublier » désormais. Cet oukase n’est qu’une autre manière, aussi despotique, de décréter que « les événements du passé n’ont aucune existence objective » et que le passé n’est désormais que ce que d’autorité, l’on « choisit d’en faire ».
On aurait cependant tort d’escompter que, dans les temps présents, la pauvreté de réflexion et le manque de scrupules intellectuels de ces inquisiteurs suffiraient à les discréditer. Ce serait négliger que leur mode caricatural d’accusation crée, à la mesure même de son exagération et de son simplisme,un violent effet d’intimidation à l’égard de toute tentative d’évaluation mieux circonstanciée. Tout à l’inverse, le mensonge aussi bien que le jugement abusif, même et surtout lorsqu’ils se réclament de la pensée critique, recouvrent la vérité historique des faits et des idées jusqu’à s’y substituer pour quiconque ne dispose pas des moyens de percer à jour ce que cette gangue a de frauduleux.
C’est pour tenter de limiter cet effet d’obscurcissement intellectuel que nous nous sommes employés à réunir ci-dessus quelques arguments de fait et de méthode propres à déjouer les abus de toutes natures du mauvais procès que l’auteur d’Oublier Camus a engagé.
Lui et ses soutiens s’y autorisent sans doute de la lutte contre ce que le préfacier de l’ouvrage identifie « de façon particulièrement spectaculaire » comme « l’illusion d’universalité perpétuée par la langue du colonisateur » et contre ce que la conclusion du pamphlet dénonce chez Camus comme une « fausse universalité » masquant insidieusement son racisme, son impérialisme aussi bien que la lutte des classes. Ces imprécations laissent cependant entière la question de savoir ce que ces deux auteurs accepteraient ou non comme principes de ce vrai universalisme « à venir » dont, en débat, le second admettait au moins qu’il pourrait trouver sens dès lors qu’il ne serait plus détourné pour couvrir les exactions contre les peuples.
Pour l’heure, le pamphlétaire choisit plutôt de faire masse de tous les griefs qu’en commissaire politique auto-désigné, il a bien voulu formuler contre Camus au fil de son libelle :
[…] il fut tour à tour réformiste, communiste, pour le Front populaire, nihiliste, munichois, pacifiste, résistant, pour l’épuration, contre l’épuration, contre de Gaulle, pour Mendès France, sympathisant libertaire, pour de Gaulle contre Maurice Thorez, contre la guillotine (pas toujours), silencieux sur la torture mais pour la « fin des impérialismes », tout en étant contre l’indépendance de l’Algérie.
La plupart de ces qualifications, on l’a cependant vu, mettent au jour, moins la réalité des positions de l’accusé Camus, que les anachronismes, les simplifications, les abus d’interprétation, voire les trucages de texte auxquels fait recours son dénonciateur. Le maître à penser de ce dernier affirme cependant que tous les errements de Camus tiendraient à ce qu’« il n’a ni l’envie, ni peut-être la capacité » de « prendre parti » quand « la révolution lui demande » de le faire, et rappelle que cet après-guerre avait « contraint les intellectuels français à un choix douloureux entre les États-Unis et l’Union soviétique ». La tonalité de nostalgie avec laquelle Jameson évoque cette période révolue suggère que pour lui « choisir » de soutenir ce dernier État s’identifiait alors à la « capacité » à « prendre parti » ainsi que l’exigeait « la révolution ».
On le comprend donc bien, dans la gravité et la complexité des conflits de notre temps, la récente et si brutale campagne anticamusienne tente en définitive de réactiver cette injonction manichéenne à « choisir son camp » que tant de « compagnons de route » des années 1950 s’imposèrent au détriment de toute vigilance à l’égard des travers autoritaires auxquels n’échappaient pas les forces qu’ils jugeaient « progressistes » : États alors dits socialistes et de « démocratie populaire », ou directions de nombre de mouvements de libération nationale. À cette fin, cette offensive s’emploie à ressusciter une conception moralisatrice et édifiante de la littérature conforme au vieux dogme du « réalisme socialiste » tel qu’il fut théorisé par Andreï Jdanov en 1946. Camus, en son temps, dénonçait déjà cet « académisme de gauche » comme promouvant « un art de propagande avec ses bons et ses méchants, une bibliothèque rose, en somme, coupée, autant que l’art formel, de la réalité complexe et vivante ». Au risque que « l’art vrai [soit] défiguré, ou bâillonné », ceux qui s’en font aujourd’hui les nouveaux champions n’hésitent pas à appeler à « oublier » tout auteur du passé tombé sous leur frénésie accusatoire. Ce néo-jdanovisme révolu ne pourrait aujourd’hui que gravement dévoyer la réflexion critique tant sur l’histoire et la littérature que sur bien des questions éthiques et politiques d’aujourd’hui que, dans ses limites, la pensée de Camus reste à même d’éclairer.