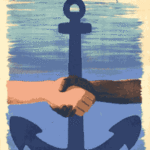Le « parti colonial »
par Charles-Robert Ageron1
Qu’est-ce que le « parti colonial » ? Ce groupe de pression très efficace fut le principal inspirateur de la politique extérieure de la France entre 1890 et 1911 et, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale encore, le plus inlassable propagandiste du mythe impérial.
Depuis que la France a renoué, au XIXe siècle, avec sa tradition d’expansion coloniale, se sont affirmés des partisans de cette politique, ceux qu’on appelait des « colonistes » dans les décennies 1830 et 1840. Mais, même renforcés par quelques coloniaux installés outre-mer ou revenus en métropole, ceux-ci ne suffisent pas à former un parti.
Ce ne fut qu’en 1883 que la Société française de colonisation, forte de 800 adhérents, imagina de demander l’appui moral et politique des parlementaires procoloniaux et offrit en 1886 à Jules Ferry de devenir son président. Bien que soutenue par une centaine de députés et de sénateurs, la Société se révéla impuissante à créer un parti colonial. Jules Ferry, chassé du pouvoir en 1885 ne fut pas même tenté de se servir de cette société comme d’un moyen d’action sur l’opinion ou sur le Parlement. Contrairement à la légende accréditée par les manuels d’histoire, il ne fut pas l’initiateur du renouveau de la politique d’expansion coloniale. Il se borna à suivre la direction indiquée par le prestigieux chef du parti républicain, Gambetta, et fut le premier exécutant du vaste dessein patriotique de celui-ci destiné à rendre à la noble vaincue de 1871 sa puissance et son rayonnement dans le monde.
En 1889, un publiciste colonial, Henri Mager, pouvait écrire « qu’il n’existait encore en France, ni un parti colonial, ni un parti anticolonial ». Or quelques années plus tard, les « gambettistes » et les coloniaux de Paris se désignaient eux-mêmes sous le nom de « parti colonial » et l’un de leurs journaux, La Quinzaine coloniale, employait couramment le sigle « PCF », abréviation désignant le Parti colonial français.
On appelle alors « parti » tout groupe de parlementaires ou de notables qui s’efforce d’exercer une influence politique au Parlement et dans le pays. En tant que groupe parlementaire, le parti colonial naquit le 15 juin 1892, jour où fut fondé un « groupe colonial » de quarante-deux députés. Un an plus tard, ils étaient cent treize. Désormais, à chaque législature nouvelle, le groupe colonial de la Chambre des députés, bientôt doublé par le « groupe de politique extérieure et coloniale » du Sénat, regroupait tous les élus coloniaux ou métropolitains favorables à une politique d’expansion outre-mer.
En 1892, ils appartenaient à toutes les tendances politiques, des monarchistes à l’extrême gauche, la grande majorité étant toutefois constituée de républicains modérés. Après les élections de 1893, sur 129 députés du groupe colonial, on comptait 8 monarchistes, 8 ralliés, 2 boulangistes, 83 républicains du centre et 28 radicaux. En 1902, s’inscrivirent 36 députés radicaux et un socialiste, 75 républicains du centre, 13 d’étiquette droitière et 15 députés sans appartenance. Le groupe colonial était devenu, en dix ans le plus important de la Chambre après le groupe agricole.
Son président, constamment réélu de 1892 à 1914, Eugène Étienne, député de l’Oranie s’imposait comme fondateur et leader incontesté. Bien qu’il ait été plusieurs fois ministre, Étienne n’a pas laissé le souvenir d’un homme d’État. Pourtant, il fut jusqu’à sa mort, en 1921, l’un des personnages clés de la République. « Étienne a dans ses mains le sort du cabinet, écrivait Théophile Delcassé en 1903. Son groupe constitue l’appoint qui est indispensable à celui-ci pour vivre. »
Il fut le grand « décideur » en matière de politique coloniale et extérieure. Il entraîna la Chambre à exiger la conquête de Madagascar, il fit aboutir l’« Entente cordiale » (1904), ainsi que le protectorat français le Maroc. Pour les coloniaux, il était le patron, voire la Providence :« Notre-Dame des coloniaux », ou « Jupiter dans le ciel colonial, disposant de la foudre ».

Lyautey, saluant en 1926 la mémoire « notre cher et grand Étienne », le reconnaissait humblement comme « le chef de ce groupement d’hommes enthousiastes, passionnément convaincus que la reconstitution d’une France extérieure était une condition essentielle de sa force et de sa richesse ». Félix Faure, Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert Lebrun furent tous des ténors du groupe colonial, avant d’accéder un jour à la présidence de la République. On peut citer aussi Théophile Delcassé, Gabriel Hanotaux, Georges Leygues, Alexandre Ribot, Charles Jonnart, Pierre-Étienne Flandin, Albert Sarraut… Mais nommer les parlementaires actifs du groupe colonial, c’est feuilleter le Gotha de la IIIe République.
Le parti colonial, si riche fût-il en personnalités, apparaissait plutôt aux contemporains comme une nébuleuse d’associations. A l’origine de celles-ci, on trouve le plus souvent des sociétés savantes et de géographie.
Le public s’intéressait depuis les années 1860 à ce qu’on appelait alors le « mouvement géographique », qui enregistrait les progrès de la découverte de la Terre. Et les sociétés de géographie se multiplièrent pour satisfaire la curiosité du public, sur le modèle de la célèbre Société de géographie de Paris. Elles répandirent tout à la fois le goût de l’exploration, la volonté de découverte des régions inconnues et l’ambition des conquêtes coloniales. Au point que l’on peut dire que le parti colonial apparut le jour où certains géographes, quelques coloniaux en chambre et quelques authentiques explorateurs décidèrent que l’Afrique occidentale, « à l’ouest d’une perpendiculaire Tunisie-Tchad-Congo », devait être française.
Puisque le 1er juillet 1890 Anglais et Allemands se partageaient à l’amiable l’Afrique orientale, ils jugèrent urgent de réaliser par la conquête du Tchad le rêve commun de l’explorateur Crampel et du journaliste Hippolyte Percher : « Unir à travers le Soudan central nos possessions d’Algérie-Tunisie, au Sénégal et au Congo, et fonder ainsi en Afrique le plus grand empire colonial. »
Telle fut l’origine du Comité de l’Afrique française, une « noble initiative », selon Maurice Barrès. Fondé le 24 novembre 1890 avec les encouragements discrets d’Eugène Étienne et les subsides de quelques grands seigneurs, comme le prince d’Arenberg ou le vicomte Melchior de Vogüe, ce comité organisa surtout des expéditions, des missions de reconnaissance et de conquête.
Mais, simultanément, le CAF se fit le zélateur de l’idée coloniale auprès de l’élite politique du pays. Il avait repris les méthodes d’action des sociétés de géographie : souscriptions publiques et adhésions individuelles ou collectives, conférences publiques et lettres confidentielles, déjeuners ou dîners-débats. « Le parti colonial, écrivaient les journalistes, c’est le parti où l’on dîne. »
Les affaires importantes étaient traitées dans des réunions plus discrètes. Les républicains pro-coloniaux, presque tous francs-maçons, agissaient selon les habitudes des loges ; ils comptaient plus sur le dévouement de leurs « frères » que sur l’opinion, et ils savaient qui ils pouvaient faire agir au ministère des Colonies ou dans les autres ministères. D’où la difficulté pour l’historien de reconstituer le cheminement de projets qui aboutissaient mystérieusement.
Le Comité de l’Afrique française s’efforça de créer des sociétés filiales, tels le Comité de l’Éthiopie (fondé en 1892), le Comité de l’Égypte (1895), le Comité de l’Asie française (1901) et le Comité du Maroc (1904). Leurs buts ? Étendre l’influence ou le protectorat français sur l’Éthiopie ou le Siam, défendre l’Égypte contre les Anglais, préparer la France au Break up of China 2 et à l’extension territoriale de l’Indochine, enfin faire du Maroc une colonie française.
La « Plus Grande France »
Ces comités civils, auxquels il faudrait ajouter les réseaux informels de militaires coloniaux – tel celui qui déclencha, avec l’alliance des coloniaux politiques, l’expédition Marchand sur Fachoda -, ne constituaient toutefois que de petits groupes de pression travaillant auprès des centres de décision politique. Pour étendre leur action fut créée en 1903 l’Action coloniale et maritime, qui se voulait un parti de masse. Ce fut l’échec : en 1911, elle n’avait pas suscité plus de 1200 adhésions.

Autre échec : la Ligue coloniale française, mise sur pied par Eugène Étienne en 1907. Alors qu’elle s’inspirait de la puissante Kolonialgesellschaft allemande, forte de 33 000 membres, ses effectifs ne dépassaient pas 2 600 adhérents en 1913-1914. Un chiffre d’autant plus faible qu’une association (sans objectif colonial) comme la Ligue maritime en comptait dix fois plus en 1913. Les responsables de la Ligue coloniale française proposèrent alors la fusion des deux associations et, en 1921, naissait la très populaire Ligue maritime et coloniale. Ce fut la première organisation de masse du parti colonial (45 217 adhérents en 1921, peut-être 100 000 en 1930).
Tous ces groupements coloniaux, comités de notables à cotisations élevées et à effectifs restreints (rarement plus de 1 000 à 1 500 adhérents et souscripteurs), ou ligues qui cherchaient à rassembler un vaste public en ne demandant que de faibles cotisations avaient en commun leurs motivations politiques et leur style patriotique, voire chauvin.
Tous prétendaient étendre la puissance nationale par la conquête de nouveaux territoires coloniaux. Ils voulaient édifier, à l’instar de la Greater Britain, la « Plus Grande France » 3, la « France des cinq parties du monde », toutes formules alors couramment employées, celles d’Empire colonial ou d’Empire restant suspectes aux yeux de ces républicains. Seuls des buts patriotiques expansionnistes rapprochaient les nombreux professeurs, officiers, publicistes, géographes qui peuplaient ces organisations.
A côté de ces comités d’action ou de propagande coloniale, plus ou moins efficaces et bruyants, prirent place très tôt d’autres associations, souvent moins connues du public, qui étaient surtout représentatives des intérêts économiques ou commerciaux suscités par l’impérialisme colonial.
Ainsi, le parti colonial fut souvent tiraillé enntre ces deux tendances, patriotique ou affairiste :« Les coloniaux ne savent faire que deux choses, ironisaient les journalistes : « manger ou se manger entre eux. » La crise de Fachoda, à l’automne 1898, révèle ces tensions et oppose les jusqu’au-boutistes, menés par les militaires et appuyés par Eugène Étienne, aux modérés, conduits par Delcassé et approuvés par les hommes d’affaires de l’Union coloniale française.
Lorsqu’elle fut créée en juin 1893, à l’initiative d’un négociant marseillais, l’Union coloniale française se voulait simplement « une chambre syndicale du commerce colonial ». Très vite pourtant, elle fut une sorte d’office colonial privé, une agence de renseignements pour les candidats à l’émigration ou les gens intéressés par le commerce outre-mer. Fondée un an avant que ne fût le ministère des Colonies, elle fut elle-même le « véritable ministère », selon le mot du général Archinard, parce que mieux organisée et mieux informée.
L’Union coloniale, qui exigeait des cotisations élevées, proportionnelles au capital et au chiffre d’affaires des sociétés, était riche et sortit vite de son rôle de syndicat représentatif des intérêts coloniaux.
Placée sous la direction de J. Chailley-Bert, un influent publiciste du parti colonial, elle se dota d’un service d’information et de propagande. Grâce à ses moyens financiers importants, elle sut, mieux encore que les associations politiques, organiser la diffusion de l’idée coloniale. En dix ans, de 1894 à 1903, elle dépensa un million de francs-or pour la seule propagande coloniale, soit une somme supérieure à tout ce que reçut le Comité de l’Afrique française, entre 1891 et 1914.
L’Union coloniale organisait elle aussi des dîners-débats mensuels et des banquets annuels. Elle montait des conférences, suscitait de grands congrès coloniaux tous les deux ou trois ans. Elle éditait des ouvrages spécialisés et des brochures de propagande et finançait des cours libres d’enseignement colonial. Elle publiait un périodique, La Quinzaine coloniale, et subventionnait un quotidien, La Politique coloniale. Bien entendu, elle intervenait aussi comme groupe de pression économique auprès des différents ministères intéressés – en matière de droits de douane, d’emprunts, de concessions foncières.
Marseille, porte de l’Orient

« L’Afrique est son faubourg, l’Inde sa banlieue, l’Amérique, sa voisine ». C’est ainsi qu’un journaliste marseillais décrit sa ville, devenue « porte de l’Orient » avant même l’âge colonial, à l’époque romantique du voyage en Orient.
Au début du XXe siècle, elle est la métropole de l’Empire colonial. Le port réalise alors près des deux tiers du commerce avec les colonies. Les négociants marseillais sont parmi les animateurs les plus actifs du parti colonial. Et c’est à Marseille que se tient, à leur initiative. la première Exposition coloniale en 1906.
Ci contre : fresque réalisée par Puvis de Chavanne pour le musée des Beaux-Arts de Marseille, inauguré en 1869. Au premier plan, un navire turc, au fond, la ville (Marseille, musée de Longchamp ; cl. J. Bernard).
Les réticences de la bourgeoisie
Se rendant indispensables à l’administration, certains de ses membres siégeaient selon leur spécialisation dans diverses commissions d’études. Il leur arrivait de rédiger, à l’usage de la rue Oudinot (le ministère des Colonies), des projets de lois ou de décrets. Plusieurs gouverneurs généraux se croyaient obligés de soumettre d’abord leurs propositions à l’Union coloniale, et tel ministre demandait avec une respectueuse courtoisie l’avis de la même UCF. Jamais sans doute elle ne fut plus influente ou plus écoutée que dans les années 1920 à 1930. Les investissements coloniaux prirent une grande ampleur du fait de la montée des taux de profit. Et l’Union coloniale obtenait presque toujours satisfaction pour des demandes où l’intérêt général était souvent sacrifié aux intérêts de quelques grandes maisons de Bordeaux ou de Marseille.
D’autre part, l’UCF avait acquis après 1919 un rôle bien peu connu d’agence de presse. Elle envoyait gratuitement à 90 quotidiens de Paris et de province, deux fois par semaine, des études ou des articles, qui étaient le plus souvent reproduits intégralement sans mention d’origine, sous la signature du rédacteur habituel du journal. Un rôle efficace et discret qui explique l’anomalie d’une presse coloniale relativement modeste.
En réalité, les coloniaux pensaient à juste raison que c’était la grande presse d’information qu’il fallait toucher pour convaincre les Français. Mais influencer dans un sens favorable la grande presse, surtout sensible aux scandales coloniaux, fut une tâche ardue dont la réussite fut mitigée jusqu’en 1927-1928. La presse parisienne, qui éliminait comme invendable l’information coloniale, découvrit alors brusquement le reportage colonial, lancé par quelques grands journalistes comme Albert Londres ou Louis Roubaud.
Le plus difficile était en effet de sensibiliser l’opinion à l’idée coloniale. Malgré tous les raisonnements patriotiques ou mercantilistes du parti, les Français d’avant 1914, gens casaniers et méfiants, patriotes qui vivaient l’oeil fixé sur la « ligne bleue des Vosges », redoutaient cette boulimie de conquêtes qui risquait de disperser les forces nationales. Gens économes, ils s’effrayaient des dépenses entraînées par la colonisation. « Nos colonies sont un débouché non pour notre industrie et notre commerce, mais pour l’argent de nos contribuables », expliquaient la plupart des économistes libéraux. La
bourgeoisie, beaucoup moins colonialiste qu’on ne l’a dit, refusait d’investir ses capitaux dans les colonies françaises : à peine 8,8 % du total des investissements de la France en 1914. Elle préférait prêter aux États étrangers jugés plus « sûrs », tel l’Empire des tsars ou celui des sultans ottomans.
Inlassablement, le parti colonial se donna pour tâche de faire « l’éducation coloniale du pays », selon une formule constamment répétée entre 1900 et 1936, en montrant que les colonies n’étaient pas seulement des terres à scandales tout juste bonnes pour les fils de famille qui avaient mal tourné.
Il sut s’adapter aux nouveaux médias et utiliser très tôt le cinéma ou la radio. Dès 1927-1928, les coloniaux avaient acquis droit de cité dans les programmes de la TSF C’était là le grand public cultivé qui était visé : on lui démontrait que la colonisation n’était pas l’affaire des coloniaux, mais celle de la France tout entière : on lui parlait profits et prestige, sans souffler mot des responsabilités.
Pour les masses populaires, le parti colonial recourut d’abord aux expositions fixes ou ambulantes, organisées surtout dans les grands ports ou à Paris. L’exposition coloniale de Vincennes, en 1931, ne fut que la plus connue d’entre elles. Toutes cultivaient l’exotisme facile et les affirmations simplistes. Leur imagerie naïve put impressionner l’imagination des enfants, mais Lyautey était le premier à admettre en 1932 que « si l’exposition de Vincennes fin un succès inespéré, elle n’avait en rien modifié la mentalité des cerveaux adultes, ni ceux des gens en place qui n’étaient pas par avance convaincus.
250 députés en 1936
Pour concentrer la propagande, le puissant Institut colonial français (40 000 adhérents en 1935) imagina de consacrer un « jour colonial », puis une « semaine coloniale », chaque année à diverses manifestations : conférences, films, expositions d’art ou de produits coloniaux. Sous son influence furent créées des collections d’ouvrages spécialisés comme les monographies de La Dépêche coloniale ou les biographies intitulées « Nos gloires coloniales » éditées par Le Petit Parisien.
Enfin, toute une littérature était destinée au public des écoles. Elle devait persuader la jeunesse de l’avenir et des bienfaits de la colonisation. Plus tard, elle dut célébrer la nécessité et la grandeur de l’Empire. Toute une série d’associations travaillèrent à l’éducation coloniale de la jeunesse scolaire. Une floraison de manuels de géographie et d’histoire indiscrètement tendancieux y pourvurent. Tous ces groupes firent aussi campagne pour une réforme de l’enseignement et des programmes, au profit de l’enseignement de la géographie et de l’histoire coloniales 4
Cette éducation s’apparentait étroitement à de la propagande. Pour célébrer le centenaire de l’Algérie, 1 200 000 brochures furent remises aux écoles et aux bibliothèques. La Ligue de l’enseignement se voyait offrir des appareils de projection et des « boîtes de vues coloniales » destinés aux instituteurs. Des journaux pour enfants, des almanachs, des albums, des images et des buvards furent distribués dans les classes : il fallait sensibiliser les enfants à l’existence d’une « France des cinq parties du monde » pour créer un jour une opinion publique procoloniale.
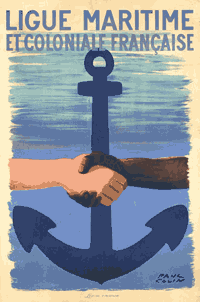
Le mouvement le plus efficace dans cette voie fut sans doute la Ligue maritime coloniale, qui visait le grand public, mais atteignit seulement le monde scolaire. Cette association, qui se bornait à une propagande simpliste dans son journal Mer et colonies, distribué presque gratuitement dans la plupart des écoles et des collèges, eut une influence certaine et durable jusque dans les débuts de la IVe République.
On a parfois douté, dans l’historiographie anglo-saxonne, que le parti colonial français ait dépassé le terme fatidique de 1932, sous prétexte que le groupe colonial n’a pas été déclaré dans la Chambre élue à cette date. En réalité, après un éclatement très provisoire, le groupe colonial se reconstitua en mars 1937 et rassembla 250 députés. La Chambre du Front populaire (mai 1936) fut donc plus coloniale que la Chambre bleu horizon, élue au lendemain de la Première Guerre mondiale (167 députés inscrits au groupe colonial en 1920). Elle fut à coup sûr la plus imprégnée par le mythe de l’Empire de toutes celles qui se succédèrent sous la IIIe République.
D’autre part, jamais les groupes coloniaux et associations ne furent plus nombreux que dans la décennie 1930-1939. On en dénombre plus d’une centaine en 1938, contre 58 en 1914 (le nombre d’adhérents ayant au moins doublé). Face à cette multiplication de comités ou de ligues, les leaders du parti colonial s’efforcèrent d’obtenir un regroupement.
Le régime de Vichy ayant annoncé, dans une loi du 6 décembre 1940, que tout organisme visant à représenter ou à défendre des intérêts économiques coloniaux serait dissous, les comités politiques pouvaient seuls survivre. C’est pourquoi l’Union coloniale se déclara « association à caractère non professionnel », puis décida de s’unir à l’Institut colonial français et au Comité de l’Indochine.
De cette fusion entre les trois principales associations représentatives du commerce colonial sortit le Comité de l’Empire français. Reconnu en 1941 il n’eut guère de possibilité d’agir avant 1945. Après cette date, il devait rester le plus puissant lobby colonial de la IVe République. et continuer d’agir pendant les premières années de la Ve République.
Financé essentiellement par les grandes sociétés commerciales de l’Afrique noire et de l’Indochine, le Comité de l’Empire français vit ses ressources tripler de 1944 à 1950. On le vit intervenir aux côtés des États généraux de la colonisation française en août 1946, mettre en garde les gouvernements contre les improvisations outre-mer : « La IVe République aurait à assumer une lourde responsabilité devant la nation etdevant l’histoire si son avènement coïncidait avec une dislocation des territoires rassemblés autour de la France grâce aux sacrifices et aux efforts de nombreuses générations de Français. »
Sur l’affaire de l’Indochine comme lors de la discussion du statut de l’Algérie, le Comité de l’Empire français, épaulé par des organisations de colons comme le Comité de défense de l’Algérie française, l’Union pour la défense de l’œuvre française en Indochine ou l’Association nationale pour l’Indochine française, plaida avec efficacité la cause de la défense impériale.
L’insurrection de Madagascar en mars-avril 1947 fut pour les associations coloniales l’occasion d’exiger une stricte politique de répression. La presse parisienne de la Libération, longtemps hostile au « colonialisme vieillot » et au libéralisme économique du Comité, se montra dès lors plus réceptive aux cris de Cassandre des groupes coloniaux. Ceux-ci retrouvèrent une audience certaine dans la classe politique. « Il est à nouveau permis de s’élever contre le décri de la colonisation française. Il recommence à être admis que la France a fait œuvre utile dans ses territoires d’outre-mer », écrit alors le président Charles-Roux.
Comme gage de la confiance retrouvée, le Comité de l’Empire français accepta en juin 1948 de renoncer à sa dénomination désormais mal venue. Il adopta le nom curieux de Comité central de la France d’outre-mer et joua un rôle important dans les questions tunisienne et marocaine, entre 1950 et 1953.
Les organisations coloniales se montrèrent toutefois maladroitement conservatrices sous la IVe République. Héritières des traditions et des méthodes du parti colonial, elles ne surent pas s’adapter aux temps nouveaux.

Un combat d’arrière-garde
Menant un combat d’arrière-garde, elles n’osèrent pas modifier leur idéologie, et refusèrent d’adhérer à l’idée fédérale et à la Communauté préconisées par de Gaulle. Elles furent incapables de déclencher une véritable contre-offensive auprès de l’opinion publique, alors que, en 1950 encore, 81 % des Français, redoutant le déclin de la puissance du pays, pensaient que « la France [avait] intérêt à avoir des colonies ». En fonctionnant comme sous la IIIe République, ces organisations se trompèrent : elles n’étaient plus assez puissantes pour exercer un droit de veto définitif sur la politique coloniale.
Le lobby d’affaires colonial perd alors de son efficacité. En juin 1956 par exemple, la loi-cadre qui visait à préparer l’autonomie de l’Afrique noire et de Madagascar, passa à une forte majorité à la Chambre (410 voix contre 105), malgré des tentatives d’obstruction.
A partir de cette date, certains publicistes coloniaux reconnaissaient qu’écartés des médias et ne disposant plus que d’équipes trop restreintes pour orienter la presse, il leur était désormais impossible de « vaincre l’indifférence ou la complaisance de l’opinion vis-à-vis des attaques convergentes menées contre l’Union française ». Eux-mêmes signaient le constat de leur échec.
Le parti colonial, sans avoir jamais été, sauf à de rares moments, approuvé par l’ensemble du pays, fut l’une des forces agissantes de la IIIe et de la IVe République. Comme l’écrivait en 1918, non sans quelque exagération, l’un des siens, le diplomate François Georges-Picot à Sir Mark Sykes :« Dans notre vie politique ordinaire le parti colonial reste au second plan, mais il est des questions où il interprète véritablement la volonté nationale. Que l’une de ces questions, comme celle de Syrie, vienne à se poser, il passe soudain au premier plan et a tout le pays derrière lui. » Au printemps 1954, rendu responsable de la défaite de Dien Bien Phu, il semblait au contraire l’avoir tout entier contre lui.
- Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Paris-X, Charles-Robert Ageron a publié de nombreux ouvrages sur la France coloniale et sur l’Algérie, parmi lesquels Histoire de l’Algérie contemporaine (1871-1954) (PUF, 7979), Histoire de la France coloniale, t. II (A. Colin, 1990).
- Par cette expression signifiant la « désagrégation de la Chine », les Européens désignaient le partage de l’Empire chinois en zones d’influence économique.
- Titre du célèbre ouvrage de Léon Archimbaud, paru en 1928.
- « Regarde tout cela, petit Français, et relève la tête. Dis-toi que tu es fils d’une grande, d’une vaillante nation, et que noblesse oblige », recommande ainsi Le Cours élémentaire d’histoire de Gauthier Deschamps, diffusé à plus d’un million d’exemplaires, entre 1904 et 1926.