Le mirage sahélien, par Rémi Carayol
Mediapart
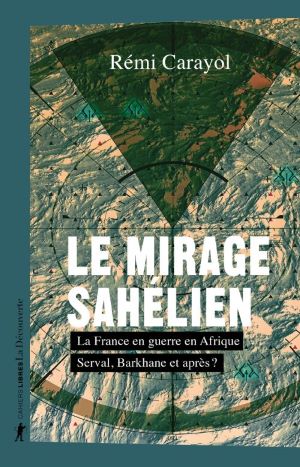
Rémi Carayol, journaliste indépendant, couvre l’actualité du Sahel depuis dix ans. Il coordonne le comité éditorial du site d’information Afrique XXI et écrit régulièrement dans Mediapart, Le Monde diplomatique et Orient XXI.
Présentation de l’éditeur
L’intervention militaire engagée par la France au Sahel tourne au fiasco. Lancée en janvier 2013, l’opération Serval ressemblait au départ à une success story. Les quelques centaines de djihadistes qui avaient pris le contrôle des principales villes du Nord-Mali furent mis en déroute. Des foules en liesse, brandissant ensemble les drapeaux français et malien, firent un triomphe à François Hollande lorsqu’il se rendit à Bamako.
Tout cela n’était pourtant qu’un mirage. En quelques mois, l’opération Barkhane, qui prend le relais de Serval en juillet 2014, s’enlise. Les djihadistes regagnent du terrain au Mali et essaiment dans tout le Sahel : des groupes locaux, liés à Al-Qaïda ou à l’État islamique, se constituent et recrutent largement, profitant des injustices et de la misère pour se poser comme une alternative aux États déliquescents. Au fil des ans, la région s’enfonce dans un chaos sécuritaire et politique : les civils meurent par milliers et les coups d’État militaires se multiplient. Impuissante, la France est de plus en plus critiquée dans son « pré carré ».
L’armée française, imprégnée d’idéologie coloniale et engluée dans les schémas obsolètes de la « guerre contre le terrorisme », se montre incapable d’analyser correctement la situation. Prise en étau entre des décideurs français qui ne veulent pas perdre la face et des dirigeants africains qui fuient leurs responsabilités, elle multiplie les erreurs et les exactions. Des civils sont tués. Des informateurs sont abandonnés à la vengeance des djihadistes. Des manifestations « antifrançaises » sont violemment réprimées.
Sous couvert de la lutte contre la « barbarie », la France a renié les principes qu’elle prétend défendre sur la scène internationale. Le redéploiement du dispositif militaire français au Sahel, annoncé par Emmanuel Macron, n’y change rien : la France poursuit en Afrique de l’Ouest une guerre qui ne dit pas son nom, et sur laquelle les Français n’ont jamais eu leur mot à dire.
Extrait du chapitre I
Papa Hollande et Tonton Lyautey
Quand les « héros » de la conquête coloniale inspirent la stratégie française.
Une image me tarabuste depuis des années. Elle date du 2 février 2013. Un samedi. C’est une pancarte brandie au milieu de la foule dans un moment de pure allégresse collective. Nous sommes sur la place de l’Indépendance, à Bamako. Le soleil est à son zénith, les photographes et les journalistes en ébullition, François Hollande en extase. C’est, dit-il depuis la tribune improvisée au pied du monument de cette place habituellement envahie par les voitures et les motos, « la journée la plus importante de [sa] vie politique ». Nombre de commentateurs se sont moqués de cette phrase. Elle n’a pourtant rien d’insensé : depuis l’aube, celui qui n’est le président de la France que depuis neuf mois est fêté en « libérateur » par les Maliens. À Tombouctou d’abord, la ville tout juste délivrée du joug des djihadistes par l’armée française. Et maintenant à Bamako, la capitale qui, elle, n’a pas (encore) subi leurs attaques. Je regarde la foule en liesse – il y a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes –, et c’est alors que j’aperçois cette pancarte au milieu des drapeaux bleu-blanc-rouge agités frénétiquement par les manifestants. Elle me semble irréelle. Je la relis une fois, deux fois… Il est écrit, noir sur blanc : « Merci à Papa Hollande et aux tontons Le Drian et Fabius ». Jean-Yves Le Drian, c’est le ministre de la Défense. Laurent Fabius, celui des Affaires étrangères. Eux aussi ont fait le déplacement express depuis Paris.
Papa Hollande, donc… Tonton Le Drian… Tonton Fabius… On se croirait revenu au temps des colonies. Je ne connais pas encore très bien le Mali à cet instant. Je n’y suis venu qu’une fois avant de couvrir l’intervention de l’armée française, et je n’ai alors jamais franchi les frontières invisibles de la ville de Bamako. Mais je sais une chose : avant le déclenchement de l’opération Serval, trois semaines plus tôt, le 11 janvier, le Mali était considéré à Paris comme l’un des pays du « pré carré » les plus rétifs à coopérer avec la France. Depuis l’indépendance de cette ancienne colonie française, acquise en 1960, les relations franco-maliennes étaient au mieux cordiales, au pire froides. « Le Mali ne faisait pas partie historiquement du pré carré foccartien, et les affinités entre élites politiques malienne et française n’avaient rien à voir avec celles qui caractérisaient à l’inverse le Congo, le Cameroun, le Gabon, la Côte d’Ivoire – voire le Sénégal », rapportent Grégory Daho, Florent Pouponneau et Johanna Siméant-Germanos dans l’introduction d’un ouvrage collectif analysant en détail le lancement de l’opération Serval : Entrer en guerre au Mali1.
« Papa Hollande », « tonton Le Drian » et « tonton Fabius »…
[…] Il y a, au sein de la population malienne, une réelle défiance vis-à-vis non pas des Français, qui sont généralement bien accueillis, mais de la politique française en Afrique, considérée comme impérialiste, néocolonialiste ou simplement inamicale. Le Mali a donné certains des intellectuels les plus critiques vis-à-vis de la politique postcoloniale de la France, parmi lesquels l’ancienne ministre de la Culture et du Tourisme, Aminata Traoré, une figure de l’altermondialisme qui n’a de cesse de dénoncer l’« ordre cynique du monde » et les dérives de la Françafrique. Immédiatement, à la vue de cette pancarte, me viennent en tête ces questions qui alimenteront le papier que j’enverrai dans la foulée à mon journal : « Qui aurait pu prédire, il y a de cela deux ans, qu’un président français serait ainsi accueilli ? Qui aurait pu imaginer qu’en lançant : “La France restera le temps qu’il faudra” au Mali, un président français ne serait pas hué, mais acclamé par une foule en liesse ? » D’autres interrogations me sont venues après coup : comment en est-on arrivé à donner du « papa » à Hollande ou du « tonton » à Le Drian, qui est alors un illustre inconnu dans ce pays, et à Fabius, ce technocrate aussi froid qu’un glaçon qui n’a jamais montré aucun intérêt pour l’Afrique ? Par quel (malheureux) « miracle » des termes venus tout droit de l’ère coloniale, lorsque la « métropole » envoyait ses missionnaires veiller sur ses « enfants », exploiter leurs bras et leur terre et faire croire au mythe de la mission civilisatrice, ont-ils subitement resurgi dans ce pays réputé pour son orgueil patriotique ? Et qu’est-ce que cela dit de cette guerre dans laquelle la France s’est engagée ? Hollande, Le Drian et Fabius se sont-ils posé ces questions ? Peut-être ne l’ont-ils pas vue, cette pancarte, accaparés qu’ils étaient par la transe collective qui les entourait. Mais leurs conseillers, eux, l’ont repérée. Elle les a même marqués… et ils en étaient très fiers ! Je le sais, parce que dans le bus qui nous ramenait – nous : les journalistes et quelques-uns des conseillers du président – à l’aéroport, où Hollande allait saluer les soldats français une dernière fois avant de reprendre la direction de la France, je l’ai revue, cette pancarte. Un membre du cabinet présidentiel l’avait récupérée – j’ignore comment –, et maintenant, dans le bus climatisé, il la montrait à ses « camarades » qui semblaient eux aussi vivre le « plus beau jour » de leur vie – professionnelle, s’entend. Et tous riaient. Quelle journée magnifique !
J’ignore ce qu’ils en ont fait. S’ils l’ont prise dans l’avion, montrée au président, puis oubliée dans un placard de l’Élysée, ou s’ils l’ont laissée traîner dans un coin d’un des hangars de l’aéroport qui servaient alors de cantine et de dortoir aux soldats français en partance pour le nord du pays. Ça n’a pas d’importance. Ce que je sais en revanche, c’est que ces quelques mots auraient dû les faire réfléchir, eux, les conseillers, mais aussi tous les responsables politiques, les diplomates, les gradés et les hauts fonctionnaires qui ont, à un moment ou à un autre, joué un rôle dans cette opération. Ils auraient dû comprendre dès lors que la France, en envoyant ses troupes dans une ancienne de ses colonies et en présentant cette opération comme une œuvre de « libération », s’était engagée dans une drôle de guerre. Que ça sentait le bourbier à plein nez. Et qu’il serait judicieux d’en partir aussi vite que possible. Ils en avaient parlé entre eux avant de s’engager dans cette opération. Des conseillers leur avaient soufflé qu’une intervention au sol pourrait être mal reçue. Mais une fois l’entrée en guerre actée, c’est comme si ces craintes s’étaient envolées.
Voir l’émission « A l’air libre » de Mediapart : dix ans de guerres françaises au Sahel, pour quoi faire ?
Sur Lyautey (1854-1934) comme référence coloniale majeure des stratèges militaires français aujourd’hui, lire Aux origines de Barkhane. Maréchal (Lyautey), nous voilà !
**Lire aussi
• l’introduction, les repères chronologiques et la table des matières
• « La prison secrète de Barkhane », extrait publié par Afrique XXI


