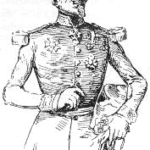Paris, 11 juillet 1845 : à la Chambre des Pairs, entre un débat sur l’aménagement des ports corses et un autre sur la loi relative aux chemins de fer, le prince de la Moskowa, fils du maréchal Ney, demande la parole pour une brève interpellation :
« Messieurs, un journal qui se publie en Algérie, l’Akhbar, contient le récit d’un fait inouï dans notre histoire militaire. Un colonel français se serait rendu coupable d’un acte de cruauté inexplicable, inqualifiable, à l’égard de malheureux arabes prisonniers. Je viens demander au gouvernement français de s’expliquer sur ce fait. » Et il donne lecture de l’article : « Il vient d’arriver dans le Dahra un de ces événements qui contristent profondément ceux qui en ont été témoins, même lorsqu’ils en ont compris l’affreuse nécessité… Le colonel Pélissier s’occupait à poursuivre les Ouled-Riah, tribu qui n’a jamais été soumise, parce que les pays qu’ils habitent renferment d’immenses cavernes … » Suit le récit de l’enfumade des Ouled-Riah. Hommes, femmes, enfants et troupeaux se sont, à l’arrivée de la colonne française, réfugiés dans leurs grottes. On en a fait le siège et, au bout d’une journée, « à bout de patience » face au « fanatisme sauvage de ces malheureux » qui exigeaient, pour sortir, que l’armée française s’éloigne, Pélissier a fait mettre le feu à des fascines disposées aux accès. Le matin, tout est consommé. Cinq cents victimes, dit le rapport officiel. Aux environs de mille, témoignera un officier espagnol présent. Péroraison de l’orateur : « Il est de l’honneur de l’armée comme il est de la dignité du Gouvernement que de pareils faits soient démentis ou désavoués hautement. »
Le ministre de la Guerre et président nominal du Conseil, le vieux Soult, affecte d’être pris de court : « Les rapports qui sont parvenus au Ministère sont tellement contradictoires que j’ai dû m’empresser de demander de nouveaux renseignements… Mais pour le fait lui-même, le Gouvernement désapprouve hautement ! (Très bien ! Très bien ! Une voix : – S’il a eu lieu !) »
Il ne s’en tire pas à si bon compte. Montalembert, catholique au coeur sensible, intervient à son tour : « Je vous demande, Messieurs, de réfléchir à l’effet qu’une pareille nouvelle va produire en Angleterre, hors de France, et je vous demande s’il ne doit pas y avoir un sentiment unanime d’horreur… » Soult lâche encore du lest : « Si l’expression de désapprobation que j’ai employée au sujet du fait dont il est question est insuffisante, j’ajoute que je le déplore. »
L’incident est clos. Provisoirement. Ça fait quand même du bruit dans le pays. Et aussi dans l’armée d’Afrique : celle-ci ressent cette agression de la métropole comme un coup de poignard dans le dos, et quelques jours plus tard Soult doit faire machine arrière : « J’ai dit que je désapprouvais et déplorais. Ces expressions se rapportent au fait en lui-même car toutes les fois qu’il s’agit d’un accident, d’un malheur, le sentiment naturel porte tout le monde à le déplorer et à gémir. Mais je veux être plus explicite. Cette affaire à laquelle s’est trouvé un des plus honorables militaires de l’armée d’Afrique, le colonel Pélissier, dont je ferai constamment l’éloge, l’a mis dans une situation fort pénible et embarrassante… Messieurs, je suis aussi patient qu’un autre, mais si j’avais été dans la situation où s’est trouvé le colonel Pélissier j’aurais peut-être fait aussi un exemple très sévère… Nous avons trop souvent le tort, nous autres Français, d’exagérer les faits sans tenir compte des circonstances… En Europe, un pareil fait serait affreux, détestable. En Afrique, c’est la guerre elle-même. Comment voulez-vous qu’on la fasse ?… Je crois qu’on ferait beaucoup mieux de s’abstenir de toutes les réflexions qui peuvent produire un très mauvais effet. »
Cette fois, l’incident est définitivement clos. On pourra jaser en Angleterre ou ailleurs : Pélissier finira maréchal de France. [ … ]

Pauvre Pélissier, un si brave homme, un peu bourru, un peu « bouledogue » même, mais si humain… Ses contemporains ne tarissent pas d’anecdotes : oui, il était soupe au lait – n’a-t-il pas, dans un restaurant, envoyé une omelette à la figure d’un serveur maladroit ? -, mais il adorait les mots d’enfants… Cette malheureuse affaire, cet « accident », pour reprendre le terme de Soult, va lui coller à la peau jusqu’à son dernier jour, et il ne cessera de se justifier, d’écrire notes, mémoires et éclaircissements. Tout cela, c’est la faute aux Ouled-Riah eux-mêmes, à leur entêtement. Il a vraiment tout essayé : « Je suis humain, mais je ne sais ce que j’aurais pu faire au-delà de ce que j’ai fait pour épargner à ces malheureux l’impasse infernale où ils sont tombés et très en dehors de ma volonté. » Absurde, leur terreur des représailles, d’être emprisonnés dans la « Tour des cigognes », célèbre prison de Mostaganem. Extravagante, leur exigence que l’armée recule pour les laisser sortir. D’ailleurs, il ne voulait que leur faire peur : ce sont leurs métiers à tisser entassés aux issues qui, prenant feu, ont produit l’épaisse fumée qui les a intoxiqués. (Mais, témoigne le sergent du génie Moret, « les soldats qui avaient essuyé des coups de feu mettaient de la rage à porter du bois ».) Et puis, ces sauvages n’ont-ils pas préféré massacrer eux-mêmes leurs femmes et leurs enfants qui tentaient de sortir ? […] Non, il ne conteste pas le regrettable résultat de l’opération, puisque c’est lui-même qui, dans son rapport à Bugeaud, tombé dans des mains malveillantes, parle de « hideux spectacle ». (« Rien ne pourrait donner idée, relate de son côté l’officier espagnol qui l’accompagnait, de l’horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu’ils avaient dû éprouver avant d’expirer… le sang leur sortait par la bouche. »)
D’ailleurs, la preuve de son souci d’humanité, c’est qu’en découvrant ledit spectacle, il a fait porter secours aux survivants. […]Ce rapport donne également le chiffre des pertes françaises : pas de morts, cinq blessés dont aucun n’est en danger, et vingt-cinq malades de diarrhée.) Non, non, s’acharnera encore Pélissier dans ses vieux jours avec, dit un témoin, « un sentiment de vive émotion et les larmes aux yeux » : « Répétez surtout que je n’ai jamais voulu la mort des tribus rebelles. » Mais son cri du coeur, c’est celui qu’il a lancé dans l’un de ses nombreux plaidoyers : « La peau d’un de mes tambours avait plus de prix que la peau de tous ces misérables. » L’«affaire du Dahra » demeure dans les annales de la conquête comme une sorte de bavure (regrettable, selon le terme consacré). Elle n’est pourtant pas isolée. On connaît officiellement au moins quatre tueries similaires opérées dans la région par des commandants de colonnes à la même époque 1.
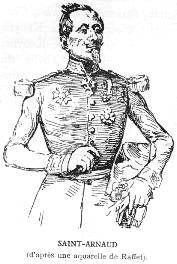
A tout seigneur tout honneur, commençons par notre ami Saint-Arnaud. Celui-ci a reçu Pélissier dans sa circonscription, il a d’autant mieux suivi l’affaire qu’ils se sont concertés, et qu’il a été le premier à en avoir communication écrite. Il a commencé par se taire, prudemment, mais la réaction métropolitaine l’a fait sortir de ses gonds. Le 27 juin 1845, il écrit à son frère Adolphe :
« Le colonel Pélissier et moi, nous étions chargés de soumettre le Dahra, et le Dahra est soumis. Pélissier est plus ancien que moi et colonel d’état-major, j’ai agi avec lui avec déférence. Je lui ai laissé la belle part… Il a dû agir avec rigueur. J’aurais été à sa place, j’aurais fait de même. » […] Faire de même ? Il n’aura pas longtemps à attendre. Le 15 août, il envoie à Adolphe le récit de sa propre « enfumade » des Sbéahs, en lui demandant de le garder pour lui. Le voici, tel qu’il a été publié par la famille :
« Cher frère, je voulais te faire un long récit de mon expédition, mais le temps me manque. Je viens d’écrire huit pages au maréchal. La fatigue et la chaleur m’accablent, j’ai passé hier vingt-quatre heures à cheval. Je t’envoie seulement une espèce de journal sommaire de mes opérations. Tu sais que j’avais dirigé mes trois colonnes, de manière à surprendre le chérif, le 8, par un mouvement combiné. J’ai rejeté Bou Maza sur les colonnes de Ténès et de Mostaganem qui l’ont tenu entre elles et l’ont poursuivi. Il a fini par s’échapper en passant entre Claparède, Canrobert, Fleury et le lieutenant-colonel Berthier. On m’a rapporté trente quatre têtes, mais c’est la sienne que je voulais.
« Le même jour, je poussais une reconnaissance sur les grottes ou plutôt cavernes, deux cents mètres de développement, cinq entrées. Nous sommes reçus à coups de fusil, et j’ai été si surpris que j’ai salué respectueusement quelques balles, ce qui n’est pas mon habitude. Le soir même, investissement par le 53e sous le feu ennemi, un seul homme blessé, mesures bien prises. Le 9, commencement des travaux de siège, blocus, mines, pétards, sommations, instances, prières de sortir et de se rendre. Réponse : injures, blasphèmes, coups de fusil… feu allumé. 10, 11, même répétition. Un Arabe sort le 11, engage ses compatriotes à sortir ; ils refusent. Le 12, onze Arabes sortent, les autres tirent des coups de fusil. Alors je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n’est descendu dans les cavernes ; personne… que moi ne sait qu’il y a là-dessous cinq cents brigands qui n’égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, simplement, sans poésie terrible ni images.
« Frère, personne n’est bon par goût ou par nature comme moi. Du 8 au 12, j’ai été malade, mais ma conscience ne me reproche rien. J’ai fait mon devoir de chef, et demain je recommencerais. Mais j’ai pris l’Afrique en dégoût. » Un mois plus tard, dégoût ou pas, il sera toujours à l’oeuvre : « Je n’ai pas encore tout à fait fini avec les Sbéahs, mais cela avance… A la fin de l’expédition, j’aurai tué ou pris plus de deux mille Sbéahs. La tribu entière compte de dix à douze mille âmes. Et peut-être ne seront-ils pas corrigés ? » […]
[En bref, quelques dates dans la fin de carrière de Saint-Arnaud :
– 1847 : Saint-Arnaud est promu général.
– 1848 : « le sentiment qui domine chez moi, c’est la haine des révolutions ».
– Octobre 1851 : le futur Napoléon III le nomme ministre de la Guerre.
– Saint-Arnaud mène de main de maître le coup d’Etat du 2 décembre 1851.
– En 1852, consécration suprême, il est nommé maréchal de France.
– 1854 : Saint-Arnaud obtient le commandement de l’expédition de Crimée.
– Il remporte la victoire de l’Alma, le 20 septembre 1854.
– Ayant contracté le choléra, il se voit contraint de remettre son commandement le 26.
– 29 septembre 1854 : mort du Maréchal de Saint-Arnaud.]

Dès sa mort, en 1854, au lendemain de la bataille de l’Alma, le frère et la veuve du maréchal avaient eu l’idée de magnifier son souvenir par la publication de ses lettres. Il fallait, écrit Adolphe de Saint-Arnaud dans son introduction, mieux faire connaître l’exemple de cet homme d’action au « patriotisme éclairé et sincère qui ne savait comprendre ni la société sans ordre, ni la France sans grandeur ». Sainte-Beuve consacra à cette correspondance une « Causerie du lundi » tellement enthousiaste qu’elle figura en préface à la seconde édition du livre. Sainte-Beuve faisait du maréchal « la définition vivante de ce qu’est un brillant officier français de notre âge », l’exemple idéal à offrir à la jeunesse française :
« Après avoir tout vu dans la vie, en savoir tous les courants et tous les écueils, s’y être brisé, puis s’en être relevé, connaître les hommes par les passions et savoir s’en servir, avoir appris à ses dépens à toucher en eux les cordes qui résistent et celles qui répondent, avoir conservé au milieu de toutes ses traverses, et jusque dans les désastres où l’on est tombé par sa faute, son sang-froid, sa gaieté, son entrain, les ressources de son esprit, sa bonne mine, son courage, son espérance surtout, et cette moralité essentielle de l’homme ; quelle préparation meilleure, quand le ressort général n’a point fléchi, quand le principe d’honneur a gardé toute sa sensibilité, pour cette improvisation perpétuelle qu’est la guerre et qui, dès qu’on arrive au commandement, est bien autre chose que ce qu’elle paraît de loin ; car on ne l’a définie qu’en gros quand on a dit qu’elle est l’art de tuer et la facilité à mourir… »[…]
Sainte-Beuve disait de Saint-Arnaud : « Militaire français s’il en fut, esprit français, saillie française… » Ombres et lumières : il apparaît, dans notre histoire et au gré des historiens, comme tout cela à la fois, gentilhomme et bourreau, chrétien et cynique, loyal et corrompu. Et toujours : français. Car cet homme est de chez nous. Cet homme est à nous.
Ce qu’il y a de fascinant, dans sa correspondance, ce n’est pas tellement qu’il y raconte avec autant de naturel que de clarté et d’élégance toute une série d’actions qui peuvent difficilement être présentées comme des faits d’armes – cette interminable répétition de pays dévastés, de villages brûlés, de populations massacrées sans distinction d’âge et de sexe. Il avait bien le droit de raconter sa vie à sa famille. Là où ça devient formidable, c’est quand on voit cette famille décider que le plus bel hommage à rendre au cher disparu est de publier ses lettres et que, tout en en supprimant ou amputant, bien légitimement, un certain nombre, elle choisit délibérément de conserver l’essentiel de ces lettres-là. Il n’y a dans ce geste aucune hésitation, aucun doute : ces massacres font partie de la gloire militaire du maréchal. La famille a été jusqu’à conserver la lettre où il écrivait lui-même qu’il ne ferait pas la bêtise de rédiger un rapport officiel sur les enfumades. Pourquoi être gêné ? Rien que d’honorable, dans tout cela. Le maréchal lui-même a été, en son temps, le premier à l’affirmer : « La place était honorable, et je suis fier d’y avoir été. »
François Maspero