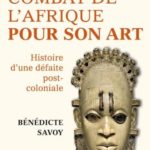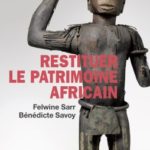Le long combat de l’Afrique pour son art.
Histoire d’une défaite postcoloniale,
par Bénédicte Savoy
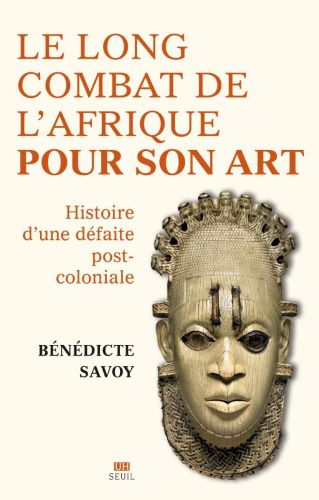
Présentation de l’éditeur Pendant des décennies, les nations africaines ont lutté pour la restitution d’innombrables œuvres d’art volées pendant l’ère coloniale afin d’être exposées dans des musées occidentaux. Bénédicte Savoy met en lumière cette histoire largement méconnue. Elle s’appuie sur de nombreuses sources inédites pour révéler que les racines de cette lutte remontent bien plus loin que ne l’indiquent les débats récents, et que ces efforts ont été menés par une multitude de militants et dirigeants des nations nouvellement indépendantes.
Peu après 1960, lorsque dix-huit anciennes colonies d’Afrique ont accédé à l’indépendance, un mouvement en faveur du rapatriement des œuvres a été lancé par les élites intellectuelles et politiques africaines. L’autrice retrace ces combats et examine aussi comment les musées européens ont tenté de dissimuler des informations sur leurs collections.
En expliquant pourquoi la restitution est essentielle à toute relation future entre les pays africains et l’Occident, ce livre pose les éléments du débat autour de ces questions cruciales pour le présent et l’avenir.
Bénédicte Savoy est depuis 2009 professeure d’histoire de l’art à l’université technique de Berlin, où elle est titulaire d’une chaire consacrée à l’« Histoire de l’art comme histoire culturelle ». Elle est l’autrice de nombreux ouvrages, dont Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2003), Nofretete. Eine deutsch-französische Affäre, 1913-1931. En 2018, elle a publié avec Felwine Sarr Restituer le patrimoine africain (Seuil/Philippe Rey).
Bénédicte Savoy, historienne de l’art :
« Restituer les œuvres d’art africaines, c’est réparer le passé »
Par Séverine Kodjo-Grandvaux
Publié par Le Monde le 30 janvier 2023. Source
L’historienne de l’art, coautrice du « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain », revient, dans un entretien au Monde, sur le mouvement de restitution des objets captés pendant les colonisations, les résistances des musées et la nécessité d’écouter les intellectuels africains et la diaspora sur le sujet.
Coautrice, avec l’économiste sénégalais Felwine Sarr, du « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain », rendu au président Macron fin 2018, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy revient avec Le Long Combat de l’Afrique pour son art (Seuil, 304 pages, 23 euros). Une enquête fouillée sur les premières demandes africaines de restitution et le débat qui s’en est suivi au niveau mondial entre 1965 et 1985.
**Comment la question de la restitution des œuvres d’art africaines est-elle née ?
Je pensais que la question était apparue dans les années 1970, puisque c’est à cette période que remontent les premières demandes officielles du Nigeria, en 1972, présentes dans les archives allemandes, et que l’ONU adopte, en 1973, une résolution en faveur de la restitution.
Mais, en fait, pour arriver à cela, il a fallu une véritable « agentivité » africaine, à l’œuvre depuis une dizaine d’années, avec entre autres, en 1965, dans la revue Bingo, l’éditorial de l’écrivain et journaliste Paulin Joachim « Rendez-nous l’art nègre », puis le festival panafricain d’Alger en 1969, où la question est abordée, et le film You Hide Me, du Ghanéen Nii Kwate Owoo, tourné en 1970 au British Museum sur les « objets cachés ». C’est lorsque Mobutu, alors président de la République démocratique du Congo, évoque la question à la tribune de l’ONU, en 1973, que le sujet, qui avait d’abord mûri en Afrique, prend une dimension internationale. L’Europe ne fait que réagir à cela.
Outre la volonté de récupérer un patrimoine disparu, il y a de la part des Africains l’idée, dites-vous, qu’un renouveau de l’historiographie de l’art du continent doit être mené par les Africains. Pourquoi ?
Il s’agissait pour des personnes comme Paulin Joachim d’affirmer qu’il fallait, maintenant que l’indépendance avait été acquise, se reconnecter avec soi-même, ses cultures immatérielles mais aussi matérielles, afin d’être fort pour l’avenir. Il y avait également de la part de certains scientifiques ou érudits, comme Ekpo Eyo [1931-2011], un archéologue nigérian de grande réputation internationale, la volonté de montrer que les Européens qui avaient parlé de leurs objets, comme les bronzes du Bénin [de Benin City, au Nigeria], ne les avaient pas compris correctement.
Il ne s’agit pas seulement de récupérer les objets en tant que tels, mais également de se les réapproprier intellectuellement, en posant les questions de leur usage, en les reconnectant avec leur cadre épistémologique naturel, religieux notamment, afin de les sortir de la simple approche esthétique européenne.
Dès la fin de la colonisation, les Européens ont conscience du problème et mettent en place des dispositifs pour conserver les œuvres…
Les puissances européennes, sans s’accorder les unes avec les autres, ont mis au point, par vagues, des stratégies de résistance. La toute première, autour de 1960, est spontanée. Immédiatement après les indépendances, plusieurs pays européens, notamment la France et l’Angleterre, prennent des mesures protectionnistes pour rendre inaliénable le patrimoine venu des colonies.
La seconde vague a lieu lorsque l’Unesco, avec à sa tête son premier directeur général africain noir, le Sénégalais Amadou-Mahtar M’Bow, fait de cette question une de ses priorités à partir de 1976. Les musées développent des stratégies juridiques, scientifiques et médiatiques pour empêcher non seulement les restitutions mais aussi le débat et l’étouffer dès que possible, même lorsque le sujet est abordé dans des grands talk-shows télévisés ou au JT.
**Stratégies mises au point dans un document top secret que vous avez découvert et qui constitue une sorte de matrice toujours active, analysez-vous…
Trouver ce document top secret a été fascinant. Il a été conçu par la commission allemande de l’Unesco… contre l’Unesco ! C’est une sorte de vade-mecum pour lutter contre les demandes de restitution, qui insiste notamment sur la nécessité d’éviter à tout prix le terme de « restitution » et de le remplacer par « transfert », car quand on restitue, c’est pour réparer le passé. Aujourd’hui, certains préfèrent parler non pas de restitution mais de circulation.
C’est une manière d’éviter la dimension historique de la restitution – et donc le sujet de la colonisation – en en restant au niveau géographique. En cela, le discours de Ouagadougou d’Emmanuel Macron, qui parle de restitution alors qu’il est attendu d’un président de la République de ne pas le faire, a sûrement produit un déclic très puissant.
**Que préconise d’autre ce document ?
Les opposants aux restitutions ont bien compris que ce sujet est lié à des émotions du côté des perdants, qui réclament une partie de leur héritage. Ils vont alors se donner comme guide d’étouffer les émotions et d’opposer la légalité à l’émotion. Cela fonctionne encore ainsi aujourd’hui. Après la remise du rapport rédigé avec Felwine Sarr, j’ai été très souvent accusée d’émotionnalité, aussi parce que je suis une femme, et de ne pas être dans l’objectivité.
Dans ces débats, il y a bien une économie de l’émotionnalité quand les musées brandissent la catastrophe de lieux vidés et leur disparition prochaine. Enfin, ce qui reste actuel en Allemagne – c’est différent en France –, c’est que les musées décident de ne plus publier leurs inventaires, parce que ça pourrait susciter des envies. Ce qui fait qu’en Allemagne aujourd’hui, il n’y a pas d’inventaire disponible des collections africaines.
Les institutions muséales ne se sont pas contentées de refuser de rendre les œuvres demandées. Elles ont largement caché la réalité, voire menti…
Ce sont les « fake news » avant la lettre. Et l’on est surpris de voir que ces fausses informations sont adressées aux autorités politiques qui doivent décider des éventuelles restitutions. Dans les années 1970-1980, les ministères des affaires étrangères étaient plutôt prorestitution, et les ministères de la culture conservateurs. Les musées n’ont pas du tout hésité à donner de fausses informations aux politiques sur la provenance et la part coloniale de leurs collections, chiffres erronés à l’appui, alors que dans les revues scientifiques d’autres chiffres circulaient.
La restitution ne remet-elle pas en question l’idée même de musée universel, sur laquelle reposent des institutions comme le Musée du quai Branly ?
On a souvent l’impression que l’idée de musée universel vient du début du XIXe siècle et de la Révolution française. Mais c’est une construction des années 2000, notamment avec une déclaration sur le musée universel signée en 2002 par une quinzaine de musées occidentaux et qui est une forme de réponse à ce débat.
En réalité, les musées qui nous occupent, y compris le Musée du quai Branly, qui arrive à la suite du Musée des colonies et du Musée de l’homme, sont au départ des musées impériaux. Ils répondent à une émulation nationale impériale assez forte au XIXe siècle. A la fin des empires, fin XXe-début XXIe siècle, on a transformé cela en universalisme. Mais c’est un universalisme rhétorique, qui postule l’accès de tous à ces musées ; ce qui n’est évidemment pas possible pour des raisons économiques et liées à l’obtention de visas.
A la suite de votre rapport, quelques œuvres ont été restituées. Mais on a l’impression, en vous lisant, que l’histoire bégaie malgré tout…
Je préfère parler d’effet boomerang et de retour du refoulé. Le débat public dans le monde anglo-saxon, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, est très fort. C’est comme le débat du climat, qui nous a étonnés mais qui avait déjà existé avant d’être oublié et de revenir décuplé. Depuis que la République du Bénin a obtenu le retour des 2,5 tonnes des trésors du royaume d’Abomey, c’est un peu comme une grande brèche dans une sorte de mur de Berlin. Le changement de paradigme est là. Le reste va se faire. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère.
L’Allemagne est en train de restituer un millier de pièces au Nigeria. Avec des collègues de Dschang [ville du Cameroun, ndlr], nous enquêtons à Berlin sur soixante mille pièces du patrimoine camerounais ignorées de tous. A partir du moment où la visibilité va être donnée, les choses vont se faire. Ce qui importe désormais, c’est que les sociétés qui souhaitent récupérer une partie de ces patrimoines mènent les négociations et les discussions publiques, politiques, économiques nécessaires pour savoir ce qu’elles-mêmes veulent en faire. Et que nous écoutions ce qu’ont à nous dire les intellectuels africains et la diaspora à ce sujet.
Vous parlez d’une défaite postcoloniale. Pour qui est-ce une défaite ?
C’est une défaite, au premier degré, pour les Etats africains qui ont tenté, avec beaucoup de discours humanistes et d’intelligence conceptuelle, de récupérer ces patrimoines au moment de leur indépendance. Mais la défaite est aussi, au second degré, peut-être bien plus forte pour nous autres Européens, en tout cas pour la génération de nos parents et grands-parents, qui n’a pas réussi à discuter sereinement de ces questions et à trouver des solutions équitables et honnêtes. Ils nous ont légué le soin de nous en occuper. Il y va de la justice patrimoniale.
Une des leçons de Bénédicte Savoy au Collège de France
Leçon donnée en 2017 sur le thème « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées ».
Le cours s’intéresse à un objet originaire du Cameroun et conservé au musée ethnologique de Berlin. Le trône du royaume de Bamoun, que les catalogues des musées de Berlin appellent « Mandu Yenu », « riche de perles », mesure 1,74 m de haut, il est fait d’une âme en bois recouverte d’un tissu tressé de perles en verre. Il est arrivé à Berlin en 1908, comme cadeau diplomatique du gouvernement impérial du Cameroun au Kaiser Guillaume II. Or, deux ans plus tôt, le directeur des musées de Berlin avait demandé à un officier colonial de suggérer au chef de Bamoun d’offrir son trône à l’empereur allemand. L’heure était alors à la course impérialiste à la collection, dans un contexte de concurrence internationale avec le musée d’ethnographie du Trocadéro et le British Museum.
À qui appartient le trône ? La première position répond que « donner, c’est donner » et que restituer reviendrait à écrire l’histoire à l’envers. Mais, dans un contexte de violence coloniale et de dissymétrie de pouvoir – le Cameroun était une des rares colonies allemandes –, peut-on vraiment parler de don ? Cet objet est aujourd’hui particulièrement contesté à Berlin. Certes, en étant présenté dans un musée, l’objet perd sa fonction politique de trône, mais ce sont également les pratiques artisanales locales qui sont affectées, car, ce modèle étant à Berlin, les artisans camerounais ne peuvent plus continuer à développer leur art au niveau local. Une solution serait de fabriquer une copie du trône et de restituer l’original mais est-ce qu’une copie dans un musée berlinois pourrait résoudre ces soucis d’appartenance ?
Lire aussi
• Du pillage culturel colonial aux difficiles restitutions postcoloniales
• Il s’agit de rendre au continent africain une partie de son histoire par Joseph Confavreux
• Faut-il restituer l’art africain ? (payant)