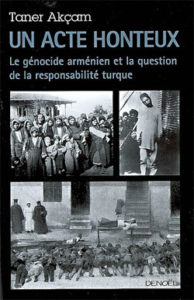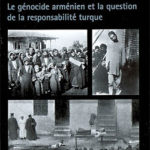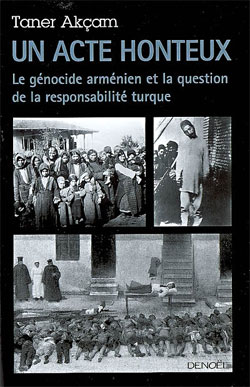
COMMUNIQUÉ LDH
Paris, le 22 avril 2008
Génocide arménien : mémoire, histoire et respect des droits
La Ligue des droits de l’Homme s’associe pleinement à la commémoration de l’anniversaire du génocide arménien les 23 et 24 avril.
Faire face à la réalité historique de ce crime de masse, refuser les histoires officielles qui la déforment ou la dissimulent, est, ici comme ailleurs, la condition de toute démarche respectueuse des droits de l’Homme.
Ainsi seulement pourra se construire, au-delà des crispations nationalistes, une mémoire partagée entre Arméniens et Turcs, sans laquelle aucun avenir de paix n’est durablement possible.
Génocide
La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (adoptée à l’unanimité, par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948) :
- Art.1 Le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens.
- Art.2 Le génocide s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux :
- meurtre de membres du groupe ;
- atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
- mesures visant à interdire les naissances au sein du groupe ;
- transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le crime de génocide, commis en temps de paix comme en temps de guerre, est déclaré imprescriptible par la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968.
Un crime contre l’Histoire
Taner Akçam démontre la responsabilité de l’Etat turc dans le génocide des Arméniens
ceux qui s’interrogent encore sur la réalité du génocide des Arméniens, perpétré en 1915 par les Jeunes-Turcs au pouvoir à Constantinople, le livre de Taner Akçam devrait ôter leurs derniers doutes. Paru aux Etats-Unis en 2006, l’ouvrage de ce sociologue turc prend à contre-pied la thèse officielle turque sur ce crime commis pendant la Grande Guerre.1
Pour la première fois, un chercheur turc a le courage d’ouvrir les archives ottomanes sur cette période sensible et d’assumer pleinement ce qui s’est passé : ici, la catastrophe est disséquée non du point de vue des victimes mais à travers le regard des assassins. La représentation du drame s’en trouve transformée. Avec Taner Akçam, ce qui compte, ce n’est plus le témoignage des rescapés, mais d’abord l’analyse d’un empire paranoïaque capable de transformer ses dirigeants en bourreaux. A 55 ans, cet enseignant au Center for Holocaust and Genocide de l’université du Minnesota concentre ses travaux sur une question : « Avons-nous des preuves d’une planification centrale et déterminée des autorités ottomanes visant la destruction totale ou partielle du peuple arménien ? »
En Turquie, la tragédie de 1915 est encore aujourd’hui présentée comme une cruelle conséquence de la guerre, et non comme un acte volontaire et formalisé : selon cette thèse, les sources officielles ne comporteraient aucune preuve de l’élimination délibérée et systématique des Arméniens. L’auteur démontre ici que ce discours est sans fondement. De façon irréfutable, il souligne la responsabilité du régime au pouvoir, de l’Etat, de son administration, et d’abord de l’armée. La bureaucratisation du meurtre collectif apparaît évidente, dit-il, dès lors que l’on se fonde sur « les minutes des débats parlementaires, la correspondance privée des organisateurs du crime et les procès-verbaux de soixante-trois tribu naux militaires jugeant en 1919 les dirigeants du CUP [le Comité union et progrès, le parti au pouvoir] », qui accablent ce dernier ainsi que l’armée turque.
Outre la responsabilité de l’Etat, Taner Akçam insiste sur la continuité entre les Jeunes-Turcs et les kémalistes qui fondent la République en 1923 : en effet, la majorité des dirigeants de la Turquie moderne sont issus des rangs jeunes-turcs, y compris Mustapha Kemal, et nombre d’entre eux sont compromis dans l’entreprise génocidaire.
Cette idée de continuité est rarement examinée par les historiens ; elle rompt avec la thèse selon laquelle la République kémaliste n’aurait rien à voir avec les événements de 1915. En réalité, les lois adoptées dans les années 1920 parachèvent le processus d’éradication de la présence arménienne dans le pays.
C’est le nationalisme qui fait le lien entre les deux régimes. Taner Akçam en décortique l’ambition : créer une Turquie homogène. Un dessein interrompu par les échecs militaires (1912-1915) attribués à « l’élément arménien ». Enfin, il aborde l’aspect économique de ce crime contre l’humanité, considérant que c’est dans la spoliation des Arméniens de l’empire, souvent aisés, que sont jetées les bases d’une bourgeoisie turque, pilier de la proto-modernité kémaliste.
Telles seraient donc les origines du négationnisme d’Etat toujours en vigueur en Turquie, mais désormais bousculé par une société turque désireuse de s’approprier son histoire. En ce sens, ce livre salué par Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature 2006, invite la Turquie à revisiter sa mémoire. L’exercice est courageux : à Ankara, tout auteur qui soulève le tabou arménien voit sa liberté menacée par les tribunaux. Ancien militant d’extrême gauche, qui a connu la prison dans les années 1980, Akçam n’en prend pas moins, désormais, ses précautions : « Un acte honteux » n’est-elle pas l’expression utilisée par Kemal lui-même pour qualifier l’extermination des Arméniens ?
Hier comme aujourd’hui, l’identité arménienne, prolongement de la culture occidentale, demeure une pierre d’achoppement entre Turcs et Européens. Tant que la Turquie ne s’interrogera pas « sur sa perception des droits de l’homme et de la démocratie », prévient-il, le dissensus sur les normes éthiques perdurera. Selon Taner Akçam, il revient donc à la Turquie de s’affranchir de cet « acte honteux » par un acte courageux : la reconnaissance du génocide.
Arménie, devoir de mémoire
Editorial du Monde, le 19 janvier 2001
En votant en dernière lecture, jeudi 18 janvier, un texte de loi qui tient en une phrase, les parlementaires français créent un événement exceptionnel : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. » Avant eux, la sous-commission des Nations unies pour les droits de l’homme en 1985 et le Parlement européen deux ans plus tard avaient qualifié de « génocide » le massacre des Arméniens par les Turcs pendant la première guerre mondiale. Sous la pression de considérations diplomatiques qui n’ont pas été absentes du débat français entre les pouvoirs législatif et exécutif, la Chambre américaine des représentants a renoncé à accomplir le même geste.
On peut certes s’interroger sur la légitimité d’une Assemblée parlementaire à trancher par un vote d’un fait historique qui donne encore lieu à des controverses entre spécialistes. Mais le fait est là : en 1915 et 1916, un à deux millions d’Arméniens qui vivaient depuis des siècles dans l’Empire ottoman ont été déportés, puis assassinés par les Turcs. Le prétexte était la collaboration de certains d’entre eux avec l’ennemi russe, la Turquie étant alors l’alliée de l’Allemagne wilhémienne. Or les massacres avaient commencé dès la fin du XIXe siècle et encore en 1909 sous l’impulsion des Jeunes Turcs, en révolte contre le sultan.
En 1948, l’ONU a défini le « génocide » comme la « soumission intentionnelle [d’un national, ethnique, racial ou religieux à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». Concernant les Arméniens, le crime de génocide paraît donc bien constitué. Les alliés de 1914- 1918 n’hésitaient pas à qualifier l’attitude turque de « crime contre l’humanité », jusqu’à la disparition de cette qualification, dans le traité de Lausanne de 1923, pour les convenances de la Realpolitik.
Au lieu de menacer d’une « crise sérieuse » les relations franco-turques si la loi sur le génocide des Arméniens est promulguée, les autorités d’Ankara seraient mieux avisées de réfléchir sur la contribution qu’elles-mêmes, dans le sillage de « nouveaux historiens » turcs qui commencent à secouer les tabous, pourraient apporter à la reconnaissance d’une responsabilité dans les horreurs infligées au nom de la Turquie. Ce travail de mémoire est douloureux – la France le sait trop bien pour être confrontée à ses périodes d’ombre, de Vichy à l’Algérie. Il est d’autant plus délicat qu’il touche aux fondements mêmes de la République kémaliste. Mais il est indispensable si la Turquie veut être acceptée comme une puissance européenne à part entière et, à terme, admise dans l’Union.
Le génocide des Arméniens a été le premier du XXe siècle. Tragique ironie de l’Histoire, des membres de la mission militaire allemande à Constantinople, qui avaient, en 1915, conseillé le pouvoir turc pour la déportation des Arméniens, se retrouveront vingt ans plus tard parmi les exécutants de la solution finale contre les Juifs. Il est urgent de ne pas l’oublier.
LOI N° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 2
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 29 janvier 2001.
REPERES
1894-1896 – Massacres de 300 000 Arméniens dans l’Empire ottoman.
Avril 1909 – Massacres de 30 000 Arméniens à Adana (Sud de la Turquie actuelle).
Novembre 1914 – La Russie, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Empire ottoman allié de l’Allemagne. Les Arméniens se retrouvent dans les deux camps.
Avril 1915 – Résistance des Arméniens de Van après l’assassinat de plusieurs notables.
24 avril 1915 – Arrestation de 235 intellectuels arméniens à Constantinople. En quelques jours, plus de 2 300 notables arméniens sont tués dans tout l’Empire.
Mai 1915 – Les responsables militaires ottomans commencent à déporter massivement les Arméniens de l’est de la Turquie, les accusant de soutenir les troupes russes qui l’ont envahie. Près de 870 000 Arméniens trouvent la mort lors de cet exode forcé, dans des massacres ou à cause de la faim et des privations. En 1916, les massacres se poursuivent. En tout, entre 1,2 et 1,5 million d’Arméniens sont morts dans l’Empire ottoman.
1918-1920 – Éphémère République d’Arménie, prise en étau entre les ambitions russe et turque.
Juillet 1919 – Procès à Istanbul de responsables du massacre des Arméniens.
Août 1920 – Traité de Sèvres qui entérine le démembrement de l’Empire ottoman et prévoit une Grande Arménie indépendante. La Turquie ottomane admet la réalité des massacres et des déportations et s’engage à procéder à des « réparations ».
Décembre 1920 – Traité d’Alexandropol qui fixe les limites de la République d’Arménie à ses dimensions actuelles. La Turquie s’empare des territoires situés au sud de l’Araxe. Le Nagorny Karabakh et le Nakhitchevan sont rattachés à l’Azerbaïdjan soviétique.
1922 – L’Arménie soviétique est incluse dans la Fédération des Républiques transcaucasiennes.
Juillet 1923 – Le traité de Lausanne, annulant le traité de Sèvres, consacre les frontières de la Turquie avec l’URSS. Pour la nouvelle République turque il n’est plus question de « réparations ». Le traité autorise les Turcs à interdire le retour des émigrés et des réfugiés arméniens, créant ainsi 600 000 à 800 000 apatrides.
1985 – Reconnaissance du génocide arménien par la sous-commission des droits de l’homme de l’ONU.
1987 – Le Parlement européen reconnaît le génocide.
1991 – L’indépendance de l’Arménie, aussitôt reconnue par Ankara.
1993 – La Turquie ferme sa frontière avec Erevan en solidarité avec l’Azerbaïdjan en guerre contre l’Arménie.
2001 – La France adopte une loi reconnaissant le génocide arménien.
6 septembre 2008 – Visite du président turc Abdullah Gül à Erevan pour assister au match de football Arménie-Turquie.