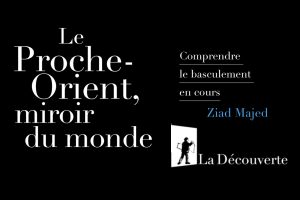Extrait du chapitre 9 de Proche-Orient, miroir du monde : comprendre le basculement en cours de Ziad Majed, La Découverte, disponible en librairie le 9 octobre 2025. Ziad Majed (né en 1970 à Beyrouth) est un politologue, professeur universitaire et chercheur franco-libanais. Il est auteur et co-auteur d’ouvrages, d’articles et d’études sur les réformes, les transitions démocratiques, les élections, la société civile et la citoyenneté au Liban, en Syrie et dans la région arabe.
D’abord publié dans L’Orient-Le Jour
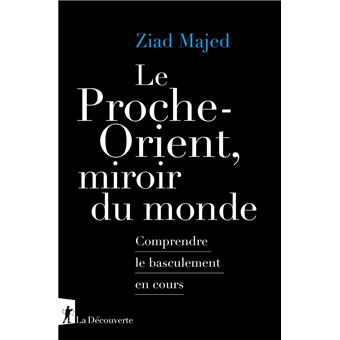
Dès les premières heures ayant suivi les attaques du Hamas le 7 octobre, un récit dominant s’imposa dans la couverture médiatique dans la plupart des pays occidentaux avec une efficacité redoutable : les victimes israéliennes furent immédiatement identifiées, nommées, photographiées, leurs histoires racontées avec minutie et humanité. À l’inverse, les victimes palestiniennes des bombardements furent – si reconnues comme telles – réduites à des données statistiques, désincarnées, banalisées et renvoyées au registre abstrait des « dommages collatéraux ». La dissymétrie atteignit son paroxysme dans la focalisation sur l’attaque de la rave party. Cette scène, abondamment médiatisée, fut érigée en allégorie universelle : une fête, une jeunesse pimpante et exaltée, dansant sur de la musique, brutalement interrompue par une « horde » violente jugée exogène et barbare. Le contraste, hautement symbolique, rejoua la scène du fantasme colonial préexistant dans lequel un Occident hédoniste, éclairé et pacifié, est agressé par un Orient musulman obscur et radicalisé.
Ce cadrage narratif s’est trouvé renforcé par l’activation d’un imaginaire analogue, puisé dans d’autres traumatismes collectifs : les attentats du 11 septembre, l’attaque du Bataclan, et plus largement les violences djihadistes qui ont marqué les sociétés occidentales au tournant du XXIe siècle. En mobilisant ces référents émotionnels profondément ancrés, la rhétorique israélienne – largement relayée sur de nombreux plateaux – opéra un puissant transfert affectif, ce qui favorisa une identification aux victimes israéliennes tout en suscitant, en contrechamp, une stigmatisation collective, quasi systématique, de celles et ceux qui partageaient, à tort ou à raison, certains attributs religieux ou « raciaux » avec les assaillants.
Plus significatif politiquement, le soutien à Israël bascula d’un registre hérité de la mémoire de la Shoah et de la culpabilité, vers une adhésion idéologique à un modèle d’État sécuritaire, colonial, ethno-national et militarisé. Ce déplacement s’accompagna d’un phénomène jusque-là marginal mais devenu alors central, à savoir une convergence stratégique et idéologique entre certains courants de l’extrême droite occidentale et les soutiens les plus fervents de l’État israélien. Là où l’antisémitisme avait longtemps structuré l’idéologie de l’extrême droite, celle-ci semblait réorienter sa haine. En effet, « le juif », autrefois ennemi intérieur fantasmé, avait cédé progressivement la place au « musulman », désormais perçu comme la figure menaçante. Dans cette perspective « racialisante », les Palestiniens de Gaza concentrent tous les stigmates : ils sont majoritairement arabes, musulmans et basanés, tandis que leurs femmes sont souvent voilées et font beaucoup d’enfants. Mais, surtout, et c’est ce qui insupporte le plus, ils ont l’outrecuidance de résister. Leur enracinement territorial, leur refus de l’effacement, leur obstination à survivre malgré le blocus, les destructions récurrentes, les privations, les déplacements forcés et les massacres successifs, dérangent. Là où l’on attendrait soumission ou implosion, ils opposent présence, dignité et endurance.
L’effritement de l’universalisme juridique
La guerre israélienne à Gaza provoqua aussi un renversement dans les prétentions éthiques de l’Occident. Aux idéaux universalistes longtemps revendiqués se substitua une logique d’exception permanente. Le droit international humanitaire, conçu pour contraindre la raison d’État à la morale juridique, fut vidé de sa substance ou suspendu. Sa mobilisation devint soumise à l’identité des victimes ou à la configuration géopolitique des alliances. La comparaison avec l’agression russe contre l’Ukraine mit en lumière cette dissonance structurelle. Là où l’invasion de février 2022 déclencha un sursaut diplomatique immédiat et une reconnaissance unanime des droits du peuple ukrainien à résister, la cause palestinienne demeura frappée d’animosité. Là où la Cour pénale internationale fut saisie avec empressement afin d’enquêter sur les crimes commis par Moscou, elle rencontra inertie, blocages et déni s’agissant de Gaza.
Ce climat affecta fatalement la pratique de la démocratie, réorientée dorénavant vers une gestion autoritaire de la dissidence. Au nom de la lutte contre l’antisémitisme ou l’apologie du terrorisme, on érigea des dispositifs d’exception restreignant la parole publique. Le pluralisme se trouva réduit à une tolérance conditionnelle. L’Université et les espaces culturels et scientifiques furent appelés à réprimer la dissonance, l’historicisation et la mise en contexte.
Ce ne fut donc pas seulement le droit international qui connut un déclin, mais tout un ensemble de repères normatifs, moraux et symboliques qui volèrent en éclats. À cela s’ajouta l’impact de la transformation de la mémoire de la Shoah en « religion civile » (selon les termes d’Enzo Traverso), c’est-à-dire en un dispositif commémoratif la figeant en référence morale absolue et conduisant à une forme de paralysie critique où cette mémoire, loin d’ouvrir à l’universel, devient un écran faisant obstacle à la reconnaissance d’autres crimes de masse – notamment ceux perpétrés contre les Palestiniens, d’autant plus que leurs auteurs sont supposés être les descendants mêmes des victimes de la Shoah. Cette religion civile, dominante en Allemagne et influente dans plusieurs cercles politiques européens, joua un rôle déterminant dans certaines prises de position publiques, ainsi que dans les formes de négation ou d’occultation du massacre commis par Israël.
Pourtant, malgré cette chape de plomb œuvrant à l’invisibilisation et à la déshumanisation, malgré la censure et le racisme décomplexé, des poches de résistance persistèrent, à New York comme à Londres, Paris, Amsterdam, Stockholm et Bruxelles, à Madrid comme à Rome, Rabat, Cape Town, Jakarta, São Paolo, Santiago et sur des dizaines de campus de par le monde. Des rassemblements, des manifestations, des concerts, des conférences, des réunions publiques ainsi que des chants et des drapeaux dans les stades de football dénoncèrent régulièrement le génocide israélien et exprimèrent un soutien sans faille à la cause palestinienne…