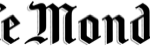La nostalgie de l’Empire britannique, une querelle anglaise
Source
Bousculé par une nouvelle historiographie s’intéressant aux zones d’ombre de la colonisation britannique, le Royaume-Uni traverse une crise mémorielle autour de son passé impérial, qu’il n’a jamais vraiment cessé de vénérer.
Samedi 6 mai, toute la pompe de la monarchie britannique se déploiera pour le couronnement de Charles III à l’abbaye de Westminster. Il deviendra alors le quarantième souverain à recevoir l’onction dans cette église depuis 1066. A travers ces traditions royales, le Royaume-Uni célèbre notamment son passé.
Le pragmatisme ambiant rend le pays étranger aux querelles historiques qui embrasent régulièrement la France. Pourtant, depuis le référendum sur le Brexit en 2016, les choses ont changé, particulièrement en Angleterre, où s’est jouée la sortie de l’Union européenne (UE). Son vote « leave » a fait pencher la balance, car elle pèse bien plus lourd démographiquement que les autres nations du Royaume-Uni (Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord). Les brexiters rêvaient de voir le pays retrouver son statut d’exception, en quittant une communauté d’égaux au sein de l’UE. Depuis, l’Angleterre est aux prises avec une polémique tenace sur l’Empire britannique sur qui, décidément, le soleil ne se couche pas : un jour sans fin s’abat sur ce passé qui ne passe pas.
Un empire de plus de quatre cent ans d’histoire
Par son ampleur, l’entreprise coloniale a profondément marqué le pays. Son histoire débute au XVIIe siècle et s’étend sur quatre cents ans. A son sommet, dans les années 1920, il formait le plus grand empire de l’histoire. Après la seconde guerre mondiale, il s’est lentement désagrégé, mais non sans résistance. Winston Churchill, héros de la victoire face au nazisme, a présidé en tant que premier ministre à la dure répression de la révolte des Mau Mau au Kenya (1952-1956) : 11 000 rebelles ont alors été tués.
L’attention se concentre aujourd’hui sur l’esclavage. Près de 12,5 millions d’Africains ont été enlevés pour servir d’esclaves en Amérique, un quart d’entre eux ont fait la traversée sur des navires britanniques, d’après la Trans-Atlantic Slave Trade Database (plus de 1,3 million de captifs ont été embarqués sur des bateaux sous pavillon français). L’Empire a toutefois aboli (progressivement) l’esclavage en 1833, soit quinze ans avant la France.
Plus que tout autre, l’ancien premier ministre Boris Johnson a remis en circulation le « roman impérial » : la puissance passée attesterait de la haute destinée à laquelle le pays serait appelé. En 2020, alors qu’il était encore au 10 Downing Street, Boris Johnson affirmait qu’il fallait en finir avec « notre gêne embarrassante à propos de notre histoire ».
Il se portait alors à la défense de l’hymne impérial Rule, Britannia ! qui continue d’être chanté en clôture des Proms, une série de concerts londoniens, l’une des manifestations culturelles les plus importantes de l’été dans la capitale britannique. Cette chanson datant du XVIIIe siècle présente les Britanniques comme un peuple choisi parmi les nations qui ne se laissera pas réduire en esclavage et à qui, donc, il revient de conquérir le monde grâce à sa maîtrise de la mer.
Vague à l’âme post-Brexit
En 2018, M. Johnson expliquait que le Brexit devait permettre de retrouver « le dynamisme de ces victoriens barbus » et « d’investir le monde d’une façon qui avait peut-être été oubliée depuis quarante-cinq ans ». En 2016, il avait été chaudement applaudi par les membres du Parti conservateur lorsque, au détour d’un discours, il s’était félicité du fait que « ce pays a dirigé l’invasion ou la conquête de 178 nations ».
L’actuel premier ministre, Rishi Sunak, fils d’un immigré d’origine indienne, cherche pour sa part à donner une autre image du conservatisme, mais il doit composer avec la frange radicale du parti tory. Réunis au sein du collectif Common Sense, une cinquantaine de députés s’opposent à l’immigration, en plus d’être ulcérés par tout ce qui relèverait du phénomène woke. Les attaques de la gauche contre l’histoire du pays seraient si graves que l’un d’entre eux, Gareth Bacon, estime que « l’Empire britannique n’est plus vu comme une force modernisatrice et civilisatrice qui a étendu les échanges commerciaux, la richesse et répandu l’Etat de droit autour du monde ». C’est ce qu’il écrivait dans sa contribution au recueil d’articles qui a valeur de manifeste pour ce collectif, Conservative Thinking for a Post-Liberal Age.
Les milieux intellectuels s’interrogent sur le sens de ce discours empreint de nostalgie. L’Empire n’est qu’un élément parmi d’autres dans la rhétorique des pro-Brexit, mais son héritage suscite aujourd’hui de larges débats. Le Royaume-Uni n’échappe pas à l’essor des études postcoloniales. Dans les grandes librairies de Londres, si les biographies de Winston Churchill continuent d’occuper de vastes pans de murs, on trouve également des sections consacrées au colonialisme et à l’impérialisme. Journaux et revues posent la question de l’impact de cet héritage. Mis sous pression par une enquête du Guardian sur l’origine de la fortune de la couronne, Charles III a indiqué soutenir la recherche étudiant les liens entre la monarchie et la traite des esclaves.
Bien avant le vague à l’âme post-Brexit, le professeur à l’University College de Londres Paul Gilroy, qui y dirige le Center for the Study of Racism and Racialisation, avait perçu que l’Angleterre dansait sur un volcan. En 2004, il a publié un essai prophétique, Mélancolie postcoloniale (éditions B42), paru en France en 2020. Rencontré fin mars à Finsbury Park, un jardin public du nord de Londres, le lauréat 2019 du prix Holberg, le « Nobel des sciences sociales », fait grève. Un vaste mouvement social secoue le secteur public britannique au moment où le pays connaît une importante inflation, venue se greffer aux tensions créées par douze années d’austérité. La capitale britannique a néanmoins gardé son calme. Quelques klaxons se font entendre pour encourager les étudiants qui font le piquet de grève devant leur fac.
Paul Gilroy regrette de voir stagner l’Angleterre à force de rater certaines occasions. « Nous avons eu le malheur de remporter la guerre », déplore-t-il. Cette boutade traduit l’impasse dans laquelle se trouve la nation de la Rose : le deuil de l’Empire n’a jamais été fait. La victoire héroïque de 1945 a empêché l’examen de conscience nécessaire pour permettre à la nation de se réinventer et d’embrasser la diversité culturelle qui la caractérise désormais. Au moment des indépendances, dans les années 1950, l’histoire de l’Empire a été refoulée, les violences coloniales oubliées.
Ne pas « diaboliser l’histoire »
A cette époque, des tensions internes émergent au sein de la Grande-Bretagne. L’Ecosse et le Pays de Galles commencent à exprimer des velléités sécessionnistes. Mais c’est en Angleterre que le nationalisme prend le visage de l’intolérance, lorsqu’en 1968 le député conservateur Enoch Powell, opposé à l’immigration venue des anciennes colonies, prononce son discours dit « des fleuves de sang », qui lance le terme de « réémigration » si populaire à l’extrême droite. De plus, dans les années 1980, le thatchérisme, en s’attaquant aux syndicats et à l’Etat-providence, a exacerbé les inégalités sociales et affaibli l’unité du pays.
« L’Angleterre est aux prises avec une grave pathologie parce que son identité se confond avec celle de la Grande-Bretagne, un pays qui a été formé après l’acte d’Union avec l’Ecosse en 1707, au moment où l’Empire prend forme. Les institutions de l’Etat britannique ont donc été pensées pour l’administrer. Si nous n’avions pas remporté la guerre en 1945, nous aurions été contraints de faire face à notre passé, d’adapter cet Etat à la modernité. Mais la victoire a fait croire qu’en dépit de la perte de l’Empire le prestige national demeurait intact, qu’il n’y avait rien à changer », explique Paul Gilroy. Dans ce contexte, l’immigré incarne un refoulement. Il reste difficile d’admettre que, s’il habite aujourd’hui l’Angleterre, c’est qu’hier l’Angleterre était chez lui. Paul Gilroy propose de sortir du repli par un cosmopolitisme du quotidien, plutôt que de s’en remettre à l’Etat. Il incite chacun à s’exposer à l’altérité et à pratiquer la tolérance, notamment par l’écoute et l’amitié.
Masquer le passé est bien au cœur de différentes controverses qui ont éclaté au cours des dernières années, mettant aux prises d’importantes institutions britanniques. En 2020, une campagne a été lancée contre les « idéologies » qui se seraient emparées du National Trust, l’association qui, avec 5,4 millions de membres, veille sur le patrimoine britannique. Sous le nom Restore Trust (« restaurer la confiance »), un groupe de pression fait souffler un vent d’insurrection au sein de cette organisation. Comme l’indique son site Internet, son intention est notamment de « restaurer un sentiment d’ouverture envers tous les visiteurs sans diaboliser l’histoire ou l’héritage de quiconque ». Fondé en 2021 par Cornelia van der Poll, une spécialiste de la Grèce antique qui enseigne à Oxford, Restore Trust est aujourd’hui dirigé par Zewditu Gebreyohanes. Cette femme de 24 ans, très engagée contre le wokisme, était auparavant à la tête du projet « History Matters » au sein du think tank conservateur Policy Exchange. Cette campagne bénéficie du soutien du Common Sense Group.
C’est un rapport rendu public en 2020 par le National Trust sur les liens entre ses différentes propriétés, châteaux et manoirs, et l’esclavage qui avait mis le feu aux poudres. « L’intention de Restore Trust est clairement d’amener le National Trust à ne plus parler de colonialisme, de l’esclavage », estime Alan Lester, professeur d’histoire et de géographie à l’université du Sussex, auteur de Deny & Disavow. Distancing the Imperial Past in the Culture Wars (« Nier et Renier. Mettre le passé impérial à distance dans les guerres culturelles », non traduit, Sunrise Publishing, 2022). En novembre 2022, Restore Trust a cherché, sans y parvenir, à faire élire à la direction du National Trust des membres plus proches de ses idées.
Curry et shampooing
Cette campagne visant l’association participe d’une contre-offensive plus générale contre la nouvelle histoire de l’Empire qui a récemment pris son essor. « L’historiographie a évolué. Il y a encore peu, les historiens se concentraient sur les “victoires” et l’administration de cet ensemble. D’autres, avec une approche marxiste, analysaient les motivations économiques des acteurs. Mais on s’intéressait peu à ce que l’Empire signifiait pour ses sujets. La théorie postcoloniale a commencé à faire bouger les choses dans les années 1980-1990. Elle avait cependant ses limites. La « nouvelle histoire impériale », qui a pris son essor après 2000, a mieux intégré les outils de l’histoire, la recherche en archives », précise Alan Lester.
A cela s’ajoute l’impact du mouvement Black Lives Matter, né aux Etats-Unis après la mort de George Floyd – un homme noir tué par la police –, qui s’est traduit par d’importantes manifestations au Royaume-Uni. Une statue d’Edward Colston (1636-1721), un marchand d’esclaves et donateur aux bonnes œuvres locales, a été déboulonnée par des manifestants à Bristol, avant d’être jetée dans le port fluvial.


A droite de l’échiquier politique, certains y ont vu la volonté d’effacer le passé, ou d’en avoir une lecture unilatérale, uniquement concentrée sur l’esclavage. Davantage de livres de vulgarisation sur l’histoire noire et celle de l’Empire se sont également mis à paraître. Sathnam Sanghera, journaliste au quotidien conservateur The Times, est l’auteur du best-seller Empireland. How Imperialism Has Shaped Modern Britain (« Empireland. Comment l’impérialisme a façonné le Royaume-Uni moderne », non traduit, Viking, 2021).
Né au sein d’une famille sikhe venue du Pendjab indien, il a entrepris l’écriture de ce livre pour souligner l’omniprésence de l’Empire, à travers notamment une immigration qui commence bien avant la fin de la seconde guerre mondiale. Il en donne entre autres pour preuve la vie trépidante – et pourtant oubliée – de Dean Mahomed (1759-1851). Originaire de Patna en Inde, il immigre en Irlande, puis en Angleterre. En 1809, il change à jamais l’Angleterre en ouvrant à Londres le premier « curry house », comme on appelle aujourd’hui les restaurants où l’on sert de la cuisine indienne, incontournable de la gastronomie populaire outre-Manche. Puis, au cours de la décennie suivante, il s’installe à Brighton, où il propose des massages de type indien, « champi » en hindi, qui donnera le mot shampooing.
L’oubli de cette figure de l’immigration, tout comme des violences de l’Empire, atteste, pour Sathnam Sanghera, de la difficulté de son pays à accepter la diversité qui le caractérise. « Le discours dominant perpétue l’idée que les personnes à peau noire ou brune sont des étrangers, arrivés par infraction, qui abusent de l’hospitalité britannique. Le premier ministre n’est pas Blanc et plusieurs membres du gouvernement aussi, je m’en réjouis. Mais persiste au sein de ce gouvernement la conviction que le racisme n’existe pas dans notre pays. »
Ce déni était encore apparent, selon lui, dans le rapport publié en mars 2021 par la commission sur les disparités raciales et ethniques, mandatée par Boris Johnson en réponse au mouvement Black Lives Matter. L’ancien premier ministre voulait ainsi « mettre fin au sentiment de victimisation et de discrimination ». La commission était dirigée par Tony Sewell, un acteur du monde caritatif d’origine jamaïcaine. Proche de Boris Johnson, il a été élevé au rang de baron en décembre 2022.
Certains commissaires ont cependant pris leurs distances avec le rapport. L’un d’entre eux a dénoncé la réécriture avant publication à laquelle s’était livré Downing Street. On pouvait y lire : « Il y a une nouvelle histoire sur l’expérience caribéenne qui parle de l’époque esclavagiste pour en dire qu’elle ne se limite pas aux profits et aux souffrances [imposées], mais aussi que des peuples de culture africaine se sont transformés pour devenir africains-britanniques. » Face au tollé, le rapport a été amendé pour clarifier ce passage, une note de bas de page a été ajoutée pour expliquer que l’intention aurait été de souligner la volonté des captifs et de leurs descendants de préserver leur culture.
« Obsession de l’esclavage »
Cette difficulté à confronter l’histoire vient peut-être du fait que l’Empire était en soi une entreprise nostalgique, cherchant sans cesse à ressusciter la grandeur de la nation. C’est ce que démontre l’historienne Hannah Rose Woods dans Rule, Nostalgia. A Backward History of Britain (« Règne, nostalgie. Une histoire à rebours du Royaume-Uni », non traduit, WH Allen, 2022). Elle explique comment « déjà au XVIe siècle, coloniser l’Amérique est pour la Couronne l’occasion de restaurer la puissance impériale, de reconquérir une gloire passée. C’est l’idée de John Dee, un proche conseiller d’Elizabeth Ière (1533-1603) ». Ce scientifique du XVIe siècle imaginait en effet que l’Angleterre avait déjà occupé une partie du nord de l’Amérique au temps du roi Arthur.
« La nostalgie est un sentiment largement partagé. Tony Blair [premier ministre de 1997 à 2007] a pu s’en servir. Margaret Thatcher [première ministre de 1979 à 1990] aussi, elle vantait ainsi les valeurs victoriennes pour faire passer ses réformes. Aujourd’hui cependant, l’histoire et les historiens sont bien plus présents dans le débat politique », indique Hannah Rose Woods. Elle rappelle comment, en 2020, des spécialistes se sont indignés du contenu d’un petit manuel émis par le ministère de l’intérieur afin d’aider les immigrés à se préparer à un test sur les valeurs du pays, prérequis pour l’obtention de la citoyenneté britannique.
Un collectif de plusieurs centaines d’historiens a ainsi signé une tribune critiquant ce document, car ils estimaient que celui-ci était « profondément trompeur et en certains endroits erroné », particulièrement son troisième chapitre. Intitulé « Une longue et illustre histoire », on peut y lire que l’esclavage était interdit au Royaume-Uni au XVIIIe siècle, alors que la loi n’était pas si claire, et que la presse accueillait des encarts publicitaires proposant des captifs à la vente. Il y est également affirmé que la fin de l’Empire se serait généralement déroulée sans heurt. Enfin, le 6 juin 1944 serait le jour de « l’invasion de l’Europe par la Grande-Bretagne », si l’on en croit les exercices qui accompagnent ce manuel. En dépit de la controverse, parmi ces trois exemples, seul le dernier a été corrigé. On peut désormais lire qu’il s’agit du « débarquement des troupes alliées en Normandie ». Un geste qui révèle quelle place occupe ce moment-clé de l’histoire de l’autre côté de la Manche.
« La victoire de 1945 a convaincu ceux qui ont voulu le Brexit, une bonne partie de nos aînés, mais surtout de nombreux membres de notre classe dirigeante, que le pays pouvait et devait se distinguer des autres pays européens », estime Danny Dorling, professeur de géographie à l’université d’Oxford. Définis ainsi, les brexiters seraient les héritiers de l’Empire, formés à l’époque où l’épopée coloniale était toujours enseignée dans les prestigieuses institutions scolaires et universitaires du pays.
Oxford, comme d’autres universités, tente aujourd’hui de sortir de l’ère impériale en élargissant le canon des œuvres étudiées pour ne pas se limiter qu’à des auteurs blancs, ou en contextualisant davantage son histoire. Des panneaux sont ajoutés à côté de certaines peintures ou sculptures pour en dire davantage sur les figures historiques représentées. C’est ainsi que Cecil Rhodes (1853-1902), homme d’affaires et premier ministre de la colonie du Cap en Afrique du Sud, a vu sa statue au Oriel College d’Oxford être flanquée d’une plaque expliquant qu’il était un « colonisateur convaincu » qui a exploité les « peuples d’Afrique du Sud ».

Mais réinventer le paysage britannique chargé d’histoire est une vaste entreprise. Danny Dorling s’en amuse. A deux pas de chez lui, la porte de la maison des scouts est chapeautée d’une inscription bien entretenue : « England expects every man to do his duty. » « L’Angleterre s’attend à ce que chaque homme fasse son devoir », soit la maxime du vainqueur de Trafalgar, le vice-amiral Nelson (1758-1805), grande figure de l’Empire.
Si, comme Danny Dorling, Matthew Goodwin estime que la déstabilisation du pays est due à une élite irresponsable, pour le reste, ce professeur de science politique à l’université du Kent est d’un tout autre avis. « Depuis le vote sur le Brexit, le point de vue dominant au sein de la classe dirigeante est que la turbulence qui s’est emparée de notre vie politique s’explique par l’héritage de l’Empire. Mais cela revient à ignorer les données dont nous disposons. » Pour lui, l’électeur britannique se soucie plutôt de l’avenir. Mais une élite minoritaire – des diplômés – occuperait des postes-clés dans les médias et les institutions culturelles, si bien que, « lorsque l’électeur moyen allume la télé, visite le site de la BBC, il y tombe sur cette obsession pour l’esclavage. Mais nombre de Britanniques ne s’y retrouvent pas et ne voient pas en quoi cela peut les aider à protéger leurs valeurs ».
C’est ce qu’il explique dans le livre qu’il vient de publier et qui figure au sommet des ventes, Values, Voice and Virtue (non traduit, Penguin, 272 pages, 9 euros). M. Goodwin estime qu’une large part de la population, plus âgée et moins diplômée, reste attachée à une « représentation traditionnelle et anglaise de ce que signifie être Britannique ». Il note dans son livre que l’« on prévoit maintenant que la proportion de la population britannique blanche chutera de 83 % en 2011 à 62 % en 2061 ». Il ajoute toutefois que 93 % des répondants à un sondage réalisé en 2020 jugent qu’il n’est pas nécessaire d’être Blanc pour être Britannique.
L’immigration reste cependant un enjeu-clé à ses yeux. Des élections doivent être organisées au plus tard en janvier 2025, et le professeur de science politique estime que le premier ministre, Rishi Sunak, doit se saisir de ce sujet s’il veut l’emporter. La promesse d’une reprise de contrôle au cœur du Brexit (« Take back control », disait le slogan) doit être relancée, seulement, cette fois-ci, elle doit être appliquée à l’immigration.
Lire aussi : Malgré les controverses, le Rwanda se prépare à accueillir les migrants expulsés par le Royaume-Uni
Aux yeux de Matthew Goodwin, Rishi Sunak soutient encore trop timidement le controversé projet visant à expulser vers le Rwanda des demandeurs d’asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Une mesure défendue bec et ongles par la ministre de l’intérieur, Suella Braverman, qui dispose de relais au sein du groupe Common Sense. L’objectif est de mettre fin à l’arrivée de migrants traversant la Manche à bord d’embarcations au départ de France. En 2022, plus de 45 000 personnes auraient ainsi rejoint les côtes anglaises.
L’avenir se joue à Calais
Robert Tombs est l’un des premiers intellectuels à s’être investi dans la campagne pour quitter l’UE. Professeur d’histoire de France à Cambridge, il s’intéresse désormais aux débats portant sur l’Empire britannique.
« Le postcolonialisme est en vogue à l’université et certains sont intimidés et préfèrent ne rien dire » par crainte d’aller contre l’opinion dominante. Robert Tombs a donc lancé en 2021 History Reclaimed (l’histoire recouvrée), un collectif rassemblant une quarantaine d’intellectuels qui produisent et diffusent des articles, podcasts et webinaires, afin de « contester les assertions historiques fausses faites par des militants dans le débat public ».
En guise d’exemple de ce qu’il estime relever de la falsification, Robert Tombs cite « les prétendus meurtres d’enfants autochtones dans des écoles au Canada ». En 2021, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a reconnu le « génocide culturel » commis par le pays, qui a placé de force, de 1831 aux années 1990, environ 150 000 enfants autochtones dans des pensionnats, où 6 000 d’entre eux ont perdu la vie. L’historien juge plus généralement que les études postcoloniales constituent une attaque contre les Lumières, en cherchant par exemple à exclure du canon David Hume (1711-1776). Une mobilisation a bien obtenu qu’une tour de l’université d’Edimbourg ne porte plus le nom de ce philosophe écossais, à cause du racisme de certaines de ses idées, mais cet auteur-clé des Lumières continue d’être étudié.
Professeur émérite de morale et de théologie pastorale à Oxford, Nigel Biggar est membre du collectif History Reclaimed et partage le point de vue de Robert Tombs. Il vient de faire paraître Colonialism. A Moral Reckoning (non traduit, William Collins, 480 pages, 29 euros), un ouvrage qui caracole en tête des meilleures ventes. S’il reconnaît que l’Empire britannique s’est livré à des violences immorales, il faudrait selon lui néanmoins souligner ses réalisations : l’abolition de l’esclavage en 1833 en Grande-Bretagne – puis ailleurs dans l’Empire –, l’autonomie peu à peu accordée à diverses colonies – en commençant par le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande – et enfin l’affrontement militaire mené seul contre le nazisme entre mai 1940 et juin 1941.
Nigel Biggar s’en indigne : « La critique du colonialisme ou de l’impérialisme est très sélective. Personne ne parle de l’esclavage pratiqué par des non-Européens ou non-Américains. Je l’interprète comme un assaut contre les pays occidentaux, qui sont pourtant les garants de l’ordre libéral international » qui repose sur le droit et les droits de l’homme ainsi qu’une défense du libre-échange. Le projet d’envoyer les demandeurs d’asile vers le Rwanda est pour lui fidèle à cette tradition alors que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés rappelle que ce projet de loi ne respecte pas la Convention relative au statut des réfugiés.
En 1805, lorsque le vice-amiral Nelson a vaincu Napoléon à Trafalgar, la France représentait « la perspective effrayante d’une invasion et d’une domination étrangère », écrit Nigel Biggar dans son livre. Mais, aujourd’hui, ce n’est plus au large de l’Espagne que se joue l’avenir de l’Angleterre. C’est maintenant face à Calais (Pas-de-Calais), sur les plages de galets de l’autre côté de la Manche, à Douvres, où arrivent les bateaux pneumatiques chargés de migrants, que se décide son destin. L’ancienne métropole impériale organise ses défenses pour préserver une uniformité perdue il y a longtemps.