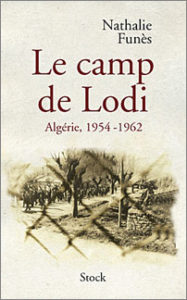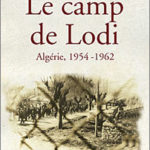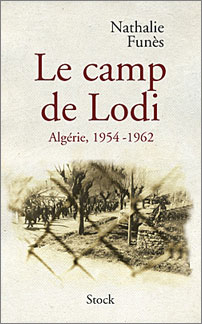
Introduction
1955.
Lodi ressemble aux villages montagneux d’Algérie. Une route qui serpente autour d’une grappe de bicoques blanches, une église dressée sur une place en terre battue, des fermes éparpillées dans la vallée, peu d’orangers et de palmiers, mais des chênes et des vignes à perte de vue… C’est là, dans la région escarpée du Titteri, à une centaine de kilomètres au sud- ouest d’Alger, que les premiers Français ont débarqué un siècle plus tôt, un jour de décembre 1848. Ils avaient grimpé, le mois d’avant, dans une péniche du quai de Paris-Bercy, avec leurs guides de conseils pratiques (tamiser les eaux à cause des minuscules sangsues, porter un chapeau de paille ou de feutre gris…) et leurs bagages limités à cinquante kilos par adulte. Ils avaient traversé la Méditerranée à bord du Christophe-Colomb puis remonté la nouvelle route des gorges de la Chiffa et tourné à l’ouest de Médéa. Au moment de poser leur barda au pied du piton du Dakla, à huit cents mètres d’altitude, ils ont changé la dénomination du village. Draa-Esmar, la « Colline-des-Joncs » en arabe, est devenu Lodi. En hommage à la bataille du pont du même nom en Lombardie, en mai 1796, qui avait permis au général Bonaparte de percer les lignes autrichiennes et d’entrer victorieux dans Milan.
En cet automne 1955, Lodi n’a guère changé depuis l’arrivée des premiers colons. C’est toujours un bourg rural de trois mille habitants qui vivent de l’élevage et du raisin. Après la crise du phylloxéra, la maladie des vignes qui a ravagé les plantations du sud de la métropole dans les années 1880-1890, le vin de Médéa et des villages alentour est devenu l’un des plus prisés des amateurs. Le climat de montagne, avec ses hivers froids et neigeux, est sain. La température tombe au-dessous de zéro degré autour de Noël mais n’est jamais trop brûlante l’été. Il n’y a pas eu ici, comme dans les plaines du reste de l’Algérie, ces terribles épidémies de malaria qui ont décimé des familles entières de Français à peine installées. Sans doute est-ce pour cela que la compagnie des chemins de fer algériens (CFA) a décidé de bâtir à Lodi la colonie de vacances des enfants de ses employés. L’endroit s’appelle le « Petit cheminot à la montagne ». Des bâtiments blanchis à la chaux, entourés d’un muret, trois dortoirs délabrés, une courette défoncée, un terrain de volley-ball, deux tables de ping-pong et des fenêtres qui donnent sur les forêts et les monts enneigés.
C’est dans les derniers jours de septembre, près d’un an après le début de l’insurrection algérienne, que la guerre fait son entrée dans Lodi. Les barbelés commencent à grimper autour de la colonie de vacances. Une rangée, puis deux. Les barreaux s’accrochent aux fenêtres. Et, dans les dortoirs, il n’y a plus de fils de cheminots, mais des instituteurs, des avocats, des médecins, des architectes, des journalistes, des dockers, des électriciens, des plombiers, des jeunes à peine sortis de l’adolescence, des vieillards, des tuberculeux, des cardiaques, des handicapés, des mutilés, des rescapés des camps de la Seconde Guerre mondiale. Des hommes, uniquement. Tous suspects, à tort ou à raison, de sympathie ou de soutien aux indépendantistes.
Une douzaine de « centres d’hébergement » ou d’« assignations à résidence », selon le terme pudique utilisé par l’administration française, ont commencé à pousser un peu partout en Algérie, après la mise en place de l’état d’urgence, en avril 1955. Mais, dans la liste, Lodi occupe une place à part. C’est le camp des Français. Le camp des pieds-noirs. Des centaines et des centaines d’Européens, comme on les appelait dans l’Algérie coloniale, vont ainsi croupir derrière les barbelés de l’ancienne colonie de vacances. Enfermés du jour au lendemain de façon arbitraire, prisonniers des années durant. Sans inculpation, sans procès, sans jugement, sans aucun moyen de défense. Sur simple arrêté préfectoral, parfois signé par un sous-fifre. La « lettre de cachet » de la guerre d’Algérie.