
Les années ont passé depuis la fin de la guerre et la vie des interviewés a repris un cours normal. Ils ont voulu oublier, se libérer de leurs mauvais souvenirs, mais ces tentatives ont échoué et les images qu’ils croyaient avoir effacées surgissent à nouveau. La mémoire de la violence est difficile à maîtriser ; elle ne tient compte d’aucune règle et surprend celle qui écoute comme celui qui parle. Elle se loge parfois dans des dénégations ou des silences, pour finalement se couler dans une faille et se laisser entrevoir. Elle explose au moment où on ne l’attend pas, au cours d’un entretien, d’une conversation téléphonique anodine ou d’une fête d’anciens combattants. La mémoire de la violence est une violence à laquelle on ne peut pas échapper.
La violence de la guerre est, pour la plupart des interviewés, un phénomène qui dépasse l’entendement ; Joseph, cheminot, estime qu’elle ne peut être définie que par elle-même et reprend à son compte une formule tautologique éprouvée : « La guerre, c’est la guerre…. il n’y a pas de guerre propre ». Le mépris des lois et des conventions internationales caractérise le conflit algérien1. Les appelés ont observé ce phénomène à leur niveau ; ils en témoignent aujourd’hui, en citant l’ordre que leur donnait leur supérieur immédiat : « Vous tirez d’abord, vous faites les sommations après »2. Cet ordre, répercuté par leur chef de section, émanait des plus hautes autorités militaires et civiles. L’institution militaire était touchée dans son ensemble, du simple soldat au responsable le plus élevé. Mais les militaires n’étaient pas seuls en cause et le général Allard, dans sa déposition au procès des barricades, rappela que les responsables politiques avaient joué un rôle dans ses développements : « J’ai personnellement assisté à un certain nombre de visites faites dans les différents états-majors des secteurs par MM. Bourgès-Maunoury, Lacoste, Max Lejeune, etc., et chaque fois, ces autorités donnaient des instructions de poursuivre la lutte à outrance »3. Ce témoignage est confirmé par les archives militaires qui ont conservé des notes incitant les cadres à poursuivre et à intensifier leur action. La violence était privilégiée.
Un aveu douloureux
Xavier Grall, concluant une enquête réalisée en 1961 auprès des soldats du contingent de retour d’Algérie, précisait déjà que les scènes de torture faisaient partie de leurs « plus mauvais souvenirs »4. Ces faits empoisonnent encore le quotidien des interviewés. Certains d’entre eux, comme Patrick et Edouard, l’expriment par l’émotion qui les étreint quand ils les signalent, d’autres comme Marcel, ouvrier du bâtiment, actuellement en analyse, Robert, ouvrier papetier, ou Noël, instituteur, insistent : « J’ai vu des atrocités commises par des Français (…) ; c’est ça qui me reste sur le cœur ». Les violences pratiquées par les Algériens sont rarement évoquées, mais deux interviewés font exception à la règle. Souhaitant relativiser les exactions françaises, Lionel et Yvan dénoncent celles des Algériens au cours d’un bref plaidoyer. Ces deux occurrences étant étudiées par ailleurs, j’analyserai ici les violences perpétrées par des militaires français car elles se situent à l’épicentre de leur mémoire.
Témoigner ou se taire ?
Il est toujours difficile d’évoquer en temps de paix des faits de guerre, surtout lorsqu’il s’agit de crimes. La remémoration des violences est une opération périlleuse, car plusieurs dangers menacent celui qui se souvient. La relation d’entretien impose le regard de l’autre sur ce qui était jusqu’alors caché. Cette nouvelle lecture des événements, dans un contexte totalement différent, par une personne extérieure, les éclaire différemment ; elle oblige les interviewés à les reconsidérer. Le retour sur un passé problématique aboutit à une interrogation sur soi qui risque de détruire un équilibre fragile et chèrement acquis ; l’évocation de la guerre conduit également celui qui parle à accepter d’affronter à nouveau l’horreur et la douleur dans un combat inégal où tout a déjà été joué. Quelques-uns, et plus particulièrement les responsables d’associations, se taisent ; lorsque la question leur est posée, ils précisent qu’ils n’ont rien vu, ni rien entendu. Gérard, responsable d’une section locale de l’UNCAFN, en poste à Khenchela en 1956, affirme au cours du premier entretien ne pas avoir été témoin de violences. Cependant, il admet qu’il ait pu y en avoir : « C’est possible qu’il y en ait eu, ça c’est vrai, il fallait bien faire causer les gars, il fallait bien les faire causer. Il y en avait eu en 39-45, en 14-18. Là, je ne vous donnerai pas de témoignages, je n’en ai pas ». L’obligation de faire parler les prisonniers fait implicitement référence aux victimes innocentes que les informations obtenues permettent de sauver. C’était d’ailleurs la justification la plus utilisée par les militaires à l’époque5. L’évocation des guerres précédentes, au cours desquelles les belligérants ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, est beaucoup moins courante et n’est utilisée que par deux interviewés. Sa fonction est de faire de la guerre d’Algérie une guerre comme les autres, mais aussi, ce qui est beaucoup plus important, de ranger la torture parmi les tâches des combattants. Au cours de l’entretien, Gérard quitte sa position défensive pour dénoncer la partialité des médias, de l’école ou des manuels scolaires et pour les accuser de vouloir déshonorer les anciens combattants d’Algérie. Il a repris ce thème au cours de la discussion qui a suivi la projection du film de Bertrand Tavernier, La guerre sans nom : « On parle trop de la torture, on salit les anciens combattants ».
Soucieux de donner une image honorable des soldats français, Gérard s’astreint au silence et refuse d’évoquer les violences commises en Algérie. Mais son argumentation présente, par la suite, des inconséquences. Ainsi au cours du second entretien, commentant ses photographies, il précise à propos de l’une d’elles qui le représente assis à sa table de travail : « [A Kenchela] nous logions dans une école et j’étais chef de poste, chargé de l’administration ». Le même document, placé une semaine plus tard dans l’exposition réalisée par les anciens combattants au cours du mois de mars 1994, au musée de la ville, est légendé : « A la prison fells [sic] de Khenchela ». Etant donné les témoignages accablants de rappelés à propos d’interrogatoires à Khenchela en 1956, elle met sérieusement en doute ses premières déclarations au cours desquelles il affirmait n’avoir rien vu ni entendu6. L’argumentation mise en place par sa mémoire s’écroule d’elle-même peu après et sa réponse à la question : « Pourquoi n’avez-vous pas photographié la guerre ? » est un aveu : « Je n’ai jamais voulu prendre de photos de morts ou de prisonniers, non. Il y en avait pourtant. Je me souviens de celle de deux prisonniers esquintés qui avaient passé un sale quart d’heure… ». Les signes des tortures, inscrits sur les corps des prisonniers, ont impressionné sa mémoire ; le souvenir n’a pas été effacé. Le qualificatif « esquintés » qui décrit les prisonniers, la métaphore qui désigne la torture, « un sale quart d’heure », établissent les faits et infirment ses précédentes dénégations. Ce sera son seul témoignage à propos des violences. La similitude entre l’acte de mémoire et la photographie a imposé la reconnaissance des faits.
Parmi les dix interviewés ne mentionnant aucune violence, quatre se trouvaient affectés à un lieu ou à un poste qui les mettaient à l’écart des situations extrêmes. Les autres préfèrent ne pas en parler, soit qu’ils n’aient effectivement rien vu, soit qu’ils n’aient rien voulu voir. Alain Maillard de la Morandais, appelé lui aussi en Algérie, remarque à ce propos : « Quand on veut ne pas voir, on peut ne pas voir »7. Patrick, ancien président d’association, explique ce choix : « Il y a eu des choses pas normales… Aujourd’hui encore, ce n’est pas possible d’accepter. Et puis, on est quand même français. On se tait, on parle sans aller trop loin. On dit ce qui est, ce qu’on peut dire. Mais il y a aussi ce qu’on ne peut pas dire, ce qu’il ne faut pas dire… ». Leur conception du patriotisme leur impose de ne pas « salir » la France, de ne pas reconnaître la violence perpétrée en son nom. Mais leurs dénégations ou leurs silences sont motivés aussi par la volonté de défendre l’honneur des anciens combattants et la mémoire de leurs camarades, morts en Algérie.
Le verrouillage des mémoires est un choix qui leur appartient, et, en général, je n’interviens pas. Cela m’est arrivé, cependant, dans des circonstances particulières. Yvan, quoique enrôlé en 1958-1959 dans un régiment disciplinaire, mêlé à l’opération « Jumelles » et constamment sur le terrain, n’avait rien vu, rien entendu8. Il s’était enfermé tout au long de l’entrevue dans une réserve méfiante. A la fin de l’entretien, après avoir décrit l’enlèvement et l’assassinat d’un instituteur militaire par les « fellaghas », il fait allusion aux violences françaises, à propos d’un film télévisé :
« [Ce film], c’était complètement le contraire de… Les Français, on les prenait pour des tortionnaires. Il n’y avait quand même pas que ça. Parce que il fallait voir ceux qui étaient pincés par les gaillards, ceux qui étaient prisonniers par les fellaghas… Des tortionnaires… non, j’ai quand même pas vu… faut pas non plus… Y en a peut-être eu, mais… ».
La logique du récit s’applique à mettre en doute ces violences. A la fiction du film, Yvan oppose implicitement la vérité du vécu. Son raisonnement s’appuie au début sur la négation nuancée « il n’y avait pas que ça » d’un postulat erroné car abusivement général, « les Français [sont] des tortionnaires ». L’adhésion de l’auditrice étant acquise, l’interviewé y ajoute le poids de son témoignage : « J’ai quand même pas vu » qui ne peut être contesté sans que la relation de confiance, structurant l’échange, ne s’écroule. S’étant ainsi assuré la direction de l’entretien, il pose l’interrogation dubitative « il y en a peut-être eu » suivie d’un « mais… » qui aboutit à la négation non formulée des faits. Le sophisme « tous les Français n’ont pas torturé, donc les Français ne sont pas des tortionnaires », parce qu’il est implicite, échappe plus facilement à la critique9. L’entretien étant arrivé à son terme, l’interviewé s’étant exprimé, le devoir de discrétion de l’enquêtrice pouvait se dissocier du silence qui cautionne ; mon intervention a été brève : « Il n’y en a pas eu ”peut-être”, il y en a eu ». Il en a alors convenu par : « Il y en a eu, oui ». La seconde entrevue s’est déroulée sur le même mode. Avant de prendre congé, je lui ai tendu le mémoire analysant les premiers entretiens réalisés, ouvert à la page comportant la liste des violences françaises recensées par les appelés10. Il les a lues et les a commentées à voix basse : « “X7 a assisté à un viol”, c’est vrai ; “X7, X8 ont entendu les cris des torturés”, c’est vrai […] ».Tous les éléments de cette liste ont été ponctués par un « c’est vrai » et, à la fin de sa lecture, il a simplement rendu le polycopié. L’entretien s’est conclu très conventionnellement ; sa mémoire, un instant entrouverte, s’était à nouveau verrouillée.
Il n’a pas été nécessaire de questionner les autres interviewés, car la force du souvenir finit par rompre le barrage du silence. C’est en général à la fin du premier entretien qu’ils évoquent la violence. D’autres, comme Nicolas, Patrick, Olivier, choisissent d’en parler encore plus tard, à la fin du second entretien. La familiarité avec l’enquêtrice est plus grande et le magnétophone n’est plus utilisé. Ils posent leurs conditions : « Posez votre crayon », « N’écrivez pas », puis, furtivement, ils évoquent la gégène ou la corvée de bois11.
Les victimes des violences étaient le plus souvent de simples « suspects ». Raflés dans la population algérienne, ils étaient jugés susceptibles de posséder des informations sur la rébellion ou soupçonnés d’apporter leur aide aux fellaghas, quand ce n’était pas d’appartenir à l’organisation politico-administrative du FLN (OPA). Les « rebelles pris les armes à la main », selon l’expression consacrée des militaires rédigeant les JMO, étaien peu nombreux. La taille des groupes FLN était réduite et le rapport des forces en présence, la stratégie du « marteau-pilon » pratiquée par les militaires avec les tirs d’artillerie, les bombardements, le strafing12, le napalm, ne laissaient que peu de chance à ceux qui auraient souhaité se rendre. La rareté des photographies de prisonniers, prises sur le terrain, après les affrontements, est un signe. Un ancien combattant que j’interrogeais à ce propos s’exclame : « Au 1/8e de hussards, on ne faisait pas de prisonniers, je n’ai que des photos de fellaghas morts ». Les témoignages d’interviewés en poste dans le Constantinois et les relations des JMO de leurs régiments confirment cette information13.
Vingt-huit interviewés, soit les trois quarts de l’ensemble, ont été témoins de violences graves ou de leurs résultats . Parmi les personnes rencontrées par Gérard Marinier, moins de la moitié d’entre elles signale des faits similaires (vingt-huit sur soixante-dix)14. Mais, pour que la comparaison entre les deux groupes soit pertinente, il est nécessaire de tenir compte de leurs caractères particuliers. La proportion des interviewés occupés à des activités exclusivement non combattantes et non policières durant leur service militaire est négligeable dans les entretiens réalisés dans les Vosges, alors qu’elle est particulièrement importante dans ceux effectués par Gérard Marinier. Les personnalités du monde des arts, du sport, de la presse, et de la politique qu’il a écoutées, ont souvent échappé aux opérations et même au quadrillage (vingt-quatre sur soixante-dix ). La forte proportion d’officiers intervient également (un tiers contre un huitième), d’autant plus qu’ils n’appartenaient pas au deuxième bureau (le renseignement) et pouvaient éviter d’être confrontés à cette réalité. Compte tenu des soldats ayant le même grade et des activités opérationnelles similaires, la proportion de témoins de violences est identique.
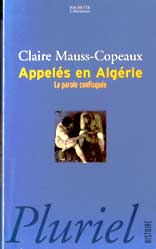
- Voir en particulier P. VIDAL-NAQUET, Les crimes de l’armée française, Paris, 1982.
- Relevé entre autres par Jean, appelé au 51e RI en poste dans le secteur de Collo avant le vote des pouvoirs spéciaux.
- P. VIDAL-NAQUET, o.c., 1982, p. 107.
- X. GRALL, « La génération du djebel », supplément à La Vie Catholique Illustrée, 25 janvier 1961, p. V.
- Voir en particulier R. TRINQUIER, La guerre moderne, Paris, 1961.
- Des rappelés témoignent, Paris, Comité de résistance spirituelle, 1957, 95 p. Voir également l’article sur le charnier découvert à Khenchela dans Libération, 3 juin 1982.
- G. MARINIER, Ils ont fait la guerre d’Algérie. 40 personnalités racontent…, Mâcon, 1987, vol. 2, p. 123.
- Faisant partie du plan Challe, l’opération « Jumelles » s’est déroulée en Kabylie de juillet 1959 à mars 1960.
- P. Nora précise : « Non, toute l’Algérie n’est pas fasciste, tous les Français ne sont pas des ultras, toute l’armée ne torture pas. Mais le fascisme, les ultras sont la France en Algérie. » P. NORA, Les Français d’Algérie, Paris, 1961, p. 75.
- Mémoire de DEA, soutenu à l’université de Reims en 1990.
- « L’expression vient des anciens de la guerre d’Indochine, on conduit le prisonnier dans la campagne, on lui dit : ‘Tu es libre, va-t-en’; il se sauve, on l’abat d’une rafale; au rapport de l’unité, on déclare : ‘Tué dans une tentative d’évasion’. » P.H. SIMON, Contre la torture, Paris, 1957, p. 90.
- Mitraillage depuis un avion.
- Particulièrement le 151e RIM, le 18e RCP.
- Tous affirment avoir été de simples témoins. Un seul observe : « Au cours de l’opération (…) j’ai dû arrêter un gars qui faisait des signaux de nuit pour prévenir les fells. Ce gars, c’était un gosse de dix ans. Vous n’imaginez certainement pas l’effet que ça fait de mettre la main sur l’épaule d’un gamin, c’est affreux ! » G. MARINIER, o.c., vol. 2, pp. 25-26.


