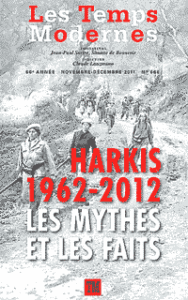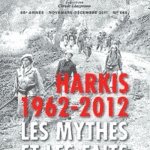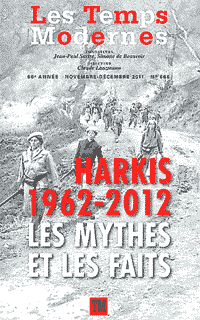
LA RÉPUBLIQUE FACE AUX HARKIS : QUESTIONS AUX HISTORIENS
En France, un consensus solidement établi – appelons-le « politiquement correct » – a rendu presque impossible l’énoncé de certaines vérités sur l’histoire algérienne du pays, et ceci particulièrement dans nombre d’écrits d’historiens sur la question des harkis. La première de ces vérités est que, oui, pendant quelques décennies et jusqu’à 1962 l’Algérie était la France. La seconde, que les Algériens étaient, tous, des Français… ceci à condition du moins que l’on pense l’histoire en termes républicains, c’est-à-dire en référence au droit, aux effets du droit, et en relation avec le territoire et l’histoire de la République française, et non pas en termes d’essence, de sang ou d’appartenance communautaire. La troisième vérité que les bien-pensants ont eu besoin de taire est que, du point de vue de l’histoire de France, l’histoire de l’Algérie française doit être pensée dans le cadre de l’histoire républicaine, et non pas rejetée dans les marges comme propre aux réactionnaires et ennemis de la République, ou définie uniquement comme une « déviation » révélatrice de la non-application des principes républicains
1.
Cette approche est peu confortable, parce qu’à la fois moins manichéenne et en contradiction avec les positions politiques des militants nationalistes de l’époque, ainsi que de la petite minorité de Français non algériens qui ont soutenu leurs combats et qui continuent de susciter l’admiration de beaucoup d’entre nous. Néanmoins, ce point de vue rend mieux compte des documents officiels de l’époque ; il est entre autres plus apte à répondre aux interrogations sur le sens et l’héritage actuels de cette histoire. C’est parce que ces vérités, partielles, sont aujourd’hui, un demi-siècle après l’indépendance algérienne, absentes des débats qu’elles méritent que l’on s’y intéresse enfin. A l’heure où l’on prétend, au nom du « politiquement incorrect », qu’il faut admettre que les analyses du Front national s’inspirent de la réalité et du bon sens, il est temps que le débat français se confronte aux limites qu’impose le vrai « politiquement correct » aux mises en perspective historiques de ces questions.
Cette exigence, fondée sur mes recherches dans les archives officielles françaises, se trouve étayée par une réflexion du philosophe Etienne Balibar. Dans son article « Algérie-France, une ou deux nations?2 », il souligne que l’indépendance algérienne a changé le sens du discours sur le rapport entre la France et l’Algérie. Avant l’indépendance, combattre l’assertion que la France et l’Algérie formaient une seule nation était une obligation politique aussi bien qu’une affirmation de vérité – et beaucoup l’ont fait pendant plus d’un siècle, et avec de plus en plus de force au cours de la guerre d’Algérie. Pourtant, poursuit Balibar, laisser croire aujourd’hui qu’entre la France et l’Algérie il existe « une irréversible dualité » entre deux nations foncièrement distinctes nous empêche de procéder à l’analyse du rôle fondamental que le colonialisme a joué pour la France. Balibar suggère que « la décolonisation a fait passer de la fausse simplicité d’une à la fausse simplicité de deux » et il pointe le travail important que cette simplification opère dans un champ aussi complexe et contradictoire, qui gomme à quel point « la forme impériale était nécessaire à la constitution des nations occidentales ». Elle est à l’oeuvre, par exemple, dans l’argument d’un historien respecté selon lequel « seulement 37 Algériens » sont morts le 17 octobre 1961 à Paris, et ceci « en temps de guerre » entre « deux gouvernements3 » : or une telle thèse doit écarter plusieurs faits, notamment que ces 37 étaient citoyens français (comme tous les Algériens en droit français) et, par ailleurs, que même « seulement 37 » morts suffiraient à faire de cet événement le plus grand massacre de citoyens français par des policiers français en territoire métropolitain au xxe siècle (le gouvernement français lui-même niant qu’il était en guerre et qu’il existait un « gouvernement algérien »). Un autre historien, pour sa part, insiste sur le prix élevé que la France a payé pour l’Algérie « coloniale4 ». Pour admettre cet argument, il faut effacer les lois françaises selon lesquelles l’Algérie était composée de trois départements français et oublier que, avant 1958, le gouvernement y octroyait moins d’argent par habitant de nationalité française qu’à n’importe quel autre département français.
Mais même si l’on écarte ces efforts militants pour minorer les points noirs du passé au nom du fait que les Algériens et l’Algérie, en dépit des lois, n’étaient pas français, la nécessité de prendre en compte l’histoire complexe et mêlée de la France avec l’Algérie se pose pour tout historien de la guerre d’Algérie, et notamment des harkis. L’indépendance algérienne n’est pas seulement la réalisation d’un fait national; elle nous confronte également avec les paradoxes et les contradictions du projet républicain. Dans le cas des harkis, le problème se révèle à travers l’incertitude de leur appartenance nationale (française ou algérienne) et en rapport avec leur territoire d’origine (l’Algérie « algérienne » ou « française »). Il faut donc nous interroger sur certaines limites liées aux présupposés qui guident encore le travail de la plupart des historiens de la période, en particulier la primauté du cadre de l’État-nation qui nous encourage à voir, soit « une nation » soit « deux », et rend difficile la prise en compte des histoires d’un entre-deux, telle celle des harkis.
Jusqu’à présent, les débats historiographiques au sujet des soi-disant harkis se définissent par quatre grandes questions : combien y a-t-il eu de morts après le cessez-le feu du 19 mars 1962 ? Peut-on appeler les violences faites aux « harkis » des « massacres », ou un massacre ? Quelle est la responsabilité du gouvernement français dans ces violences et les morts qui en découlent ? Comment qualifier l’engagement des Algériens comme « harkis » aux côtés de la France – étaient-ils profondément politisés et profrançais ou, au contraire, massivement prépolitiques, et donc inconscients des enjeux nationaux de leur enrôlement comme point d’appui des forces françaises ? Une des manières de repenser ces questions, pour ne pas les réduire aux questionnements français, est d’encourager la prise en compte de la question « harkis » dans l’histoire algérienne. Ce qui pose la question des archives nécessaires pour écrire cette histoire. Mais il faut rappeler une question d’égale importance et dans la lignée de la précédente : le travail dans les archives, si nécessaire soit-il, n’est rien sans les questions et les contextes auxquels l’historien confronte les documents. La méthode historique, avec sa nécessaire maîtrise du dialogue entre les historiographies pertinentes et les sources primaires appropriées, nous permet de poser d’autres questions, de faire référence à d’autres historiographies qui interrogent l’histoire française, sans se laisser piéger par l’idée que toute histoire n’est que nationale et sans réduire toute histoire des relations entre l’Algérie et la France à une histoire française. Il faut, par exemple, mettre en cause les présupposés contradictoires des historiens français, selon lesquels les harkis en 1962 et avant sont soit français, soit non français. Il faut plutôt s’interroger sur le va-et-vient entre les différentes manières dont les harkis, comme tous les Algériens, étaient traités par la République française et considérés par le gouvernement et la population française5.
En 1962 les Algériens sont français en droit, mais, dans presque tous les autres domaines, la vaste majorité d’entre eux est traitée et représentée de manière différente, et plus négative que leurs concitoyens. Dans le cas des harkis, cette tension entre le « légal » et le « réel » est particulièrement accentuée. Mais leurs historiens ont préféré mettre en avant soit une perspective, soit l’autre. Ceux qui se sont penchés avec un regard critique sur le « réel » ont produit plus de travaux empiriques, ancrés dans les archives (françaises) et ont proposé les grilles de lecture les plus nuancées. A l’inverse, ceux qui ont insisté sur la « francité » des harkis ont tendance à écarter toute discussion sur les inégalités flagrantes qui ont façonné l’histoire de l’Algérie française depuis 1830, au profit d’une dénonciation des discriminations dont ils ont été victimes à partir de 1962, du fait de leur engagement aux côtés de la France. De plus, ceux qui s’en tiennent uniquement au « réel » dénient toute importance au fait qu’en 1944 la loi française a affirmé que tous les Algériens sont « citoyens français » et, plus important, que la Constitution de 1958 garantit les mêmes droits et devoirs à tous les « citoyens français » partout dans la République, aussi bien dans les départements métropolitains que dans les départements du sud de la Méditerranée. C’est là un des seuls domaines de l’histoire contemporaine dans lequel autant d’historiens français (qui ne s’identifient pas comme antirépublicains) écrivent comme si les catégories de nationalité, citoyenneté et république, n’étaient que des mots ; un « légal » sans prises sur le « réel6 ».
Mais, pour analyser l’histoire des harkis, il faut prendre au sérieux le « légal » et le « réel » à la fois ; le droit français qui affirme qu’ils sont tous citoyens français avec les mêmes droits que d’autres Français, en même temps que les certitudes variées (chez une énorme majorité de Français, en France et parmi les Algériens) qu’ils étaient autre chose, un peuple différent et certainement pas des Français à part entière, avec les traitements qui en découlent. Paradoxalement, suivre l’évolution de ces deux phénomènes apparemment contradictoires au cours de la guerre révèle que tous les deux s’expriment avec de plus en plus de force.
Entre la fin de 1961 et le début de 1962, les archives du gouvernement français, y compris celles des armées, montrent très clairement la difficulté que les autorités rencontraient en essayant de faire coïncider les faits légaux – l’affirmation d’égalité de tous les citoyens – avec le « réel » : ces certitudes de différence, et l’indépendance imminente de l’Algérie. En mars 1962, après l’annonce des accords d’Evian, on n’affichait en France officiellement aucun doute quant au sens donné à l’appellation « citoyens » pour les « citoyens français musulmans d’Algérie ». Un télégramme émanant du Quartier général de la Défense à Paris, destiné au service homologue en Algérie, faisait connaître « les instructions du Premier ministre » concernant l’avenir de ces hommes et de ces femmes.
« Question : auront-ils les mêmes possibilités que les Français de souche pour l’installation en métropole avec la citoyenneté française et le bénéfice de la loi Boulin sur l’aide aux Français rapatriés ?
Réponse : oui.Question : Cette faculté sera- t-elle maintenue aux Français musulmans de statut civil local ?
Réponse : oui. »
Le 22 février 1962, un message adressé à tous les officiers par le ministre des Armées, Pierre Messmer, avait rappelé à ces derniers « le devoir d’ apporter aux Français musulmans en service dans les forces armées et supplétives la garantie que leurs intérêts légitimes de soldats et de citoyens seront sauvegardés ». En métropole, un porte-parole officiel interrogé sur les effets du référendum du 8 avril 1962, qui entérine les accords dans le droit français, a également précisé que « la République maintiendra la nationalité française à tous ceux qui la possèdent actuellement en Algérie, Européens ou musulmans, qui ne manifesteront pas la volonté d’y renoncer7 ».
Le bon sens républicain attire notre attention sur les qualificatifs « Français musulmans » , « de statut local » , « musulmans », et nous fait remarquer tout de suite comment ils circonscrivent, comme une donnée d’évidence, un groupe de personnes : soit en affirmant que ces soi-disant nationaux font partie d’un groupement qui empêche le rapport entre chaque citoyen et la nation, soit en leur déniant leur « vraie » nationalité qui est algérienne. De telles critiques ont conduit des historiens à parler, au sujet des Algériens et de la République française, de « nationalité dénaturée », de « citoyenneté diminuée » ou « paradoxale »8. Mais le travail historien nous montre que ces mises en garde, bien qu’ancrées dans des faits de discrimination et d’inégalité massive, servent aujourd’hui à cacher une situation juridique nettement plus complexe qui nous parle de l’histoire de France, notamment des paradoxes historiques de la citoyenneté et de la nationalité françaises tout court. Effectivement, à partir de 1865, le terme de « statut civil local » indique qu’un système juridique distinct gouvernait les questions dites « de statut civil » (mariage, divorce, héritage, filiation) de la plupart des Algériens. Ce fait juridique a donné une justification « républicaine » (théoriquement distincte des références relatives aux origines ou à la religion) à l’exclusion des « musulmans » hors de la citoyenneté. Après la déclaration, en 1944, selon laquelle les Algériens étaient des « citoyens », on continuait de les exclure du plein exercice des droits accordés à d’autres citoyens dans les trois départements algériens (mais pas en France métropolitaine) ; les termes « Français musulmans » et même « citoyens français musulmans » devenaient fréquents pour indiquer cette nouvelle situation et pour bien marquer qu’ils formaient un groupe à part dans la nation. Avec le 1er novembre 1954, cette situation confuse a commencé de changer. En mars 1956, ce dernier terme est codifié juridiquement : la catégorie de « citoyens français musulmans d’Algérie », ou FMA, englobe les Français « de statut civil coranique » (appelé aussi « local ») et tous ceux ou leurs ascendants qui ont renié le statut civil coranique pour bénéficier du « statut français » ou leurs descendants, ceci sur la base de leurs origines (avoir eu des ancêtres en Algérie au moment de la conquête française de 1830). Oui, sur les origines et non pas sur la religion. Comme l’explique un sénateur dans un débat parlementaire fin 1959 :
« Certains ont pensé que l’expression « Français musulmans » pouvait comporter une signification religieuse […] votre commission a estimé qu’il y avait lieu de maintenir l’expression « Français musulmans » pour une raison majeure, celle que les dispositions législatives antérieures intéressant l’Algérie […] ont employé cette expression de « Français musulmans » sans que ce terme implique aucune distinction d’ordre religieux9. »
Qualifier la citoyenneté et la nationalité françaises des Algériens de « dénaturée(s) » ou « paradoxale(s) » circonscrit les incohérences aux seuls Algériens privés de leur « vraie » nationalité (algérienne) et a pour effet de minimiser ce que ces histoires franco-algériennes peuvent nous apprendre sur l’histoire des républiques françaises, qui se révèle profondément paradoxal et contradictoire. Ces paradoxes se dévoilent au cours de la guerre, quand la violence raciste et extrême est poursuivie en parallèle avec des réformes politiques qui établissent l’égalité de droit entre les Algériens et les autres Français, dans les départements français des deux côtés de la Méditerranée. Mais peu d’historiens s’intéressent au deuxième volet de l’histoire, avec une tendance pour les historiens des harkis à s’arrêter aux réformes de 194710.
Avec la Constitution de 1958, toutes les distinctions de droits et de devoirs de citoyens français de « statut civil coranique » sont éliminées ; ils gardent leur statut, mais sont considérés juridiquement comme pleinement français. Au même moment la catégorie FMA devient de plus en plus centrale aux projets de réformes ; son existence n’apporte aucun droit (ou devoir), mais permet au gouvernement d’ octroyer des formes d’assistance ciblée, des privilèges. Dans les premières années de la Ve République, la nation française est donc, en droit, composée de citoyens relevant de différents régimes juridiques sur le plan du « statut civil » et comporte une partie de citoyens définis comme FMA pour bénéficier d’assistances exceptionnelles. (On peut noter que la même définition juridique d’une sous-catégorie de citoyens français qui ne comporte pas de droits ou devoirs spéciaux, mais à laquelle le gouvernement peut décider d’octroyer des aides, est utilisée pour établir le statut des « rapatriés » en décembre 1961.) Annoncés le 19 mars 1962, les accords d’Evian ignorent la catégorie de FMA, mais ils affirment que, pour le gouvernement français, tous les Algériens gardent l’exercice de la nationalité française, sauf en cas de renonciation explicite11.
Assez vite, les événements provoquent une confrontation brutale entre le « légal » et le « réel ». Entre fin avril et début mai 1962, alors qu’il niait publiquement qu’un « exode » fût en cours, le gouvernement prenait des mesures pour barrer l’accès de la métropole aux citoyens français musulmans d’Algérie ; ou plutôt aux « harkis », ou tout simplement aux « musulmans », comme les appellent de plus en plus souvent les directives militaires et les décrets gouvernementaux. Fin mai, un officier du Bureau du Moral observait :
« […] il ne paraît guère opportun de transférer des personnes dont le recasement est impossible en raison de leur âge, de leur incapacité physique, ou trop jeunes pour s’occuper utilement des enfants qu’ils se proposent d’emmener avec eux, ou des jeunes filles seules. […] Ces personnes sont en effet destinées à vivre soit de la charité publique, soit, en ce qui concerne les jeunes filles, de la prostitution et à devenir des épaves. »
Au niveau ministériel, les citoyens français de statut civil de droit coranique, ceux qu’on appelait encore « rapatriés musulmans » en mai 1962, sont de plus en plus souvent nommés « harkis » ou « réfugiés », glissement de vocabulaire qui les dépouille des dénominations « rapatriés » et « citoyens ». Le 25 juillet, de Gaulle déclare que le terme de « rapatriés » ne s’applique « évidemment pas aux musulmans. Dans leur cas, il ne saurait s’agir que de réfugiés ». Cette déclaration était contraire aux accords d’Evian et à la définition des « rapatriés », textes qui avaient pourtant force de loi en France. De telles certitudes auront des effets directs sur le traitement des « harkis » arrivés en métropole, comme le montre la réticence, voire le refus, du gouvernement français d’aider ceux qui cherchaient à fuir les exactions en Algérie. Tous devaient faire une demande devant un juge pour acquérir l’exercice de leur nationalité de naissance – française – laquelle pouvait être refusée
12.
La tragédie des harkis, en 1962, se voit dans les archives françaises (militaires surtout) qui donnent peu d’informations sur les questions de chiffres, mais dans lesquelles de multiples rapports de terrain sont ignorés, parce qu’ils ne correspondent pas aux attentes dans les bureaux. Elle soulève seulement des questions pour les historiens. Un des points forts de l’historiographie française, son travail rigoureux et détaillé sur une catégorie déterminée de la population, révèle toutes ses faiblesses quand elle se trouve confrontée à des catégories floues ou, plus difficiles encore à saisir avec cette approche bien rodée, en construction, ce qui est exactement la situation en 1962. Parce que l’appartenance nationale des Algériens pendant les mois durant lesquels se pose la question « harkis » n’est pas une ; elle est toujours soit double, soit « entre deux ». N’oublions pas que des incertitudes identiques s’expriment constamment pour savoir si les « pieds-noirs » sont français ou algériens.
Les problèmes d’interprétation se posent de manière éclatante dans deux des débats historiographiques concernant les harkis. A la suite des analyses du grand historien Charles-Robert Ageron, (que l’on retrouve également dans les mémoires de Pierre Messmer et d’autres hommes politiques de l’époque), des chercheurs nient la responsabilité du gouvernement français dans l’abandon des harkis, en se fixant sur les « trois choix » offerts par le décret du 20 mars 1962 : 1) rejoindre l’armée française ; 2) revenir à la vie civile avec prime de licenciement; 3) prendre six mois de réfiexion13. Mais si l’on revient au message de Messmer écrit en février 1962, on voit que ces « trois choix » concernent uniquement les harkis comme « soldats » et non pas comme « citoyens » ; la décision de s’éloigner ou non d’un emploi par l’Etat français ne peut pas expliquer l’indifférence du gouvernement français à l’égard de ses obligations envers ses citoyens. Il faut que les historiens fassent la part des choses : le gouvernement français avait décidé et insistait sur le fait que tous les Algériens allaient garder leur citoyenneté française. Cette décision faisait fi de deux types d’opposition : d’abord les protestations des négociateurs algériens, puis, dès l’annonce des accords d’Evian, les accusations d’illégalité des derniers défenseurs de l’Algérie française. Réduire les harkis à des supplétifs, à des soldats, sans les analyser comme citoyens, c’est tout simplement reproduire les affirmations du gouvernement français après le commencement de l’exode, plusieurs semaines après le 20 mars. L’histoire franco-algérienne qui touche aux responsabilités gouvernementales est bien plus longue.
Quant à la question du ou des massacre(s), elle aussi est nécessairement mal posée, lorsque l’on affirme une distinction nette entre deux nations au moment même d’un changement de souveraineté sur le territoire, et d’une incertitude totale (dans le droit, sinon dans tous les esprits) quant au fait de savoir qui était français et qui était algérien — ne serait-ce parce qu’un grand nombre pouvait être les deux. Suivant Charles-Robert Ageron, Sylvie Thénault, une des grandes historiennes de la nouvelle génération, questionne l’appellation « massacre » sur la base d’autres travaux dans les archives du gouvernement français et affirme que les seules voix françaises de l’époque parlant de massacres étaient celles de l’extrême droite. Ces deux affirmations posent problème. Plus problématique encore est son appel, à première vue de simple bon sens, à faire un travail de fouille, de détail, une histoire totale quant au nombre d’Algériens ayant été tués ou persécutés par d’ autres Algériens en Algérie, en raison de leurs attaches françaises à la fin de la guerre. Pour parvenir à une recherche aussi fine, il faudrait être sûr du cadre, des lignes de démarcation et de définition. Thénault présume que le cadre est l’Etat-nation. Et effectivement à la mi-1962, les deux catégories – les Algériens et l’Algérie – existent (enfin !) en droit. Mais suggérer que la France et les Français n’y sont pas présents est incorrect. Pendant ces quelques mois, l’Etat algérien, tout comme la nation algérienne, est toujours en construction. Les harkis sont une petite minorité parmi les nombreux Algériens qui ont fait plus pour la France que pour le camp nationaliste, mais, à l’opposé de ceux-ci, ils ne bénéficient ni de l’oubli ni du pardon, et leur diabolisation est, au contraire, un des leviers de la construction de l’Etat et de la nation. Or l’Etat français et la nation française sont également, pendant ces mois, en construction – notons, par exemple, parmi d’autres changements, la mise en place de l’élection directe du président de la République au suffrage universel ; l’assimilation des « Européens » d’Algérie ainsi que l’exclusion des « musulmans » – et la question « harkis » est également signifiante pour cette histoire14.
Pour les historiens, la manière dont, sous la pression des événements, le gouvernement français a ignoré, puis effacé ses obligations juridiques, morales et républicaines envers les harkis pour se refugier dans le sens commun, en affirmant que les Algériens sont algériens et non pas français, ne peut servir de caution. Elle doit être analysée et non pas reproduite. Parce que l’abandon des harkis par le gouvernement est un déni de tout ce que la République a essayé de faire en Algérie : une Algérie, avec son peuple, pleinement français. En droit, dans la Constitution de 1958, dans les codes de la nationalité et dans la législature française – où, entre les élections de novembre 1958 et le 2 juillet 1962, 10% des députés et sénateurs étaient « FMA » – , la Ve République a effectué un travail d’égalité. Après, elle a tout fait pour tout effacer et tout exclure de l’histoire de France. En prenant cette histoire au sérieux, on peut non seulement mieux cibler l’histoire des harkis, mais encore se confronter au fait central : elle est tout aussi constitutive de l’histoire de la France que de celle de l’Algérie.
- Gilles Manceron, « La République et son passé colonial », in Marianne et les colonies : une introduction à l’histoire coloniale de la France, Paris, La Découverte, 2003.
- Etienne Balibar, « Algérie-France : une ou deux nations? », Lignes, n° 30, février 1997, pp. 7-22.
- Jean-Paul Brunet, Police contre FLN. Le drame d’octobre 1961, Paris, Flammarion, 1999.
- Daniel Lefeuvre, Chère Algérie. Comptes et mécomptes de la tutelle coloniale 1930-1962, Paris, Société française d’histoire d’outre-mer, 1997.
- Sur l’historiographie actuelle, voir Les Harkis dans la colonisation et ses suites, sous la direction de Fatima Besnaci-Lancou et Gilles Manceron (2008); Les Harkis. Histoire, mémoire et transmission, sous la direction de Fatima Besnaci-Lancou, Gilles Manceron et Benoît Falaize, Paris, éd. de l’Atelier, 2010; sur la prise en compte des harkis dans l’histoire algérienne, voir Gilles Manceron, « Les supplétifs dans la guerre d’Algérie : mythes et réalités », in Besnaci-Lancou, et al (2008), p. 32.
- Pour une analyse concise de cette histoire, voir Todd Shepard, 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008, chapitre 1.
- DefNat Paris, « Télégramme au Bureau Moral », reçu le 15 mars 1962, in Service historique de la Défense, Vincennes (SHD) : 1H/2467/6; Commandement supérieur des Forces en Algérie, « MESSAGE n° 0560/ CSFA/EMI/MOR », 22 février 1962, p. 3, in SHD : 1H/1260/ 1. Réponse de Philippe Thibaud, chargé des relations avec la presse au ministère des Affaires étrangères, Bulletin d’informations (13 h) : « Comment pourra-t- on être algérien et français ? », 7 et 10 avril 1962, AN:F/la/5055.
- Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale : une nationalité française dénaturée », in La Justice en Algérie (1830-1962), Paris, La Documentation française, 2005, pp. 95-109; Emmanuel Blanchard, « Encadrer des citoyens diminués. La police des Algériens en région parisienne, 1944-1962 », Thèse de doctorat, université de Dijon, 2008 ; Alexis Spire, « Semblables et pourtant différents. La citoyenneté paradoxale des « Français musulmans d’Algérie » en métropole », Genèses, n°53, 2003, pp. 57-58.
- Sénateur Charles Fruh, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires, Sénat, séance du 26 novembre (1959), 1207; voir Todd Shepard, op. cit.
- Un livre qui montre bien le développement conjugué des violences et des reformes françaises est celui de Sylvie Thénault, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Flammarion, 2005. Parmi les historiens des harkis qui excluent de leur analyse les changements institutionnels postérieurs à 1947, citons Laure Pitti, « De l’histoire coloniale à l’immigration postcoloniale : le cas des harkis », in Besnaci-Lancou, et al. (2010), pp. 78-88.
- Todd Shepard, o.c. (2008).
- Bureau du Moral : commandement supérieur des forces en Algérie, « Recasement des supplétifs et civils F. S. N. A. menaces », SP 87.000, 26 mai 1962, p. 2, in SDN : 1H/1260/2; secrétariat d’Etat aux rapatriés, « Comité des Affaires algériennes du 28 avril 1962 : accueil des rapatriés », p. 6, in archives du ministère des Affaires étrangères (MAE) : 39 ; secrétariat d’Etat aux Rapatriés, « Mercredi 23 mai à 15 h30. OBJET : personnes rentrant d’Algérie », pp. 5-6, in MAE : 39; Maurice Faivre, Les Combattants musulmans de la guerre d’Algérie. Des soldats sacrifiés, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 197.
- Charles-Robert Ageron, « Le drame des harkis en 1962 », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 42 (avril 1994) ; ibid., « Les supplétifs algériens dans l’armée française pendant la guerre d’Algérie », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 48 (octobre 1995); parmi les historiens qui s’intéressent particulièrement au « trois choix », voir Yann Scioldo-Ziircher, Devenir métropolitain. Politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie en métropole (1954-2005), Paris, éd. EHESS, 2010; François- Xavier Hautreux, « L’armée française et les supplétifs « Français musulmans » pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). Expérience et enjeux », Thèse de doctorat, université Paris X, 2010.
- Sylvie Thénault, « Massacre des harkis ou massacres de harkis ? Qu’en sait-on? », in Besnaci-Lancou (2008), op. cit., pp. 81-91.