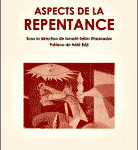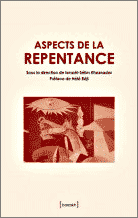
De la repentance, nécessité ou alibi ?
Cinquante ans après l’indépendance, les relations algéro-françaises restent otages de surenchères sémantiques autour de «la repentance» dressées comme un obstacle infranchissable qui, pour être dépassé, nécessite une franche reconnaissance du passé colonial.
Depuis que le Parlement français a fait voter la controverse loi du 23 février 2005 glorifiant le fait colonial, un concept a fait brusquement irruption dans le débat sur la question de la mémoire et de l’histoire : la repentance. Il alimente périodiquement les polémiques et empêche de faire avancer sereinement et rigoureusement le travail sur un passé colonial qui continue de «miner» les relations algéro-françaises.
Qu’est-ce que la repentance ? Qui peut la réclamer ? De qui doit-on l’exiger ? Doit-on seulement la souhaiter ? Comment éviter les calculs politiciens et les surenchères politiques ? Autant de questions auxquelles les chercheurs Olivier La Cour Grandmaison, Malika Rahal, Abdelmadjid Merdaci ont tenté de répondre à l’occasion du débat organisé conjointement par les éditions Barzakh et El Watan Week-end, hier à Alger, sur le thème «Repentance : nécessité ou alibi ?»
L’exercice qui consiste à déconstruire un concept «devenu étrangement à la mode» ne cesse de passionner des deux côtés de la Méditerranée. Souvent, il fait des vagues à Alger comme à Paris. «Il y a une récurrence de la question de la repentance dans le débat algéro-algérien. D’où la nécessité d’en parler avec un maximum de rigueur pour essayer de comprendre de quoi on parle et pourquoi on en parle maintenant», lance Abdelmadjid Merdaci, professeur à l’université Mentouri de Constantine.
D’emblée, le chercheur Ismaïl Sélim Khaznadar (fils d’un militant nationaliste mort au combat dans le Constantinois) juge que la demande de repentance «ne sert absolument à rien. Parce que la guerre de Libération, qui a été un succès, devrait nous prémunir de nous retourner vers ce passé. Peut-on exiger un repentir collectif de la part des anciennes autorités coloniales ? Non». L’essentiel, pour lui, est de «comprendre cet enchaînement diabolique» qu’a été le passé colonial. Le rejet de repentance est justifié, selon lui, en raison de l’origine religieuse du concept : «La repentance est une démarche religieuse qui ne peut avoir un sens dans l’histoire. Elle ne va pas aider à l’écriture de l’histoire. Tout comme le pardon, la repentance ne sert absolument à rien.»
Repentance : débat franco-français
Si étymologiquement, la repentance renvoie à un champ plutôt religieux, elle a «squatté» le débat intellectuel en France à chaque fois qu’il est question de la présence française en Algérie. Elle sert à détourner du vrai débat. «C’est un concept aux dents creuses. Et sous le couvert de qualification objective, ce terme a pour but de disqualifier ceux et celles qui estiment nécessaire de demander aux hautes autorités de l’Etat français de reconnaître les crimes perpétrés sous les IIIe et IVe Républiques», analyse l’historien français Olivier La Cour Grandmaison (OLCG). Le terme est «utilisé en France par certains journalistes de droite du Figaro, certains essayistes, voire par une presse de gauche (Marianne), alors qu’en France, ce qui est exigé c’est la connaissance qui peut conduire vers une reconnaissance par l’Etat de ce qu’a été le colonialisme», ajoute-t-il. «Il est de notre devoir, en tant que chercheurs mais également en tant que citoyens, d’exiger des autorités françaises qu’elles reconnaissent ce qui a été commis. Et pour reconnaître ces crimes, en France, il faut les identifier en leur donnant un nom, en les situant géographiquement», assène OLCG.
L’historien – qui faisait partie des intellectuels français qui sont montés au créneau pour dénoncer la fameuse loi du 23 février 2005 – estime que la bataille pour la connaissance «est une bataille pour la reconnaissance et elle est en partie gagnée en France au regard du nombre important de débats, de productions de livres, de l’ouverture des archives, du communiqué sur les événements du 17 Octobre 1960 à Paris qui constituent des pas en avant».
Cependant, si le discours officiel français évolue, l’historien juge que la France «est relativement en retard sur cette question comparativement à ce que a été fait par ailleurs». OLCG saisit la présence en Algérie de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale française, pour dire que si l’article 4 de la loi du 23 février, «il reste que le premier article de ladite loi exprime l’esprit glorificateur du fait colonial. Cette loi est toujours une loi de la République française, elle n’a pas été supprimée. Il serait intéressant de demander à Claude Bartolone, qui est actuellement à Alger, en tant que président de l’Assemblée, quelle opinion il a sur le fait que cette loi continue d’être une loi de la République».
Gérer un passé marqué par la violence
De son côté, la chercheure Malika Rahal développe une autre thèse pour expliquer l’entrée du concept de repentance dans le champ de l’histoire et de la mémoire. Un concept qu’elle trouve «problématique et agaçant, qui oriente le débat sur une direction pas intéressante». Mais que cherche-t-on en utilisant ce terme ? Pour d’innombrables raisons. «Sans doute pour gérer un passé marqué par la violence, pour remettre les compteurs à zéro et revenir à une situation de justice. Il permet aussi de construire de nouveaux rapports apaisés et la réalisation du deuil de ce passé et retisser le lien entre les morts et les vivants, mais enfin mettre le passé dans le passé pour qu’il ne soit plus pesant et douloureux», suggère-t-elle.
Mais pas seulement. Malika Rahal ose une question embarrassante à propos des usages politiques faits du passé colonial en Algérie. En mettant en avant la demande de repentance, «n’est-ce pas une façon d’occulter la guerre civile qui s’est déroulée en Algérie durant les années 1990 ?», affirmant encore une fois que la question de la repentance n’est «pas indispensable».
Ce qui permet à Abdelmadjid Merdaci de ramener le débat sur ce qu’a fait l’Etat algérien après cinquante ans d’indépendance. Peu. «Au-delà des énoncés, la question fondamentale est de savoir qu’avons-nous fait, nous les Algériens ? Qu’a fait l’Etat algérien depuis l’indépendance ? Quel bilan de la colonisation pour l’Algérie indépendante ? Pourquoi les dirigeants algériens, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, n’ont pas fait le procès de la colonisation ? On ne peut pas avoir de la reconnaissance tant que l’Algérie n’a pas fait ce travail», tranche-t-il. Merdaci dit ne pas comprendre pourquoi l’Algérie «a consenti au silence» !
Si les intervenants ont émis des hypothèses et des questionnements, dans la salle, le public est catégorique : «Si la question de la repentance est posée aujourd’hui, c’est pour marquer un échec généralisé», tonne une intervenante.
Cependant, Mme Fadhila Chitour donne la réplique, estimant qu’il est «important que l’on condamne, que l’on reconnaisse que le système colonial est une abomination. Mais en France, je ne crois pas qu’on en soit à ce stade de prise de conscience».
En somme, s’il est admis que la repentance ne fait pas avancer le débat pouvant permettre la compréhension du fait colonial, mais plutôt soumet les rapports entre l’Algérie et la France à une surenchère sémantique bloquant toute possibilité de «désacraliser» l’histoire, il est par contre exigé de part et d’autre l’examen critique d’un passé colonial obscur. Chercheurs et politiques des deux rives de la Méditerranée estiment que «le chemin de la réconciliation passe nécessairement par la reconnaissance».
Les Accords d’Evian et le jugement des crimes coloniaux
Est-il possible de juger les responsables des crimes commis durant la guerre d’Algérie ? Pas si sûr. Les Accords d’Evian signés entre l’Etat français et le gouvernement algérien contiennent des lois amnistiant tous les crimes et assurant l’impunité aux militaires français. «Au regard de la situation juridique scellée par les Accords d’Evian, aucune action de justice ne pourra être menée», déclare Olivier Le Cour Grandmaison.
Cependant, il estime que «le jugement est la seule façon de rendre justice aux victimes de ces guerres», en faisant allusion au procès qui se déroule actuellement en Argentine où des lois ont défait l’amnistie accordée aux militaires. «En Argentine, la bataille pour la reconnaissance n’a pas seulement pris une forme symbolique. Aujourd’hui, les plus hauts responsables de la dictature ont été jugés, condamnés et purgent des peines de prison1.
Mais paradoxe en France : la gauche comme la droite se félicitent des poursuites contre le dictateur Videla, alors que ceux, en France, qui ont avoué avoir commis des crimes de guerre coulent une retraite tranquille dans le 16e. Ils ne sont ni jugés ni emprisonnés», s’exclame-t-il en établissant le rapport entre le général Paul Aussaresses et les méthodes militaires employées par la dictature argentine et partout en Amérique latine. «Il y a un rapport entre la guerre d’Algérie et ce qui a été mis en place dans certaines dictatures d’Amérique latine. Aussaresses a participé à la formation des militaires argentins à des techniques de terrorisme d’Etat», affirme-t-il.
Malika Rahal estime que «le passage à la justice est improbable en raison de l’amnistie qui existe déjà à l’intérieur des Accords d’Evian, mais aussi dans plusieurs textes de loi, comme celle votée en 1982, qui verrouillent tout».
D’autres formes de procès peuvent se substituer à ceux de la justice : «Le procès Papon, en 1996, pour les crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale, a permis un débat au sein du tribunal. Le juge avait accepté que des parties civiles apportent de façon publique des témoignages et des récits sur les crimes commis lors des événements du 17 Octobre 1960, certes sans aucun impact du point de vue du droit, mais on le raconte et cela a un impact considérable !»
- [Note de LDH-Toulon] – Voir sur ce site : 5303.