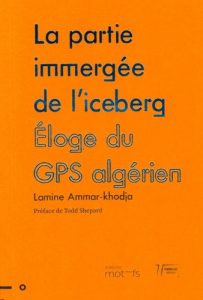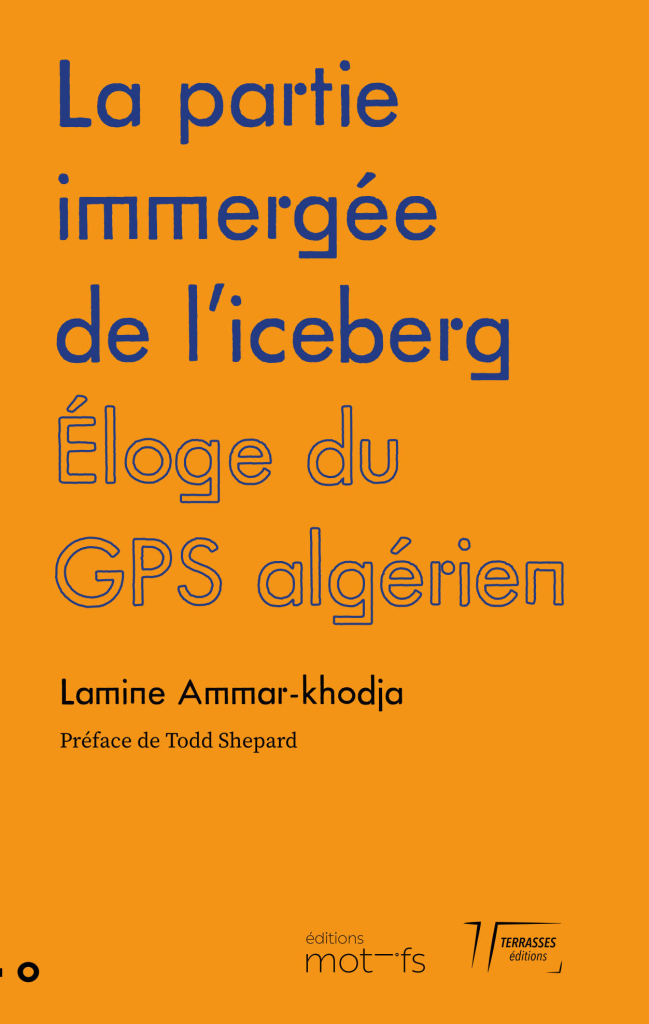
Présentation de l’éditeur
Une phrase qui tournoie dans la tête de Lamine Ammar-khodja ouvre cet essai. Une interrogation lue dans un journal français : « Pourquoi est-il devenu impossible de comprendre l’Algérie ? »
En la prenant comme point de départ, il convoque la littérature algérienne à partir des fondateurs, Assia Djebar, Kateb Yacine, Mohammed Dib mais aussi ceux qui ont suivi, pour nous rappeler leurs parcours, et les questions auxquelles ils ont été confrontés, notamment par rapport aux problèmes de langue et d’identité. Pour exister, ces auteurs devaient passer par le système éditorial français, non seulement avant mais aussi après l’indépendance. Avec tout le passé colonial que l’on connait, le statut de l’écrivain algérien en France, reste encore aujourd’hui un impensé majeur, et un excellent révélateur de l’état de santé morale de la politique française. D’autant plus que depuis 2015 et les attentats de Paris (ce n’est pas un hasard), les discours socio-politiques autour de l’Algérie sont monopolisés par deux écrivains : Boualem Sansal et Kamel Daoud. Une question se pose alors : « Pourquoi sommes-nous lʼun des rares, peut-être le seul pays arabe, à fabriquer des écrivains qui font la une des journaux de lʼextrême droite française ? »
De par son parcours entre les deux pays, Lamine Ammar-Khodja a été témoin de la terreur qui s’est installée, d’abord dans les années 1990 en Algérie, puis dans les années 2010 en France, mais aussi des glissements de sens et des ruptures dans les positionnements entre individuel et collectif qui n’ont fait qu’aggraver les malentendus. Dans ce texte essentiel, il en fait une analyse brillante, pour comprendre ce qui se joue, peut-être aujourd’hui plus que jamais, de « la question algérienne » en France.
Terrasses éditions en co-édition avec les Éditions Motifs
La préface de Todd Shepard
Traduction Tiphaine Samoyault
« On a tous un Algérien en nous »
À chaque fois que je pense à Lamine Ammar-khodja, ce qui m’arrive souvent, je pense à Alger. J’y ai passé du temps avec lui et, qui plus est, j’ai vu ses films où la capitale apparaît sous de multiples formes, sombres et colorées, éclairées par le soleil, dans l’ombre et la nuit. Outre la lumière changeante, ce qui définit son Alger, ce sont les gens qui se déplacent dans la ville, des Algériens, des habitants et des personnes de passage. Celui qui me vient à l’esprit à l’instant est l’inconnu qui entre dans l’avant-dernière scène de son film le plus récent, Houbla (2024). Vêtu de noir, le mot « RIEN » tatoué sur les doigts d’une main, la quarantaine, il se décrit comme un visiteur « de l’ouest, de la ville de Mohammed Dib, le mystique », il se compare aux hommes de la caverne dont l’histoire se trouve dans le Coran. Cette comparaison est justifiée par la question qu’il pose : « est-ce qu’il y a eu un événement marquant ces derniers temps ? », qui éclaire de façon puissante l’artiste profondément troublé au centre du film et, peut-être, de nombreux spectateurs. Ammar-khodja sait apporter de la clarté.
J’ai rencontré Lamine Ammar-khodja pour la première fois à Baltimore et, en juillet 2024, nous avons passé du temps ensemble en Italie. Ces deux moments ont eu pour occasion ces films algériens : une présentation à Bologne d’une copie (très mal) remastérisée de La Nouba des femmes du mont Chenoua et, à Baltimore, de son premier long métrage. Même si ses films fonctionnent comme des œuvres d’art, en dialogue avec le travail
d’autres auteurs et d’autres œuvres d’art, le peuple algérien et les questions algériennes y sont au centre, et son intérêt pour les deux transparaît. Lorsqu’il évoque, dans les pages qui suivent, « tous ces gens incroyablement divers que j’ai rencontrés depuis ma naissance jusqu’à mon arrivée en France », on comprend qu’il a beaucoup réfléchi à ce qu’il montre.
Lorsque je pensais à lui, je ne le rattachais pas à la France ou aux Français, alors même que mon parcours d’universitaire, qui m’a permis de le rencontrer, tourne précisément autour des relations denses et tendues entre l’Algérie et la France, avant et après 1962, où conquête, résistance, domination coloniale, révolution anticoloniale jouent des rôles essentiels. Grâce à son texte, j’en sais désormais plus long sur la façon dont il pense cette relation. J’ai aussi revu ses films, qui m’ont rappelé ce que j’avais oublié, premièrement qu’il y montre des images de Paris – Demande à ton ombre (2012) s’ouvre sur un plan de Paris, avant qu’Alger n’occupe l’écran, on a ensuite un plan de la tour Eiffel, puis un autre de la Seine, encore plus centré que le plan d’ouverture – et deuxièmement que nous nous sommes bien rencontrés dans cette ville, au moins une fois, après une conférence sur « “l’homme arabe” dans le cinéma des années 1970 ». À bien y regarder, il semblerait qu’Ammar-khodja ait une meilleure mémoire que moi. Ce qu’il révèle dans ce texte, aussi bien avec ses souvenirs des années 1990 en Algérie qu’avec le rappel d’un commentaire de 2001 qu’il a lu dans un article d’un journal français : « Pourquoi est-il devenu impossible de comprendre l’Algérie ? » C’est l’une des nombreuses raisons, me semble-t-il, pour lesquelles on devrait être bien plus nombreux à s’intéresser à Lamine Ammar-khodja et à son œuvre.
Je ne suis ni Algérien ni Français et ma langue maternelle est l’anglais. Cela pourrait paraître suspect si j’attribuais à Ammar-khodja un rôle quelconque – d’intellectuel, de critique majeur, d’écrivain remarquable, par exemple – dans l’un ou l’autre de ces pays étrangers ou dans une langue étrangère. Je continue de penser que d’autres le feront, même si je suis spécialiste de l’histoire algérienne de la France, que je passe beaucoup de temps à Alger, à Paris et à Marseille, et que je lis beaucoup d’histoires et de romans dans les langues que je maîtrise. Je suis certain que ce texte fait clairement entendre une voix qui résonnera chez tous ceux qui se réjouissent de voir le drapeau algérien flotter dans les endroits les plus improbables. En effet, il a des choses à dire à celles et ceux qui ne savent pas très bien quoi penser de la France, ainsi que sur un certain nombre d’autres questions plus larges, en tout cas qui semblent larges depuis une perspective états-unienne. Il le fait en superposant des références littéraires et historiques, réfractées par un amour intense de l’Algérie – « un océan insondable » – et par un contact important avec la France qui lui a permis de mettre au point une lentille puissante pour regarder la situation.
En juillet 2025, alors que je lisais pour la première fois le texte d’Ammar-khodja, mon fil d’actualité sur les réseaux sociaux annonçait la mort tragique d’un humoriste français encore jeune, il avait une quarantaine d’année. Il s’appelait Bun Hay Mean, surnommé « le Chinois marrant », et j’ai été rapidement arrêté par une phrase qu’il a répétée plusieurs fois : « On a tous un algérien en nous ». Dans un clip, en réponse à un journaliste qui lui demande d’expliquer ce qu’il veut dire, il affirme que « L’Algérien, c’est ce sentiment de se dire que… Cette soif de liberté en fait, qu’il y a un monde plus grand que nous, qui essaie de nous “écraser”, nous exploiter et qui se dit, mais NON, viens, on se lève. » Cela m’a donné des frissons, car ce qu’il disait correspondait tellement à ce que j’avais retracé historiquement, après 1962, dans certains débats de gauche en France et à ce que m’inspirent beaucoup d’Algériens et leur rapport à leur histoire aujourd’hui, que j’ai été saisi. Dans la France des années 1970, ce que j’ai décrit comme l’idolâtrie de « l’homme algérien révolutionnaire » (il s’agissait en effet d’un stéréotype), était une trappe qui pouvait s’ouvrir à tout moment sur des représentations réductrices moins reluisantes. En outre, une telle idolâtrie limitait encore plus les marges à l’intérieur desquelles les individus qui se trouvaient définis comme des « hommes algériens » pouvaient agir : soyez (ce que j’imagine être) révolutionnaire ! ou bien : soyez révolutionnaire (à mes conditions) ! Ici aussi, Ammar-khodja apporte un éclairage bien plus convaincant, qui repose sur sa capacité à plonger profondément dans la spécificité de ce qu’il entend par « Algérien ».
Au centre de son essai, Ammar-khodja propose sa propre interprétation d’un événement télévisé important, qui a eu lieu en direct des rues d’Alger le 2 avril 2019, lorsqu’un homme a fait irruption dans une séquence où une journaliste tentait d’expliquer les événements depuis une situation d’urgence. Ammar-khodja traduit en français ce que l’homme déclare « en arabe vernaculaire », et qui culmine avec son « Je sais pas l’arabe, c’est comme ça qu’on parle ici. » L’analyse qui suit se penche sur les questions de langue et sur le surgissement de l’image elle-même : « Il y a ensuite la posture de l’homme. Ferme, sans trembler, il se tient droit dans ses bottes, mais il n’y a aucune violence en lui ». Cette phrase m’a permis de comprendre ma réaction à l’affirmation de Bun Hay Mean : « On a tous un Algérien en nous ». Ce qui m’a éclairé c’est la lecture que fait Lamine de ce que produit l’homme à l’écran : « il entre dans l’image. Et une fois dans le cadre, il cherche moins à la détruire qu’à la faire imploser de l’intérieur ». Cette lecture me convainc, et elle prépare la suite : « C’est par ce genre de signes et symboles qu’on arrive à mieux comprendre toute l’histoire de l’art de ce pays, et ce que le mot « résister » veut dire en Algérie. » Ce n’est pas que tous les Algériens aient à résister, c’est ainsi que je le comprends, mais qu’ils le fassent et la manière dont ils le font a une histoire, et la confrontation avec cette histoire fait surgir des possibilités infinies. Si vous n’avez jamais vu cette scène, cherchez-la sur Internet. Ce genre de geste critique est rare et c’est aussi celui que le texte d’Ammar-khodja propose, ce qui le rend si important dans notre actualité tellement lourde, alors même que la France, qui a réduit sur la longue durée la possibilité pour les Algériens d’interpréter leur propre histoire ainsi que leurs vies, conduit cette réduction à de nouveaux sommets.
L’événement déclencheur du texte est la réponse tragicomique algérienne à un véritable cirque qui avec une intensité nouvelle depuis l’automne 2024 se déroule dans les salons parisiens et les médias français. Ammar-khodja appelle les deux personnages centraux Kamel Daoud et Boualem Sansal, et il en dit plus sur ce qu’ils sont. Il me tarde de prendre connaissance des réactions des lecteur·ices français·es à ses propos. Mais je veux simplement souligner que le feu critique que cette étincelle allume est plus durable que le contretemps : ce qui brille à travers lui et mérite notre attention, c’est sa voix. Les références historiques et littéraires ne sont pas un masque mais elles illuminent la beauté de ses métaphores, les éléments qu’il met en circulation. C’est ainsi que Lamine Ammar-khodja se distingue des autres commentateurs des relations algéro-françaises.
Mes recherches se sont concentrées, depuis le début de ma thèse, sur ce que j’appelle aujourd’hui l’histoire algérienne de la France. Mes sources primaires ont été écrites en français, en grande majorité par des Français et des Algériens. Pourtant, ce sur quoi je travaille et j’écris, même si je suis également plongé dans les discussions des deux côtés de la Méditerranée, reste principalement inspiré par des questions politiques et historiques qui sont profondément états-uniennes. J’ai été supris de constater que des historiens qui sont des références pour moi, en France et, plus récemment, en Algérie, s’intéressent à ce que j’écris. J’aimerais maintenant être aussi généreux que Lamine lorsque, dans ce texte, il s’efforce d’expliquer au public français ce qu’il se passe dans les propos franchement insensées qui sont tenus en France au sujet de l’Algérie : « je ne crois pas que les Français puissent le débusquer ». C’est en historien qu’il note que, lorsqu’ils parlent de Kamel Daoud, « il leur manque le contexte d’où il a émergé » ; mais c’est en artiste et en penseur qu’il nomme ce contexte : « la partie invisible qu’ils ne peuvent pas voir ou connaître. La partie immergée de l’iceberg. »
La fixation française actuelle sur Kamel Daoud et Boualem Sansal les présente comme des interprètes incisifs, capables de révéler la vérité de l’Algérie, ce qui est absurde. Comme Ammar-khodja le dit clairement, cette situation révèle quelque chose de la France plus que de son pays. Les commentateurs français les plus écoutés d’aujourd’hui ne veulent pas ou ne peuvent pas reconnaître que l’« Algérie » qu’ils prétendent décrire et expliquer est un miroir d’eux-mêmes et de leur vision, que Kamel Daoud et Boualem Sansal leur renvoient de façon mimétique. La motivation du texte de Lamine est de pointer que cette image bruyante renvoyée par la France rend plus difficile pour les Algériens de se penser par eux-mêmes. Ce qui ne les empêche pas de le faire.
Ammar-khodja semble reconnaître qu’on a besoin du regard de l’historien sur des sujets comme Kamel Daoud et Boualem Sansal, notamment les méthodes et les présupposés qui guident ceux que j’admire et parmi lesquels j’espère me tenir. L’une de ces approches consiste à rechercher le document ou la personne qui, une fois compris, peut révéler quelque chose d’important sur le monde. Notre formation – et le type de documents sur lequel nous avons l’habitude de nous appuyer – est plus efficace si nous repérons une récurrence qui ouvre la possibilité de se concentrer sur quelque chose – même une seule chose – surtout une chose – qui ne semble pas particulièrement intéressante, mais qui continue d’apparaître dans les sources : alors on décide de comprendre pourquoi, ce que cela signifie. Ce qui est en jeu dans la notoriété de Kamel Daoud et Boualem Sansal, note à juste titre Lamine, n’est pas exceptionnel, mais exemplaire ; il ne s’agit pas vraiment de littérature au sens de l’art, mais de quelque chose de beaucoup plus banal. Ainsi, comme le souligne Ammar-khodja, « en assumant la posture du traître, Kamel Daoud essaye de se distinguer alors qu’en réalité il agit comme tout le monde », mais c’est en lisant en historien qu’il peut remarquer que « c’est ce qui le rend si intéressant à mes yeux ». Cette capacité à reconnaître une anecdote révélatrice, pouvant être appréciée pour ce qu’elle est, un moment qui compte avant tout parce qu’il condense quelque chose de très répandu et autrement difficile à saisir, est remarquable. L’attention portée à l’exceptionnel peut permettre de voir plus grand. Il en va de même, à des degrés divers, de l’attention au banal, qui peut devenir exemplaire.
Je continue de penser qu’Ammar-khodja a une bonne mémoire, mais ce sont les souvenirs qu’il choisit de partager avec nous qui importent : l’anecdote révélatrice, qui offre une perspective sur des choses d’autant plus cruciales qu’elles paraissent banales permet, grâce à l’analyse d’Ammar-khodja, d’accéder à quelque chose de plus grand et de plus difficile à apercevoir. Ammar-khodja reconnaît que les textes et les déclarations de Kamel Daoud et Boualem Sansal ne méritent pas plus d’attention que cela. C’est précisément leur banalité qui leur permet d’apparaître comme la vérité de l’Algérie d’aujourd’hui dans les médias français. Notre auteur préfère clarifier les enjeux : quelque chose a mal tourné, qui a ses racines dans un contexte et ses développements spécifiques, plutôt que dans des vérités universelles ou des problèmes intemporels.
Pour donner un sens à ce qu’il a diagnostiqué, Ammar-khodja dépasse le banal pour se tourner vers l’art, vers des œuvres algériennes exceptionnelles, qui lui permettent de cartographier un passé qui donne de l’avenir. Malgré son intérêt d’historien pour le banal, il choisit de marquer une limite au travail de l’histoire en recourant à des œuvres d’art pour analyser le passé. J’y lis une façon de refuser que tout le passé soit sous le contrôle des historiens, qu’ils soient historiens officiels, historiens dissidents ou même sa grand-mère qui sait parce qu’elle était là, tous ceux qui affirment une autorité exclusive pour raconter et interpréter le passé.
Avec sa ferveur artistique et sa profonde culture littéraire, Lamine offre de beaux et saisissants rappels de la puissance et de la profondeur des œuvre littéraires. Il revient à plusieurs reprises sur Kateb Yacine, Assia Djebar, Mohammed Dib et Dostoïevski. Il raconte comment Dib « le mystique » regarde le désert ; il raconte comment, à Paris, il a passé un temps fou à essayer de dénicher un texte épuisé de Kateb Yacine. Il explique pourquoi ces textes sont importants pour les Algériens d’aujourd’hui, en Algérie et ailleurs, et il s’inspire de ces écrits pour exposer sa vision du monde et offrir de nouveaux points de vue. Sa méthode invite à comprendre qu’« il n’y aura aucune discussion possible tant qu’il n’y aura pas un nouveau lexique posé sur la table ». Les mots sont importants. Comment se fait-il que des auteurs pour lesquels ce n’est manifestement pas une priorité aient pris une place aussi importante dans le débat français actuel sur l’Algérie ? Ici, Ammar-khodja se tourne à nouveau vers l’histoire. Les conséquences du terrorisme jouent un rôle clé : qu’il s’agisse des attentats parisiens d’il y a dix ans ou, encore plus important à tous points de vue, de ceux qui ont eu lieu en Algérie au cours des années 1990. Il évoque à propos des années noires « ceux qui avaient vingt ans au début des années 1990 ». Ils représentent ce qu’on appelle aux États-Unis une « lost generation », comme le disait Gertrude Stein à Ernest Hemingway : « C’est-à-dire la génération de Kamel Daoud, dont un très grand nombre allait s’enrôler dans les groupes armés pour semer la terreur dans le pays ». Il n’est pas simple de résumer son interprétation puissante de l’importance de ces deux moments de violence et de leur lien. La seule chose que je peux dire, cependant, c’est qu’il s’agit de ma génération. Contrairement à Ammar-khodja, je suis quinquagénaire. Ce que nous avons vécu aux États-Unis dans les années 1990 n’a rien à voir avec ce qu’ont vécu les Algériens. Pourtant, aujourd’hui, nous sommes la génération – on nous appelle la génération X – qui a le plus violemment basculé vers Trump lors des dernières élections. Le magazine The Economist a récemment publié un article intitulé « Why Gen X is the real loser generation ? » (2 mai 2025). Il y aurait beaucoup à dire, mais je voudrais juste insister sur un point : l’Algérie a beaucoup à apprendre au monde. Plus encore que ne le dit Bun Hay Mean. Par bien des aspects, ce que les Algériens ont dû affronter depuis quarante ans les placent, une fois de plus, à l’avant-garde. Comme Ammar-khodja, ma génération, aux États-Unis comme en France, a vu le film Titanic (1997). Mais nous n’avons pas été assez attentifs et n’avons pas été capables de voir, comme lui l’a vu, l’iceberg.