Il est difficile, en l’absence de sondage et d’études scientifiques, de savoir comment les Français ont considéré, entre 1940 et 1980, la Nouvelle-Calédonie et son avenir. Certes, ils entendaient à l’issue de la guerre la défendre contre les convoitises supposées des Américains et des Australiens. Rétrospectivement, ils se félicitaient du patriotisme du « bataillon du Pacifique qui fut le premier à répondre à l’appel du 18 juin 1940 ». Mais, faut bien avouer qu’en dépit du livre du pasteur Maurice Leenhardt, ni les « gens de la Grande Terre » (les Mélanésiens) ni les « Caldoches » (les colons français) ne faisaient recette auprès de l’opinion.
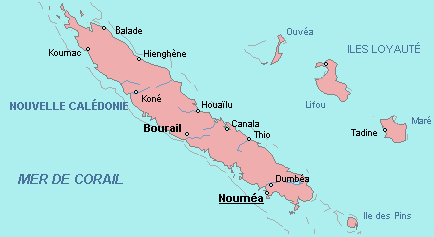
Les Français les plus informés savaient que cette colonie de peuplement qu’ils rapprochaient de l’Algérie végétait jusque dans les années 1940, au rythme du passé. Une société coloniale de type archaïque y vivotait chichement de l’élevage extensif, de quelques cultures et du petit commerce. Le peuple français ne s’y développait pas, gêné par la réputation d’insécurité de la brousse calédonienne. Les révoltes armées des Canaques, celles de 1878 et de 1917, qui étaient essentiellement des protestations contre l’empiètement des colons sur les terres, avaient elles-mêmes servi de prétexte à de nouvelles confiscations ou cantonnements, et à de nouvelles rancœurs. Le code de l’indigénat et le travail forcé, le retard économique et social des Mélanésiens, qu’on croyait tous parqués dans des réserves indigènes et soumis au régime de la propriété collective et de la chefferie, expliquaient, disait-on, la mauvaise situation de l’île. Le ministère des Colonies lui-même envisageait, en 1944, pour combattre le complexe d’infériorité des populations calédoniennes et leurs rancœurs vis-à-vis de la métropole, de « doter l’île d’un statut libéral prévoyant une certaine autonomie, dans le cadre français, de développer et de moderniser l’enseignement, d’instituer libéralement des bourses en France » et d’augmenter «par une immigration contrôlée la proportion de la population blanche. Dans le même temps, la population indigène sera traitée avec toute la sollicitude à laquelle elle a droit ». Elle pourrait disposer notamment d’une assemblée « qui sera consultée sur les affaires propres des tribus ».
En fait d’immigration, peu de Français arrivèrent, si ce n’est après 1962 des pieds-noirs qui entendaient prolonger un genre de vie colonial. Dans les années 1970, au contraire, en liaison avec le boom du nickel (1966 – 1973), et face au projet des autonomistes, fut organisée une : importante immigration de Tahitiens, Wallisiens et Futuniens, qui devait donner une courte majorité aux populations non canaques.
Pourtant, les Mélanésiens, grâce aux progrès des services de santé et de l’enseignement, voyaient leur nombre et leur niveau d’instruction s’élever. Leurs revendications essentielles n’en portaient pas moins sur les rares bonnes terres cultivables (50 000 ha) ou les terrains de bonnes aptitudes pastorales (environ 250 000 ha) exclusivement attribués à la colonisation. Seule une vaste réforme foncière pouvait apporter une solution. Elle était rendue possible par le départ de nombreux petits colons découragés qui allaient travailler dans les emplois de la société « Le Nickel » ou du secteur tertiaire. Bien que tardivement adoptée, la réforme foncière actuellement en cours pouvait porter fruits.
En 1953, l’année du centenaire de la Nouvelle-Calédonie, « la libre province française du Pacifique » ne comptait que 23 000 Français, 4 000 Vietnamiens, 5 000 Indonésiens et 33 000 autochtones. Il devenait impossible de tenir à l’écart ces derniers (45% du corps électoral en 1951), et la loi-cadre permit l’instauration d’un Conseil de gouvernement dirigé par l’Union calédonienne qui voulait rassembler les ethnies. Pourtant, l’évolution vers l’autonomie ne se fit pas dans l’union, comme il était prévu. Paris décida alors d’abandonner la loi-cadre et de revenir à un régime d’autorité.
Ce fut une erreur. Le souhait d’autonomie devint presque unanime, En 1970, apparut le premier parti politique kanak. Les Mélanésiens, sensibles au mot d’ordre d’indépendance « kanak » lancé en 1975, n’acceptaient plus d’attendre et le firent savoir de plus en plus vivement de 1976 à 1981. Le parti de libération kanak (Palika) réclamait dès 1976 l’indépendance, bientôt suivi par le Front uni de libération kanak (Fulk) et par l’Union calédonienne désertée par les Européens. Regroupés en 1979 dans le Front indépendantiste, ces partis entendaient « contraindre la France à décoloniser ».
Celle-ci crut d’abord pouvoir résoudre le problème en accordant par la loi du 28 décembre 1976 un statut de large autonomie de gestion. Mais les élus locaux « loyalistes» trop divisés se révélèrent incapables de gouverner. Ni la réforme électorale de mai 1979, ni le plan décennal de développement de 1979, ni la réforme foncière de janvier 1981 n’apaisèrent l’ardeur des indépendantistes acharnés à faire triompher « la seule légitimité du premier occupant de la terre, le peuple kanak ». En 1981, éclatèrent les premiers troubles graves.
Légiférant par ordonnances, le gouvernement socialiste multiplia les réformes favorables à. la communauté mélanésienne conformément à une logique décolonisatrice. Puis il fit adopter par le Parlement, le 6 septembre 1984, un nouveau statut d’autonomie interne, lequel prévoyait un référendum d’autodétermination dans un délai de cinq ans. Mais le boycottage des élections territoriales par le FLNKS, accompagné d’une flambée de violences (novembre 1984) et la formation d’un « gouvernement provisoire de Kanaky » firent craindre le pire. Le gouvernement déclara que le processus d’autodétermination serait accéléré, cependant que le responsable du parti socialiste demandait à ce que le vote référendaire fût séparé selon les communautés, et aboutît à une « indépendance pluriethnique ». Dès lors, l’affaire calédonienne devint en France l’enjeu des luttes de partis. La naissance du FLNKS (Front de 1ibération nationale kanak et socialiste), dont le sigle rappelait celui des Algériens, persuada l’opinion que la Nouvelle-Calédonie, cette nouvelle Algérie, échapperait bientôt à la France.
En janvier 1985, après l’annonce d’un nouveau plan dit d’« indépendance-association » qui prévoyait l’indépendance pour janvier 1986, une majorité relative de 49 % de Français métropolitains souhaitaient que la Nouvelle-Calédonie restât dans la République, tandis que 33 % préféraient qu’elle devînt un Etat indépendant. Or, la presse avait révélé que la France versait annuellement à Nouvelle-Calédonie les deux tiers de son budget et que le produit national brut était à hauteur de 46 % alimenté par les transferts de la métropole. Ainsi la Nouvelle-Calédonie, qui passait pour un pays riche, vivait sous perfusion financière. Mais les partisans du « porte-avion français ancré en plein cœur du Pacifique » comme ceux « des droits du peuple de Kanaky à se libérer de l’impérialisme » préféraient l’ignorer.
Face à la montée de l’opposition qui accusait les socialistes de ne pas défendre l’intégrité du territoire national, le gouvernement Fabius retarda le scrutin d’autodétermination et mit en place par ordonnances un statut provisoire de régionalisation, qui devait permettre aux indépendantistes de contrôler trois régions sur quatre. Tel fut le résultat prévisible des élections territoriales du 29 septembre 1985.
Avec le retour au pouvoir de la droite, un nouveau statut fondé sur l’autonomie de gestion et un autre découpage territorial fut mis en place ; il ne prévoyait plus d’évolution vers l’indépendance. Le référendum d’autodétermination du 13 septembre 1987 donna bien 98,3 % des suffrages « pour le maintien au sein de la République ». Mais l’abstention recommandée par les indépendantistes avait porté sur 40,8 % des inscrits. L’avenir de la Nouvelle-Calédonie n’était pas résolu.
Il parut l’être lorsque le 26 juin 1988 un accord fut signé à Paris entre les représentants des deux principales communautés calédoniennes. Les propositions du Premier ministre socialiste sur l’évolution du territoire étaient acceptées. Un projet de loi prévoyait qu’après une période de dix années les habitants décideraient de leur avenir, par un scrutin d’autodétermination. Mais ce projet approuvé par la grande majorité de la classe politique française fut soumis à référendum.
Or, les résultats positifs de ce référendum du 6 novembre 1988, 80 % de Oui, 20 % de Non, sont entachés par un taux record d’abstentions (63 % des inscrits) et de bulletins blancs (12 % des votants). En Nouvelle-Calédonie, le Oui l’emporte seulement à 57 % et dans la province Sud à majorité européenne on compte 60 % de Non. Dans ces conditions, on imagine mal que le statut de 1988 puisse être appliqué pendant dix ans.
En mai 1989, l’assassinat des deux principaux leaders: indépendantistes favorables aux accords de juin 1988 et, la formation d’un Front du refus purent faire craindre la reprise des violences. Les élections provinciales du 11 juin 1989 donnèrent, au contraire, une forte majorité aux signataires des accords Matignon. Cependant, les extrémistes ne cessent de revendiquer « l’indépendance immédiate » et ont obtenu du FLNKS l’adhésion au groupe « Fer de lance» des trois États indépendants de Mélanésie. La Nouvelle-Calédonie reste désespérément écartelée et son avenir incertain.


